Néron : né le 15 décembre 37, mort le 9/11 juin 68Titre : Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (13 octobre 54 - 9/11 juin 68 : 13 ans)Nom
Lucius Domitius Ahenobarbus. La famille des Ahenobarbi a été distinguée par sept consulats, un triomphe et deux censures. Ses membres ont été élevés au rang de patriciens et ont tous conservé le même surnom. Ils ont également adopté une tradition remarquable consistant à alterner exclusivement entre les prénoms Gnaeus et Lucius. Le 25 février 50, lors de son adoption par Claude, Nero reçoit le nom de Tiberius Claudius Nero. Plus tard, il adoptera les noms de Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus. NaissanceNéron est né à Antium le 15 décembre 37, neuf mois après le décès de Tibère. PèreCneus Domitius Ahenobarbus, un aristocrate, était le père de Néron. Il avait tué un affranchi qui refusait de boire jusqu'à l'ivresse et, sur la voie Appienne, il écrasa intentionnellement un enfant sous les sabots de son cheval. En outre, en plein Forum, il creva l'oeil d'un chevalier romain qui avait eu l'audace de le contredire. Il décède en 40, d'une attaque d'hydropisie, à Pyrgi, lorsque son fils Néron n'avait que trois ans. MèreAgrippine la Jeune, soeur de Caligula, fille de Germanicus et d'Agrippine l'Aînée, est la petite-fille de Julie et d'Agrippa, et l'arrière-petite-fille d'Auguste et de Scribonia. Elle est née le 6 novembre 15 à Cologne (Ara Ubiorum) en Germanie inférieure, après que sa mère, Agrippine l'Aînée (Agrippina maior), ait trouvé refuge avec ses trois enfants à Trèves. En 28, à l'âge de 13 ou 14 ans, elle épouse Cneius Domitius Ahenobarbus, choisi pour elle par Tibère. A la suite de la mort de Messaline en 48, Claude, désirant se remarier, épouse ainsi Agrippine, sa nièce, en 49. L'année suivante, il adopte Néron, le fils d'Agrippine. En 51, il désignera Néron comme son héritier et le fiance à sa fille Octavie. 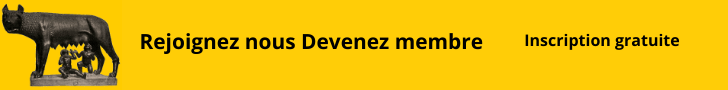
EnfanceA l'âge de trois ans, Néron perdit son père et se retrouva presque dans la pauvreté. Il fut alors élevé chez sa tante Lepida, avec pour seuls éducateurs un danseur et un barbier. A onze ans, il fut adopté par Claude et placé sous la tutelle de Sénèque, déjà sénateur à cette époque. Pendant le règne de Claude, il récupéra les biens de son père et hérita de la fortune de son beau-père, Crispus Passienus. Adolescent, il participait activement aux jeux troyens dans le cirque, où il remportait de nombreux applaudissements. Après son adoption, son frère Britannicus l'appela habituellement Ahenobarbus; Néron tenta alors de convaincre Claude que Britannicus n'était pas son fils. Lorsqu'il prit la toge virile au Forum, il fit des distributions au peuple et offrit des présents aux soldats. Dies imperii : 13 octobre 54Les premières annéesNéron commença son règne prometteur, à l'image de Caligula, mais fut corrompu par le pouvoir et sa chute fut similaire à celle de ce dernier. Dans un discours rédigé par Sénèque, il s'engagea devant le sénat à prendre Auguste comme modèle et à distinguer clairement les affaires de l'Etat de celles de sa maison personnelle, afin que les décisions soient prises publiquement, non pas à l'ombre du palais par les favoris du prince, mais conformément aux lois et par les sénateurs, les consuls et les autres magistrats de la république. Charmé, le sénat chercha à consolider ces promesses : il décida que ses paroles seraient inscrites sur une plaque d'argent et que les consuls en feraient une lecture solennelle chaque année. Une fois le discours prononcé et les représentations terminées, Néron retourne à ses divertissements et à ses jeunes amis qui encouragent ses passions émergentes et trouvent des louanges pour toutes ses excentricités, ainsi que des excuses pour tous ses actes répréhensibles. Cette cour frivole et ambitieuse qui se constitue autour de lui n'ose pas encore affronter le cercle dominé par sa mère et ses anciens ministres. Othon, le licencieux Pétrone, et tous ses compagnons respectent encore Agrippine; Burrus (Afranius Burrus, commandant de la garde prétorienne) leur fait encore autorité, et Sénèque (philosophe stoïcien exilé en Corse par Claude puis rappelé par le même empereur pour être le précepteur de Néron) se montre suffisamment conciliant pour ne pas les contrarier. Pour l'instant, Néron joue le rôle du bon fils, du bon prince : il est affectueux avec sa mère, compatissant envers les malheureux, et exprime son inquiétude face aux décisions difficiles. Lors de son premier combat de gladiateurs, il ne laissa mourir personne, et, confronté un jour par Burrus à signer deux condamnations à mort, il s'exclama : " Ah ! Que je voudrais ne pas savoir écrire". BritannicusSelon Tacite, Britannicus entrait dans sa quinzième année. Locuste, condamnée pour de nombreux crimes, était conservée comme un outil utile sous la surveillance d'un tribun du prétoire. Néron fait appel à ce soldat et demande un poison que Locuste prépare, mais qui s'avère trop faible ou trop lent à l'effet selon le prince. Il menace alors le tribun, frappe l'empoisonneuse de sa propre main et ordonne qu'elle soit punie. Lors des repas, il était coutume que les jeunes membres de la famille impériale mangent à une table séparée et plus simple, sous la surveillance de leurs parents. Britannicus y avait sa place et ne consommait rien qui n'ait été préalablement goûté par un esclave de confiance. Assurer la mort de l'esclave et du maître simultanément aurait exposé le crime. On servit à Britannicus une boisson suffisamment chaude pour que l'esclave puisse la goûter sans danger, mais lorsque le prince demanda de l'eau pour la refroidir, le poison y fut versé. Britannicus s'effondra aussitôt. Certains présents s'alarment, d'autres s'enfuient, mais les plus rusés restent assis, observant Néron qui, imperturbable, leur assure : "C'est une crise d'épilepsie, comme celles dont souffre mon frère; il va reprendre conscience." Et il continue de boire, tandis que les esclaves emportent le corps du dernier descendant des Claudes pour le placer sur le bûcher déjà préparé. Sa mort survient moins de quatre mois après celle de son père. La guerre parthiqueDès 54, les Parthes, dirigés par Vologèse, avaient envahi l'Arménie (en 55). Corbulon passa trois ans à rétablir la discipline, mise à mal par un séjour prolongé des soldats dans les villes de Syrie. Il lança une offensive en Arménie, contrant les attaques et les stratagèmes de Tiridate, et s'empara de sa capitale, Artaxata, qu'il réduisit en cendres. Il s'empara de Tigranocerte. En 60, Rome envoya comme gouverneur le petit-fils d'un ancien roi de Cappadoce, Tigrane, à qui Corbulon laissa quelques troupes pour maintenir l'ordre. Tigrane osa provoquer les Parthes en envahissant l'Adiabène. A l'annonce de cette provocation, Vologèse, poussé par les nobles de son empire prépara une force impressionnante. Corbulon, inquiet de cet élan national, demanda qu'un second général défende l'Arménie pendant qu'il ferait face à l'offensive principale des Parthes sur l'Euphrate. Cette division des forces conduisit à des revers. Si Corbulon réussit à empêcher les Parthes d'envahir la Syrie, Caesennius Paetus, qui commandait en Arménie, fut vaincu et assiégé dans son camp avec les restes de deux légions. A bout de courage et de patience, il négocia avec Vologèse, promettant d'évacuer l'Arménie et ramena ses troupes humiliées en Cappadoce en 62 av. J.-C. Cette défaite rehaussa la gloire de Corbulon, et après une consultation avec les principaux membres du sénat, Néron lui conféra des pouvoirs presque aussi étendus que ceux de Pompée contre Mithridate. Corbulon n'eut finalement pas à combattre Vologèse, qui lui proposa la paix sur les lieux mêmes de son récent triomphe. Oubliant Tigrane, son ancien protégé, Corbulon promit de reconnaître Tiridate, à condition que le frère du roi des Parthes dépose son diadème devant les légions, puis aille à Rome recevoir la couronne d'Arménie des mains de Néron en 65 av. J.-C. L'Arménie restait un Etat vassal, conformément aux souhaits d'Auguste et Tibère. La BretagneEn Bretagne, les frontières des territoires romains étaient mal définies, avec le Nord et l'Ouest qui restaient non soumis. Suetonius Paulinus, rivalisant en gloire avec Corbulon, décida de franchir les montagnes de l'Ouest pour s'emparer du sanctuaire central de la religion druidique, l'île de Mona (Anglesey). L'intervention fut rapide : les haches des légionnaires rasèrent leurs vieilles forêts et détruisirent ces autels. Ce fut la dernière résistance des druides. Le roi des Mènes avait légué la moitié de ses biens à Néron. Malgré cela, de lourds impôts furent imposés à son peuple, qui fut également incité à engager des dépenses extravagantes financées par des prêts onéreux provenant de banquiers romains. Par ce geste de largesse, le roi espérait protéger sa famille, mais sa femme Boadicée (Boudicca, Boudica) et ses deux filles subirent néanmoins des violences brutales. Une multitude d'Italiens et de provinciaux affluaient pour exploiter la récente conquête, en particulier ses mines de plomb et d'étain, dont les produits étaient exportés en Gaule. Plus de cent mille étrangers s'étaient déjà établis en Bretagne, témoignant de la rapide expansion de la civilisation romaine sur les territoires conquis. Londinium, sur la Tamise, était déjà un centre commercial important; Verulamium (près de Saint-Albans) ne lui cédait guère en richesse; d'autres villes émergeaient, adoptant les institutions et les coutumes italiennes : Camulodunum possédait même un temple et un sacerdoce dédiés au divin Claude. Et tout cela en moins de dix-huit ans depuis l'arrivée des légions dans l'île ! Cette invasion pacifique, l'introduction de coutumes étrangères, et la prise de possession de la Bretagne par une nouvelle société, plus encore que les exactions des procurateurs et la rapacité des usuriers, provoquèrent la révolte des tribus de l'Est. Boadicée se mit à leur tête; Camulodunum fut capturé et incendié; une légion fut en partie exterminée; Londres et Verulam furent détruits, et leurs habitants, hommes, femmes et enfants, furent massacrés ou crucifiés. Quatre-vingt mille alliés ou citoyens périrent (selon Dion; Tacite en compte soixante-dix mille). Suetonius, revenant de l'île de Mona (Anglesey), le principal centre du druidisme celtique, ne réussit à rassembler que dix mille hommes. Il décida néanmoins de faire face à l'immense armée des Bretons, menée par Boadicée qui, avec ses deux filles sur son char, les exhortait à venger son honneur et leur liberté perdue. La bataille fut à la hauteur de l'habileté d'un général et de la bravoure des soldats qui défendaient ce jour-là les intérêts de Rome. On dit que jusqu'à quatre-vingt mille Bretons, hommes et femmes (ces derniers ayant été amenés pour assister à ce qu'ils croyaient être leur victoire), tombèrent sur le champ de bataille. Boadicée tint sa promesse et s'empoisonna. D'un seul coup, la province fut de nouveau assujettie en 61, mais cette victoire coûta son commandement à Suetonius. Dénoncé à Rome par le procurateur impérial en raison de sa sévérité, il vit arriver un affranchi de Néron chargé d'enquêter sur sa conduite. Le général glorieux, défait par un ancien esclave, fut rappelé la même année. Passions et passe-tempsBurrus et Sénèque, avec le soutien actif du sénat auquel ils témoignaient un grand respect, dirigeaient habilement l'Etat. Le prince lui-même, dans ses fonctions publiques, adoptait une attitude appropriée. Cependant, Rome, qui admirait cette maturité précoce, était stupéfaite d'apprendre que le prince parcourait la nuit les rues de la ville déguisé en esclave, semant le chaos dans les boutiques et les tavernes, brisant et pillant, ou s'en prenant à des passants, parfois confronté à des adversaires plus coriaces. Le jour, il fréquentait les théâtres, perturbant l'ordre de la salle, stimulant les applaudissements ou les huées, incitant le public à détruire les bancs et à se battre sur scène, tout en participant lui-même à la bagarre depuis une position surélevée, lançant des projectiles au hasard, blessant même un prêteur de sa propre main. On l'accuse également d'avoir contraint des femmes mariées. Sur le plan sexuel, il est célèbre pour ses unions avec ses amants Pythagoras et Sporus, ce dernier étant un jeune garçon qu'il avait fait castrer. L'histrionLe premier caprice de Néron fut de vouloir conduire des chars. Sénèque, soucieux de la dignité de son rang, s'y opposa. Finalement, ses ministres cédèrent : un circuit fut aménagé dans la vallée du Vatican, sous les yeux de sa cour, où il put démontrer son adresse. Encouragé par ce succès facile, il décida également de flatter sa vanité de chanteur et de poète. Un théâtre de cour fut installé, et pour préparer le terrain à la performance de l'empereur acteur, des personnalités consulaires et des femmes de haut rang jouèrent des rôles particulièrement osés. Suite à cela, Néron monta sur scène pour y chanter ses vers. Une cohorte de prétoriens, des centurions, et des tribuns étaient présents, tout comme Burrus, qui, bien qu'affligé et honteux, se résigna à louer la performance ouvertement (en 59). Dans son engouement pour les traditions grecques, il décida l'année suivante d'organiser un concours entre orateurs et poètes, puis instaura les jeux Néroniens, célébrés tous les cinq ans aux frais de l'Etat. Ces jeux comprenaient des compétitions de musique, de courses équestres et d'exercices gymniques. Durant son règne, qui fut bref, quatre cents sénateurs et six cents chevaliers participèrent en tant que gladiateurs dans l'arène. Ils ne bénéficièrent même pas de l'honneur accordé aux esclaves, celui de mourir courageusement : pour une fois, Néron interdit les coups mortels. Pour beaucoup, sa passion pour la musique n'est guère plus estimable que ses autres passe-temps. Néron interprète ses propres compositions tout en jouant de la lyre. Ce n'est qu'en 64 que Néron commence à se produire en public, optant pour Naples plutôt que Rome pour ses débuts. L'année suivante, Néron se produit à Rome, vêtu de son costume de scène, les préfets du prétoire portant sa lyre, devant le peuple romain. Octavie et PoppéeOthon était marié à Sabina Poppea (Poppée), considérée comme la plus belle femme de Rome. Il éprouvait pour elle une profonde affection. Malheureusement, il commit l'erreur de parler d'elle à Néron, qui exprima le désir de la rencontrer. Charmé par ses refus calculés et sa tactique habile, Néron finit par oublier la vertueuse Octavie ainsi que son favori imprudent, Othon. Ce dernier fut alors exilé au gouvernement de Lusitanie en 58, où il resta dix ans. Jusqu'à ce moment, Néron avait réussi à dissimuler ses excès et ses vices. Sous l'influence de Poppée, une femme ambitieuse et calculatrice qui n'avait reculé devant rien pour atteindre ses objectifs, il cessa de réprimer sa nature néfaste. Insatisfaite d'une simple liaison, Poppée aspirait à devenir impératrice. Deux femmes représentaient des obstacles pour elle : Octavie, l'épouse légale de Néron, et Agrippine, la mère de l'empereur. Néron était toujours marié à Octavie, fille de Claude, ce qui en faisait une union stratégiquement importante. En 62, se sentant en position de force, Néron divorça d'Octavie pour épouser Poppée. Octavie fut d'abord renvoyée du palais, puis de Rome, et finalement exilée sous surveillance militaire en Campanie. Le peuple, qui chérissait cette fille de Claude tragiquement frappée par la mort de son père, de sa mère et de son frère et désormais détrônée par une intrigante à l'âge de vingt ans, réagit avec indignation. Lorsque la nouvelle se répandit, des murmures se firent entendre, non pas en privé comme parmi les consulaires, mais ouvertement, la population exprimant son mécontentement sans crainte. Néron, manquant de courage, fut troublé par ces réactions et rappela Octavie. Le peuple, ravi, se précipita au Capitole pour remercier les dieux, renversa les statues de Poppée et décora de fleurs celles d'Octavie. Mais la vengeance de Poppée fut impitoyable. Il fut nécessaire de concocter une machination abominable. Anicetus, le préfet de la flotte qui avait assassiné Agrippine, toujours prêt à tout, fut convoqué pour une nouvelle mission : on lui demanda de débarrasser l'empereur de sa femme, comme il l'avait libéré de sa mère. Cette fois, ni violence directe ni poignard ne seraient nécessaires : il suffirait qu'il avoue avoir été le complice des adultères d'Octavie et qu'il accepte de subir une condamnation à un exil confortable. S'il acceptait, il serait secrètement récompensé par de grandes richesses; en cas de refus, il serait mis à mort. Anicetus n'hésita pas; il proclama publiquement avoir violé la couche impériale et partit jouir en Sardaigne de son opulente infamie. Néron, qui avait précédemment reproché à Octavie sa stérilité, l'accusa alors dans un édit public de provoquer des avortements pour dissimuler ses fautes et de conspirer avec Anicetus pour soulever la flotte de Misène. Il la bannit sur l'île de Pandataria, où elle reçut bientôt un arrêt de mort. Agrippine était considérée comme particulièrement dangereuse, car en tant que fille de Germanicus et arrière-petite-fille d'Auguste par sa grand-mère Julie, femme d'Agrippa et fille d'Auguste, soeur de Caïus et épouse de Claude, elle incarnait tous les souvenirs et tous les droits de la maison impériale. Poppée s'employa à en convaincre Néron, qui, las d'obéir alors que le monde entier lui était soumis, avait déjà laissé la haine remplacer l'affection dans son coeur. Néron épousa Poppée douze jours après avoir répudié Octavie et la chérissait passionnément, bien que cela ne l'ait pas empêché de la tuer d'un coup de pied pendant qu'elle était enceinte et malade, après qu'elle lui eut reproché de rentrer tard d'une course de chars. Elle lui avait donné une fille, Claudia Augusta, née le 21 janvier 63, qui mourut quatre mois plus tard. Il fit exécuter Antonia, la fille de Claude, pour conspiration après qu'elle eut refusé de remplacer Poppée. Il traita de même tous ceux qui lui étaient proches ou alliés, y compris le jeune Aulus Plautius, qu'il viola avant de le faire mettre à mort, en disant : "Que ma mère aille maintenant embrasser mon successeur," suggérant ainsi qu'Agrippine l'aimait et lui avait fait miroiter l'empire. Son beau-fils Rufrius Crispinus, fils de Poppée, fut noyé par ses esclaves sur ordre de Néron alors qu'il allait à la pêche, pour avoir simplement joué aux commandements et aux empires. Il exila Tuscus, son frère de lait, parce que, en tant que gouverneur d'Egypte, il avait utilisé les bains construits pour l'accueil de l'empereur. Il força son précepteur Sénèque à se donner la mort, même si ce philosophe lui avait souvent demandé de le laisser partir en lui offrant tous ses biens, et malgré les assurances de Néron qui lui avait juré qu'il préférerait mourir plutôt que de lui faire du mal. Au lieu d'un remède promis à Burrhus, préfet du prétoire, pour guérir un mal de gorge, il lui envoya du poison. Il fit périr de la même façon plusieurs affranchis riches et âgés qui l'avaient aidé à être adopté par Claude et qui avaient été ensuite les soutiens et les conseillers de sa couronne, en mélangeant le poison à leur nourriture ou à leurs boissons. En 64, il épouse Statilia Messalina et prend ensuite pour compagnon Sporus, un jeune garçon ressemblant physiquement à Poppée. L'assassinat contre Agrippine
L'affranchi Anicetus, commandant de la flotte de Misène, suggéra un stratagème pour détourner les soupçons. Alors que Néron résidait à Baïes, il y attira sa mère avec des lettres affectueuses, la traita avec une grande attention et courtoisie, et, après le souper, la raccompagna au magnifique vaisseau qui l'attendait pour la reconduire. Le navire avançait silencieusement. Soudain, le plancher de la cabine s'effondra sous le poids d'énormes masses de plomb, le vaisseau commença à se briser et tout sombra dans les flots; un des officiers près d'elle fut écrasé, mais le dais du lit protégea l'impératrice et sa suivante. Libérée des débris, cette dernière, espérant être sauvée, cria qu'elle était la mère de l'empereur; on la tua à coups de crocs et de rames. Agrippine, restant silencieuse malgré ses blessures, parvint à nager jusqu'à des barques qu'elle rencontra, atteignit le lac Lucrin, et de là, se fit transporter à sa résidence secondaire. Le crime était manifeste; toutefois, Agrippine choisit de feindre l'ignorance pour éviter une tentative ultérieure sur sa vie et envoya dire à son fils que grâce à la clémence divine et à la fortune de l'empereur, elle avait survécu à un grand danger. Néron était déjà au courant et, craignant la réaction de sa mère et ses possibles démarches pour rallier les soldats contre lui, il consulta Sénèque et Burrus, qui étaient peut-être restés jusque-là dans l'ignorance des événements. Ils gardèrent le silence pendant un long moment; Sénèque fut le premier à parler : demandant au préfet du prétoire si les soldats exécuteraient l'assassinat. Burrus refusa pour ses prétoriens, affirmant qu'ils étaient trop attachés à la famille des Césars et à la mémoire de Germanicus. Il suggéra que Anicetus achève ce qu'il avait commencé. L'affranchi accepta. Néron conclut alors : "Dès aujourd'hui, je vais vraiment régner." Le grand incendie de RomeEn 64, un incendie dévastateur a duré six à neuf jours, du 18 au 23 juillet, détruisant dix des quatorze quartiers de Rome. C'était le plus grand désastre qu'ait connu la ville depuis l'invasion gauloise, surpassant les destructions précédentes qui avaient touché principalement des structures modestes et quelques temples. Les rhéteurs et poètes de l'époque, enclins à dramatiser les événements, ont rapidement pointé du doigt Néron, fascinés par l'idée qu'il aurait pu incendier sa propre capitale pour la reconstruire selon ses désirs, effaçant ainsi les vestiges de l'ancienne Rome pour la remplacer par une nouvelle à son image. Ils décrivent Néron observant le feu depuis la tour de Mécène ou le sommet du Palatin, vêtu en acteur, lyre à la main, chantant sur la chute de Troie, pendant que ses soldats et esclaves attisaient les flammes, et que des engins de siège détruisaient les obstacles. Tacite, alors peut-être présent dans la ville et âgé de huit ou neuf ans, rapporte ces accusations sans les confirmer, suggérant que l'incendie pourrait plutôt résulter d'un accident fréquent à Rome, dans un contexte de vents forts et de magasins d'huile inflammables. A cette époque, Néron se trouvait dans sa villa à Antium, distant de 15 à 16 lieues de Rome. A son arrivée, son palais avait déjà été ravagé par les flammes. Il passa la nuit à coordonner les secours et, dans les jours qui suivirent, ouvrit les monuments d'Agrippa et ses jardins aux sans-abri, fit construire des abris provisoires pour les plus nécessiteux, et importa du mobilier d'Ostie et d'autres villes. Il abaissa également le prix du blé à 3 sesterces le modius. Seules quatre des quatorze régions de la ville échappèrent à l'incendie, qui détruisit notamment le centre et une partie de la résidence impériale sur le Palatin. Cependant, comme les pauvres avaient beaucoup souffert et qu'il faut toujours à la foule un coupable, on s'en prit naturellement à l'empereur de l'incendie, comme on s'en prenait à lui de la famine. Il y avait d'ailleurs des gens intéressés à propager les bruits accusateurs pour ruiner la popularité de Néron : la conspiration de Pison était alors en pleine activité, et ces consulaires qu'on disait avoir vus au milieu du désordre, excitant les esprits, faisaient sans doute partie du complot. Par une habile manoeuvre, le gouvernement détourna sur d'autres les soupçons et donna un aliment à la colère publique en accusant les chrétiens d'avoir mis le feu aux quatre coins de la ville. Les premières persécutions contre les ChrétiensPour apaiser le peuple, il fut décidé de trouver des incendiaires, c'est-à-dire des responsables d'un crime clairement défini. Lorsque Néron eut rassemblé les victimes nécessaires, des individus dont il était certain que personne ne défendrait, il envisagea, dans le but de consolider sa réconciliation avec le peuple, d'organiser une grande fête où les condamnés joueraient un rôle. Il n'était pas aisé de surprendre ces habitués de l'amphithéâtre avec de nouvelles formes de supplices. La crucifixion, la décapitation et les pinces ardentes étaient monnaie courante; brûler ces malheureux aurait empiété sur les divertissements du cirque; les enterrer vifs aurait privé les spectateurs de l'agonie visuelle de la souffrance et de la mort. On décida alors de les revêtir de peaux de bêtes et de les jeter à des chiens enragés qui les déchiquetèrent. Mais Néron voulait encore innover. Ceux qui restaient furent enduits de résine et attachés vivants à des poteaux, d'où ils pouvaient observer les jeux organisés dans les jardins du palais. A la tombée de la nuit, ils furent embrasés et servirent de torches pour illuminer la fête. Tacite, en relatant ces cruautés, ne peut s'empêcher de ressentir une certaine pitié pour les victimes. On raconte que Néron, qui avait lancé cette répression contre les chrétiens, étendit bientôt la persécution aux philosophes. Le stoïcien Musonius, impliqué dans la conspiration de Pison, fut exilé à Gyaros puis contraint de travailler enchaîné à l'isthme de Corinthe, malgré son rang de chevalier. Le célèbre Apollonius de Tyane, qui était venu à Rome pour voir de ses propres yeux quel genre de bête était un tyran, fut également accusé de magie : il s'en sortit cette fois, mais lorsqu'il partit pour la Grèce, Néron ordonna l'expulsion de tous ceux qui enseignaient publiquement la philosophie à Rome. La conjuration de Caius Calpurnius Pison (12 au 19 avril 65)Il est clair que le mépris que Néron suscitait auprès de l'élite romaine incitait à vouloir se débarrasser de lui. Les conspirateurs n'étaient pas des parangons de vertu antique ou des hommes de l'âge d'or. Leur meneur était Pison, issu de la prestigieuse famille des Calpurnius. Il possédait des attraits qui, à cette époque, charmaient les foules sans susciter l'envie : une grande fortune, un rang élevé et de bonnes manières. La conspiration était principalement d'ordre militaire. Néron avait réparti le commandement de la garde prétorienne entre deux préfets : Tigellinus, son favori, et Faenius Rufus, relégué à l'arrière-plan et désireux de se mettre en avant. Rufus avait rallié à sa cause des tribuns et des centurions, ainsi que des soldats peu concernés par les enjeux politiques mais, pour certains, embarrassés par la déchéance de l'empereur, et pour beaucoup d'autres, simplement avides de changement pour progresser ou pour gagner en grade. Derrière eux se trouvaient les habituels mécontents et individus ruinés, souvent prêts à rejoindre les rangs des complots et des révoltes. Parmi les sénateurs impliqués dans la conjuration se trouvait Plautius Lateranus, un des consuls désignés. Sénèque, informé de la conspiration, réalisa que sa seule sécurité résidait dans la mort de Néron, qui avait tenté de l'empoisonner. Bien qu'il n'ait pas pris de rôle actif dans l'exécution du complot, il envisagea de tirer profit de la bonne disposition de plusieurs conjurés à son égard. La vanité d'un poète blessé poussa son neveu Lucain à rejoindre la conspiration. Néron lui interdit de faire des lectures publiques de ses poèmes, ce qui raviva chez le poète l'esprit de Brutus et Cassius, et il adopta leur rôle. Une femme impliquée dans le complot, Epicharis, tenta de recruter un chiliarque de la flotte de Misène qui finit par la trahir, mais elle nia tout, préservant ainsi le secret. Cependant, les conspirateurs comprirent que leurs mouvements étaient surveillés et qu'il était urgent d'agir. Ils suggérèrent à Pison de tuer le prince lors de sa visite habituelle sans gardes à sa villa de Baïa, mais Pison refusa, craignant qu'une action à Baïa ne prévienne Rome, soit par l'ambition d'un rival, soit par le consul Vestinus qui aurait pu tenter de rétablir la république. L'exécution fut donc reportée au jour des jeux du cirque (12 au 19 avril 65), et le sénateur Flavius Scaevinus demanda l'honneur de porter le premier coup. La veille de l'action prévue, Scaevinus rédigea son testament et demanda à son affranchi Milichus d'aiguiser un poignard, qu'il avait obtenu dans un temple étrusque et qu'il croyait destiné à une noble cause. Il organisa ensuite un grand banquet pour ses amis, affranchit les esclaves qu'il préférait et distribua de l'argent aux autres. Il demanda également à Milichus de préparer le nécessaire pour soigner les blessures et arrêter le saignement. Ces agissements éveillèrent les soupçons de l'affranchi, qui se précipita au palais pour tout révéler. Convoqué immédiatement, Scaevinus nia d'abord toute implication. Cependant, il avait eu une longue discussion avec un autre conspirateur, Antonius Natalis. Interrogés séparément, leurs témoignages divergèrent, et sous la torture, Natalis avoua tout, impliquant Pison et Sénèque. Informé que Natalis avait parlé, Scaevinus révéla les noms des autres conspirateurs, y compris Tullius Sénécion, Lucain et Afranius Quintianus. Lucain alla jusqu'à dénoncer sa propre mère, Acilia, tandis que les deux autres dénoncèrent Glitius Gallus et Asinius Pollion, leurs meilleurs amis. On avait encouragé Pison à entreprendre une action audacieuse, à s'adresser au peuple ou aux soldats, ou à se lancer dans les risques d'un combat désespéré, car il ne pouvait attendre de l'empereur que la mort. Cependant, ces démarches audacieuses effrayaient le patricien indolent, qui était déjà acteur à l'instar de Néron et qui, peut-être, aurait gouverné comme lui. Il rédigea de grands éloges de l'empereur dans un codicille et attendit que les soldats lui apportent l'ordre de se donner la mort par ouverture des veines. La mort de CorbulonNéron humilia les généraux les plus renommés en les plaçant sous la surveillance de ses affranchis et retira aux armées les chefs qu'elles adoraient pour leurs victoires passées. Suetonius Paulinus, qui avait vaincu les Maures et les Bretons, fut disgracié, tandis que Plautius Silvanus, le compétent commandant de la Moesie, fut laissé dans l'oubli sans honneur à son poste. Deux frères de la noble famille Scribonia, Rufus et Proculus, qui commandaient les armées des deux Germanies, furent rappelés sous prétexte de discussions avec l'empereur sur les affaires de leurs provinces, mais reçurent en chemin l'ordre de se suicider. Ce fut également le destin du meilleur capitaine de l'époque, Domitius Corbulon. Attiré en Grèce, à peine avait-il débarqué au port de Cenchrées que les agents de la terreur impériale l'encerclèrent; il se suicida avec son épée en déclarant : "Je l'ai bien mérité." Etait-ce le regret d'avoir servi un tel souverain, ou de ne pas l'avoir renversé ? Face à ces événements, les généraux, voyant le sort réservé aux plus illustres d'entre eux, se sentirent tous menacés; certains, comme Galba, commencèrent à se préparer pour une crise inévitable et imminente. Néron se mettait à dos aussi bien les soldats que les provinciaux. Les armées devenaient des gouffres financiers et les provinces des sources de revenus; pour équilibrer un budget déséquilibré par ses extravagances, il cessait de payer les troupes et alourdissait les taxes sur les provinces. Les soldes étaient en retard et les gratifications aux vétérans suspendues; Dion affirme même qu'il avait supprimé les distributions de blé à Rome, et que la révolte en Bretagne avait été provoquée par l'instauration de taxes excessives. Aux revenus fiscaux, il ajoutait d'autres formes de profits. Avec le temps, il inventa de nouvelles sources de revenus, autorisant le pillage à condition d'en recevoir une part. Et comme il avait persécuté les généraux appréciés des soldats, il fit condamner les gouverneurs prisés des provinces, à l'instar de Barea Soranus, proconsul d'Asie, qui fut exécuté pour son intégrité, ses talents et l'affection que lui portaient les habitants de Pergame et d'Ephèse. Le grand tour de la GrèceIl part, mais son armée n'est pas armée de pilums ou de boucliers; à la place des épées, ils portent des lyres, et des masques de théâtre remplacent les casques. C'est une troupe de baladins qui suit son chef, et la Grèce deviendra la scène de ses prouesses. Ce voyage en Grèce constitue sa seule visite à l'étranger pendant son règne. Il participe à tous les jeux, y chante et y conduit des chars (en l'an 67 après J.-C.). Il remporte naturellement tous les prix. Les spectateurs n'ont pas le droit de quitter leurs sièges pendant qu'il chante, ce qui crée des situations compliquées, ses performances pouvant durer des heures. Le futur Vespasien, qui s'endort pendant une session, est renvoyé. Même après une chute en plein stade d'Olympie, les Grecs ne lui ménagent ni les applaudissements ni les triomphes. Il reçoit dix-huit cents couronnes, et les statues des anciens vainqueurs sont abattues devant lui. Il élimine parfois lui-même ses concurrents : à Corinthe, un acteur qui lui dispute l'attention du public et le prix du chant est étranglé sur scène. Ces victoires parmi un peuple artistique et raffiné le comblent de joie, au point qu'il décide de les récompenser généreusement : comme Flamininus, il proclame la liberté de la Grèce et lit lui-même à Corinthe, durant les jeux isthmiques, le décret que Flamininus avait au moins fait annoncer par un héraut. Il promet un avantage encore plus grand : il se lance dans le projet de percer l'isthme de Corinthe. Ses prétoriens commencent le travail au son de la trompette et lui-même, avec une pelle en or, déplace quelques pelletées de terre qu'il transporte. De toutes les îles arrivent les exilés, de toutes les provinces, les condamnés; Vespasien lui envoie six mille prisonniers juifs. Il n'y aura pas d'exécution tant que les travaux ne seront pas terminés (du moins avait-ce été ainsi décidé pour son canal de Misène à Rome, qui aurait de toute façon presque tué tous les travailleurs en traversant les marais Pontins...). Mais cette activité constructive l'ennuie rapidement; il déclare le canal impossible et retourne à ses jeux et fêtes, entrecoupés d'exécutions, comme celle de Corbulon. De Delphes, il emporte cinq cents statues, en prend d'autres à Olympie et contraint les Thespiens à lui céder l'Eros de Praxitèle, afin de compenser les pertes d'objets d'art à Rome causées par l'incendie de 64, répétant les vols des premiers conquérants de la Grèce. Le désespoir et la mortUne agitation menaçante régnait parmi les esprits, tant dans les armées que dans les provinces. Les Juifs étaient en révolte ouverte, nécessitant l'envoi de grandes forces contre eux. Dans tout l'Occident, dépourvu des souvenirs mythologiques et des moeurs grecs, on ne ressentait que mépris pour l'impérial histrion, à qui beaucoup auraient tout pardonné, sauf son reniement des coutumes nationales. Si la gravité romaine tolérait le vice et le crime, elle exigeait néanmoins un respect officiel. En Lusitanie, l'ex-mari de Poppée, Othon, attendait depuis dix ans l'opportunité de se venger. Le gouverneur de la Bétique se laissait influencer par les discours d'Apollonius contre l'ennemi des philosophes, et en Tarraconaise, le vieux Galba, un parent de Livie, gagnait en popularité en contrariant les agents du fisc dans leurs exactions. Dans sa propre garde prétorienne, on parlait ouvertement du sénat, de la république, et lui, qui avait refusé l'empire après la mort de Caïus vingt-six ans plus tôt, devenait plus audacieux avec l'âge, ayant moins à perdre. Il collectait des oracles prédisant qu'un empereur émergerait d'Espagne, conservait soigneusement les portraits des sénateurs assassinés par Néron et entretenait des relations secrètes avec les exilés des Baléares. En Gaule, un nouveau recensement et les taxes levées pour la reconstruction de Rome provoquaient une grande irritation. Ces provinces, si proches de l'Italie, voyaient presque et entendaient les étranges saturnales se déroulant à Rome. Elles étaient encore trop récemment romanisées, trop gauloises, pour ne pas être indignées par les vices honteux que Néron affichait impunément sur les rives du Tibre. Toujours avides de nouvelles, elles regorgeaient de personnes venues raconter les scènes infâmes de la Maison d'Or ou des jeux Néroniens, et à ces récits, la vieille sève barbare remontait, suscitant l'indignation de devoir obéir à un tel maître. Parmi ceux qui revenaient de Rome avec le plus de mépris et de colère se trouvait l'Aquitain Julius Vindex, de sang royal et alors gouverneur de la Lugdunaise. Il partagea ses griefs avec les nobles des Séquanes, des Eduens et des Arvernes, les persuadant de se révolter contre Néron. Si lors de ces rencontres, les vices de l'empereur furent largement discutés, certains évoquèrent également les désavantages de l'empire et envisagèrent l'idée d'une sécession. Toutefois, Vindex, malgré ses origines gauloises, était trop imprégné de la culture romaine pour envisager autre chose qu'un changement de prince ou de régime; ceci est démontré par le fait qu'il fit prêter serment de fidélité au Sénat et au peuple romain à ses partisans. Mais il n'aurait pas rallié autant de Gaulois à sa cause si, en plus du mépris pour Néron, de secrètes espérances n'avaient pas germé dans le coeur de nombreux Gaulois. Avant de lancer son mouvement, Vindex avait contacté plusieurs gouverneurs des provinces occidentales pour solliciter leur soutien, dont Galba. Ce dernier n'hésita plus, surtout après avoir intercepté un ordre de Néron adressé aux procurateurs pour l'exécuter (2 avril 68). Il leva une légion dans sa province, portant ainsi ses forces à deux légions, constitua une sorte de sénat, une garde de chevaliers et diffusa largement des proclamations dénonçant l'ennemi commun. Othon, gouverneur de Lusitanie, contribua à l'effort en donnant son argenterie et sa vaisselle d'or pour être frappées en monnaie. Lorsque Néron apprit que Galba et les provinces d'Espagne s'étaient également soulevées, il perdit tout courage, tomba à terre et resta longtemps prostré, comme à demi mort. Dans un premier temps, il avait voulu tout détruire, ensuite expulser les consuls, se faire apporter les faisceaux et traverser lui-même les Alpes; il avait même mis à prix la tête de Vindex : 2 500 000 drachmes pour son assassin. Le légat de la Germanie supérieure Lucius Rufus Verginius méprisait profondément la vie lâche de Néron, mais restait attaché au sénat, au peuple romain et à la légalité. L'idée des catastrophes qui pourraient s'abattre sur l'empire si les provinces et les armées réalisaient qu'il était possible de faire un empereur en dehors de Rome le terrifiait. La Belgique, bien que non dévouée à Néron, était mal à l'aise face à cette prétention des Gaulois du centre de nommer un maître au monde, et restait inerte. Libre de ce côté, Verginius pénétra dans le pays des Séquanes et menaça Besançon. Vindex, venu défendre la ville, demanda une entrevue. Les deux généraux, tous deux désintéressés et méprisant Néron, s'entendirent sur une restauration républicaine lors d'une longue discussion. Cependant, les légionnaires, calculant le butin à prendre sur les villes rebelles et indifférents aux noms jadis vénérés du sénat et du peuple romain, chargèrent malgré leurs chefs les milices gauloises qu'ils méprisaient, tuant vingt mille Gaulois. Vindex, désespéré, se suicida. Cette victoire ne profita pas à Néron; les légions victorieuses renversèrent ses statues et tentèrent de proclamer Verginius empereur. Celui-ci refusa, malgré leurs menaces, de se rallier à Néron, et réussit à contenir ses troupes jusqu'à ce que des informations fiables lui parviennent de Rome. En Basse Germanie, Fonteius Capito soulevait ses légions tant contre Néron que contre Galba. En Afrique, Claudius Macer, abandonnant le titre impérial de legatus Augusti, adopta le nom républicain de propréteur et intercepta les convois destinés à Rome, non tant dans l'intention de restaurer la république que dans l'espoir que le peuple offrirait l'empire à celui qui mettrait fin à la famine. Othon, en Lusitanie, appuyait Galba, voyant en lui une porte vers le pouvoir. Les légions d'Illyrie envoyèrent des délégués à Verginius pour lui offrir leur allégeance; et si l'armée d'Orient ne prenait pas position, c'était parce qu'elle était engagée dans un conflit difficile. Cependant, l'exemple donné de toutes parts ne serait pas vain, et elle se rappellerait bientôt que ce n'est plus à Rome que se font les empereurs. Un des préfets du prétoire, Tigellinus, négociait secrètement avec un ami de Galba; l'autre, Nymphidius Sabinus, pensait que le chaos ambiant lui offrirait une voie libre vers le palais des Césars. Il n'osait pas encore revendiquer le pouvoir pour lui-même, mais, capitalisant sur le mécontentement des prétoriens envers Néron, notamment en raison de la faveur que ce dernier accordait à sa garde germaine, il les convainquit que le prince avait fui. Pour rendre le futur gouvernement de Galba ingérable, il promit en son nom 30 000 sesterces par tête, une somme que le vieil homme économe ne pourrait ni ne voudrait jamais payer. Il espérait ainsi se positionner pour acheter facilement l'empire. Ainsi, les provinces et les armées se révoltaient; le peuple de Rome, affamé, grondait, et les prétoriens étaient manipulés par un intermédiaire qui attendait son heure pour agir en son propre nom. Dans ce chaos d'ambitions rivales, un ancien nom, un droit ancestral fréquemment bafoué mais toujours existant, conféraient au sénat un rôle de leader, du moins en apparence, de la situation. C'était vers lui que Verginius se tournait, et c'était en son nom que Galba prétendait agir. Bien que peu habitués à prendre des initiatives résolues, la gravité de la situation allait contraindre les sénateurs à sortir de leur torpeur. Que faisait Néron pendant ce temps ? Il envisageait de fuir en Egypte, chez les Parthes, ou même de se rendre aux pieds de Galba. Il tentait de convaincre des aventuriers et des tribuns de le suivre, mais tous refusaient et l'abandonnaient. Le palais impérial se vidait peu à peu. Néron, déserté par ses courtisans et ses gardes, appelait en vain un gladiateur pour mettre fin à ses jours. Personne ne répondait. Il était seul, seul avec ses crimes, ses peurs et sa lâcheté. Phaon, un de ses affranchis, prit pitié de lui et lui proposa sa villa, située à quatre milles de Rome. A la tombée de la nuit, il quittait le palais. Encouragés par cette nouvelle, les consuls convoquèrent le sénat, annoncèrent la fuite du prince et proposèrent de le déclarer ennemi public. L'un d'eux était le poète Silius Italicus, célèbre pour son épopée sur la seconde guerre Punique. Les Pères, ravis de pouvoir agir sans risque, utilisèrent la prérogative qu'on leur accordait de disposer de l'empire, en se prononçant pour le candidat qui semblait avoir les meilleures chances, l'élu de Vindex. Néron s'enfuyait. Il avait quitté le palais à cheval, vêtu simplement d'une tunique, les pieds nus, enveloppé d'un vieux manteau, la tête couverte et le visage dissimulé par un mouchoir, accompagné seulement de quatre personnes. Passant près du camp des prétoriens, il perçut les cris des soldats maudissant son nom tout en clamant leur soutien pour Galba. La puanteur d'un cadavre abandonné fit hésiter son cheval; son mouchoir tombant, un ancien prétorien le reconnut et l'interpella par son nom. Parvenu à un chemin secondaire, il renvoya les chevaux et s'engagea à travers buissons et épines sur un sentier où il dut faire étaler des vêtements pour marcher. Non sans difficulté, il atteignit l'arrière des murs de la villa. Là, Phaon lui suggéra de se réfugier temporairement dans une ancienne carrière de sable, mais il refusa de s'y "enterrer vivant". Il s'attela ensuite à détacher les ronces accrochées à son manteau. Une fois le trou creusé sous le mur achevé, il se glissa à quatre pattes jusqu'à la pièce la plus proche, où il s'effondra sur un vieux matelas recouvert d'une couverture râpée. La faim et la soif le tourmentant, on lui offrit du pain grossier qu'il refusa, et un peu d'eau tiède dont il but. Tous ceux qui étaient avec lui le pressaient de se dérober le plus tôt possible aux outrages dont il était menacé. Il ordonna de creuser une fosse devant lui, sur la mesure de son corps, de l'entourer de quelques morceaux de marbre, s'il s'en trouvait, et d'apporter près de là de l'eau et du bois, pour que les derniers devoirs fussent rendus à son cadavre, pleurant à chaque ordre qu'il donnait, et répétant sans cesse : Quel artiste le monde va perdre ! Pendant ces préparatifs, un courrier vint remettre un billet à Phaon; Néron s'en saisit, et y lut que le sénat l'avait déclaré ennemi de la patrie, et le faisait chercher pour le punir selon les lois anciennes. Il demanda quel était ce supplice; il consiste, lui dit-on, à dépouiller le criminel, à lui serrer le cou dans une fourche et à le battre de verges jusqu'à la mort. Epouvanté, il saisit deux poignards qu'il avait apportés avec lui, en essaya la pointe et les remit dans leur gaine en disant : L'heure fatale n'est pas encore venue. Tantôt il exhortait Sporus à se lamenter et à pleurer; tantôt il demandait que quelqu'un lui donnât, en se tuant, le courage de mourir. Quelquefois aussi il se reprochait sa lâcheté; il se disait : Je traîne, une vie honteuse et misérable; et il ajoutait en grec : Cela ne convient pas à Néron; non, cela ne lui convient pas : il faut prendre son parti dans de pareils moments; allons, réveille-toi. Déjà s'approchaient les cavaliers qui avaient ordre de le saisir vivant. Quand il les entendit, il prononça, en tremblant, ce vers grec : Des coursiers frémissants j'entends le pas rapide. Et il s'enfonça le fer dans la gorge, aidé par son secrétaire Epaphrodite. Il respirait encore lorsque entra le centurion, qui, feignant d'être venu pour le secourir, voulut bander la plaie. Néron lui dit : Il est trop tard. Et il ajouta : Est-ce là la foi promise ? Il expira en prononçant ces mots, les yeux ouverts et fixes (Suétone). Icelus, affranchi de Galba, permit qu'on brûlât ses restes. Les derniers devoirs furent rendus à ce maître du monde par sa vieille nourrice et par Acté, fidèle au souvenir de celui dont elle avait été le premier amour (9 juin 68). |
