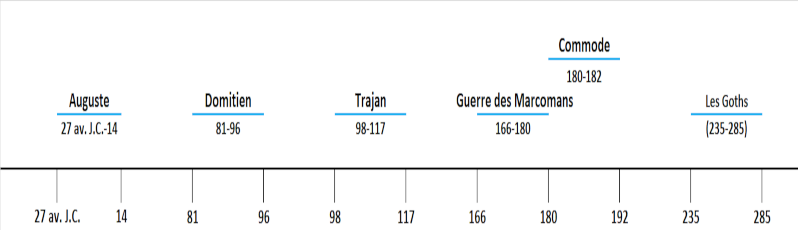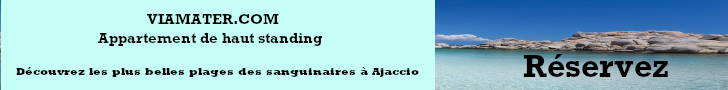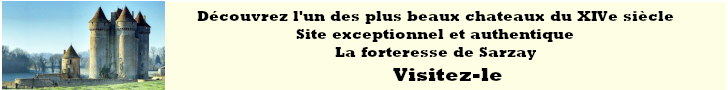|
|||||
L'Egypte
Sources historiques : Théodore Mommsen Vous êtes dans la catégorie : Empire Chapitre suivant : Les provinces d'Afrique Chapitre précédent : La Judée Dans ce chapitre : 39 rubriques; 29 892 mots; 157 295 caractères (espaces non compris); 186 886 caractères (espaces compris) Format 100% digital de cette rubrique (via l'espace membre) | |||||
81-30 av. J.C. |
Soumission de l'EgypteRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes deux empires d'Egypte et de Syrie, qui avaient lutté et rivalisé pendant si longtemps à tous égards, tombèrent presque à la même époque, sans résistance, sous la domination romaine. Les vainqueurs ne firent aucun usage du testament réel ou prétendu d'Alexandre II (mort en 673 de Rome = 81 av. J.-C.) et n'annexèrent pas alors l'Egypte; mais les derniers souverains de la dynastie des Lagides se reconnurent les clients de Rome. Lorsque plusieurs princes se disputaient la royauté, c'était le sénat qui décidait, et, depuis le jour où le gouverneur romain de Syrie, Aulus Gabinius avait, à la tête de ses troupes, ramené en Egypte le roi Ptolémée Aulétès (699 de Rome = 55 av. J.-C.), les légions romaines n'avaient plus quitté le pays. Les rois d'Egypte, commes les autres princes vassaux, prirent part aux guerres civiles sur l'ordre du gouvernement qu'ils avaient reconnu, ou plutôt qui s'imposait à eux; et, si l'on ne peut pas savoir exactement quel rôle Antoine réservait à la patrie de sa maîtresse dans le fantastique empire d'Orient qu'il avait rêvé, du moins le règne de ce Romain à Alexandrie et le dernier combat de la dernière guerre civile, qui se livra devant les portes de cette place, appartiennent aussi peu à l'histoire spéciale de l'Egypte que la bataille d'Actium à l'histoire particulière de l'Epire. Mais, après cette catastrophe, que suivit immédiatement la mort de la dernière princesse issue de la famille des Lagides, Auguste, au lieu de mettre un nouveau prince sur ce trône vacant, plaça le royaume d'Egypte sous son autorité immédiate. Tout le rivage de la mer Méditerranée était donc désormais soumis à l'administration directe des Romains en même temps qu'était fondée la nouvelle monarchie. Ces deux événements modifient l'un le gouvernement, l'autre la constitution de l'immense empire; ils marquent la fin d'une période et le commencement d'une nouvelle époque. |
||||

|
|||||
30 av. J.C. |
L'Egypte territoire impérialRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste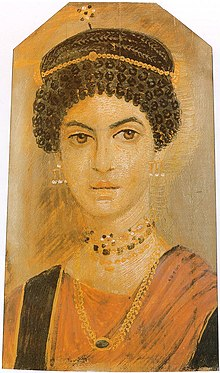
L'annexion de l'Egypte à l'empire romain eut un caractère tout à fait spécial; tandis que le principe de la Dyarchie, c'est-à-dire du partage du gouvernement entre les deux plus grandes puissances de l'empire, le Prince et le Sénat, était appliqué dans l'Etat tout entier, sauf dans quelques districts peu importants, l'Egypte seule n'y fut pas soumise1; ni le sénat, en tant qu'assemblée politique, ni aucun de ses membres pris isolément, ne purent avoir part au gouvernement de cette province; et même l'accès de l'Egypte fut interdit aux sénateurs et aux citoyens de rang sénatorial2. Pour expliquer cette anomalie, on ne peut pas dire que l'Egypte fut réunie au reste de l'Empire par une simple union personnelle; d'après le sens et l'esprit de la constitution d'Auguste, le prince est un élément intégrant et toujours en fonction de l'état politique romain, au même degré que le sénat, et l'autorité que l'empereur exerçait sur l'Egypte faisait partie de la souveraineté romaine comme l'autorité du proconsul d'Afrique3. Si l'on veut se faire une idée claire de cette situation politique, on peut se figurer l'empire britannique constitué de telle façon, que le ministère et le parlement s'occupent exclusivement de la mère-patrie, tandis que les colonies seraient soumises à l'autorité absolue de l'impératrice des Indes. Il ne nous appartient pas de rechercher quels motifs poussèrent le nouveau monarque à prendre, dès les premières années de son règne, cette mesure qui divisait si profondément l'empire et qu'on ne rapporta jamais, ni d'indiquer quelle fut son importance dans l'histoire politique générale; cette tâche appartient à un historien de l'empire tout entier. Nous devons seulement exposer ici quelles furent, sous la domination des empereurs romains, les destinées intérieures de l'Egypte. Les Romains, en annexant à leur empire les autres pays helléniques ou hellénisés, laissèrent aux peuples conquis leurs anciennes institutions, et ne les modifièrent que dans les cas absolument nécessaires; en Egypte ils suivirent absolument la même politique. L'Egypte comme la Syrie, était un pays de nationalité double, lorsqu'elle devint romaine; auprès et au-dessus de l'indigène, il y avait le Grec; au-dessus de l'esclave, le maître. Mais, en droit et en fait, les rapports des deux éléments n'étaient pas du tout les mêmes en Egypte qu'en Syrie. 1. Pour nous expliquer que ni le sénat ni les sénateurs ne furent admis à gouverner cette province, Tacite nous dit (Hist., I, 11) qu'Auguste voulut faire administrer l'Egypte exclusivement par ses serviteurs personnels (domi retinere; cf. Staatsrecht, II, p. 963). En principe cette forme particulière de gouvernement devait être appliquée à toutes les provinces qui n'étaient pas administrées par des sénateurs, et dont les gouverneurs portèrent d'abord le nom de praefecti (Corp. insc. lat., V, p. 809 et 902). Mais, lors du premier partage des provinces entre l'empereur et le sénat, il n'y eut probablement pas d'autre province organisée comme l'Egypte; plus tard la différence devint encore plus frappante, lorsque toutes les autres provinces sénatoriales ne recurent pas de légions. Ce qui nous indique le mieux que le sénat fut exclu du gouvernement de l'Egypte, c'est qu'il fut de règle dans cette province que les légions fussent commandées par un chevalier et non par un sénateur. 2. Cette interdiction ne fut appliquée qu'à l'Egypte, et non pas aux autres provinces, qui n'étaient pas gouvernées par des sénateurs. Ce qui nous montre combien cette mesure paraissait essentielle au gouvernement, c'est l'appareil constitutionnel et religieux prescrit pour empêcher qu'elle ne fût violée (Trig. Tyr., 2, 22). 3. On prétend d'habitude, mais sans fondement, que la provincia n'existait pas en réalité pour les districts qui n'étaient pas administrés par des sénateurs. L'Egypte n'était, ni plus ni moins que la Gaule et la Syrie, une propriété privée de l'empereur, Auguste lui-même le dit (Mon. Anc., V, 24): AEgyptum imperio populi romani adjeci - et le gouverneur de cette province, qui, étant chevalier, ne pouvait pas être pro praetore, recevait par une loi spéciale la compétence judiciaire dont jouissaient les préteurs romains (Tacite, Ann., XII, 60). |
||||
30 av. J.C.-476 |
Villes grecques et égyptiennesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAvant l'époque romaine et même sous la domination des Romains, la Syrie n'était qu'indirectement soumise à un gouvernement unique; elle était divisée soit en principautés, soit en territoires de villes autonomes; elle était administrée par des souverains locaux ou par des autorités municipales. En Egypte1, au contraire, il n'y a ni princes indigènes ni villes impériales constituées sur le modèle des cités helléniques. Les deux divisions administratives de l'Egypte, le pays des Egyptiens avec ses trente-six nomes (vouci) d'autrefois, et les deux villes grecques d'Alexandrie dans la Basse-Egypte et de Ptolémaïs dans la Haute-Egypte2, sont essentiellement séparées et même rivales, quoique au fond fort peu différentes. La province et la cité ne sont pas seulement limitées dans leurs territoires, mais l'une et l'autre forment une petite patrie; on appartient à sa province ou à sa cité par droit héréditaire, et en quelque lieu que l'on habite. L'Egyptien du nome de Chemmis, même s'il demeure à Alexandrie, fait toujours partie de ce nome avec sa famille; l'Alexandrin, qui habite à Chemmis, reste de même membre de la bourgeoisie d'Alexandrie. Au centre de chaque province se trouve une agglomération urbaine: la province de Chemmis, par exemple, a pour capitale la ville de Panopolis construite autour du temple de Chemmis ou de Pan; suivant l'expression grecque, chaque nome a sa métropole. Le territoire de la province peut donc être considéré également comme le territoire d'une ville; aussi, à l'époque chrétienne, les nomes, autant que les villes, furent-ils pris comme bases de l'organisation diocésaine. Les provinces sont déterminées d'après la religion qui domine tout en Egypte; chacune d'entre elles a pour centre le temple d'une divinité spéciale; elle tire son nom soit de cette divinité, soit de l'animal qui lui est consacré; ainsi la province de Chemmis porte le nom du dieu Chemmis, ou Pan, suivant l'assimilation grecque; d'autres provinces rappellent les noms du chien, du lion, du crocodile. Le centre religieux ne manque pas non plus aux territoires de villes; le dieu protecteur d'Alexandrie est Alexandre, celui de Ptolémaïs est Ptolémée I; les prêtres, qui célèbrent dans ces deux villes le culte de ces héros et de leurs successeurs, sont les Eponymes des deux cités. L'autonomie n'existe pas pour la province; là toute l'administration politique, judiciaire et financière, est entre les mains des fonctionnaires royaux3; la collégialité, palladium de la constitution politique des Grecs et des Romains, est complètement et à tous les degrés exclue du gouvernement. Il n'en est guère autrement dans les deux villes grecques. La population était bien divisée en tribus et en dèmes; mais les cités n'avaient pas de conseil municipal4; les fonctionnaires ne sont pas les mêmes et ne portent pas les mêmes noms que dans les nomes, mais ils sont aussi nommés par le Roi et ne forment pas de collèges. Hadrien est le premier qui ait donné le droit de cité à une localité égyptienne et qui l'ait constituée sur le modèle des villes grecques, lorsqu'il fonda Antinooupolis en souvenir de son ami noyé dans le Nil; plus tard Sévère, peut-être pour porter préjudice aux habitants d'Antioche autant que pour rendre service aux Egyptiens, accorda à la capitale de l'Egypte, à la ville de Ptolémaïs, et à plusieurs autres cités égyptiennes, non pas le droit d'avoir des magistrats municipaux, mais un conseil municipal. Jusqu'alors, en langage officiel, la ville égyptienne s'appelle nome, la ville grecque polis; mais une polis sans archontes et sans bouleutae, c'est un nom vide de sens. Il en fut de même pour le monnayage. Les nomes égyptiens n'ont jamais eu le droit de monnayage; mais Alexandrie n'a pas davantage frappé de monnaies. Parmi les provinces grecques de l'empire, l'Egypte est la seule qui n'ait pas connu d'autre monnaie que la monnaie royale. Cette situation ne fut pas modifiée à l'époque romaine. Les empereurs firent disparaître les abus qui s'étaient introduits sous les derniers Lagides; Auguste abolit la fabrication des monnaies de cuivre dont la valeur n'était pas réelle; et lorsque Tibère rétablit le monnayage d'argent, il donna aux pièces d'argent égyptiennes une valeur réelle comme à toutes les monnaies courantes des provinces de l'empire5. Mais le caractère du monnayage ne fut pas essentiellement transformé. Il y a une différence entre le nome et la polis comme entre le dieu Chemmis et le dieu Alexandre; mais cette différence n'existe pas au point de vue administratif. L'Egypte se composait d'un grand nombre de localités égyptiennes et d'un petit nombre de localités grecques, qui toutes étaient privées de l'autonomie et soumises à l'autorité immédiate et absolue du roi et des fonctionnaires nommés. 1. Nous ne parlons ici naturellement que de l'Egypte proprement dite, et non des pays soumis aux Lagides. Cyrène fut organisée de la même manière. Mais le régime égyptien ne fut jamais appliqué à la Syrie méridionale ni aux autres territoires qui furent soumis pendant plus ou moins de temps aux maîtres de l'Egypte. 2. Il faut y ajouter d'abord Naucratès, la plus ancienne ville grecque fondée en Egypte avant les Ptolémées, puis Paraetonion, qui se trouve, il est vrai, en dehors des limites de l'Egypte. 3. Il existait naturellement une certaine puissance municipale, semblable à celle que possèdent les régions et les vices des cités qui s'administrent elles-mêmes; c'est à elle qu'il faut rattacher toutes les institutions relatives à l'Agoranomie et à la Gymnasiarchie, qu'on rencontre dans les nomes, ainsi que le droit de dédier des monuments honorifiques, etc., toutes choses d'ailleurs qui apparurent fort tard et ne devinrent jamais importantes. D'après l'édit d'Alexandre (Corp. insc. graec., 1957, ligne 34) il ne semble pas que les stratèges fussent, à proprement parler, nommés par le gouverneur; mais ils devaient être confirmés par son approbation. Nous ne savons pas à qui appartenait le droit de les proposer. 4. La situation nous est clairement indiquée dans l'inscription qui fut dédiée par les Grecs d'Egypte au célèbre orateur Aristide, dans les premières années du règne d'Antonin (Corp. insc. graec., 4679) : sont nommés parmi les signataires de?'inscription?. Ainsi Antinooupolis seule, la ville des nouveaux Hellènes, a un sénat; on ne fait pas mention d'une pareille assemblée à propos d'Alexandrie, qui est citée comme une ville grecque au milieu des autres villes. En outre l'inscription est dédiée par les Grecs qui habitent le Delta et Thèbes; parmi les villes égyptiennes Hermoupolis la Grande figure seule sur ce document, sans doute à cause du voisinage immédiat d'Antinooupolis. Strabon (XVII, 1, 42, p. 813) cite Ptolémaïs comme un cuoinuo Fulltexov; mais il est difficile de voir dans ce texte autre chose qu'une allusion au partage de la population en tribus, partage que nous retrouvons dans la constitution d'Alexandrie beaucoup mieux connue aujourd'hui. Il est possible que la ville grecque de Naucratis, fondée avant les Ptolémées, ait conservé sous cette dynastie le sénat, qu'elle avait eu certainement auparavant; mais cet exemple n'est pas décisif en ce qui concerne les institutions des Ptolémées. Dion nous raconte (II, 17) qu'Auguste laissa à toutes les villes égyptiennes leur ancienne organisation, mais qu'il enleva aux Alexandrins leur conseil municipal parce qu'ils se révoltaient sans cesse : ce récit doit reposer sur un malentendu, d'autant plus qu'Alexandrie se serait trouvée dans une situation inférieure aux autres cités égyptiennes, ce qui n'est pas possible. 5. Le monnayage d'or cessa naturellement en Egypte au moment de l'annexion; dans l'empire romain il n'y avait que des monnaies d'or impériales. Auguste interdit de même le monnayage d'argent; comme souverain de l'Egypte, il fit frapper des pièces de cuivre, mais en petit nombre. Tibère le premier mit en circulation, à partir de l'an 27/28 ap. J.-C., des monnaies d'argent égyptiennes, suivant toute apparence comme de simples médailles, puisque les pièces correspondent presque d'après le poids à quatre deniers romains, et d'après à leur taux d'argent à un seul de ces deniers. (Feuardent, Numismatique, Egypte ancienne, II, p. 11). Mais légalement la drachme d'Alexandrie était considérée comme équivalente à l'obole (au sixième par conséquent, et non au quart, cf. Rom. Munzwesen, p. 43 et 723) du denier romain (Hermes, V, p. 136), et l'argent provincial perdait toujours dans les échanges avec l'argent d'empire; il en résulte que la tétradrachme d'Alexandrie, dont la valeur réelle était d'un denier, n'était légalement équivalente qu'à 2/3 de denier. Jusqu'à Commode, à partir duquel cette tétradrachme fut essentiellement une monnaie de cuivre, elle n'avait qu'une valeur relative, comme la tétradrachme de Syrie et la drachme de Cappadoce; on lui conserva seulement son ancien nom et son ancien poids. 6. Une des fantaisies de l'empereur Hadrien, pendant son voyage d'Egypte, fut d'accorder pour une fois le droit de battre monnaie aux Nomes et à sa nouvelle fondation d'Antinooupolis; par lui. Le même privilège fut encore accordé deux fois dans la suite. Mais cette exception ne détruit pas la règle. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Absence de l'assemblée provincialeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl résulta de cette organisation que, seule parmi toutes les provinces romaines, l'Egypte n'eut pas de représentation générale. L'assemblée provinciale est constituée par tous les délégués des cités autonomes de chaque province. Il n'y eut pas en Egypte de pareille réunion. Les nomes étaient des districts administratifs purement impériaux ou plutôt royaux; non seulement Alexandrie était isolée dans la province, mais encore elle ne possédait pas d'organisation municipale proprement dite. Sans doute le prêtre qui gouvernait la capitale du pays pouvait s'appeler le Grand-Prêtre d'Alexandrie et de toute l'Egypte; il avait même certains rapports avec l'Asiarque et le Bithyniarque de l'Asie Mineure; mais cette analogie ne faisait que dissimuler la profonde différence des deux constitutions. |
||||
323-30 av. J.C. |
Le gouvernement des LagidesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAussi la royauté n'a-t-elle pas en Egypte le même caractère que dans les autres provinces, où dominait la civilisation grecque et romaine, et qui avaient été définitivement réunies sous le gouvernement impérial. Dans ces pays c'est la commune qui administre : le maître de l'empire n'est au fond que le président commun de toutes les municipalités plus ou moins autonomes; les défauts et les dangers de ce système se manifestent partout à côté de ses avantages. En Egypte le maître est roi, les indigènes sont des sujets, l'administration du pays se confond avec celle des domaines. Ce gouvernement, absolu en principe du haut en bas, et qui cherche à faire le bonheur de tous les sujets sans distinction de rang ni de fortune, caractérise le règne des Lagides; il se rattache plutôt à la domination des antiques pharaons adoucie par l'hellénisme qu'à la royauté universelle, basée sur l'organisation municipale, qu'avait rêvée le grand conquérant Macédonien et qu'il avait réalisée aussi parfaitement que possible dans la Nouvelle-Macédoine de Syrie. Cette constitution exigeait un roi qui sût non seulement commander à une armée, mais encore gouverner chaque jour par lui-même une hiérarchie de fonctionnaires très vaste et sévèrement disciplinée, une justice égale pour les grands et pour les petits; et, comme ces souverains se donnèrent, non sans raison, le surnom de Bienfaiteur, on peut comparer la monarchie des Lagides à celle de Frédéric, dont elle ne s'écarte pas d'ailleurs dans ses lignes générales. Mais l'Egypte avait aussi connu le revers de la médaille, c'est-à-dire la chute inévitable de cette constitution en des mains incapables. La théorie n'en subsista pas moins; le principat d'Auguste à côté de l'autorité du sénat n'est pas autre chose que l'union du gouvernement des Lagides et de l'antique institution des cités et des confédérations. |
||||
30 av J.C.-476 |
L'Egypte et l'administration impérialeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteUne conséquence nouvelle de cette forme de gouvernement, c'est la supériorité, incontestable surtout sous le rapport financier, de l'administration égyptienne sur celle des autres provinces; l'époque antérieure à la conquête romaine est caractérisée par la lutte entre la grande puissance financière de l'Egypte et l'empire asiatique qui occupe presque tout le reste de l'Orient. Sous les Romains cette situation se continue en ce sens que les finances impériales sont plus prospères que celles du sénat, c'est en grande partie parce que l'empereur possède seul l'Egypte. Si le but d'un gouvernement est de tirer d'un territoire donné les plus gros revenus possible, les Lagides ont été dans l'antiquité les maîtres de la science politique. En tout cas ils ont été sur ce terrain les professeurs et les modèles des Césars. Nous ne pouvons pas dire avec précision ce que les Romains tiraient de l'Egypte. Au temps des Perses l'Egypte avait payé un tribut annuel de 700 talents d'argent de Babylone; le revenu que les Ptolémées réalisaient chaque année en Egypte ou plutôt dans toutes leurs possessions atteignit, pendant la période la plus brillante de leur règne, 14,800 talents d'argent d'Egypte, sans compter un million et demi d'artabes, = 591,000 hectolitres de froment; à la fin de leur domination, ils en tiraient largement 6,000 talents. C'est d'Egypte que les Romains recevaient annuellement le tiers du grain nécessaire à la consommation de Rome, 20 millions de boisseaux romains1 = 1,740,000 hectol.; mais une partie de cette provision était certainement tirée des domaines proprement dits; une autre était peut-être livrée contre indemnité; d'autre part les impôts égyptiens se payaient au moins pour une grande partie en argent; aussi nous est-il impossible de déterminer même approximativement ce que le fisc romain retirait de l'Egypte. Non seulement les revenus de l'Egypte étaient d'une importance considérable dans l'histoire économique de l'Etat romain; mais en outre on a pris modèle sur l'administration financière de cette province, d'abord pour les territoires domaniaux que l'empereur possédait dans les autres pays, et surtout pour le gouvernement général de l'empire; c'est un fait à signaler pour expliquer l'administration romaine. 1. C'est l'ouvrage appelé l'Epitome de Victor (c. 1), qui nous fournit ces chiffres pour l'époque d'Auguste. Lorsque le produit de cet impôt fut transporté à Constantinople, cette ville recevait annuellement sous Justinien (Ed., 13, c. 8), 8 millions d'artabes ou 26 millions 2/3 de boisseaux romains (Hultsch, Metrol., p. 628); il faut y ajouter la contribution de même nature, instituée par Dioclétien, que l'Egypte fournissait à la ville d'Alexandrie. Le fisc impérial payait annuellement 8,000 solidi aux armateurs qui transportaient le blé à Constantinople. |
||||
30 av J.C.-476 |
Privilèges des HellènesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais, si l'autonomie communale n'existait pas en Egypte, et si à ce point de vue il n'y avait pas de différence réelle entre les deux nations dont se composait cet Etat comme la Syrie, on avait du moins élevé entre elles une barrière, que la Syrie n'a jamais connue. D'après la constitution établie par les conquérants macédoniens, aucun Egyptien de naissance ne pouvait exercer de fonctions publiques ni s'élever dans la carrière militaire. Lorsque le gouvernement accordait quelques faveurs à ses administrés, il les réservait aux habitants des cités grecques1; en revanche, les Egyptiens seuls payaient la capitation, et les Grecs d'Alexandrie étaient exemptés des charges municipales qui pesaient sur les habitants du nome égyptien où ils résidaient2. En cas de délit, le dos de l'Alexandrin était puni comme celui de l'Egyptien; mais le Grec pouvait se vanter, et il se vantait, en effet, d'être bâtonné au lieu d'être fouetté comme l'indigène3. Il était impossible à l'Egyptien d'obtenir le plein droit de cité4. La liste des citoyens des deux grandes villes établies dans la Haute et dans la Basse-Egypte par les deux fondateurs de l'empire, et qui portaient leurs noms, comprenait la population dirigeante; en Egypte, sous les Ptolémées, la possession du droit de cité dans l'une de ces deux villes était la même chose que la possession du droit de cité romaine dans l'empire romain. Aristote avait recommandé à Alexandre d'être pour les Hellènes un chef (iruov) et pour les Barbares un maître, de traiter les uns comme des amis et des compagnons, d'utiliser les autres comme on utilise les animaux et les plantes : les Ptolémées ont complètement suivi ces conseils. Le roi, plus magnanime et plus libéral que son précepteur, eut la pensée plus noble de transformer les Barbares en Hellenes, ou au moins de substituer des cités helléniques aux établissements barbares; presque partout et particulièrement en Syrie, les successeurs d'Alexandre réalisèrent cette idée dans une large mesure5. Il n'en fut pas de même en Egypte. Les maîtres de ce pays cherchèrent à se tenir en contact avec les indigènes particulièrement sur le terrain religieux et voulurent régner, non pas comme Grecs sur les Egyptiens, mais comme dieux terrestres sur leurs sujets, quels qu'ils fussent; cette conception se conciliait fort bien d'ailleurs avec l'inégalité de ces sujets mêmes. C'est ainsi que les avantages accordés en droit et en fait à la noblesse par le roi Frédéric étaient un caractère tout aussi essentiel de son gouvernement que l'uniformité de la justice pour les forts et pour les faibles. 1. Au moins Cléopâtre ordonna d'exclure les Juifs, et à plus forte raison les Egyptiens, d'une distribution de grains qu'elle fit faire à Alexandrie (Josèphe, Contra Ap., II, 5).
2. L'édit d'Alexandre (Corp. insc. graec., 4957, ligne 33 et suiv.) exenopte des ? qui résident pour leurs affaires ? (non ?). 3. Il y a, dit le juif d'Alexandrie Philon (in Flacc., 10), pour les châtiments corporels des différences dans notre ville, suivant la nationalité des coupables : les Egyptiens sont châtiés avec des fouets étrangers et par des étrangers; les Alexandrins sont frappés avec des bâtons (c'est la partie plate de la tige du palmier) et par des gens d'Alexandrie chargés de cette besogne (à peu près bacillarius). Un peu plus loin Philon se plaint amèrement que les Anciens de sa communauté, quand ils doivent être punis, ne le soient pas au moins avec des fouets convenables et dignes de citoyens (?). 4. Josèphe, Contra Ap.. ??, 4 : ?V; 6 : Aegyptiis neque regum quisquam videtur jus civitatis fuisse largitus neque nunc quilibet imperatorum (cf. Eph. epigr., V, p. 13). Il reproche aussi à son adversaire de mépriser sa patrie, lui Egyptien de naissance, et de se faire passer pour un Alexandrin (ibid., II, 3, 4). Il n'en exista pas moins quelques exceptions. 5. Les savants d'Alexandrie ont protesté contre cette idée d'Aristote et ont approuvé le roi (Plutarque, De fort. Alex., 1, 6). Eratosthène disait que la civilisation n'était pas particulière aux seuls Hellènes, qu'on ne pouvait pas la refuser à tous les Barbares, par exemple aux Indiens, aux Ariens, aux Romains, aux Carthaginois; il était beaucoup plus juste de diviser les hommes en bons et en mauvais (Strabon, I, fin, p. 66). |
||||
30 av J.C.-476 |
Privilèges personnels à l'époque romaineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl en fut en Egypte comme dans tout l'Orient où les Romains ne firent guère que continuer l'oeuvre des Grecs; non seulement les Egyptiens indigènes ne purent pas acquérir plus qu'auparavant le droit de cité grecque, mais encore le droit de cité romain leur fut inaccessible. Au contraire le Grec d'Egypte pouvait devenir citoyen romain comme tout autre sujet de l'empire. Il est vrai que l'entrée du sénat ne lui fut pas moins refusée qu'au citoyen romain de Gaule; et même le gouvernement maintint cette mesure pour l'Egypte plus longtemps que pour la Gaule1 : c'est seulement au commencement du troisième siècle que l'on admit quelques exceptions isolées, mais la règle était encore générale au cinquième siècle. Dans l'Egypte même, les hautes dignités, c'est-à-dire celles qui embrassaient toute la province, ainsi que les fonctions militaires étaient réservées aux citoyens romains, puisqu'il fallait être chevalier pour les exercer; c'était une conséquence de l'organisation générale de l'empire, et, sous les premiers Lagides, les Macédoniens avaient joui en Egypte de privilèges analogues, à l'exclusion des autres Grecs. Sous la domination romaine les fonctions de second ordre restèrent comme auparavant interdites aux Egyptiens nés en Egypte; elles furent données à des Grecs et principalement aux citoyens d'Alexandrie et de Ptolemaïs. Pour entrer au service de l'empire dans les troupes de première classe, il fallait être citoyen romain; cependant les légions cantonnées en Egypte se recrutèrent souvent de Grecs Egyptiens, auxquels on accordait le droit de cité romaine lors de la conscription. Les Grecs purent servir, sans aucune espèce de restriction, dans les troupes auxiliaires; les Egyptiens n'y furent admis que très peu ou pas du tout; on les versait au contraire en nombre considérable dans la dernière classe, formée par les troupes de la flotte, qui se composaient encore d'esclaves sous les premiers empereurs. Avec le temps la situation des Egyptiens indigènes s'améliora; ils obtinrent souvent le droit de cité grecque, et par là ils purent devenir citoyens romains; mais en somme le gouvernement romain ne fit que continuer l'oeuvre des Grecs et imiter leur exclusivisme. Les Macédoniens s'étaient contentés de fonder Alexandrie et Ptolemaïs; les Romains n'établirent même pas dans cette province une seule colonie2 1. Il était même au moins très difficile d'obtenir les dignités équestres : non est ex albo judex patre Aegyptio (Corp. insc. lat., IV, 193; cf. Staatsrecht, II, p. 919, note 2; Eph. epigr., V, p. 13, note 2). Cependant on rencontre de bonne heure quelques Alexandrins exerçant des fonctions équestres, comme Tiberius Julius Alexander. 2. Si les expressions de Pline (Hist. nat., V, 31, 128) sont exactes, l'île de Pharos, située en avant du port d'Alexandrie, était une colonia Caesaris diclatoris. Le dictateur fut, comme Alexandre, plus libéral qu'Aristote. Mais ce qui est certain, c'est qu'après l'annexion de l'Egypte à l'empire, il n'y eut jamais dans ce pays de fondation de colonie romaine. |
||||
Devenez membre de Roma LatinaInscrivez-vous gratuitement et bénéficiez du synopsis, le résumé du portail, très pratique et utile; l'accès au forum qui vous permettra d'échanger avec des passionnés comme vous de l'histoire latine, des cours de latin et enfin à la boutique du portail ! 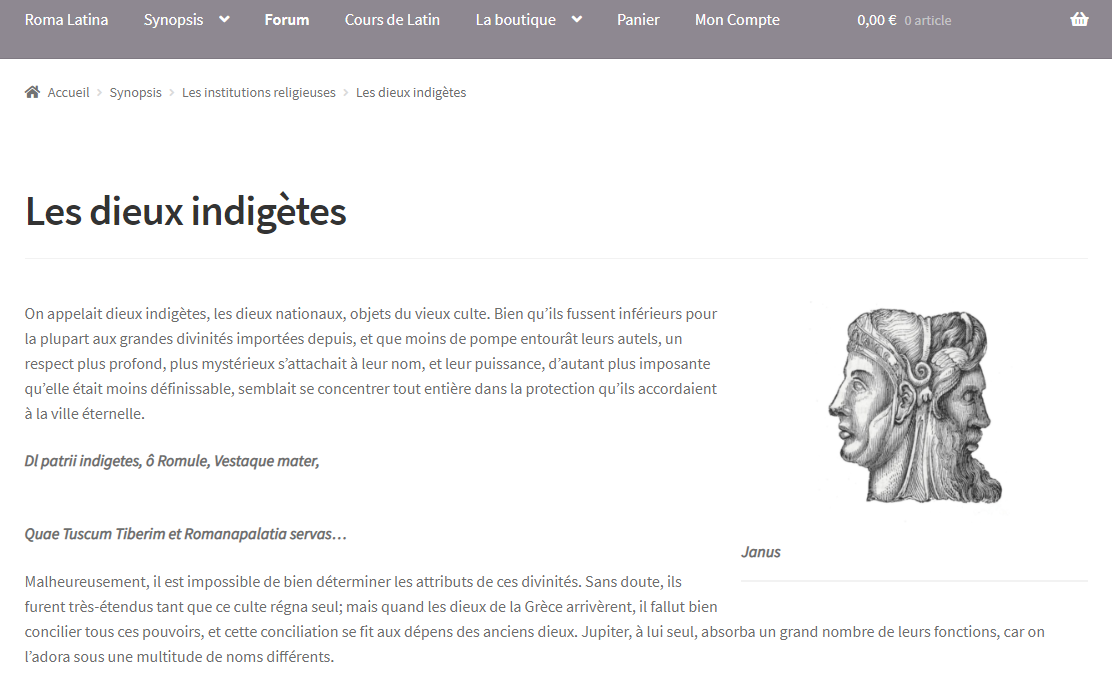 |
|||||
30 av J.C.-476 |
La langueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes relations de la langue indigène et des idiomes étrangers en Egypte restèrent sous les Romains ce qu'elles avaient été sous les Ptolémées. Abstraction faite du monde militaire, où le latin seul était parlé, la haute société employait le grec comme langue courante. Quant à l'idiome indigène, aussi radicalement différent des langues sémitiques que des langues ariennes, mais apparenté peut-être de très près à l'idiome des Berbères de l'Afrique septentrionale, il ne servit pas plus que l'écriture du pays aux maîtres et aux gouverneurs romains; déjà sous les Ptolémées il fallait ajouter une traduction grecque aux actes officiels écrits en égyptien; cette mesure ne fut pas moins nécessaire au temps de la domination romaine. Mais on permit toujours aux Egyptiens de se servir de la langue indigène et de l'antique écriture hiératique, lorsqu'elles étaient exigées par le rituel ou même toutes les fois qu'il leur semblait bon de les employer; on dut même, dans cette première patrie de l'écriture, admettre la langue indigène, qui seule était connue du grand public, et les caractères ordinaires, non seulement pour les contrats privés, mais encore pour les quittances d'impôt et pour d'autres pièces semblables. Mais ce n'était là qu'une concession, et l'hellénisme vainqueur s'efforça toujours d'étendre son empire. On tenta de donner aux idées et aux traditions qui régnaient dans le pays une expression grecque, qui fût comprise de tout le monde; aussi les doubles noms ont-ils été plus abondants en Egypte que partout ailleurs. Tous les dieux égyptiens, ceux même dont le nom n'était pas très connu des Grecs, comme Isis, furent assimilés à des divinités helléniques qui leur correspondaient plus ou moins; une foule de personnes, et peut-être la moitié des villages portent à la fois un nom grec et un nom indigène. La civilisation hellénique pénétrait ainsi peu à peu en Egypte. Sur les monuments que nous avons conservés, l'ancienne écriture hiératique se rencontre pour la dernière fois à l'époque de l'empereur Dèce, vers le milieu du troisième siècle, et les caractères démotiques se conservent jusqu'au milieu du cinquième : mais tous deux avaient disparu depuis de longues années de l'usage courant. C'est là le signe qui indique l'abandon et la chute des éléments indigènes de civilisation. La langue du pays survécut longtemps encore dans les localités écartées et dans les couches inférieures; elle ne disparut complètement qu'au dix-septième siècle; c'est que, lorsque le christianisme s'était répandu en Egypte, on avait essayé de créer une littérature chrétienne populaire, et la langue des Coptes, comme celle de Syrie, avait été ainsi, dans une certaine mesure, régénérée pendant le bas empire. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Abolition de tout l'appareil royalRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe qu'il faut signaler avant tout dans le gouvernement de l'Egypte, c'est la disparition de la cour et de l'appareil royal, conséquence nécessaire de l'annexion du pays par Auguste. Il en resta ce qui pouvait en rester. Sur les inscriptions écrites en langue indigène, et par conséquent pour les Egyptiens seuls, les empereurs sont appelés, comme les Ptolémées, rois de la Haute et de la Basse-Egypte, élus des divinités nationales du pays; on leur donne de plus, ce qui ne s'était pas vu sous les Ptolémées, le titre de Grands-Rois1. On continua à se servir en Egypte de l'ancien calendrier du pays, et à compter par années royales, mais en prenant pour base les années de règne des empereurs romains; la coupe d'or, que le roi jetait autrefois dans le Nil grossi, au mois de juin de chaque année, fut dès lors jetée par le vice-roi romain. Ce fut tout ce qu'on conserva; l'empereur de Rome ne pouvait pas jouer le rôle d'un roi d'Egypte, incompatible avec la situation qu'il occupait dans l'empire. Le nouveau maître du pays, qui avait délégué son autorité à un subordonné, fit une expérience fâcheuse avec le premier gouverneur qu'il envoya en Egypte. Cet officier habile et ce poète de talent ne put pas s'empêcher de faire graver son nom sur les Pyramides; il fut destitué, et sa carrière fut brisée. Il fallait élever une barrière à de semblables ambitions. Le gouverneur romain pouvait expédier, comme le roi indigène, les affaires qui relevaient personnellement du prince2 dans le système d'Alexandre comme dans l'organisation du principat romain: mais il ne pouvait ni être, ni paraître un roi3. Le coup produisit certainement une impression vive et pénible dans la seconde ville du monde. Le changement de dynastie seul n'aurait pas eu une importance aussi grande; ce qui était grave, c'était de voir disparaître une cour comme celle des Ptolémées, organisée d'après le cérémonial des Pharaons, un roi et une reine qui ne se montraient que dans un appareil divin, la pompe des fêtes, la réception des prêtres et des ambassades, les banquets royaux, les grandes cérémonies du couronnement, de la prestation du serment, du mariage, des funérailles, l'appareil honorifique des gardes du corps, du chef des gardes du corps, du chambellan charge des introductions, de l'écuyer tranchant, du grand-maître de la vénerie, des parents et des amis du roi, les décorations. Or tout cela fut à jamais perdu pour les Alexandrins, lorsque leurs maîtres habitèrent sur le Tibre et non sur le Nil. Seules, les deux bibliothèques célèbres d'Alexandrie avec toutes leurs dépendances et leur personnel restèrent, pour témoigner de l'ancienne munificence royale. Sans aucun doute, l'Egypte se ressentit beaucoup plus vivement de la chute de ses rois que la Syrie; mais les deux peuples étaient si impuissants, qu'ils durent accepter toutes les volontés du vainqueur; aucun d'eux ne songea à se révolter pour reconquérir la domination universelle qu'il avait perdue. 1. Voici les titres que les prêtres égyptiens donnaient à Auguste : Bel enfant, aimable et digne d'être aimé, Roi des Rois, choisi par Ptah et par Noun le père des Dieux, roi de la Haute-Egypte et roi de la Basse-Egypte, maître des deux pays, Autocrator, fils du soleil, maître du diadème, César, éternel, aimé de Ptah et d'Isis.Les deux noms propres Autocrator et César sont empruntés au grec. Le titre d'Auguste apparait pour la première fois sous Tibère dans la traduction égyptienne; on le rencontre sous Domitien avec le mot grec Lebastos. Le titre de bel enfant aimable, qui n'était donné auparavant qu'aux fils de rois que l'on déclarait co-régents, devint plus tard une expression stéréotype, et fut appliqué à Césarion et à Auguste, comme à Tibère, à Claude, à Titus, à Domitien. Ce qui est plus important, c'est qu'à partir d'Auguste les empereurs portèrent le titre de Roi des Rois, qui n'avait pas été donné aux Ptolémées, et qui ne se trouve pas dans l'inscription grecque de Rosette (Corp. insc. graec., 4697); on voulait sans doute indiquer par là que les rois antérieurs de l'Egypte n'avaient pas eu la puissance des Grands-Rois. 2. Le roi Séleucus avait l'habitude de dire (Plutarque, An seni, etc., 11): Si les hommes savaient combien il est ennuyeux d'écrire et de lire tant de lettres, ils ne se baisseraient pas pour prendre un diadème mis à leur pied. 3. On ne peut guère conclure de la vie d'Hadrien (c. 4) que ce fonctionnaire ait eu d'autres marques distinctives que les officiers (Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, p. 271). |
||||
|
|
|||||
30 av. J.C.-476 |
Les fonctionnairesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'administration du pays est, comme nous l'avons déjà dit, entre les mains du représentant, c'est-à-dire du vice-roi; car, bien que le nouveau maître du pays, tenant compte de la situation qu'il occupait dans l'empire, se soit bien gardé de prendre pour lui et pour ses principaux lieutenants en Egypte des titres royaux, il n'en a pas moins gouverné ce pays comme successeur des Ptolémées, et réuni dans sa main et dans celle de son représentant toute l'autorité civile et militaire. Nous avons déjà fait remarquer que le gouverneur de l'Egypte ne devait être ni un non-citoyen, ni un sénateur; cette dignité fut parfois conférée à des Alexandrins qui avaient obtenu le droit de cité et qui étaient entrés par exception dans l'ordre équestre1. D'ailleurs, parmi toutes les fonctions réservées à ceux qui n'étaient pas sénateurs, le gouvernement de l'Egypte l'emporta d'abord pour le rang et pour l'influence; plus tard il céda la place au commandement de la garde prétorienne, mais à lui seul. Aucun des officiers envoyés en Egypte n'était sénateur et les commandants de légions portaient un titre moins élevé que dans les autres provinces (praefectus au lieu de legatus); c'étaient les seules anomalies qui existassent dans l'organisation militaire de l'Egypte. Auprès et au-dessous du gouverneur se trouvaient un fonctionnaire suprême pour la justice et un administrateur général des finances, dont la compétence embrassait également toute l'Egypte: tous deux étaient citoyens romains de rang équestre. Il ne semble pas qu'on ait emprunté ces deux rouages administratifs au système des Ptolémées; on avait adjoint et subordonné ces personnages au gouverneur, comme on le faisait dans plusieurs provinces impériales2. Tous les autres fonctionnaires n'ont d'autorité que dans un seul district et rappellent pour la plupart l'organisation des Ptolémées. Les gouverneurs des trois provinces de Basse, Moyenne et Haute-Egypte, dont la compétence s'étend aux mêmes questions que celle du gouverneur général, abstraction faite du commandement militaire, furent pris sous Auguste parmi les Grecs d'Egypte, et plus tard, comme les hauts fonctionnaires proprement dits, parmi les chevaliers romains; c'est là un symptôme remarquable, qui nous indique comment, pendant le courant de l'empire, on chercha de plus en plus à chasser l'élément indigène de l'administration. Au-dessous de ces autorités supérieures et moyennes on rencontre les fonctionnaires locaux, les chefs des villes égyptiennes et des cités grecques, puis les subalternes très nombreux qui s'occupaient du recrutement et des impôts de toute nature prélevés sur le commerce, enfin dans chaque district les chefs des sous-districts et des villages, toutes dignités que l'on considérait plutôt comme des charges que comme des honneurs, et que les pouvoirs supérieurs imposaient aux Egyptiens nés ou résidant dans chaque localité, sauf toutefois les Alexandrins. Le plus important de ces fonctionnaires, le gouverneur du nome, est nommé par le gouverneur général pour trois ans. Les autorités locales des cités grecques étaient différentes par leur nombre et par leur titre; Alexandrie par exemple était gouvernée par quatre hauts fonctionnaires, le prêtre d'Alexandre3, le secrétaire municipal4, le juge suprême et le chef des gardes de nuit. Ils étaient plus considérés que les stratèges des nomes, cela va de soi; l'habit de pourpre que portait le premier magistrat d'Alexandrie en est une preuve. Ils datent d'ailleurs de l'époque des Ptolemées, et, comme les gouverneurs des nomes, ils sont nommés pour un temps déterminé par le gouvernement romain, qui les choisit parmi les habitants de la ville. Au-dessous de ces gouverneurs de cités, ne se trouve aucun fonctionnaire romain nommé par l'empereur. Mais le prêtre du Museum, qui est en même temps président de l'Académie des sciences d'Alexandrie, et qui administre les finances considérables de cette compagnie, est nommé par le souverain. De même la surveillance du tombeau d'Alexandre, l'entretien de certaines constructions qui en dépendent, et quelques autres dignités importantes de la capitale de l'Egypte sont confiés par le gouvernement romain à des fonctionnaires de rang équestre5. 1. Ainsi Tiberius Julius Alexander, un Juif d'Alexandrie, exerça cette fonction pendant les dernières années du règne de Néron; mais ce juif appartenait à une famille très riche, très puissante, et même apparentée à la maison impériale; il s'était distingué pendant la guerre contre les Parthes comme chef d'état-major général de Corbulon, et, quelques années plus tard, il avait occupé le même poste auprès de Titus dans la guerre de Judée. Ce dut être l'un des officiers les plus remarquables de son temps. C'est à lui qu'est dédié l'ouvrage pseudo-aristotélicien tepi zoouoU, écrit certainement par un autre juif d'Alexandrie (Bernays, Ges. Abhandl., II, p. 278). 2. Sans aucun doute le juridicus Aegypti (Corp. insc. lal., X, 6976; appelé aussi missus in Aegyptum ad jurisdictionem, Bull. dell' Inst., 1856, p. 142; juridicus Alexandreae, Corp. insc. lat., VI, 1564; VIII, 8925. 8934; Dig., I, 20, 2) et le idiologus ad Aegyptum (Corp. insc. lat., X, 4862; procurator ducenarius Alexandriae idiulogu, Eph. epig., V, p. 30, et Corp. insc. graec., 3751; . ibid., 4957, 1. 44, cf. I. 39) ont été créés sur le modèle des fonctionnaires adjoints aux légats des provinces impériales pour rendre la justice (legati juridici) et pour administrer les finances (pro. curatores provinciae) (Staatsrecht, 2e edit., p. 223, note 5). Strabon (XVII, 1, 12, p. 797) nous dit expressément qu'ils embrassaient la province tout entière et qu'ils étaient soumis au praefectus Aegypti, d'ailleurs le mot d'Egypte apparait souvent dans leurs titres, et c'est ainsi qu'ils sont désignés dans l'édit qui se lit au Corpus inscriptionum graecarum, 4957, 1. 39). Mais leur compétence n'était pas exclusive. Beaucoup de procès, dit Strabon, sont tranchés par le fonctionnaire qui rend la justice (le Digeste, I, 20, 2, nous apprend que ce fonctionnaire nominait les tuteurs); d'après le même auteur l'Idiologus décidait s'il fallait ou non rattacher au fisc les bona vacantia et caduca. Mais cela ne prouve pas que le juridicus romain n'ait pas remplacé l'ancien tribunal des trente, dirigé par l'ap? (Diodore, I, 75), qui est égyptien, qu'il ne faut pas confondre avec l'doyoraots d'Alexandrie, et qui d'ailleurs avait peut-être disparu avant l'époque romaine; il se peut aussi que l'idiologus ait été nommé pour représenter un certain droit que les rois d'Egypte avaient sur les héritages, et qui n'existait pas dans de telles proportions en d'autres contes de l'empire. Lumbroso (Recherches, p. 285) a rendu cette dernière hypothèse très vraisemblable. 3. L'énynths, qui d'après Strabon (XVII, 1, 12, p. 797) était le premier fonctionnaire municipal d'Alexandrie sous les Ptolémées comme sous les Romains, et qui avait le droit de porter la pourpre, est certainement identique au prêtre annuel du testament d'Alexandre cité dans le roman d'Alexandre, qui est très bien informé en pareille matière (III, 33, p. 149, ed. Muller). L'exégète, outre son titre qu'il faut interpréter dans le sens religieux, a encore ?; de même ce prêtre du roman est?. L'auteur du roman n'a pas inventé plus que la pourpre et la couronne d'or, les appointements d'un talent qu'il attribue à cette fonction et l'hérédité; ce dernier caractère, à propos duquel Lumbroso (L'Egillo al tempo dei Greci e Romani, p. 157) rappelle l'enynors tvapxos des inscriptions d'Alexandrie (Corp. insc. graec., 4688, 4976'), signifie probablement qu'un certain nombre de personnes pouvaient être appelées à cette haute fonction par droit héréditaire, et que le gouverneur choisissait le prêtre annuel parmi ces candidats. Ce prêtre d'Alexandre (qui fut aussi le prêtre des rois d'Egypte postérieurs, d'après la pierre de Canope et d'après celle de Rosette, Corp. insc. graec., 4697) était, sous les premiers Lagides, magistrat éponyme pour les actes d'Alexandrie, tandis que, sous les derniers princes de cette dynastie et sous les Romains, c'est le nom du roi que nous trouvons sur les documents officiels. Il n'est sans doute pas distinct du grand-prêtre d'Alexandrie et de toute l'Egypte, signalé par une inscription de Rome au temps d'Hadrien (Corp. insc. graec., 5900): ). Le titre spécial d'estiro tris est évité en dehors de l'Egypte, parce qu'il désigne habituellement le sacristain. Il semble, d'après la teneur de cette inscription, que la dignité de grand-prêtre fut viagère; nous retrouvons donc encore ici, à propos des sacerdoces provinciaux, la transformation bien connue des fonctions annuelles en fonctions viagères au moins par le titre, et souvent dans la réalité. Il est vrai que le prêtre d'Alexandrie n'était pas un prêtre de province, mais il en tenait la place en Egypte. Cette même inscription nous prouve que la prêtrise et la direction du Museum étaient deux charges distinctes. C'est ce que nous apprend aussi l'inscription d'un grand médecin royal, du temps des premiers Lagides, qui fut à la fois exegete et directeur du Museum (?). Mais les deux documents nous indiquent aussi que la première dignité municipale d'Alexandrie et la direction du Museum étaient souvent confiées au même homme, quoique à l'époque romaine l'une fût conférée par le préfet, l'autre par l'empereur. 4. Il ne faut pas confondre cette dignité avec la fonction de même nature, que Philon cite (in Flacc., 16) et que Lucien exerça (Apolog., 12); cette fonction n'est pas une charge municipale, c'est un emploi subalterne près la préfecture d'Egypte, en latin a commentariis ou ab actis. 5. C'est le procurator Neaspoleos et mausolei Alexandriae (Corp. insc. lat., VIII, 8934; Henzen, 6929). Le procurator ad Mercurium Alexandriae (Corp. insc. lat., X, 3847) et le procurator Alexandreae Pelusii (ibid., VI, 1624) sont des fonctionnaires de même nature et de même rang, mais dont nous ne connaissons pas exactement la compétence. De même le Phare est sous la direction d'un affranchi de l'empereur (ibid., VI, 8582). |
||||
270-305 |
Révoltes au temps de la guerre de Palmyre et sous DioclétienRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Grecs d'Alexandrie et les Egyptiens ont naturellement été entraînés dans toutes les révoltes que les prétendants à l'empire provoquèrent en Orient; ils ont régulièrement pris part à tous ces mouvements; c'est ainsi qu'ils ont proclamé empereurs Vespasien, Cassius, Niger, Macrien, Vaballathus, fils de Zénobie, et Probus. Mais, dans aucune de ces circonstances, l'initiative ne fut prise par les citoyens d'Alexandrie ni par les troupes d'Egypte, peu considérables, et la plupart de ces révolutions, même celles qui échouèrent, n'ont pas eu pour l'Egypte de conséquences vraiment sensibles. Au contraire le soulèvement, que rappelle le nom de Zénobie, a été pour Alexandrie et pour l'Egypte tout entière presque aussi funeste que pour Palmyre. Les partisans de la reine et ceux des Romains luttaient dans les villes et dans les campagnes, les armes et la torche à la main. La frontière du Sud avait été violée par le peuple barbare des Blémyes, alliés, semble-t-il, avec les habitants de l'Egypte qui soutenaient la reine de Palmyre et une grande partie de la Haute-Egypte était déjà tombée entre leurs mains1. Dans Alexandrie toute relation était rompue entre les deux quartiers ennemis; la transmission des lettres était difficile et même dangereuse2. Les rues étaient remplies de sang et de cadavres sans sépulture. Les épidémies qui s'étaient développées sévissaient plus cruellement encore que la guerre, et, pour qu'aucun des quatre coursiers destructeurs ne manquât, le Nil lui-même refusa de grossir, et la famine se joignit aux autres fléaux. La population fut tellement décimée que, suivant un contemporain, le nombre des citoyens d'Alexandrie fut désormais inférieur à celui des vieillards que la cité contenait auparavant. Lorsque le général envoyé par Claude, Probus, eut enfin triomphé de l'émeute, les partisans de Zénobie, et parmi eux la majorité des membres du conseil, se jetèrent dans la forteresse de Prucheion, très voisine de la ville: lorsque Probus eut promis la vie sauve à tous ceux qui se rendraient, le plus grand nombre des rebelles se soumit, mais une partie considérable de la garnison s'obstina jusqu'à la dernière extrémité dans une lutte désespérée. La forteresse succomba enfin à la famine (année 270); elle fut rasée, et depuis lors abandonnée; les remparts d'Alexandrie furent détruits. Les Blémyes restèrent encore dans le pays pendant plusieurs années; c'est l'empereur Probus qui, le premier, leur enleva de nouveau Ptolemaïs et Koptos, et les chassa de la province. Il se peut que la détresse, causée par ces troubles qui s'étaient prolongés pendant plusieurs années, ait provoqué la seule révolution née certainement en Egypte même3. Sous le règne de Dioclétien, les Egyptiens indigènes et les citoyens se révoltèrent contre le gouvernement de cet empereur, nous ne savons pour quelle cause ni dans quelle intention. Lucius Domitius Domitianus et Achilleus furent proclamés Césars, si toutefois ces deux noms ne désignent pas une seule et même personne. L'émeute dura trois ou quatre ans; Busiris, dans le Delta, et Koptos, non loin de Thèbes, furent détruites par les troupes impériales; enfin, au printemps de 297, une armée commandée par Dioclétien lui-même s'empara d'Alexandrie après un siège de huit mois. Cette province riche, mais à laquelle était nécessaire la paix intérieure et extérieure, fut complètement ruinée; rien ne le prouve plus clairement que l'ordonnance rendue par l'empereur Dioclétien en l'an 302 : elle établit qu'une partie du blé que l'on envoyait autrefois à Rome sera réservée dès lors aux habitants d'Alexandrie4. C'est aussi là, sans doute, une des mesures qui furent prises pour enlever à Rome son rang de capitale; mais l'empereur n'avait aucune raison pour favoriser les Alexandrins, et ce blé ne leur eût certes pas été donné, s'ils n'en avaient eu absolument besoin. 1. C'est la biographie de Firmus (c. 3) qui nous apprend que les partisans de Palmyre firent alliance avec les Blèmyes, et que, d'après Zosime (I, 71), Ptolemaïs fit défection pour se livrer à ces Barbares (cf. Eusebe, Hist. eccl., VII, 32). Aurélien ne fit que traiter avec eux (Vila, 34, 41); Probus est le premier qui les ait chassés de l'Egypte (Zosime, loc. cit.; Vita Probi, 17). 2. Nous possédons encore quelques-unes de ces lettres envoyées par Dionysios, alors évêque d'Alexandrie (+ 265), à des coreligionnaires enfermés dans la partie ennemie de la ville (Eusèbe, Hist. eccles., VII, 21, 22, cf. 32). On y lit: Il est plus difficile d'aller d'un quartier d'Alexandrie à l'autre, que d'Orient en Occident; c'est-à-dire la rue ornée de portiques qui traverse la ville depuis la pointe de Lochias (cf. Lumbroso, l'Egitto al tempo dei Greci e Romani, 1882, p. 137) est comparée au désert qui s'étend entre l'Egypte et la Terre Sainte. Il semblerait donc que Sévère Antonin ait bâti un mur à travers toute la ville et l'ait militairement occupé, comme il en avait menacé les Alexandrins (Dion, LXXVII, 23). On pourrait rapprocher de cette construction la destruction des murs après la défaite des révoltés (Ammien. XXII, 16, 15). 3. La prétendue existence de tyrans égyptiens, AEmilianus, Firmus, Saturninus, au moins en tant que tyrans, est incertaine. L'ouvrage appelé Biographie de Firmus n'est que le récit défiguré de la chute du Prucheion. 4. Chr. Pasch., p. 414; Procope, Hist. arc., 26; Godefroy, ad Cod. Theod., XIV, 26, 2. Il y avait auparavant à Alexandrie des distributions permanentes de blé, mais, semble-t-il, uniquement pour les vieillards pauvres; elles étaient faites au compte de la ville et non de l'Etat (Eusèbe, Hist. eccl., VII, 21). |
||||
|
|
|||||
30 av. J.C.-476 |
AgricultureRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'Egypte, comme on le sait, est un pays agricole par excellence. La Terre Noire - telle est la signification du nom de chemi que le pays porte dans la langue indigène - n'est qu'une double bande assez étroite, allongée sur les deux rives du Nil, ce fleuve puissant, qui depuis la dernière cataracte de Syène, à la frontière méridionale de l'Egypte proprement dite, coule jusqu'à la mer Méditerranée à travers une plaine large au plus de cent vingt milles, bornée à droite et à gauche par le désert jaunâtre; c'est seulement à son extrémité que le présent du fleuve s'élargissant, le delta du Nil s'étend des deux côtés entre les bras divers de son embouchure. La récolte de ce pays dépend chaque année du Nil et des seize coudées de sa crue, des seize enfants qui jouent autour de leur père, suivant la conception artistique des Grecs; c'est avec raison que les Arabes donnent aux coudées qui manquent pour parfaire ce nombre, le nom d'anges de la mort; car si le fleuve n'atteint pas la hauteur voulue, c'est pour toute l'Egypte la faim et la ruine. En Egypte, où les frais de labourage sont infimes, le blé rend au centuple; la culture des légumes, de la vigne, des arbres fruitiers, et surtout du dattier, l'élève des troupeaux rapportent beaucoup; aussi le pays peut-il non seulement nourrir une population très dense, mais encore exporter une très grande quantité de céréales. Il resta bien peu de toutes ces richesses dans le pays lui-même après l'établissement de la domination étrangère. Comme au temps des Perses et comme de nos jours, c'était pour les étrangers que le Nil débordait et que les Egytiens travaillaient; aussi l'Egypte a-t-elle joué un rôle important dans l'histoire de la Rome impériale. Lorsque la culture du blé eut été abandonnée en Italie, et lorsque Rome fut devenue la plus grande ville du monde, elle dut être alimentée continuellement par le blé d'outre-mer; c'est en résolvant le difficile problème économique, qui consistait à rendre possible et à assurer l'alimentation de la capitale que le Principat s'est établi solidement. Or, pour résoudre ce problème, il fallait posséder l'Egypte, et il fallait que l'empereur y fût maître absolu, parce qu'il faisait échec, en occupant cette province, à l'Italie et à ses dépendances. Lorsque Vespasien s'empara de l'empire, il envoya ses troupes en Italie, mais il se dirigea lui-même vers l'Egypte et se rendit maître de Rome en arrêtant les transports de grains. Toutes les fois qu'un empereur romain songea ou dut songer à transporter en Orient le siège de son gouvernement, comme on nous le raconte de César, d'Antoine, de Néron, de Géta, sa pensée se fixa d'elle-même non pas sur Antioche, quoique cette ville fut la résidence ordinaire des gouverneurs de l'Orient, mais sur Alexandrie, où l'empire était né, et qui en restait la place forte. Aussi le gouvernement romain s'est-il occupé des progrès de l'agriculture en Egypte plus que partout ailleurs. Comme la prospérité du pays dépend des débordements du Nil, il était possible d'agrandir dans de vastes proportions la surface propre à l'agriculture, en construisant tout un système de canaux, de digues et de réservoirs artificiels. On avait fait beaucoup dans ce sens, pendant les périodes heureuses qu'avait traversées l'Egypte, cette patrie de l'arpentage et des ouvrages d'art; mais ces constructions bienfaisantes avaient malheureusement été détruites pendant les derniers gouvernements misérables et toujours ruinés. Les Romains prirent dignement possession de la contrée: Auguste ordonna aux troupes cantonnées en Egypte de curer à fond et de réparer les canaux du Nil. Lorsque la province fut conquise par Rome, il fallait que le fleuve atteignit une hauteur de quatorze coudées, pour que la récolte fût bonne; lorsqu'il ne dépassait pas huit coudées, l'année était mauvaise; plus tard, après la reconstruction des canaux, une hauteur de douze coudées suffisait pour donner une récolte excellente, et, si le fleuve n'atteignait que huit coudées, l'année était encore passable. Quelques siècles plus tard l'empereur Probus non seulement délivra l'Egypte des Ethiopiens, mais encore il s'occupa de réparer les constructions hydrauliques de la vallée du Nil. Il faut d'ailleurs reconnaître que les meilleurs successeurs d'Auguste administrèrent cette province dans le même sens, et comme elle jouit pendant plusieurs siècles d'une paix et d'une sécurité intérieures, qui furent à peine interrompues, l'agriculture égyptienne n'a jamais été aussi prospère que sous l'empire romain. Nous ne pouvons pas déterminer avec précision quelle influence ces événements ont eue sur les Egyptiens eux-mêmes. Les revenus de l'Egypte provenaient en grande partie des domaines impériaux, qui formaient sous les Romains, comme aux époques antérieures, une partie considérable du territoire arable1; sur ces terres, pour lesquelles les frais de labourage étaient peu considérables, on ne dut laisser aux petits fermiers qui les cultivaient qu'une faible partie de la récolte, ou bien on exigea d'eux un fort loyer en argent. D'autre part les propriétés nombreuses et généralement petites durent payer un lourd impôt foncier en nature ou en espèces. La population agricole, frugale comme elle était, resta très dense à l'époque impériale; mais les impôts, soit en eux-mêmes, soit à cause de l'exportation du blé, pesèrent plus lourdement sur l'Egypte à l'époque de la domination romaine que sous le gouvernement des Lagides, qui cependant ne ménageaient guère leurs sujets. 1. Dans la ville d'Alexandrie il semble qu'il n'y ait pas eu de propriété foncière proprement dite, mais seulement une espèce de location héréditaire (Ammien, XXII, 11, 6; cf. Staatsrecht, II, p. 963, note 1); dans le reste de la province la propriété privée du sol existait, comme le droit provincial la connaissait partout. Il est souvent question des terres domaniales; par exemple Strabon (XVII, 1, 51, p. 828) nous dit que les meilleures dattes d'Egypte venaient dans une île où les particuliers ne pouvaient posséder aucune propriété, mais qui avait été auparavant terre royale, qui était alors terre impériale, et qui rapportait beaucoup. Vespasien vendit une partie des terres du domaine égyptien, ce qui exaspéra les Alexandrins (Dion, LXVI, 8), sans doute les gros fermiers qui sous-louaient le pays aux véritables cultivateurs. On peut mettre en doute que les propriétés de mainmorte, possédées surtout par des collèges de prêtres, aient été aussi étendues à l'époque romaine qu'auparavant; on ne sait pas non plus si c'était la grande ou la petite culture qui dominait. A coup sûr, les petites fermes étaient très nombreuses dans le pays. Nous n'avons de chiffres ni pour la quotité de l'impôt domanial ni pour celle de l'impôt foncier. Lumbroso (Recherches, p. 94) a remarqué avec raison que dans Orose (I, 8, 9) tout le passage où il est question de la cinquième partie des fruits de la terre, y compris les mots usque ad nunc, est copié de la Genèse. La rente domaniale ne pouvait pas être inférieure à la moitié, et l'impôt foncier devait être au moins équivalent au dixième (Lumbroso, op. cit., p. 289, 293). Dans la suite, l'exportation des blés égyptiens ne put se faire sans le consentement du gouverneur (Hirschfeld, Annona, p. 23); on craignait sans doute qu'une disette ne se produisit trop facilement dans ce pays si peuplé. Mais cette mesure établissait certainement un contrôle plutôt qu'une prohibition; dans le Périple, écrit par un Egyptien, le grain est cité plusieurs fois parmi les articles d'exportation (ch. 7, 17, 24, 28, cf. 56). Il semble que l'ensemencement des terres ait été de même contrôlé; les Egyptiens, dit un auteur, cultivent des navets plus volontiers que du blé, lorsqu'ils le peuvent, parce qu'ils en retirent de l'huile. (Pline, Hist. nat., XIX, 5, 79). |
||||
30 av. J.C.-476 |
IndustrieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'agriculture ne constituait qu'une partie des richesses économiques de l'Egypte; si le pays était, sous ce rapport, supérieur à la Syrie, il ne l'était pas moins, pour l'industrie et le commerce, à la province d'Afrique essentiellement agricole. Les filatures d'Egypte étaient au moins aussi anciennes, aussi prospères et aussi célèbres que celles de Syrie; et quoique, à cette époque, les toiles les plus fines fussent fabriquées en Syrie et en Phénicie1, l'industrie du lin a cependant subsisté en Egypte pendant tout l'empire. Lorsque, sur l'ordre d'Aurélien, l'Egypte dut fournir à la capitale du monde romain d'autres produits que le blé, la liste comprit la toile de lin et l'étoupe. Pour les verreries fines les Alexandrins conservèrent certainement le premier rang, aussi bien dans la coloration que dans la forme; ils en avaient même le monopole, comme ils le croyaient, parce que plusieurs des produits de qualité supérieure ne pouvaient être fabriqués qu'avec des matières premières d'Egypte. Quant à l'industrie du papyrus, il est incontestable qu'elle régnait exclusivement dans ce pays. Cette plante, qui fut cultivée en grande quantité dans l'antiquité sur les fleuves et les lacs de la Basse-Egypte, et qui ne venait bien dans aucune autre région, fournissait aux indigènes un aliment et des matières premières pour la corderie, la vannerie et la fabrication des barques; elle donnait de quoi écrire à tous les hommes qui écrivaient, dans le monde entier. Les mesures que le sénat romain prit, en un moment où le papyrus devint rare et menaça de manquer sur la place de Rome, nous permettent de calculer tout ce que la culture de cette plante a dû rapporter; et, comme on ne pouvait exécuter que sur place le travail pénible de sa préparation, un très grand nombre d'Egyptiens vécurent probablement de cette industrie. Aurélien ajouta le verre et le papyrus1 au lin sur le catalogue des marchandises qu'Alexandrie devait fournir à la capitale de l'empire. Le commerce de l'Egypte avec l'Orient, en modifiant l'offre et la demande, doit avoir influé sur l'industrie égyptienne. On fabriquait des tissus, pour les exporter en Orient, et l'on s'inspirait des usages locaux : les vêtements ordinaires des habitants d'Habech étaient de fabrication égyptienne; dans les Indes et en Arabie on envoyait de magnifiques étoffes, faites de mille couleurs et brodées d'or à Alexandrie par de véritables artistes. De même les verroteries d'Egypte jouaient, comme aujourd'hui, un rôle important dans le commerce de la côte africaine. Les Indiens tiraient de la province soit des coupes de verre, soit du verre non travaillé pour leur industrie particulière; même à la cour de Chine les vases de verre, dont les étrangers romains faisaient hommage à l'empereur, doivent avoir excité une grande admiration. Des négociants égyptiens portaient au roi des Axomites (Habech), comme présents annuels, des vases d'or et d'argent fabriqués pour servir aux usages de ce pays; aux rois plus civilisés des côtes de l'Inde et de l'Arabie méridionale ils donnaient, entre autres cadeaux, des statues, même de bronze, et des instruments de musique. Au contraire, les matières premières nécessaires aux industries de luxe, qui venaient de l'Orient, par exemple l'ivoire et l'écaille, n'étaient guère travaillés en Egypte, mais à Rome même. Enfin, pendant cette période, qui n'a pas eu son égale dans le monde pour la magnificence des constructions publiques, les précieux matériaux de construction, tirés des carrières de pierre égyptiennes, sortaient de l'Egypte par masses énormes pour être employés dans d'autres régions : le beau granit rouge de Syrie, la brèche des environs de Koser, le basalte, l'albâtre, à partir de Claude, le granit gris et surtout le porphyre des montagnes situées au-dessus de Myos Hormos. La plupart de ces pierres étaient extraites, pour le compte du gouvernement impérial, par des condamnés déportés; mais le transport tout au moins doit avoir profité à la province entière et en particulier à la ville d'Alexandrie. Nous pouvons juger de l'importance considérable qu'avaient prise l'industrie et le commerce égyptiens par un renseignement que le hasard nous a conservé sur le chargement d'un vaisseau de transport (anztos) célèbre par ses grandes dimensions, qui sous Auguste apporta jusqu'à Rome, avec son piédestal, l'obélisque qui se dresse encore aujourd'hui près de la Porta del Popolo : ce navire amenait en outre 200 matelots, 1200 passagers, 40000 boisseaux romains (34,000 hectolitres) de froment, et un chargement de toile, de verre, de papier et de poivre. Alexandrie, dit un écrivain romain du troisième siècle3, est une ville populeuse, riche et corrompue, où personne n'est oisif; celui-ci est verrier, celui-là fabricant de papier, cet autre tisserand; le seul dieu de cette cité est l'argent. Ces paroles sont vraies dans une certaine mesure de l'Egypte tout entière. 1. Dans l'édit de Dioclétien, parmi les cinq qualités de lin les plus fines, les quatre premières sont syriennes ou ciliciennes (de Tarse); le lin d'Egypte est mis non seulement au dernier rang, mais il est encore désigné sous le nom de lin de Tarse d'Alexandrie, ce qui veut dire qu'il était fabriqué à Alexandrie sur le modèle du lin de Tarse. 2. On a dit d'un riche Egyptien qu'il aurait pu remplacer le marbre par du verre dans les lambris de son palais, et qu'il possédait assez de papyrus et de lin pour en équiper une armée tout entière (Vita Firmi, 3). 3. Ce qui nous prouve que la prétendue lettre d'Hadrien (Vita Saturnini, 8) est l'oeuvre d'un faussaire postérieur, c'est, par exemple, que l'empereur se plaint, dans cette lettre adressée en termes tout à fait amicaux à son beau-frère Servianus, des injures dont les Alexandrins ont couvert son fils Verus pendant son premier voyage : or il est certain d'autre part que ce Servianus fut exécuté en l'an 136, à l'âge de quatre-vingt-dix ans, pour avoir blâmé l'adoption de Verus peu antérieure à cette date. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Les vaisseaux égyptiens sur la mer méditerranéeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNous parlerons plus loin des relations commerciales que l'Egypte entretenait avec les contrées qui la bornaient au Sud, ainsi qu'avec l'Arabie et avec l'Inde. Les auteurs anciens nous parlent beaucoup moins du commerce qu'elle faisait dans le bassin de la mer Méditerranée, sans aucun doute parce qu'il ne sortait pas du cours ordinaire des événements, et parce qu'on ne trouvait pas souvent l'occasion de le mentionner. Le blé d'Egypte était apporté en Italie sur des vaisseaux d'Alexandrie - aussi à Portus, près d'Ostie, vit-on se fonder un sanctuaire, construit sur le modèle du Sérapeum d'Alexandrie, avec un collège de navigateurs1, mais il était difficile à ces vaisseaux de transport de participer activement au commerce des marchandises envoyées d'Egypte en Occident. Ce négoce était probablement autant et peut-être plus entre les mains des armateurs et des capitaines italiens que des navigateurs d'Egypte. Une colonie italienne considérable existait déjà sous les Lagides à Alexandrie2. Les négociants d'Egypte n'ont jamais pris en Occident la même extension que ceux de Syrie3. Les ordonnances d'Auguste, que nous citerons plus loin, destinées à réglementer le commerce dans les mers de l'Arabie et de l'Inde, ne furent pas appliquées à la navigation de la mer Méditerranée, le gouvernement n'ayant aucun intérêt à favoriser les commerçants égyptiens plus que les autres. La situation resta à peu près dans le même état qu'auparavant. 1. Les ?, auteurs d'une inscription qui provient sans aucun doute de Portus (Corp. inscr. graec., 5889), sont les capitaines des navires qui transportaient le blé. Nous possédons une série d'inscriptions du Serapeum d'Ostie (Corp. insc. lat., XIV, 47), d'après lesquelles ce monument était dans toutes ses parties la copie du temple d'Alexandrie; son administrateur est en même temps ? (Corp. insc. graec., 5973). Il est probable que ces navires servaient surtout au transport du grain; le blé n'arrivait donc à Rome que successivement, comme nous l'indiquent aussi les mesures prises par l'empereur Gaïus dans le détroit de Reggio (Josèphe, Ant., XIX, 2, 5). Nous savons en outre que la première apparition de la flotte d'Alexandrie au printemps était célébrée par une fête à Pouzzoles (Sénèque, Ep., 77, 15). 2. C'est ce que nous apprennent les remarquables inscriptions de Délos (Eph. epigr., V, p. 600-602). 3. Les Syriens ont déjà une place prépondérante dans les inscriptions déliennes du dernier siècle de la République. Les divinités égyptiennes ont bien eu dans cette île un sanctuaire très vénéré; mais parmi les nombreux prêtres et parmi les fidèles qui dédiaient des ex-voto, on ne trouve qu'un seul Alexandrin (Hauvette - Besnault, Bull. de corr. hellen., VI, p. 316 et sq.). Nous connaissons l'existence de sociétés de négociants Alexandrins à Tomis (t. X, p. 75, n. 1) et à Périnthe (Corp. insc. graec., 2024). | ||||
30 av. J.C.-476 |
La populationRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'Egypte n'était donc pas seulement un pays habité par beaucoup d'agriculteurs dans les régions cultivables; c'était aussi, comme nous le prouvent le grand nombre et la prospérité en partie considérable des bourgades et des villes, une contrée industrielle; il en résulte qu'elle était la province la plus peuplée de l'empire romain. L'ancienne Egypte a dû avoir une population de sept millions d'hommes. Sous Vespasien on comptait dans les listes officielles sept millions et demi d'habitants soumis à la capitation; en y ajoutant les Alexandrins et les Grecs qui ne payaient pas cet impôt, ainsi que les esclaves probablement peu nombreux, on atteint, pour la population totale, au moins le chiffre de huit millions. De nos jours la superficie des terres arables peut être évaluée à 500 milles carrés allemands (environ 28,000 kilom. carrés; elle était tout au plus sous les Romains de 700 (environ 39,000 kilom. carrés); par conséquent en Egypte chaque mille (56 kilom. carrés) était peuplé en moyenne de 11,000 habitants. Si nous jetons un coup d'oeil sur la population de l'Egypte, nous voyons que les deux peuples qui habitent le pays, la grande masse des Egyptiens et la petite minorité de Grecs d'Alexandrie, forment deux sociétés entièrement distinctes1; mais la contagion du vice, et l'espèce de ressemblance que le vice-roi établit entre tous les hommes, fonda dans le pays une association funeste des deux éléments dans le mal. 1. Juvénal, après avoir décrit les orgies grossières auxquelles se livraient les Egyptiens indigènes en l'honneur des divinités locales de chaque nome, ajoute que ces indigènes ne le cédaient en rien à Canope, c'est-à-dire à la fête Alexandrine de Sérapis, renommée pour ses débordements sans frein (Strabon, XVII, 1, 17, p. 801): Horrida sane AEgyptus, sed luxuria, quantum ipse notavi, Barbara famoso non cedit turba Canopo. (Sat., V, 15, 44). |
||||
30 av. J.C.-476 |
Les moeurs égyptiennesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste
La situation et la manière de vivre des Egyptiens indigènes ne doivent guère s'être modifiées depuis l'antiquité. Ce peuple était frugal, sobre, travailleur et actif; il se composait d'ouvriers adroits, de matelots, de négociants habiles, fidèles à leurs anciens usages et à leur antique religion. Lorsque les Romains nous racontent que les Egyptiens montraient avec orgueil les coups de fouet qu'ils avaient reçus pour avoir fraudé l'administration des finances1, ce ne sont là que des propos de percepteur. La civilisation nationale ne manquait pas de bons éléments. Quoique, dans la lutte intellectuelle livrée entre ces deux peuples si complètement différentes, les Grecs eussent acquis une grande supériorité, les Egyptiens avaient sur les Hellènes certains avantages essentiels, et ils s'en rendaient parfaitement compte. C'est par un réveil du sentiment national, que les auteurs égyptiens, prêtres de la littérature grecque courante, raillaient ce que les Hellènes appelaient leur érudition historique et se moquaient des savants qui traitaient des légendes poétiques comme l'histoire réelle des temps passés. En Egypte, disaient-ils, on ne fait pas de vers, mais tous les événements d'autrefois sont gravés sur les temples et sur les tombeaux; il est vrai qu'un grand nombre de ces documents a disparu, parce que beaucoup de monuments ont été détruits, et que la tradition s'efface au milieu de l'ignorance et de l'indifférence des modernes. Le désespoir perce à travers cette plainte légitime elle-même; l'arbre vénérable de la civilisation égyptienne était marqué depuis longtemps pour être abattu. L'hellénisme pénétrait jusque dans le sacerdoce lui-même. L'Egyptien Chérémon, qui a décrit les temples de sa patrie et qui fut appelé à la cour de Claude pour enseigner la philosophie grecque aux fils de l'empereur, prétendait, dans son Histoire d'Egypte, retrouver dans les divinités indigènes les éléments de la physique stoïcienne, et il interprétait en ce sens les documents écrits dans la langue nationale. Au milieu de la vie pratique de l'époque impériale, on ne s'occupait plus de l'antiquité égyptienne que sur le terrain religieux. Pour ce peuple la religion était tout. La domination étrangère fut supportée de bonne grâce, on pourrait même dire qu'elle fut à peine sentie, tant qu'elle n'attaqua pas les usages consacrés du pays et tout ce qui s'y rattachait; or, dans le régime intérieur de l'Egypte presque tout s'y rattachait : l'écriture et la langue, les privilèges et l'appareil des prêtres, l'étiquette de la cour et les moeurs locales. Si un gouvernement montrait de la sollicitude pour le boeuf sacré qui vivait alors, s'il participait aux frais des funérailles du dieu mort, et à la recherche de son successeur, c'était un criterium auquel les prêtres et le peuple reconnaissaient son excellence, et cette attitude lui garantissait le respect et la fidélité des Egyptiens. Le premier roi des Perses se créa une popularité en Egypte lorsqu'il rendit à sa véritable destination, c'est-à-dire aux prêtres, le sanctuaire de Neith à Saïs. Ptolémée I, lorsqu'il n'était encore que gouverneur macédonien, replaça dans leurs anciens temples les statues de dieux égyptiens qui avaient été emportées en Asie, et restitua aux dieux de Pé et de Tèp les présents des indigènes dont on les avait dépouillés. Dans le célèbre décret de Canope, rendu en l'an 238 avant J.-C., les prêtres égyptiens expriment leur reconnaissance au roi Evergète, parce qu'il a rapporté de Perse, après sa grande expédition victorieuse, les statues sacrées jadis ravies dans les temples. Enfin tous ces princes et ces princesses étrangers se sont laissé mettre, comme les Pharaons d'Egypte, suivant la coutume du pays, au rang des divinités indigènes. Les empereurs romains n'ont pas complètement suivi cet exemple. Ils ont bien accepté dans une certaine mesure, comme nous l'avons vu, les qualificatifs que leur donnait la religion du pays; mais ils ont évité de prendre, même présentés à l'égyptienne, les titres indigènes, qui choquaient trop vivement les idées des Occidentaux. Ces favoris de Ptah et d'Isis, qui ne sévissaient pas moins en Italie contre le culte égyptien que contre la religion juive, ne se sont pas ouvertement vantés de ces faveurs divines en dehors des hiéroglyphes et, dans la province elle-même, ils n'ont pas participé au culte des divinités nationales. Les Egyptiens proprement dits restaient fidèles avec opiniâtreté, même sous la domination étrangère, à leurs antiques croyances; mais la situation de parias, dans laquelle ils se trouvaient, au-dessous de leurs maîtres grecs et romains, influait nécessairement sur la religion et sur le sacerdoce, le gouvernement romain n'ayant laissé à l'ancienne caste des prêtres d'Egypte qu'un faible reste de sa prépondérance, de sa puissance et de sa grandeur. Cependant le culte indigène, dont la forme, dès l'origine, était étrangère à toute beauté et l'esprit à toute élévation, resta, en Egypte et au dehors, le point de départ, et le centre de tous les miracles imaginables et de toutes les folies sacrées - il suffit de mentionner l'Hermès trismegiste, originaire d'Egypte, avec le cortège de petits traités et d'ouvrages merveilleux qui s'y rattache, avec les pratiques très répandues auxquelles il donna naissance. A cette époque la religion avait fait naître chez les indigènes les plus tristes abus : non seulement ils célébraient, avec le dérèglement ordinaire, des orgies pendant plusieurs jours en l'honneur des divinités locales de chaque nome, mais encore des luttes religieuses existaient entre les différents districts pour savoir qui avait la préséance de l'ibis, du chat, du crocodile ou du singe. En l'année 127 ap. J.-C. les Ombites de l'Egypte méridionale furent attaqués sous un prétexte de ce genre par les habitants d'un nome voisin2; ils furent surpris au milieu d'un banquet, et les vainqueurs mangèrent sans doute un des morts. Peu de temps après, les adorateurs du chien, pour braver les adorateurs du brochet, dévorèrent un brochet; en revanche les adorateurs du brochet mangèrent un chien : la guerre éclata entre les deux nomes, mais les Romains intervinrent et punirent les deux partis. En Egypte de pareils événements étaient à l'ordre du jour. Le pays était d'ailleurs sans cesse troublé. Le premier vice-roi établi par Auguste dans la province dut envoyer des troupes dans la Haute-Egypte où une augmentation d'impôts avait provoqué quelques mouvements; il dut en envoyer aussi, peut-être pour la même raison, contre Héroonpolis, à l'extrémité supérieure du golfe Arabique. 1. Ammien, XXII, 16, 23: Erubescil apud (Aegyptios), si qui non infitiando tributa plurimas in corpore vibices ostendat. 2. D'après Juvénal, ce serait Tentyra; mais il doit s'être trompé, s'il veut parler de la ville connue sous ce nom; cependant l'anonyme de Ravenne (3, 2) nomme aussi ensemble les deux localités. |
||||
166-172 |
Révolte des BucoliRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteUne seule fois, sous l'empereur Marc-Aurèle, la révolte des Egyptiens indigènes prit un caractère dangereux. A l'Est d'Alexandrie, dans les sables presque inaccessibles qui bordent la côte, et qui portaient le nom de pâturages à boeufs (bucolia), les criminels et les bandits trouvaient un refuge et formaient une sorte de colonie; plusieurs d'entre eux ayant été faits prisonniers par un détachement de soldats romains, toute la bande se souleva pour les délivrer, et les habitants du pays se joignirent aux rebelles. La légion romaine d'Alexandrie marcha contre eux; mais elle fut battue, et la ville elle-même faillit tomber entre les mains des insurgés. Le gouverneur de l'Orient, Avidius Cassius, vint en Egypte avec ses troupes; il n'osa pas pourtant livrer combat à des adversaires trop supérieurs en nombre; il se contenta de faire naître la discorde dans le camp des rebelles; lorsque les deux bandes luttèrent entre elles, le gouvernement n'eut pas de peine à triompher de la révolte. Cette insurrection, que l'on appela l'insurrection des bouviers, avait probablement un caractère religieux, comme toutes les guerres de paysans de ce genre; le chef, Isidoros, le plus vaillant homme de toute l'Egypte, était un prêtre, et, de plus, pour consacrer l'union des rebelles, lorsqu'ils eurent prêté serment, un oflicier romain fut sacrifié et dévoré par les conjurés. Ce détail trahit la préoccupation religieuse, comme le cannibalisme qui avait marqué la guerre des Ombites. Un écho de ces événements se retrouve dans les histoires de voleurs égyptiens, qui existent dans la littérature grecque de second ordre à la basse époque. D'ailleurs ces révoltes n'ont pas beaucoup inquiété le gouvernement romain; elles n'avaient pas de but politique, et elles n'ont troublé que partiellement et passagèrement la paix générale du pays. |
||||
30 av. J.C.-476 |
AlexandrieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Alexandrins vivaient à côté des Egyptiens, à peu près comme dans l'Inde orientale les Anglais à côté des indigènes. Avant l'époque de Constantin, Alexandrie était en général considérée comme la seconde ville de l'empire romain et la première cité commerciale du monde. A la fin de la dynastie des Lagides, elle comptait plus de 300000 habitants libres; sous les empereurs romains, elle était certainement encore plus peuplée. Les deux grandes capitales du Nil et de l'Oronte, qui devaient leur grandeur à leur rivalité même, présentent, lorsqu'on les compare, autant de ressemblances que de différences. Toutes deux sont des villes relativement neuves, créées de rien par des monarques; elles sont bâties suivant un plan fixé d'avance, et leur organisation municipale est régulière. A Alexandrie comme à Antioche l'eau coule dans chaque maison. La ville de l'Oronte l'emportait sur sa rivale par la beauté de sa situation et la splendeur de ses monuments; mais Alexandrie était mieux placée pour faire le grand commerce et sa population était plus nombreuse. Les grands édifices publics de la capitale de l'Egypte, le palais des rois, le Muséion consacré à l'Académie, surtout le temple de Sérapis, étaient les oeuvres merveilleuses d'une époque antérieure, où l'architecture avait atteint son apogée; mais Alexandrie, peu fréquentée par les Césars romains, ne saurait rivaliser avec la résidence de Syrie, toute remplie de constructions impériales. |
||||
30 av. J.C.-476 |
L'esprit frondeur des AlexandrinsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteComme les gens d'Antioche, les habitants d'Alexandrie étaient turbulents, et se plaisaient à faire de l'opposition au gouvernement. L'on peut ajouter ici que les deux villes, et surtout Alexandrie, prospérèrent sous la domination romaine et grâce à elle; elles avaient donc plus de raisons pour se montrer reconnaissantes que frondeuses. Si nous voulons savoir comment les Alexandrins traitaient leurs maîtres grecs, nous n'avons qu'à consulter la longue liste de sobriquets employés encore aujourd'hui, que tous les Ptolemées sans exception reçurent du public de leur capitale. L'empereur Vespasien fut surnommé par les Alexandrins le marchand de sardines, parce qu'il avait établi un impôt sur le poisson salé; le Syrien Sévère Alexandre fut appelé le Grand rabbin. Mais les empereurs venaient rarement en Egypte; ces souverains lointains et étrangers n'offraient pas à la raillerie une véritable cible. A leur défaut, c'étaient les vice-rois qui offraient au zèle infatigable des Alexandrins l'occasion de se témoigner par de semblables égards. La crainte même d'un châtiment inévitable ne pouvait réduire au silence la langue souvent spirituelle et toujours effrontée de ces citadins1. Comme représailles de la bienveillance qu'on lui avait témoignée, Vespasien se contenta d'augmenter de six deniers l'impôt de la capitation; aussi fut-il encore surnommé l'homme aux six deniers; mais les discours que les Alexandrins tinrent sur Sévère Antonin, le petit singe du grand Alexandre et l'amant de sa mère Jocaste, devaient leur coûter plus cher. Le perfide empereur vint en ami en Alexandrie; il laissa le peuple lui faire une ovation, puis il fit tailler en pièces par ses soldats la foule qui le fêtait: pendant plusieurs jours, les places et les rues de la grande ville furent inondées de sang; il voulut faire dissoudre l'Académie, et ordonna d'établir une légion dans la ville elle-même; il est vrai que ces deux ordres ne furent pas exécutés. 1. Senèque, Ad Helv., 19, 6: Loquac et in contumelias praefeciorum ingeniosa provincia;..... etiam periculosi sales placent. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Les émeutes d'AlexandrieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteSi à Antioche on se borna toujours à railler, la population d'Alexandrie s'armait au moindre prétexte de pierres et de bâtons. Les Egyptiens, nous affirme un Alexandrin que nous pouvons croire, sont les premiers de tous les peuples pour faire du vacarme; la moindre étincelle suffit pour allumer une révolte. Qu'on néglige de leur rendre visite, qu'on leur confisque des aliments gâtés, qu'on les chasse d'un établissement de bains, qu'une querelle éclate entre l'esclave d'un riche Alexandrin et un fantassin romain à propos de la valeur ou du peu de valeur de leurs pantoufles respectives, il n'en faut pas davantage pour que les légions soient obligées de massacrer les habitants. Ces quelques lignes nous apprennent que les couches inférieures de la population d'Alexandrie étaient composées surtout d'indigènes; sans doute les Grecs, dans toutes ces émeutes, jouaient le rôle d'instigateurs, les rhéteurs, c'est-à-dire les excitateurs, doivent toujours être cités en pareil cas1, mais au cours de de l'insurrection, apparaissaient bientôt la perfidie et la cruauté de l'Egyptien indigène. Les Syriens sont lâches; comme soldats les Egyptiens le sont aussi; mais, dans les tumultes de la rue, ils sont capables de montrer une valeur digne d'un meilleur objet2. Comme les habitants d'Antioche, les Alexandrins étaient fous des courses, de chevaux; mais en Egypte on finissait toujours, en pareille circonstance, par lancer des pierres et par jouer du couteau. Sous l'empereur Gaïus les Juifs furent persécutés dans les deux villes; à Antioche un mot sévère de l'autorité suffit pour arrêter l'effusion du sang, tandis qu'à Alexandrie des milliers d'hommes furent victimes de cette émeute provoquée par quelques sauvages à propos d'une parade de foire. Les Alexandrins, dit-on, lorsqu'un tumulte a éclaté, ne cessent pas la lutte avant d'avoir vu du sang. La situation des fonctionnaires et des officiers romains envoyés en Egypte était donc des plus difficiles. Les gouverneurs, dit un écrivain du quatrième siècle, sont pris de peur et de tremblements, quand ils entrent dans Alexandrie; ils redoutent la justice populaire; dès que l'un d'entre eux a commis une injustice, immédiatement son palais est incendié et lui-même est lapidé. La confiance naïve dans la justice de cette procédure nous montre à quel point de vue s'est placé l'écrivain, qui a appartenu à ce peuple. Nous retrouvons ce système de lynchage, qui déshonore à la fois le gouvernement et la nation, appliqué dans l'histoire de l'Eglise; il suffit de citer l'assassinat, sous Julien, de l'évêque Georgios, qui ne déplaisait pas moins aux orthodoxes qu'aux païens, et de ses partisans, et le meurtre de la belle libre-penseuse Hypatia, sous Théodose II, par les pieux compagnons de l'évêque Cyrille. Ces émeutes d'Alexandrie étaient plus hargneuses, plus fréquentes, plus cruelles que celles d'Antioche; mais ni les unes ni les autres ne mettaient en danger l'existence de l'empire ou même le gouvernement particulier de la province. Dans les Etats comme dans les familles, les gamins légers et méchants sont bien incommodes, mais ils ne sont qu'incommodes. 1. Dans le discours qu'il adresse aux Alexandrins, Dion Chrysostome leur dit (Or., 32, p. 663; ed. Reiske) : Maintenant que les gens intelligents se retirent et gardent le silence, on ne voit plus dans votre ville que compétitions et luttes continuelles; on n'entend que cris sauvages, que discours méchants et déréglés; ce ne sont plus qu'accusations, que soupcons, que procès; c'est le règne de la canaille bavarde. On voit ces orateurs populaires à l'oeuvre dans la persécution des Juifs d'Alexandrie, dont Philon a fait un récit si dramatique. 2. Dion Cassius (XXXIX, 58): En toute chose les Alexandrins sont le plus effrontés qu'ils peuvent, et disent tout ce qui leur passe par la tête. Dans la guerre et dans ses terreurs, ils se montrent lâches; mais au milieu des émeutes, qui sont chez eux très fréquentes et très sérieuses, ils tuent et ils sacrifient leur vie pour un succès passager; ils courent même à leur perte, comme si les plus grands intérêts étaient en jeu. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Le culte AlexandrinRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes deux cités se ressemblent également pour la religion. La population indigène en Syrie comme en Egypte est restée fidèle à son ancienne foi, mais les habitants d'Antioche et ceux d'Alexandrie ont modifié les formes primitives de leur culte. Comme les Séleucides, les Lagides se sont bien gardés de toucher aux principes mêmes de l'antique religion nationale; ils ont seulement cherché, en accommodant aux formes souples de l'Olympe grec les vieilles conceptions nationales et les sanctuaires consacrés, à helléniser l'Egypte au moins extérieurement dans une certaine mesure; ils ont par exemple introduit dans le pays le dieu grec des enfers, Pluton, sous le nom peu connu jusqu'alors de la divinité égyptienne, Sérapis, et ont peu à peu détourné vers lui le culte de l'antique Osiris1. C'est ainsi que la déesse Isis, purement égyptienne, et la divinité pseudo-égyptienne Sérapis jouaient presque à Alexandrie le même rôle que Bélos et Elagabal en Syrie; comme eux elles pénétrèrent insensiblement, sous l'empire, dans la religion occidentale, sans acquérir, il est vrai, autant d'influence, et plus vivement combattues. Quant à l'immoralité qu'engendrèrent ces cérémonies religieuses, quant aux débauches approuvées et provoquées par les prêtres, les deux villes n'ont rien à se reprocher l'une à l'autre. Jusqu'à une époque très avancée l'ancienne religion a conservé sa forteresse la plus solide dans la pieuse province d'Egypte2. Ce fut surtout à Alexandrie que l'on s'efforça de restaurer les antiques croyances, soit scientifiquement dans la philosophie qui en dérivait, soit pratiquement en repoussant les attaques dirigées par les chrétiens contre le polythéisme, et en faisant revivre les cérémonies et la divination païennes. Lorsque la nouvelle religion eut enfin emporté cette citadelle, les coutumes locales ne disparurent pas encore; la Syrie fut le berceau du christianisme, l'Egypte celui du monachisme. Nous avons déjà apprécié dans un autre chapitre l'importance et la situation des colonies juives, qui se ressemblent dans les deux villes. Comme les Hellènes, les Juifs étaient des immigrés que le gouvernement avait appelés dans le pays; mais ils leur étaient inférieurs; ils payaient la capitation comme les Egyptiens, tout en s'estimant et en étant vraiment supérieurs aux indigènes. Leur nombre atteignit sous Vespasien un million, environ la huitième partie de la population totale de l'Egypte. Comme les Hellènes aussi, ils habitaient de préférence la capitale, dont ils occupaient deux quartiers sur cinq. Bien avant la chute de Jérusalem, les Juifs d'Alexandrie étaient les plus libres, les plus puissants, les plus civilisés et les plus riches de tous; aussi les derniers actes de la tragédie juive se sont-ils joués en grande partie, comme nous l'avons déjà raconté, sur le sol égyptien. 1. Les pieux Egyptiens protestèrent, comme nous l'apprend Macrobe (Sat., I, 7, 14), mais tyrannide Plolemaeorum pressi hos quoque deos (Serapis et Saturne) in cultum recipere Alexandrinorum more, apud quos potissimum colebantur, coacti sunt. Comme ils devaient offrir à ces divinités des sacrifices sanglants, ce qui était contraire à leur rituel, ils ne les laissèrent pas pénétrer au moins dans les villes : Nullum Aegypti oppidum intra muros suos uut Salurni aut Sarapis fanum recepit. 2. L'auteur anonyme d'une description de l'empire romain à l'époque de Constance, que nous avons souvent citée, un bon païen, vante surtout la piété exemplaire des Egyptiens : Nulle part les mystères des dieux ne sont célébrés depuis aussi longtemps qu'en Egypte... Et il ajoute : Sans doute plusieurs personnes croient que les Chaldéens il fait allusion au culte syrien honoraient mieux les Dieux; mais je veux m'en tenir à ce que mes yeux ont vu. Il y a en Egypte des sanctuaires de toute sorte, des temples magnifiquement ornés; dans la foule se trouvent des sacristains, des prêtres, des prophètes, des croyants, d'excellents théologiens, et tous sont rangés d'après leur ordre hiérarchique; toujours la flamme brille sur les autels, les prêtres sont ornés de leurs bandeaux, et les encensoirs exhalent leurs violents parfums. Nous avons une autre description assez méchante des mêmes usages, qui date à peu près de la même époque (et non d'Hadrien), et dont l'auteur n'était pas moins bien informé (Vita Saturnini, 8). L'Egyptien qui adore Sérapis est aussi un chrétien, et ceux qui se donnent le titre d'évêques chrétiens adorent également Sérapis; tous les grands rabbins juifs, tous les samaritains, tous les membres du clergé chrétien sont à la fois magiciens, prophètes et charlatans (aliptes). Si le patriarche vient en Egypte, les uns lui demandent d'adresser ses prières à Sérapis, les autres au Christ. Ce qui explique certainement cette diatribe, c'est que les chrétiens considéraient la divinité égyptienne comme le Joseph de la Bible, l'arrière petit-fils de Sara, portant à bon droit le boisseau. La situation des Egyptiens restés fidèles à leur ancienne religion est décrite plus sérieusement par l'écrivain, probablement du troisième siècle, qui a composé ce dialogue des dieux, dont la traduction latine s'est conservée parmi les oeuvres attribuées à Apulée. Hermes Trismégiste y dévoile ainsi l'avenir à Asklepios : Tu sais, Asklèpios, que l'Egypte est une image du ciel, ou, pour parler plus justement, la contrée où s'est transportée et où est descendue toute l'activité céleste; pour m'exprimer encore plus exactement, notre patrie est le temple de l'univers entier. Et pourtant une époque viendra où l'on pourra croire que l'Egypte se sera vainement montrée pieuse et empressée à servir les Dieux, où toute adoration de la divinité sera inutile et ne sera pas récompensée. Car la divinité remontera au ciel; l'Egypte sera abandonnée; la puissance divine ne résidera plus dans ce pays, antre de la religion, qui sera rendu à lui-même. Cette terre sacrée, où s'élevaient des sanctuaires et des temples, sera remplie de tombeaux et de cadavres. O Egypte, Egypte, la renommée seule de ton culte divin survivra; mais il paraîtra incompréhensible aux races qui t'habiteront; il n'y aura plus que des mots tracés sur les pierres pour conserver le récit de tes pieuses actions; l'Egypte sera envahie par les Scythes, par les Indiens ou par d'autres barbares, venus des pays voisins ! Ce nouveau droit, de nouvelles lois apparaitront; on n'entendra, on ne croira désormais rien de sacré, rien qui atteste la puissance des Dieux, rien qui soit digne du ciel ni de ses habitants. Les hommes seront tristement séparés des Dieux; il ne restera en Egypte que les mauvais anges, qui se mêlent à l'humanité ! (D'après la traduction de Bernays, Gesch. Abhandl., I, p. 330). |
||||
30 av. J.C.-476 |
La vie des affaires à AlexandrieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAlexandrie, comme Antioche, était surtout peuplée de riches commerçants et de grands industriels; mais à Antioche manque un port de mer avec tout ce qui en résulte, et, quoique les rues de la capitale syrienne fussent pleines de mouvement, on ne peut pas pourtant comparer cette vie à l'agitation que produisaient les ouvriers de fabrique et les matelots d'Alexandrie. Au contraire, en ce qui concerne les jouissances matérielles, les théâres, les festins, les plaisirs de l'amour, Antioche était mieux approvisionnée que la ville où il n'y avait point d'oisifs. De même la littérature proprement dite qui était surtout liée aux exhibitions de rhéteurs, et dont nous avons esquissé le tableau dans notre description de l'Asie Mineure, disparut d'Egypte1, beaucoup plutôt parce que les affaires quotidiennes absorbaient toute la vitalité de la ville que sous l'influence des érudits Alexandrins, nombreux, bien payés, et pour la plupart originaires du pays. Le caractère général de la cité n'était pas essentiellement modifié par ces hommes du Musée, sur lesquels nous reviendrons plus loin, surtout lorsqu'ils se contentaient de travailler avec zèle. En revanche les médecins d'Alexandrie étaient réputés les meilleurs de tout l'empire. Il est vrai que l'Egypte était aussi la véritable patrie des charlatans, des remèdes secrets, de cette forme civilisée de la médecine rustique, dans laquelle, pour étonner le peuple, la pieuse niaiserie et l'escroquerie s'affublent du manteau de la science. Nous avons déjà parlé de l'Hermès Trismegiste; le Sérapis d'Alexandrie a fait, dans l'antiquité, plus de cures merveilleuses qu'aucun de ses différents collègues; il a même, par contagion, entraîné le pratique empereur Vespasien à guérir les aveugles et les perclus, mais seulement à Alexandrie. 1. Lorsque les Romains demandèrent au fameux rhéteur Proaeresios (fin du troisième, commencement du quatrième siècle) un de ses disciples, pour occuper une chaire d'enseignement, il leur envoya Eusèbe d'Alexandrie : Pour ce qui a trait à la rhétorique, disait-on de cet Eusebe (Eunapios, Proaer., p. 92, ed. Boissonade), il suffit de savoir qu'il était Egyptien; ce peuple combat avec passion la poésie, mais la rhétorique sérieuse (otrou Q10; "Esuns) a pour patrie l'Egypte. La curieuse restauration de la poésie grecque en Egypte, à laquelle appartient par exemple l'épopée de Nonnos, est en dehors des limites de notre sujet. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Le monde érudit à JérusalemRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa place qu'occupe ou que semble occuper Alexandrie dans le développement intellectuel et littéraire de la Grèce postérieure et de la civilisation occidentale, doit être appréciée non pas dans un exposé de l'histoire locale de l'Egypte, mais dans un tableau de ce développement lui-même; cependant la littérature alexandrine, qui se continua sous la domination romaine, est un événement trop remarquable pour que nous n'indiquions pas dans ce chapitre son caractère général. Nous avons déjà fait remarquer, que l'esprit oriental et l'esprit hellénique se pénétrèrent surtout en Egypte et en Syrie; si la nouvelle religion, qui devait conquérir l'Occident, sortit de Syrie, c'est en Egypte que naquit la science, sa proche parente, cette philosophie qui reconnaît et enseigne, à côté et en dehors de l'esprit humain, l'existence d'un Dieu supérieur au monde et la révélation divine; c'est là que se développèrent probablement le néo-pythagorisme, certainement le néo-judaïsme philosophique, dont nous avons déjà parlé, ainsi que le néo-platonisme, dont le fondateur, l'égyptien Plotin, a été déjà mentionné. C'est parce que les éléments helléniques et les éléments orientaux se sont mêlés surtout à Alexandrie, que l'hellénisme prit en Italie, au début de l'empire, une forme tout égyptienne, particularité qu'il ne faut pas oublier de signaler dans une peinture de l'Italie à cette époque. Jadis les philosophies de Pythagore, de Moïse et de Platon étaient parties d'Alexandrie pour pénétrer ensuite en Italie; de même la déesse Isis et toutes les pratiques de son culte jouèrent le principal rôle dans cette piété mondaine et commode, que nous révèlent les poètes romains du temps d'Auguste et les temples de Pompéi, construits sous Claude. L'art égyptien domine dans les fresques campaniennes du même temps et dans la villa d'Hadrien à Tibur. La littérature alexandrine occupe une place analogue dans la vie intellectuelle de l'empire romain. Le principe de cette littérature, c'est la protection par l'Etat des intérêts intellectuels; elle se rattacherait au nom d'Alexandre avec plus de raison qu'à celui d'Alexandrie; elle réalise cette idée que, dans une certaine période du développement de la civilisation, l'art et la science doivent être protégés et encouragés par la puissance matérielle et morale du gouvernement; elle est issue de ce moment unique dans l'histoire universelle, qui vit Aristote auprès d'Alexandre. Il ne faut pas rechercher ici comment, dans cette conception puissante, l'erreur se mêle à la vérité, comment la vie intellectuelle y est à la fois abaissée et élevée; il ne faut pas davantage comparer la triste arrière-fleur des chants divins et des hautes pensées des Hellènes libres avec les fruits luxuriants et pourtant encore grandioses de la recherche, de l'érudition et de la classification postérieures. Les institutions qui sortirent de cette idée ne pouvaient pas rendre à la nation grecque, ou du moins ne pouvaient lui rendre qu'en apparence, ce qui est plus triste encore, ce qu'elle avait perdu pour toujours; mais elles lui ont donné, sur le terrain qui restait encore libre dans le monde intellectuel, la seule compensation possible, qui d'ailleurs n'était pas à dédaigner. Nous devons examiner surtout le développement de cette littérature en Egypte. Les produits artificiels de l'horticulture sont en quelque sorte indépendants du sol; il en est de même de ces institutions scientifiques, quoiqu'elles se rattachent étroitement par leur essence aux cours royales. L'appui matériel peut leur venir en partie d'ailleurs; mais ce qui est plus important que cet appui pour la littérature, c'est la faveur des hautes classes, dont le souffle la pousse; comme aussi les relations qui, affluant dans les grands centres, remplissent et étendent le cercle de la science. Au plus beau temps des monarchies issues de l'empire d'Alexandre, il y avait eu autant de centres de cette sorte que d'Etats; la cour des Lagides n'était que la plus considérée de toutes. La république romaine avait successivement triomphé des autres royautés; en même temps que les cours, elle avait fait disparaître les établissements et les sociétés scientifiques qui s'y rattachaient. Le futur Auguste, lorsqu'il détruisit la dernière de ces cours, laissa subsister les corps savants qui en dépendaient, ce qui est une marque manifeste et excellente du changement des temps. Le philhellénisme du gouvernement impérial se distingua, à son avantage, du philhellénisme de la république par son énergie et son élévation; non seulement il permit aux littérateurs grecs de gagner leur vie à Rome, mais il regarda et il traita comme une partie de l'héritage d'Alexandre la grande tutelle de la science grecque. Il est vrai qu'en cela comme dans toute la régénération de l'empire, le plan fut plus vaste que la construction. Les Muses, patentées et pensionnées royalement, que les Lagides avaient appelées à Alexandrie, ne dédaignèrent pas d'accepter des Romains les mêmes revenus; la munificence impériale ne fut pas inférieure à la générosité des anciens rois. La bibliothèque d'Alexandrie, les positions libérales réservées aux philosophes, aux poètes, aux médecins et aux érudits de toute espèce1, ainsi que les immunités qui leur étaient accordées, furent conservées par Auguste et augmentées par l'empereur Claude, à une seule condition : les nouveaux académiciens créés par Claude durent, pendant leurs séances, rédiger année par année les oeuvres historiques grecques de leur étrange fondateur. Alexandrie possédait la première bibliothèque du monde; pendant tout l'empire, elle exerça une certaine suprématie intellectuelle, jusqu'au moment où l'Islam mit le feu à la bibliothèque et détruisit l'antique civilisation. Ce n'était pas seulement par l'effet des circonstances, mais par fidélité aux anciennes traditions et grâce à la tendance d'esprit de ces Hellènes, qu'Alexandrie conservait la première place; de même, parmi les érudits, les Alexandrins l'emportaient en nombre et en importance. A cette époque la société des savants du Musée, on dit de même aujourd'hui à Paris de l'Institut, - produisit un grand nombre d'oeuvres honorables, surtout en philologie et en physique; mais l'importance littéraire que la science et l'art de cour d'Alexandrie et de Pergame avaient eue à la meilleure époque de l'hellénisme, pour tout le monde hellénique et hellénisant, n'existe guère pour la littérature romano-alexandrine. Ce n'est pas que les écrivains de talent ou d'autres circonstances favorables fissent défaut; ce n'est pas non plus parce que les empereurs donnaient les places du Musée aux gens qui leur faisaient de riches présents et qui jouissaient de leur faveur, ou parce que le gouvernement les distribuait comme le titre de chevalier et comme les fonctions du palais les anciens rois n'avaient pas agi autrement -; mais si Alexandrie -; avait encore des philosophes et des poètes de cour, elle avait perdu la cour; et l'on vit nettement, alors, que les pensions et les gratifications n'étaient pas tout, et qu'il fallait encore ce contact de la grande politique et du grand travail scientifique, également vivifiant pour tous les deux. Ce contact subsista sous la nouvelle monarchie avec les mêmes conséquences; mais Alexandrie n'en était plus le centre; la floraison du développement politique se produisait exclusivement chez les Latins et dans leur capitale. Sous Auguste, la poésie et la science se sont trouvées dans les mêmes conditions, elles se sont épanouies avec autant de grandeur et de succès que chez les Hellènes à la cour des rois de Pergame et des premiers Ptolémées. Même dans le cercle de la société grecque, l'influence que le gouvernement romain put exercer dans la même direction que les Lagides se fit sentir à Rome plus qu'à Alexandrie. Sans doute les bibliothèques grecques de la capitale n'étaient pas comparables à celle d'Alexandrie - il n'y eut jamais à Rome un Institut semblable au Musée égyptien; mais à Rome la situation de bibliothécaire donnait accès à la cour; de même le titulaire de la chaire de rhétorique grecque fondée par Vespasien, nommé et payé par le gouvernement, jouissait de faveurs semblables à celles qu'avait le bibliothécaire impérial, quoiqu'il ne fût pas, comme lui, fonctionnaire du palais au sens propre du mot; en raison de cette situation, la chaire de rhétorique grecque était considérée comme la première de l'empire. Le dignitaire le plus élevé et le plus influent était le secrétaire du cabinet impérial pour le département des affaires grecques : c'était presque toujours un littérateur grec. Quitter l'Académie d'Alexandrie pour obtenir une fonction de ce genre dans la capitale était à coup sûr un avancement2. Si l'on fait abstraction de tous les autres avantages que les littérateurs grecs trouvaient à Rome, les fonctions et les dignités de la cour suffisaient pour attirer les plus célèbres d'entre eux dans la capitale de l'empire et pour les détourner de la pension égyptienne. La cité savante d'Alexandrie à cette époque était devenue, pour ainsi dire, le séjour de veuvage de la science grecque, résidence honorable et utile, mais où elle n'exerçait pas une influence puissante sur le grand mouvement de la formation et de la déformation de l'empire; les places du Musée furent souvent données, comme il était juste, à des savants étrangers, et l'Institut lui-même s'occupa beaucoup plus des livres de la bibliothèque que des citoyens de la grande ville commerciale et industrielle. 1. Un poète homérique Mougelou vient à bout de célébrer Memnon en quatre vers homériques, sans y ajouter un seul mot de son cru (Corp. inscr. graec., 4748). Hadrien récompense un poète alexandrin pour une épigramme de courtisan en le nommant membre du Musée (Athénée, XV, p. 677 e). Philostrate (Vita soph., I, 22, 3, cf. 25, 3) cite plusieurs rhéteurs du temps d'Hadrien. A Halicarnasse, il y eut un pidosopos Mougelou (Bull. de corr. hellen., IV, p. 405). Plus tard, à une époque où le cirque est tout, nous y trouvons un célèbre lutteur comme membre honoraire de la section de philosophie, pourrait-on dire (Inscription de Rome : Corp. insc. graec., 5914 : ??oslo, c'est-à-dire une société de médecins éphésiens, se rattachent aussi au Musée d'Alexandrie; mais ils ne peuvent guère en être membres; ils y ont seulement été formés. 2. On peut citer comme exemples : Chérémon, le maître de Néron, qui professait auparavant à Alexandrie (Suidas; cf. Zeller, Hermes, XI, p. 430, et plus haut, p. 191); Dionysios, fils de Glaucos, qui avait d'abord été le successeur de Chérémon à Alexandrie, puis qui fut bibliothècaire à Rome et secrétaire du cabinet impérial depuis Néron jusqu'à Trajan (Suidas, loc. cit.); L. Julius Vestinus, sous Hadrien, qui, après avoir été président du Musée, exerça à Rome les mêmes charges que Dionysios (p. 175, note 1), et qui est connu comme philologue. |
||||
30 av. J.C.-476 |
L'armée d'EgypteRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa situation militaire de l'Egypte, comme celle de la Syrie, donnait aux troupes une double tâche : il fallait à la fois protéger la frontière méridionale et la côte orientale, oeuvre qui sans doute ne peut pas être comparée, même de loin, à la défense de la ligne de l'Euphrate, et maintenir l'ordre dans l'intérieur du pays et dans la capitale. Abstraction faite des vaisseaux qui stationnaient près d'Alexandrie et sur le Nil, et qui semblent avoir servi surtout au contrôle des douanes, la garnison romaine se composait, sous Auguste, de trois légions, puis des troupes auxiliaires peu nombreuses qui en dépendaient, au total environ 20000 hommes. C'était à peu près la moitié des soldats que l'empereur destinait à l'ensemble des provinces asiatiques; cette proportion correspondait à l'importance que l'Egypte devait avoir dans la nouvelle monarchie. Mais la garnison fut diminuée d'un tiers probablement dès le règne d'Auguste, puis d'un autre tiers sous Domitien. Primitivement deux légions étaient cantonnées en dehors de la capitale; mais le camp principal et bientôt le seul camp de toute la province fut établi aux portes d'Alexandrie, à l'endroit même où Auguste avait vaincu définitivement Antoine, dans le faubourg qui porta depuis lors le nom de Nicopolis. Nicopolis avait son ainphithéâtre spécial; elle célébrait des fêtes populaires en l'honneur de l'empereur; elle jouissait d'une organisation pleinement indépendante, et pendant longtemps les réjouissances publiques d'Alexandrie furent éclipsées par les siennes. La surveillance proprement dite de la frontière était confiée aux auxiliaires. Les mêmes causes qui en Syrie avaient amolli la discipline, l'obligation de faire la police et le contact immédiat avec une grande capitale, exercèrent aussi leur influence sur les troupes égyptiennes; en outre, dans cette province, la mauvaise habitude d'autoriser les soldats à mener sous les drapeaux la vie conjugale ou une image de cette vie, et de compléter les troupes avec les enfants nés dans le camp, avait été introduite depuis longtemps par les régiments macédoniens des Ptolémées, et avait pénétré de bonne heure chez les Romains, au moins dans une certaine mesure. Aussi l'armée d'Egypte, dans laquelle les Occidentaux servaient plus rarement encore que dans les autres troupes de l'Orient, et qui se recrutait en grande partie parmi la population et dans le camp d'Alexandrie, semble avoir été moins considérée que toutes les autres; de même que les officiers de cette légion, comme on l'a déjà remarqué, étaient inférieurs en hiérarchie à ceux des autres légions. La tâche militaire proprement dite, imposée aux troupes égyptiennes, se rattache par des liens très étroits aux mesures qui furent prises pour assurer la prospérité du commerce de l'Egypte. Il faudra donc traiter les deux sujets ensemble et exposer les relations de l'Egypte d'abord avec ses voisins africains du Sud, puis avec l'Arabie et l'Inde. |
||||
30 av. J.C.-476 |
L'EthiopieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNous avons déjà dit que l'Egypte s'étendait vers le Sud jusqu'à la barrière que la dernière cataracte oppose, non loin de Syene (Assouan), à la navigation. Au-delà de Syène commence la lignée des Kâch, comme les Egyptiens les nomment, ou comme traduisent les Grecs, des Ethiopiens, apparentés sans doute aux habitants primitifs de l'Abyssinie dont nous parlerons plus loin; quoiqu'ils sortent peut-être du même tronc que les Egyptiens, ils apparaissent, en face d'eux, dans le développement historique, comme un peuple différent. Plus loin vers le Sud habitent les Nahsiou des Egyptiens. A l'apogée de la puissance égyptienne, les rois du pays avaient étendu leur domination dans l'intérieur de l'Afrique; tout au moins des étrangers venus d'Egypte s'étaient-ils faits rois de ces contrées; les témoignages écrits du gouvernement des Pharaons s'étendent jusqu'à Dongola, au-dessus de la troisième cataracte, dans une région où Nabata (près de Nouri) semble avoir été le centre de leurs établissements; et beaucoup plus loin dans le bassin supérieur du fleuve, à six jours de marche environ au Nord de Khartoum, près de Chendi dans le Sennaar, non loin de Meroë, ville éthiopienne, qui disparut de bonne heure, on trouve des groupes de temples et de pyramides, qui ne présentent, il est vrai, aucune inscription. Lorsque l'Egypte devint romaine, il y avait longtemps que sa puissance avait été détruite au-delà de Syène et que le pays était occupé par une lignée éthiopienne soumise à des reines, qui portaient régulièrement le nom et le titre de Kandaké1, et qui résidaient dans la région jadis égyptienne de Nabata à Dongola; c'était un peuple à peine civilisé, composé surtout de bergers, capable de mettre sur pied une armée de 30000 hommes, mais armé de boucliers en peaux de boeuf, et combattant le plus souvent non pas avec des épées, mais avec des haches ou des lances et des massues ferrées; voisins pillards, qui ne pouvaient pas soutenir la lutte avec les Romains. 1. On connaît l'histoire de l'eunuque de Kandaké, qui lisait Isaïe (Acta Apostol., VIII, 27 et suiv.); une Kandaké régnait aussi à l'époque de Néron (Pline, Hist. nat., VI, 29, 182) et joue un certain rôle dans le roman d'Alexandre (III, 18 et suiv.). |
||||
40-10 av. J.C. |
Guerre contre la reine KandakéRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste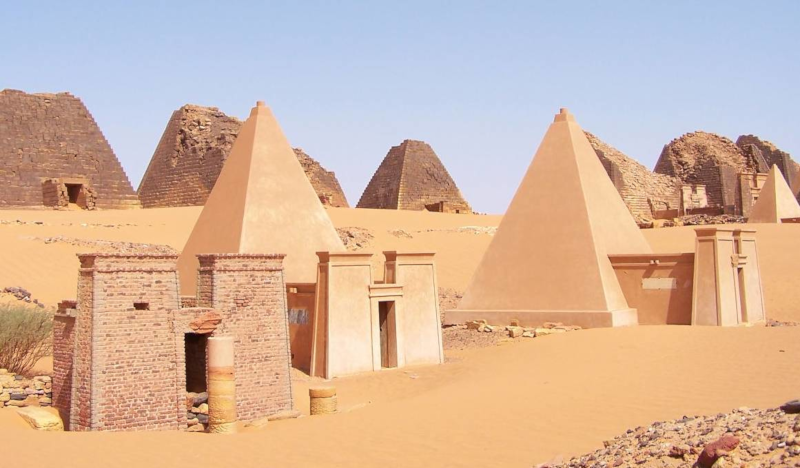
Ils envahirent le territoire romain en l'an 730 ou 731 ( 24 ou 23 av. J.-C.), parce que, prétendaient-ils, les commandants des nomes limitrophes les avaient attaqués; ou parce que, comme le pensaient les Romains, la plus grande partie des troupes égyptiennes était alors occupée en Arabie et que les barbares espéraient ravager le pays impunément. En fait ils battirent les trois cohortes qui couvraient la frontière; ils emmenèrent en esclavage les habitants des districts égyptiens les plus proches, Philae, Eléphantine, Syène, et emportèrent comme trophées les statues de l'empereur, qu'ils y trouvèrent. Mais le gouverneur, qui arrivait au même moment pour administrer la province, Gaius Petronius, usa immédiatement de représailles; avec 10000 fantassins et 800 cavaliers, non seulement il les chassa de l'Egypte, mais encore il les poursuivit le long du Nil dans leur pays même; il leur infligea une défaite décisive à Pselchis (Dakkè); il emporta leur forteresse de Prémis (Ibrim), et leur capitale, qu'il détruisit. La vaillante reine reprit l'offensive l'année suivante et tenta de reconquérir Prémis, où était restée une garnison romaine; mais Petronius amena à temps des secours; la reine se décida à lui envoyer des ambassadeurs et à demander la paix. L'empereur ne se contenta pas de la lui accorder; il ordonna d'évacuer le territoire soumis et défendit au gouverneur d'Egypte d'imposer un tribut aux Ethiopiens. C'est là ce qui donne de l'intérêt à cet événement d'ailleurs peu important; le gouvernement romain se montrait fermement décidé à conserver la vallée du Nil, là où le fleuve était navigable; mais il renonçait une fois pour toutes à prendre possession des vastes contrées du bassin supérieur. Seul le pays, qui s'étend depuis Syène, où campaient sous Auguste les troupes chargées de défendre la frontière, jusqu'à Hiéra Sykaminos (Maharraka), et qu'on appelait la région des douze lieues, fut considéré comme relevant de l'empire, quoiqu'il n'ait jamais été organisé en nome, et qu'il n'ait jamais fait partie de l'Egypte; plus tard, sous Domitien, les postes militaires furent même avancés jusqu'à Hiéra Sykaminos1. On n'alla pas plus loin. Néron, pendant l'expédition d'Orient qu'il avait projetée, devait aussi conquérir l'Ethiopie; mais tout se borna à une reconnaissance du pays, faite au préalable par des officiers romains jusqu'au-delà de Méroë. Les relations de voisinage, sur la frontière méridionale de l'Egypte, restèrent sans doute généralement pacifiques jusqu'au milieu du troisième siècle; néanmoins plusieurs querelles peu considérables éclatèrent avec cette Kandaké, dont nous avons parlé plus haut, avec les princesses qui lui succédèrent et qui semblent avoir longtemps occupé le trône, plus tard peut-être avec d'autres peuples qui avaient fondé leur puissance de l'autre côté de la frontière impériale. Les barbares n'envahirent de nouveau l'Egypte qu'au temps de Valérien et de Gallien, lorsque l'empire commença à se disloquer. 1. La frontière de l'empire s'étendait jusqu'à Hiéra Sykaminos; pour le second siècle c'est Ptolémée (V, 5, 74) qui nous l'apprend; pour l'époque de Diocletien, ce sont les itinéraires qui conduisent jusque-là les routes impériales. Dans la Notitia dignitatum, postérieure d'un siècle, les postes romains sont ramenés à Syène, à Philae, à Eléphantine. Dans la région qui sépare Philae de Hiéra Sykaminos, dans le Dodekaschoenos d'Hérodote (II, 29), il semble que de bonne heure déjà on ait levé des contributions religieuses pour la déesse Isis de Philae, qui fut toujours commune aux Egyptiens et aux Ethiopiens; on y a trouvé, non pas des inscriptions grecques du temps des Lagides, mais de nombreuses inscriptions datées de l'époque romaine; les plus anciennes remontent à Auguste (Pselchis; an 2 ap. J.-C.: Corp. insc. graec., n. 5086) et à Tibère (ibid., an 26 : n. 5104; an 33: n. 5101); la plus moderne est du temps de Philippe (Kardassi; an 248: n. 5010). Ces monuments ne prouvent pas absolument que le pays, où on les a découverts, ait appartenu à l'empire; mais une inscription de l'an 33, relative à un soldat arpenteur (n. 1501), les inscriptions d'un praesidium de l'an 84 (Talmis, n. 5042 et suiv.), ainsi qu'un grand nombre d'autres nous permettent d'admettre cette hypothèse. Aucune pierre semblable ne s'est trouvée au-delà de la frontière indiquée; en effet la curieuse inscription de la regina (Corp. insc. lat., III, 83), découverte à Messaourât, au Sud de Chendi (16 25 de latitude, à cinq lieues au Nord des ruines de Naga), la plus méridionale de toutes les inscriptions latines connues, et qui est aujourd'hui au musée de Berlin, n'est pas l'oeuvre d'un sujet de Rome; elle a été probablement gravée à son retour de Rome par un ambassadeur d'une reine africaine, qui parle latin, et qui veut peut-être montrer simplement par là qu'il est allé à Rome. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Les BlémyesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNous avons déjà dit que les Blémyes, établis dans les montagnes à la frontière Sud-Est de la province, et jadis soumis aux Ethiopiens, peuple sauvage d'une effroyable cruauté, qui plusieurs siècles plus tard n'avait pas encore renoncé aux sacrifices humains, et qui était alors indépendant, envahirent l'Egypte à cette époque, et que, de connivence avec les Palmyréniens, ils occupèrent une grande partie de la Haute-Egypte et gardèrent leurs conquêtes pendant quelque temps. Le vaillant empereur Probus les en chassa; mais les incursions une fois commencées ne cessèrent plus1, et l'empereur Dioclétien dut reculer la frontière. Le pauvre pays des Douze-Lieues réclamait une forte garnison et ne rapportait presque rien à l'Etat. Les Nubiens, qui habitaient dans le désert de Libye et qui envahissaient continuellement la grande oasis, consentirent à quitter leurs anciennes demeures, et à s'établir dans ce territoire, qui leur fut formellement cédé; en même temps on leur paya des tributs annuels, ainsi qu'à leurs voisins de l'Est, les Blémyes, pour les récompenser, disait-on, de garder la frontière; en réalité on voulait se racheter de leurs incursions, qui naturellement ne cessèrent pas. C'était un pas en arrière, le premier, depuis que l'Egypte était devenue romaine. (Relations commerciales avec l'Ethiopie) L'antiquité nous a transmis peu de renseignements sur les échanges commerciaux dont cette frontière était le théâtre. Comme les cataractes du haut Nil barraient la route fluviale, la plus directe de toutes, le commerce, surtout le commerce de l'ivoire entre l'Afrique centrale et l'Egypte, passait à l'époque romaine par les ports de l'Abyssinie plutôt que par le Nil, quoique cette dernière voie n'ait pas été complétement abandonnée?. Les nombreux Ethiopiens, qui habitaient l'île de Philae en même temps que les Egyptiens, étaient certainement pour la plupart des négociants, et la paix, qui régnait sur ce point de la frontière, doit avoir contribué pour sa part à assurer la prospérité des villes voisines de la Haute-Egypte et surtout du commerce égyptien. 1. Les tropaea Niliaca, sub quibus Aethiops et Indus intremuit, dans un discours prononcé vraisemblablement en l'an 296 (Paneg., 5, 5), font allusion à une querelle de ce genre, et non pas à l'insurrection égyptienne; les attaques des Blémyes sont mentionnées dans un autre discours de l'an 289 (Paneg., 4, 17). - C'est Procope qui nous renseigne sur la cession du pays des Douze-Lieues aux Nubiens (Bell. Pers., I, 19) D'après Olympiodore (fr. 37; ed. Muller) et l'inscription de Silko (Corp. insc. graec., 5072), ce territoire était soumis non pas aux Nubiens, mais aux Blémyes. On a récemment découvert un fragment d'un poème historique grec sur la guerre faite aux Blémyes par un empereur romain de la basse époque; Bücheler (Rhein Mus., XXXIX, p. 279 et suiv.) le rapporte à l'expédition de Marcien en l'an 451 (cf. Priscus, Fr. 21). |
||||
30 av. J.C.-476 |
La côte orientale de l'Egypte et le commerce du mondeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa côte orientale de l'Egypte offre au développement du commerce général des obstacles difficiles à surmonter. Le rivage, désolé et rocheux dans toute son étendue, est impropre à la véritable culture; c'est un désert aujourd'hui comme autrefois1. Au contraire, les deux mers qui ont joué le rôle le plus important dans les progrès de la civilisation antique, la mer Méditerranée et la mer Rouge ou des Indes, sont considérablement rapprochées l'une de l'autre par les deux pointes septentrionales de la mer des Indes, le golfe Persique et le golfe Arabique: le premier reçoit l'Euphrate, dont le cours moyen est très voisin de la mer Méditerranée; le second n'est séparé que par quelques jours de marche du Nil qui se jette dans la même mer; aussi dans l'antiquité le commerce entre l'Orient et l'Occident s'est-il surtout dirigé soit par l'Euphrate vers les côtes de Syrie et d'Arabie, soit par la côte orientale de l'Egypte vers le Nil. Les routes commerciales de l'Euphrate sont plus anciennes que celles du Nil; mais la navigation est plus facile sur le fleuve égyptien, et les transports par terre sont plus courts. Il est impossible d'éviter cet inconvénient dans le bassin de l'Euphrate par la construction d'une voie fluviale artificielle; en Egypte l'antiquité et les temps modernes ont jugé l'entreprise difficile, mais possible. C'est la nature elle-même qui a prescrit aux Egyptiens de réunir la côte orientale au cours du Nil et à la côte septentrionale par des routes de terre ou par des voies fluviales; les premiers essais dans ce sens remontent jusqu'à l'époque des souverains indigènes, qui ont ouvert l'Egypte aux étrangers et au grand commerce. 1. A entendre Ptolémée (IV, 5, 14, 15) parler de cette côte, il semble qu'elle n'ait pas été comprise dans la division par nomes, comme le pays des Douze-Lieues. |
||||
30 av. J.C.-476 |
La route de mer vers l'IndeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugustePour marcher sur les traces, semble-t-il, des grands rois constructeurs Sethi I et Rhamsès II, Nécho, fils de Psammétik (610-594 av. J.-C.) commença la construction d'un canal, qui, se détachant du Nil aux environs du Caire, devait établir une communication d'abord entre le fleuve et les lacs amers d'Ismaïlia, puis par ces lacs amers avec le golfe Arabique; l'oeuvre ne fut pas achevée. Il songeait non seulement à se rendre maître du golfe Arabique et du commerce avec les Arabes, mais encore à étendre son influence sur le golfe Persique, sur la mer des Indes, et sur les régions plus éloignées de l'Orient; ce qui le prouve, c'est qu'il fit exécuter le seul périple de l'Afrique qui nous soit signalé dans l'antiquité. Il est certain que le roi Darius I, maître à la fois de la Perse et de l'Egypte, termina le canal; mais, comme nous l'apprennent des inscriptions trouvées sur l'emplacement même de ce canal, il le fit obstruer probablement parce que ses ingénieurs craignaient que l'eau de mer, en pénétrant dans le canal, n'inondat la campagne égyptienne. La lutte des Lagides et des Séleucides, qui domine l'histoire politique après la mort d'Alexandre, était aussi un combat entre l'Euphrate et le Nil. L'Euphrate était roi, le Nil prétendant. Dans cette guerre pacifique, les meilleurs Lagides prirent l'offensive avec une grande énergie. D'abord, ce canal, construit par Nécho et Darius, et qui s'appelait maintenant le fleuve Ptolémée, fut ouvert pour la première fois à la navigation par Ptolémée II Philadelphe (? 247 av. J.-C.); puis de vastes ports furent creusés sur la côte orientale, aux endroits les plus favorables pour la sécurité des navires et pour les communications avec le Nil. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Les ports orientaux de l'EgypteRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCes travaux furent d'abord faits à l'embouchure du canal qui conduisait au Nil, près des villes d'Arsinoë, de Kléopatris, de Klysma, situées toutes les trois dans la même région que la moderne Suez. Beaucoup plus au Sud, s'élevèrent, outre quelques ports peu considérables, les deux grandes villes commerciales de Myos Hormos, un peu au-dessus de la moderne Koséir et de Bérénike, dans le pays des Troglodytes, presque à la même latitude que Syène et que le port de Leuke-kome, sur la côte arabique; la ville de Koptos, où le Nil atteint son point extrême vers l'Est, est située à 6 ou 7 jours de marche de Myos-Hormos, à 11 jours de marche de Bérénike; elle est reliée à ces deux ports à travers le désert par des routes importantes, que bordent de vastes citernes. Sous les Ptolemées, les marchandises, au lieu de passer par le canal, étaient probablement envoyées de préférence à Koptos par ces routes de terre. |
||||
30 av. J.C.-476 |
L'AbyssinieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAu temps des Lagides, l'Egypte proprement dite ne s'est pas étendue au-delà de ce port de Bérénike, situé dans le pays des Troglodytes. Les établissements fondés plus loin vers le Sud, Ptolémaïs pour la chasse, au-dessous de Souakim, et Zula, la ville la plus méridionale de l'empire des Lagides bâtie non loin de la moderne Massaouah, et qui, appelée peut-être à cette époque Béréniké la dorée ou Béréniké près de Saba, fut plus tard Adulis, de beaucoup le meilleur port de toute la côte, n'ont guère été que des places fortes maritimes, sans communication avec l'Egypte par le continent. D'ailleurs ces colonies lointaines ont été certainement soit perdues soit abandonnées volontairement sous les derniers Lagides; à l'époque où la domination romaine s'établit, la frontière de l'Egypte se trouvait, dans l'intérieur des terres, à Syène, sur la côte, dans la ville troglodyte de Bérénike. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Le royaume des AxömitesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteDans ce pays que les Egyptiens n'ont jamais occupé ou qu'ils ont abandonné de bonne heure se constitua, à la fin de l'époque des Lagides ou au commencement de l'empire, un Etat indépendant vaste et puissant, l'empire des Axômites1, qui correspond à l'Abyssinie moderne. Il tira son nom de la ville d'Axômis, aujourd'hui Axoum, située à huit jours de marche de la mer, au coeur de cette région alpestre, dans le royaume moderne de Tigré; cette cité avait comme port la plus importante place commerciale de toute la côte, Adulis, dont nous avons déjà parlé, dans la baie de Massaouah. La population primitive de ce pays peut bien avoir parlé l'Agaou, langue qui s'est conservée pure jusqu'à nos jours dans quelques districts de l'Abyssinie méridionale, et qui appartient à la même famille hamitique que les idiomes modernes Bedcha, Dankali, Somali, Galla; les peuples qui parlaient ces langues semblent être apparentés à la population égyptienne comme les Grecs aux Celtes et aux Slaves : pourtant si la linguistique établit une parenté, l'histoire constate beaucoup plutôt de grandes différences. Mais avant l'époque où nous commençons à connaître ce pays, de nombreux immigrés sémitiques, appartenant aux tribus himiaritiques de l'Arabie méridionale, doivent avoir franchi l'étroit bras de mer et fait de leur langue et de leur écriture la langue et l'écriture populaires de cette région. L'antique langue écrite de l'Abyssinie, qui ne disparut de l'usage courant que longtemps après l'époque romaine, le géez, ou, comme on la nomme souvent à tort, l'éthiopien2, est un idiome purement sémitique3; il en est de même des dialectes qui subsistent encore, particulièrement le Tigrina, quoiqu'ils aient été un peu modifiés sous l'influence de l'Agaou plus ancien. Aucune tradition ne s'est conservée sur les débuts de cet empire. Au commencement du règne de Néron et peut-être depuis longtemps déjà, le roi des Axômites régnait sur la côte africaine depuis Souàkim environ jusqu'au détroit de Bab-el-Mandeb. Quelque temps après nous ne pouvons fixer l'époque avec plus de précision ce prince nous apparait comme le voisin immédiat des Romains à la frontière méridionale de l'Egypte; sur le rivage opposé du golfe Arabique il guerroie dans le pays intermédiaire situé entre les possessions romaines et le territoire des Sabéens; ses Etats sont donc, même en Arabie, limitrophes de l'empire romain dans la direction du Nord; enfin, hors du golfe Arabique, il domine la côte africaine peut-être jusqu'au cap Guardafoui. On ne sait pas au juste quelle était l'étendue du royaume d'Axômis dans l'intérieur des terres; il ne peut guère avoir embrassé, au moins dans les premiers temps de l'empire, l'Ethiopie tout entière, c'est-à-dire Sennaar et Dongola; il est beaucoup plus probable qu'à cette époque l'empire de Nabata subsistait à côté de l'Etat d'Axômis. Lorsque nous rencontrons les Axômites pour la première fois, c'est un peuple déjà relativement développé. Sous Auguste, l'Egypte n'entretenait pas moins de relations commerciales avec ces ports africains qu'avec l'Inde. Le roi du pays commandait non seulement à une armée, mais encore à une flotte, comme l'indiquent ses rapports avec l'Arabie. Un négociant grec, qui était allé à Adulis, parle du roi Zoskalès, qui régnait à Axômis au temps de Vespasien, comme d'un homme loyal et qui sait écrire en grec; un des successeurs de ce prince a placé, dans sa capitale, une inscription en grec courant, qui racontait ses exploits aux étrangers; lui-même s'y donne le titre de fils d'Arès, que les rois des Axômites ont gardé jusqu'au quatrième siècle, et il consacre le trône, qui porte cette inscription, à Zeus, à Arès et à Poseidon. Déjà au temps de Zoskalès le négociant cité plus haut trouve qu'Adulis est une place de commerce bien organisée. Les rois postérieurs forcèrent les tribus nomades de la côte arabique à rester tranquilles sur terre et sur mer; ils établirent une communication par voie de terre entre leur capitale et la frontière romaine, oeuvre difficile à exécuter dans un pays habitué aux communications maritimes. Sous Vespasien les indigènes se servaient, en guise de monnaies, de morceaux de laiton qu'ils partageaient suivant leurs besoins; les pièces romaines ne circulaient que parmi les étrangers établis à Adulis; à la fin de l'empire les rois des Axômites ont eux-mêmes frappé des monnaies. En outre le souverain de ce pays s'appelle Roi des Rois, et l'on ne trouve aucun indice d'où l'on puisse inférer qu'il ait été client de Rome : ce prince bat monnaie d'or, ce que les Romains interdisaient non seulement sur leur territoire, mais encore dans les pays où leur influence était prépondérante. Il serait difficile de trouver, à l'époque impériale, en dehors des limites du monde hellénicoromain, un pays qui ait su donner à l'hellénisme, tout en gardant son indépendance, une aussi large place que l'Etat d'Abyssinie. Plus tard la langue populaire indigène ou plutôt venue d'Arabie redevint prépondérante, et refoula l'idiome grec; il faut attribuer cet événement soit à l'influence des Arabes, soit à l'introduction du christianisme et à la résurrection des dialectes populaires qui en fut la conséquence, comme cela se passa en Syrie et en Egypte; mais il n'en est pas moins vrai que la langue grecque, pendant les deux premiers siècle de notre ère, a été parlée à Axômis et à Adulis comme en Syrie et en Egypte, si toutefois il est permis de comparer les petites choses aux grandes. 1. Les meilleurs renseignements que nous ayons sur l'empire d'Axômis ont été recueillis sur la pierre élevée à Adulis, au début de l'empire romain, par un de ces rois abyssiniens (Corp. insc. graec., 5127 b); c'est une sorte de mémoire, où sont racontés les exploits de ce prince, qui paraît être le fondateur de l'empire; il est écrit dans le même style que le monument de Darius à Persépolis ou que le testament d'Auguste à Ancyre; ce récit ornait le trône royal, devant lequel les criminels furent exécutés jusque dans le courant du VIe siècle. Le commentaire savant de Dilmann (Abhandl. der Berliner Akademie, 1877, p. 135 et suiv.) nous explique ce qui dans ce monument est explicable. Au point de vue romain, il faut remarquer que le roi ne nomme pas les Romains, mais qu'il fait évidemment allusion aux frontières de l'empire; lorsqu'il dit qu'il soumit les Tangaites, ?, et qu'il construisit une route, plus loin il cite Leuke Kome comme le point septentrional extrême de son expédition en Arabie; or cette cité est la dernière station romaine sur la côte occidentale de cette péninsule. Il s'ensuit également que cette inscription est moins ancienne que le Périple de la mer Rouge écrit sous Vespasien; d'après cet ouvrage (c. 5) le roi d'Axomis règne aco ?; il faut comprendre ?'expression ?? dans un sens exclusif, puisque l'auteur, au 2, signale les des Moschophages, et qu'il nous apprend, au 14, qu'au-delà du détroit de Bab-el-Mandeb il n'y avait pas de roi, mais seulement des Tyrans. A cette époque l'empire d'Axômis ne touchait donc pas encore à la frontière romaine; il s'étendait jusque dans les environs de Ptolémaïs pour la chasse; dans une autre direction il n'atteignait pas Guardafoui, et s'arrêtait au détroit de Babel-Mandeb. De même le Périple ne parle pas des possessions du roi d'Axomis sur la côte d'Arabie, quoiqu'il cite plusieurs fois les dynastes qui règnent dans cette contrée. 2. Le nom d'Ethiopiens s'applique dans la bonne époque à la région du haut Nil, plus particulièrement aux empires de Meroë et de Nabata (p. 212), par conséquent au pays que nous appelons aujourd'hui la Nubie. A la fin de l'antiquité, par exemple dans Procope, ce nom est réservé à l'état d'Axômis, et depuis longtemps les Abyssiniens le donnent à leur empire. 3. C'est ce qui a donné naissance à la légende, d'après laquelle les Axômites seraient des Syriens établis en Afrique par Alexandre et parleraient encore le syriaque (Philostorgius, Hist. eccl., III. 6). |
||||
30 av. J.C.-476 |
Rome et les AxômitesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes relations politiques des Romains avec l'état des Axômites nous sont presque inconnues pendant les trois premiers siècles de notre ère, période à laquelle se borne notre récit. Les Romains occupèrent, en même temps que le reste de l'Egypte, les ports de la côte occidentale; ils pénétrèrent jusqu'à Béréniké des Troglodytes, qui fut alors placée, à cause de son éloignement, sous l'autorité d'un commandant particulier1. Ils ne songèrent jamais à étendre leur puissance sur les montagnes inhospitalières et stériles qui bordent la côte; quant à la population peu nombreuse qui habitait les territoires immédiatement voisins et qui se trouvait au dernier degré de la civilisation, elle n'a jamais inquiété sérieusement les Romains. Les Césars n'ont pas cherché, plus que les premiers Lagides, à s'emparer des ports de la côte d'Axômis. Nous savons seulement, par un renseignement très précis, que des envoyés du roi des Axômites négocièrent avec l'empereur Aurélien. Ce silence et la situation tout à fait indépendante du roi des Axômites2: nous prouvent que les frontières établies furent continuellement respectées par les deux puissances, et que les relations des deux Etats voisins furent excellentes, ce qui profita à la paix et surtout au commerce de l'Egypte. Ce commerce, principalement le trafic si important de l'ivoire, dont Adulis était le premier entrepôt pour l'Afrique intérieure, était fait en grande partie par des Egyptiens et sur des vaisseaux égyptiens; il est impossible d'en douter déjà pour l'époque des Lagides, étant donnée la civilisation supérieure de l'Egypte; sous les Romains ce commerce a pu devenir plus important, mais les conditions n'en ont pas changé. 1. C'est le praefectus praesidiorum et montis Beronices (Corp. insc. lat., t. IX, 3083) praefectus montis Berenicidis (Orelli, 3881), praefectus Bernicidis (Corp. insc. lat., X, 1129), officier de rang équestre, analogue à l'officier résidant à Alexandrie, dont nous avons parlé plus haut. 2. La lettre, adressée en 356 par l'empereur Constance au roi d'Axomis Aeizanas, est la lettre d'un souverain à un autre souverain; il le prie de l'aider, en bon voisin, à combattre l'hérésie d'Athanase, de destituer et de lui livrer un prêtre d'Axômis soupçonné d'être hérétique. Les deux états devaient donc être également civilisés; et cela d'autant plus que c'est un chrétien qui réclame contre des chrétiens l'assistance d'un païen. |
||||
30 av. J.C.-476 |
La côte occidentale de l'ArabieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe commerce avec l'Afrique méridionale était beaucoup moins important pour l'Egypte et pour l'empire romain que le commerce avec l'Arabie et avec les côtes situées plus à l'Est. La civilisation hellénique n'a pas pénétré dans la péninsule arabique. Il en aurait peut-être été autrement, si le roi Alexandre avait vécu une année de plus; la mort l'enleva au moment où il se préparait à visiter, en partant du golfe persique, et à occuper la côte méridionale de l'Arabie, déjà reconnue. Mais ce voyage, que le grand roi n'avait pas pu faire, aucun Grec après lui ne l'a entrepris. Néanmoins des relations actives s'étaient établies depuis très longtemps entre les deux côtes du golfe Arabique, que sépare un bras de mer assez étroit. Les expéditions maritimes au pays de Pount, l'encens, le bois d'ébène, les émeraudes, les peaux de léopard qu'on en rapportait comme butin, jouent un rôle important dans les récits égyptiens au temps des Pharaons. Nous avons déjà relaté que plus tard la partie septentrionale de la côte Ouest d'Arabie fut rattachée au royaume des Nabatéens, et tomba avec lui sous la domination romaine. C'était une côte déserte1; seul le port de Leuke-komé, la dernière ville de l'Etat nabatéen et par conséquent de l'empire romain, entretenait des relations par mer avec Béréniké, située en face de lui; en outre c'était le point de départ de la route de caravanes, qui conduisait à Pétra et de là aux ports de la Syrie méridionale; le commerce de l'Orient se reliait dans Leuke-komé à celui de l'Occident. Les territoires situés plus au Sud, au Nord et au Sud de la cité moderne de la Mecque, ressemblent par leur nature physique au pays des Troglodytes, situé sur la côte opposée; comme lui, ils n'ont eu dans l'antiquité aucune importance politique ni commerciale; ils ne semblent pas avoir été réunis sous un sceptre; ils ont été habités au contraire par des tribus nomades. 1. Dans l'intérieur des terres est située l'antique Teima, le fils d'Ismaël de la Genèse, citée au huitième siècle avant J.-C. par le roi Tiglath-Pilesar comme une de ses conquêtes, nommée par le prophète Jérémie à côté de Sidon; c'est un point de contact remarquable pour les relations de l'Assyrie, de l'Egypte et de l'Arabie; aujourd'hui que de hardis voyageurs l'ont révélée, les études orientales devront s'en occuper plus amplement. A Teima même, Euting a récemment trouvé des inscriptions araméennes d'une époque très ancienne (Noeldeke, Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1884, p. 813 et suiv.). De la ville assez voisine de Medainsalih (Hidjr) proviennent quelques monnaies frappées sur le modèle des monnaies attiques; le hibou de Pallas y est souvent remplacé par l'image de cette divinité, que les Egyptiens nomment Bésa le maître de Pount, c'est-à-dire de l'Arabie (Erman, Zeitschrift fur Numismatik, IX, p. 296 et suiv.). Nous avons déjà parlé des inscriptions nabatéennes découvertes dans le même lieu. Non loin de là, à Ola (el-Ally) l'on a trouvé des inscriptions qui ressemblent pour l'écriture et pour les noms de rois et de Dieux à celles des Minéens de l'Arabie méridionale; elles montrent que ce peuple a eu dans cette ville une station importante, à soixante jours de marche de sa patrie, mais sur la route citée par Eratosthène qui va de Minaea à AElana et que suivait le commerce de l'encens; on y a aussi trouvé d'autres inscriptions relatives à une tribu de l'Arabie méridionale, parente des Minéens, mais non pas identique à cette peuplade (D. H. Muller dans les Berichte der Wiener Akademie, 17 déc. 1884). Les inscriptions minéennes sont certainement antérieures à l'époque romaine. Lorsque Trajan annexa à l'empire le royaume des Nabatéens, il abandonna cette bande de terre; il se peut qu'une autre tribu de l'Arabie méridionale ait régné dès lors dans ce pays. |
||||
30 av. J.C.-476 |
L'Etat des HoméritesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais à l'extrémité méridionale du golfe habitait la seule peuplade arabique qui ait joué un rôle important avant l'Islam. Les Grecs et les Romains ont d'abord donné à ces Arabes le nom de la tribu la plus considérable à cette époque, les Sabéens; plus tard ils ont adopté le nom d'une autre tribu, celle des Homérites; quant à nous, nous les appelons le plus souvent les Himiarites, forme d'Homerites dans l'arabe moderne. La civilisation de ce peuple intéressant avait atteint un assez grand développement, longtemps avant que l'Egypte fût soumise aux Romains1. La patrie de cette peuplade, l'Arabie heureuse des anciens, la région de Moka et d'Aden, est bordée d'une côte plate, étroite, brûlante et déserte; mais l'intérieur du Yémen et de l'Hadramaout est sain et tempéré; les pentes des montagnes et les vallées sont couvertes d'une luxuriante végétation; les eaux nombreuses qui tombent des montagnes donnent à ce pays, lorsqu'il est bien cultivé, l'aspect d'un jardin. La riche et curieuse civilisation de cette contrée apparaît encore aujourd'hui vivante dans les restes de remparts, de tours, de constructions d'utilité publique, surtout hydrauliques, et de temples couverts d'inscriptions, qui confirment absolument ce que les écrivains anciens nous ont dit de la splendeur et du luxe de ces peuples; les géographes arabes ont écrit des livres entiers sur les forteresses et les châteaux des nombreux principicules du Yémen. On connaît surtout les ruines de la digue puissante qui arrêtait les eaux du fleuve Dana près de Mariaba, et qui permettait d'arroser les campagnes en amont2; pendant longtemps les Arabes ont compté leurs années à partir du moment où elle se rompit, ce qui obligea, dit-on, les habitants du Yémen à émigrer vers le Nord. Ce pays est un des plus anciens foyers du grand commerce par terre et par mer, non seulement parce que ses produits, l'encens, les pierres précieuses, la gomme, la casse, l'aloès, le séné, la myrrhe et beaucoup d'autres épices doivent être exportés, mais encore parce que cette tribu sémitique, comme celle des Phéniciens, était entièrement créée pour le commerce; de même que les voyageurs modernes, Strabon nous dit que les Arabes sont tous marchands et commerçants. Les monnaies d'argent sont chez eux anciennes et spéciales au pays; les pièces étaient frappées d'abord sur le modèle des pièces athéniennes, puis sur celui des monnaies romaines du temps d'Auguste; mais le titre en était particulier, probablement semblable à celui de Babylone. De cette région les antiques routes, suivies par les marchands d'encens, conduisaient à travers le désert aux comptoirs du golfe Arabique, AElana et Leuke-komé, déjà citée, puis de là aux entrepôts syriens de Petra et de Gaza3; ces routes commerciales de terre, qui depuis l'antiquité la plus reculée ont établi des relations entre l'Orient et l'Occident à côté des vallées du Nil et de l'Euphrate, ont probablement fondé en même temps la prospérité du Yémen. Mais le commerce maritime s'y ajouta bientôt; la principale étape en fut Adanè, aujourd'hui Aden. De là, les marchandises partaient, par mer, et certainement sur des vaisseaux arabes, pour ces comptoirs du golfe Arabique que nous venons de mentionner; elles se dirigeaient ensuite vers les ports de la Syrie ou bien vers Bérénikè et Myos-Hormos, pour gagner de là Koptos et Alexandrie. Nous avons déjà dit que, de très bonne heure, ces mêmes Arabes s'emparèrent de la côte opposée, et introduisirent en Abyssinie leur langue, leur écriture et leur civilisation. Si Koptos, l'entrepôt du commerce oriental sur le Nil, comptait comme habitants autant d'Arabes que d'Egyptiens, si même les mines d'émeraude, situées au-dessus de Bérénike (près de Djebel-Zebara), étaient exploitées par des Arabes, c'est qu'ils étaient maîtres du commerce dans l'Etat même des Lagides, jusqu'à un certain point; et l'on comprendra mieux pourquoi le gouvernement égyptien a gardé une attitude passive dans le golfe Arabique, pourquoi il n'a entrepris qu'une seule expédition contre les pirates4, si un empire maritime puissant et organisé dominait cette région. Nous rencontrons les Arabes du Yémen même hors du golfe qui porte leur nom. Adanè resta jusque pendant l'empire romain une étape pour les relations d'une part avec l'Inde, d'autre part avec l'Egypte; elle prospéra tellement, malgré la situation peu favorable qu'elle occupait sur une côte dépourvue d'arbres, que la région lui doit certainement d'avoir été appelée l'Arabie heureuse. L'autorité que de nos jours de Mascate, établi dans le Sud-Est de la péninsule, exerce sur les îles de Socotora et de Zanzibar et sur la côte orientale de l'Afrique au Sud du cap Guardafoui, appartenait sous Vespasien depuis longtemps aux princes de l'Arabie; l'île des Dioskorides, aujourd'hui Socotora, obéissait alors au roi d'Hadramaout; Azania, c'est-à-dire la côte de Somal et les régions situées plus au Sud, était soumise à l'un des vice-rois de son voisin de l'Ouest, le prince des Homérites. Le point le plus méridional de la côte orientale de l'Afrique que les négociants égyptiens connussent, Rhapta, dans les environs de Zanzibar, était concédé par ce prince, moyennant tribut, aux négociants de Mouza, presque la moderne Moka, qui envoient dans ce pays leurs navires de commerce, montés le plus souvent par des capitaines et des matelots arabes, habitués à traiter avec les indigènes, unis souvent à eux par les liens du mariage, connaissant le pays et la langue courante. L'agriculture et l'industrie se joignaient au commerce; dans les plus riches maisons de l'Inde, on buvait du vin d'Arabie, à côté du falerne italien et du cru syrien de Laodicée; les lances et les alènes de cordonniers, que les indigènes de la côte de Zanzibar achetaient aux marchands étrangers, étaient fabriquées à Mouza. Ainsi cette région, qui d'ailleurs vendait beaucoup et achetait peu, était l'une des plus riches du monde. Il est impossible de déterminer, pour l'époque antérieure à la domination romaine et pour les premiers temps de l'empire, dans quelle mesure le développement politique de l'Arabie a suivi sa prospérité économique; tout ce que l'on peut tirer aussi bien des renseignements fournis par les Occidentaux que des inscriptions du pays, c'est que l'extrémité Sud-Ouest de la péninsule était partagée en territoires d'étendue moyenne soumis à des princes indépendants. On trouvait là, auprès des Sabéens, les plus célèbres de ces tribus, et des Homérites, les Chatramotites, dont nous avons déjà parlé, qui habitaient l'Hadramaout, et plus au Nord dans l'intérieur des terres les Minéens; chacun de ces peuples avait son souverain particulier. A l'égard des Arabes du Yémen, les Romains ont suivi la politique exactement contraire de celle qu'ils adoptèrent vis-à-vis des Axômites. Auguste, dont le premier principe de gouvernement était de ne pas étendre les frontières de l'empire, et qui abandonna presque tous les projets de conquête de son père et modèle, fit une exception pour la côte Sud-Ouest de l'Arabie, et de son plein gré prit l'offensive contre les peuplades de cette contrée. Ce qui le décida à agir ainsi, c'est la situation que ce groupe de tribus occupait alors dans les relations commerciales de l'Inde et de l'Egypte. Pour donner à la province la plus importante de son empire, politiquement et financièrement, la prospérité économique, dont ses prédécesseurs ne s'étaient pas occupés ou qu'ils avaient laissée déchoir, il devait assurer avant tout les communications entre l'Europe d'une part, l'Arabie et l'Inde de l'autre. Le Nil rivalisait depuis longtemps non sans succès, comme voie commerciale, avec les routes de l'Arabie et de l'Euphrate; mais, comme nous l'avons vu, l'Egypte elle-même ne jouait, au moins sous les derniers Lagides, qu'un rôle secondaire. Ce n'était pas avec les Axômites, mais bien avec les Arabes qu'il fallait lutter sur le terrain économique; pour que de passif, le commerce égyptien devînt actif, pour que d'indirect il devint direct, il fallait que les Arabes fussent écrasés; tel est le but qu'Auguste s'est donné et que le gouvernement romain a en quelque sorte atteint. 1. Les renseignements que Théophraste (+ 187 av. J.-C.), nous donne sur le commerce de l'encens (Hist. plant., IX, 4), et les détails plus complets que nous trouvons dans Erastothène (+ 194 av. J.-C.) et dans Strabon, VI, 4, 2, p. 768 sur les quatre grandes tribus des Minéens (Mamali, Théophraste?) dont la capitale est Karna; des Sabéens (Saba, Théophr.), capitale Mariaba; des Kattabans (Kitibaena, Theophr.), capitale Tanina, et des Chatramotites (Hadramyta, Theophr.), capitale Sabata; tous ces documents, dis-je, embrassent la région où s'est développé l'empire des Homérites, et montrent les débuts de cet Etat. Les Minéens longtemps cherchés sont maintenant fixés avec certitude à Ma'in, dans l'intérieur des terres au-dessus de Marib et d'Hadramaout, où l'on a découvert des centaines d'inscriptions et relevé déjà jusqu'à vingt-six noms de rois. Mariaba s'appelle encore aujourd'hui Marib; le pays de Chatramotis ou Chatramitis est l'Hadramaout. 2. Les ruines curieuses de ce monument construit avec une précision parfaite et une très grande habileté sont décrites par Arnaud (Journal asiatique, 7e série, tome III, 1874, p. 3 et suiv. avec des plans; cf. Ritter, Erdkunde, XII, p. 861). Sur les deux côtés de la digue, aujourd'hui presque entièrement détruite, on voit deux constructions en pierres de taille de forme conique presque cylindrique, entre lesquelles se trouve une ouverture pour l'eau qui coule du bassin; un canal aux parois couvertes de caillous conduit l'eau à cette ouverture, au moins sur un côté. Cette ouverture était jadis fermée par des planches placées les unes sur les autres, que l'on pouvait enlever isolément, pour laisser couler l'eau suivant les besoins. L'un de ces cylindres de pierre porte l'inscription suivante (d'après la traduction de D. H. Muller, qui n'est pas définitive dans tous ses détails, Wienersitzungsberichte, t. XCVII, 1880, p. 965). Jata'amar le magnifique, fils de Samah'ali le grand, prince de Saba, a fait percer le [mont] Balap et (construire] l'aqueduc nommé Rahab pour faciliter l'irrigation. Nous manquons de points de repère certains pour fixer chronologiquement ce nom de roi et les autres noms royaux des inscriptions sabéennes. Le roi d'Assyrie, Sargon, dit dans l'inscription de Khorsabad, après avoir raconté la défaite du roi de Gaza, Hanno, en l'an 716 av. J.-C. : Je reçus les tributs de Pharaon, roi d'Egypte, de Schamsijja, reine d'Arabie, et d'Ithamara, le Sabéen : de l'or, des plantes d'Orient, des esclaves, des chevaux et des chameaux (Muller, loc. cit., p. 988; Duncker, Gesch. des Alt., II, 5 edit., p. 327). 3. Pline (Hist. nat., XII, 14, 65) nous apprend que pour transporter de la côte arabique jusqu'à Gaza par la voie de terre l'encens, qui forme la charge d'un chameau, les frais s'élèvent à 688 deniers. Pendant tout le voyage, dit-il, il faut payer le pâturage, l'eau, les caravansérails, et les différents droits; les prêtres et les scribes royaux exigent certaines portions; en outre les gardes, les satellites, les gardes du corps et les serviteurs extorquent leur part; enfin il faut acquitter les droits d'entrée dans notre empire. Tous ces frais intermédiaires n'existaient pas avec le transport par mer. 4. Le châtiment des pirates est raconté par Agatharchides, dans Diodore (III, 43) et dans Strabon (XVI, 4, 18, p. 777). Ezion-Gaber, en Palestine, sur le golfe élanitique, a vuv Bepsvin zadeibai (Josèphe, Ant., VIII, 6, 4) doit certainement son nom, non pas à une Egyptienne (Droysen, Hellenismus, III, 2, 349), mais à la Juive aimée par Titus. |
||||
27-25 av. J.C. |
Expédition de GallusRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteDans la sixième année de son règne en Egypte (fin de 729= 25 av. J.-C.), Auguste envoya contre les états du Yémen une flotte de 80 vaisseaux de guerre et de 130 bâtiments de transport, spécialement préparée pour cette expédition, ainsi que la moitié de l'armée égyptienne, un corps de 10000 hommes, sans compter les auxiliaires fournis par les deux rois vassaux les plus voisins, le roi des Nabatéens, Obodas, et le roi des Juifs Hérodes; ces troupes devaient ou soumettre ou au moins ruiner ces royaumes arabes1; l'empereur songeait bien aussi aux trésors amassés dans ce pays. Mais l'expédition échoua complètement, par l'incapacité, il est vrai, du chef Gaius AElius Gallus, qui était alors gouverneur de l'Egypte2. Comme il ne s'agissait ni d'occuper ni de conquérir la côte qui s'étend depuis Leukè-Komè jusqu'à la frontière des territoires ennemis, l'expédition devait être immédiatement dirigée contre le Yémen, et l'armée devait être directement transportée du port le plus méridional de l'Egypte dans l'Arabie heureuse3. Au contraire la flotte fut préparée dans le port le plus septentrional, à Arsinoë (Suez); puis l'armée fut débarquée à Leukè-Komè, comme si l'on avait voulu allonger à plaisir la route de la flotte et la marche des troupes. En outre les vaisseaux de guerre étaient inutiles, puisque les Arabes n'avaient pas de flotte militaire; les matelots romains ne savaient pas se diriger le long de la côte Arabique, et les bâtiments de transport, quoique spécialement construits pour cette campagne, étaient impropres à leur destination; les pilotes se perdaient sur les bas fonds et sur les écueils. Le voyage seul d'Arsinoë à Leuke-Komé dans les eaux romaines coûta beaucoup d'hommes et de navires. On passa l'hiver à Leuke-Komè; l'expédition en pays ennemi commença au printemps de l'année 730. L'obstacle fut non pas les Arabes, mais l'Arabie. Toutes les fois que les doubles haches, les frondes et les arcs se heurtaient au pilum et à l'épée des Romains, les indigènes disparaissaient comme la poussière que chasse le vent; mais les maladies endémiques de la contrée, le scorbut, la lèpre, la paralysie décimèrent les soldats plus cruellement que la bataille la plus sanglante, d'autant plus que le général ne sut pas porter rapidement en avant cette lourde armée. Les troupes romaines arrivèrent pourtant jusque sous les murs de Mariaba, la capitale des Sabéens qui furent attaqués les premiers. Mais les habitants, après avoir fermé les portes de leurs puissants remparts, qui se sont conservés jusqu'à nos jours4, résistèrent énergiquement. Le général romain désespérant d'accomplir la tâche dont il était chargé, quitta la ville au bout de six jours et battit en retraite; les Arabes ne l'inquiétèrent pas sérieusement, et le retour s'effectua relativement vite, sous l'action de la nécessité; mais l'on perdit beaucoup d'hommes. 1. Tel était le but véritable de l'expédition (Strabon, XVI, 4, 22,; 4, , p. 780; ?] ?; id., XVII, 1, 53, p. 819); néanmoins on ne dissimulait pas l'espérance d'emporter un riche butin, qui devait être alors bien venu dans l'aerariuin. 2. Le récit de Strabon (XVI, 4, 22 et sq., p. 780) sur l'expédition en Arabie de son ami Gallus (Strabon, II, 5, 12, p. 118), à la suite duquel il avait visité l'Egypte, est certainement consciencieux et honnête comme tous ceux de Strabon, mais il a été visiblement accepté par un ami sans critique. Le combat, qui couta la vie à 10000 ennemis et à deux Romains, ainsi que le nombre total des soldats qui furent victimes de cette expédition, nombre qui est de sept, se condamnent eux-mêmes; Strabon n'est pas plus heureux lorsqu'il essaie d'attribuer l'échec à une trahison du ministre nabatéen Syllaeos, comme font tous les généraux vaincus. Ce Syllaeos servit toujours de bouc émissaire; quelques années plus tard, il fut accusé par Hérodés, poursuivi sur l'ordre d'Auguste, condamné et exécuté (Josèphe, Ant. Jud., XVI, 10); mais, quoique nous possédions la version de l'accusateur, qui fut envoyé à Rome par Hérodés, nous n'y trouvons pas trace de cette prétendue trahison. Il est absurde de supposer, comme le fait Strabon, que Syllaeos, sujet d'un état vassal de Rome, ait eu l'intention de détruire d'abord les Arabes par les Romains, puis d'écraser ceux-ci; on croirait plutôt que Syllaeos fut hostile à l'expédition, parce qu'elle pouvait nuire au commerce qui traversait le pays des Nabatéens. Mais accuser de trahison le ministre arabe, parce que les transports romains ne purent pas longer la côte d'Arabie ou parce que l'armée romaine fut obligée d'emporter son eau à dos de chameau, et de manger des grains de blé et des dattes au lieu de pain et de viande ou du beurre en guise d'huile; mais affirmer que Gallus a été trompé par ses guides, pour le disculper d'avoir fait à l'aller en 180 jours un chemin qu'il parcourut à son retour en 60 journées; mais critiquer l'observation parfaitement juste de Syllaeos, qui déclarait impossible d'aller par terre d'Arsinoë à Leuke-Komè, en disant qu'une route de caravanes conduit de ce port à Petra; tout cela nous montre seulement ce qu'un riche Romain pouvait faire croire à un littérateur grec. 3. La critique la plus vive de cette expédition se trouve dans les renseignements que le marchand égyptien nous donne sur l'état de la côte arabique depuis Leukè-Komé (el Haoura, au Nord de Janbo, le port de Médine) jusqu'à l'île Katakekaumene (Djebel-Tair près de Lohaia): Cette côte est habitée par divers peuples, qui parlent des langues tantôt peu, tantôt complètement différentes les unes des autres. Sur le rivage même ils habitent dans des huttes, comme les Ichthyophages de la côte opposée (il décrit ces huttes au c. 2: elles sont isolées les unes des autres et installées dans les fentes des rochers); dans l'intérieur du pays ils sont réunis en villages groupés autour de pâturages communs; ce sont des hommes cruels, qui parlent deux langues, qui pillent les navigateurs égarés et qui emmènent les naufragés en esclavage. Aussi les princes et les vice-rois de l'Arabie leur font-ils continuellement la chasse; ils portent le nom de Kanraïtes ou Kassanites). D'ailleurs la navigation est dangereuse sur toute cette côte; le rivage est dépourvu de ports et inaccessible, bordé de mauvais écueils, sans profondeur, en un mot très périlleux. Aussi, lorsque nous naviguons dans ces eaux, nous nous tenons au milieu du golfe, et nous nous hâtons de gagner l'île Katakekaumene, située en territoire arabe; à partir de cet endroit les habitants sont hospitaliers, et l'on trouve des troupeaux nombreux de brebis et de chameaux. C'est de même à cette région, qui sépare l'empire romain de l'état des Homérites, c'est à cet aspect du pays que songe le roi d'Axômis, lorsqu'il écrit: ? (cf. Ptolermee, VI, 7, 20). 4. Ces murs, construits en pierre de taille, forment un cercle d'un quart de lieue de diamètre. Ils sont décrits par Arnaud (loc. cit., cf. p. 604, n. 2). |
||||
30 av. J.C.-476 |
Expéditions postérieures contre les ArabesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteC'était un grave échec; Auguste ne renonça pas pourtant à la conquête de l'Arabie. Nous avons déjà raconté, que le voyage d'Orient, entrepris en l'année 753 par le prince héritier Gaius, devait se terminer en Arabie; on projetait cette fois d'atteindre les embouchures de l'Euphrate, après avoir soumis l'Arménie d'accord avec le gouvernement parthe ou, s'il le fallait, en détruisant ses armées; puis de se diriger vers l'Arabie heureuse par la route maritime, que l'amiral Néarque avait jadis explorée pour Alexandre1. Ces espérances furent détruites d'une autre façon, mais non moins malheureusement, par la flèche parthe qui atteignit le jeune prince sous les murs d'Artageira. Avec lui fut enterré pour toujours le projet de conquérir l'Arabie. La grande péninsule, sauf les côtes Nord et Nord-Ouest, garda pendant tout l'empire cette indépendance de laquelle devait sortir en temps voulu l'Islam. Mais le commerce des Arabes fut frappé à mort, soit par les mesures que prit le gouvernement romain pour protéger la navigation égyptienne, nous en parlerons plus loin - soit par l'expédition que les Romains dirigèrent contre le principal comptoir du commerce indo-arabique. Peut-être sous Auguste, lorsque l'on préparait l'invasion que Gaius devait conduire en Arabie, peut-être sous un de ses successeurs immédiats, une flotte romaine parut-elle devant Adané et détruisit-elle la place; au temps de Vespasien cette ville n'était plus qu'un village, et sa prospérité s'était évanouie. Nous ne connaissons que le fait isolé2; mais il est assez significatif. La ruine d'Aden, qui fait pendant à la destruction de Corinthe et de Carthage sous la République, n'a pas eu moins de conséquences; elle a assuré au commerce égypto-romain la suprématie dans le golfe Arabique et dans la mer des Indes. 1. Pline dit expressément (surtout Hist. nat., XII, 14, 55, 56; cf. II, 67, 168; VI, 27, 141; 28, 160; et XXXII, 1, 10) que l'Arabie était le but extrême de l'expédition de Gaius en Orient. Gaius devait s'embarquer aux bouches de l'Euphrate; cela résulte de ce qu'il devait auparavant faire une expédition en Arménie et négocier avec le gouvernement parthe. Aussi les renseignements rassemblés par Juba, avant le départ du prince, reposaient-ils surtout sur les récits que les généraux d'Alexandre avaient faits de leur exploration en Arabie. 2. Le seul récit de cette curieuse expédition a été conservé par le capitaine égyptien, qui a raconté vers l'année 75 son voyage sur les côtes de la mer Rouge. Il parle de l'Adané des écrivains postérieurs, aujourd'hui Aden, comme d'un village situé sur la côte, qui relève du roi des Homérites, Charibael, mais qui était jadis une ville florissante et qui en a tiré son nom, parce qu'avant l'établissement des communications directes entre l'Inde et l'Egypte cette cité était la principale étape du commerce: ?. Ce dernier mot ne peut pas se traduire, comme on le fait d'habitude par soumettre, mais par détruire; il faut que la transformation de cette ville en un village ait une cause. Au lieu de Katoap, Schwanbeck (Rhein. Mus., nouvelle série, VII, p. 353) a proposé de lire ?ria, et C. Muller Ihaoap (à cause de Strabon, XVI, 4, 21, p. 782). Ces deux hypothèses sont inadmissibles; la seconde, parce que ce prince arabe régnait dans un district trop éloigné, et qu'il ne peut pas être mentionné comme un roi connu; la première, parce que Charibaël était contemporain de l'écrivain, et que l'événement cité est de beaucoup antérieur à la composition de l'ouvrage. On admettra sans difficulté la tradition, si l'on se rend compte de l'intérêt que les Romains devaient avoir à détruire ce comptoir arabe entre l'Inde et l'Egypte et à établir des communications directes. Le silence des documents romains sur cet événement est conforme à leur caractère lui-même; cette expédition, qui fut conduite sans aucun doute par une flotte égyptienne et qui consista tout simplement à démolir un port sans défense, ne doit avoir eu aucune importance militaire. Les annalistes ne se sont jamais occupés du grand commerce; d'autre part l'histoire d'Egypte était connue du sénat et par conséquent des annalistes bien moins encore que celle des autres provinces impériales. Le mot isolé de Kaisap, qui, d'après le texte, ne saurait désigner l'empereur régnant, s'explique par cette circonstance, que le capitaine historien connaissait bien en elle-même la destruction de la ville par les Romains, mais qu'il n'en savait ni la date ni l'auteur. Peut-être le passage suivant de Pline (Hist. nat., II, 67, 168) concerne-t-il cet épisode : majorem (Oceani) partem et Orientis victoriae magni Alexandri lustravere usque in Arabicum si num, in quo res gerente C. Caesare Aug. f. signa navium ex Hispaniensibus naufragiis feruntur agnita. Gaius ne vint pas en Arabie (ibid., VI, 28, 160); mais il se peut que, pendant l'expédition d'Arménie, une escadre romaine, partie d'Egypte, ait été conduite sur cette côte par un des lieutenants du prince, pour préparer la grande expédition. Nous ne devons pas trouver étrange le silence qui règne encore sur ces événements; l'expédition de Gaius avait été si bruyamment annoncée et si piteusement abandonnée, que les historiographes officiels avaient toutes sortes de raisons pour omettre le récit d'un épisode qu'ils ne pouvaient pas citer, sans signaler en même temps l'échec du plan général. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Histoire postérieure des HoméritesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais la prospérité de l'heureux pays du Yémen avait des racines trop solides, pour être ruinée par cette catastrophe; c'est peut-être à cette époque qu'il s'est le plus resserré sur lui-même au point de vue politique. Mariaba n'était sans doute que la capitale des Sabéens, lorsque les armes de Gallus vinrent échouer contre ses murs; mais déjà à cette époque la tribu la plus puissante de l'Arabie heureuse était celle des Homérites, dont la capitale Sapphar est située dans l'intérieur des terres un peu au Sud de Mariaba. Un siècle plus tard nous trouvons les deux peuplades des Homérites et des Sabéens réunies sous un seul roi qui règne à Sapphar, et qui domine sur Moka, sur Aden, et, comme nous l'avons déjà dit, sur l'île de Socotora ainsi que sur la côte de Somal et de Zanzibar; et c'est au moins à partir de ce moment que l'on peut parler d'un empire des Homérites. Le désert qui s'étend au Nord de Mariaba jusqu'à la frontière romaine ne leur était pas alors soumis et ne dépendait d'aucune autorité constituée1; de même les principautés des Minéens et des Chatramotites gardèrent leurs souverains indépendants. La partie orientale de l'Arabie a toujours été comprise dans l'empire perse, et n'a jamais été sujette des maîtres de l'Arabie heureuse. L'Etat des Homérites était donc renfermé même à cette époque dans des limites étroites qui ne sont pas élargies; l'on connaît fort peu son histoire postérieure2. Au milieu du IVe siècle l'empire des Homérites était réuni à celui des Axômites; le souverain résidait à Axômis3; mais plus tard les Arabes ont secoué cet esclavage. A la fin de l'empire romain, l'Etat des Homérites, isolé ou réuni au royaume d'Axômis, est toujours resté indépendant dans ses rapports avec Rome. 1. Le marchand égyptien distingue expressément l'Evoeculo; des Homérites (c. 13) des pupavvo!, chefs de tribus tantôt soumis à ce roi, tantôt indépendants (c. 14), et non moins expressément cet Etat organisé de la barbarie des habitants du désert (c. 2). Si Strabon et Tacite avaient eu pour ces sortes de choses d'aussi bons yeux que ce commerçant, nous connaitrions davantage l'antiquité. 2. La guerre de Macrin contre les Arabes eudaimories (Vila, 12) et les présents envoyés par eux à Aurélien (Vita, 33), qui sont cités en même temps que ceux des Axômites, prouveraient que ces peuples étaient encore indépendants à cette époque, si l'on pouvait se fier avec certitude à de pareils renseignements. 3. En l'an 356 (p. 224, n. 1), dans un document (Corp. insc. graec., 5128) le roi se donne le titre de ? "Oumpitov za! Toll 'Pastozv (château de Sapphar, la capitale des Homérites : Dillmann, Abh. der Berl. Akad., 1878, p. 207) za! va! ToU Ltden (château de Mariaba, capitale des Sabéens: Dillmann, loc. cit.). Il faut en rapprocher l'ambassade envoyée à la même époque ad gentem Axumitarum et Homerita[rum] (Cod. Theod., XII, 12, 2). Pour l'histoire postérieure cf. surtout Nonnosus (Fr. hist. Gr., IV, p. 179, ed. Muller) et Procope (Hist. Pers., I, 20). |
||||
30 av. J.C.-476 |
Commerce des HoméritesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Arabes du Sud-Ouest de la péninsule ont continué d'occuper dans le commerce et la navigation du monde, sinon le premier rang, du moins une place prépondérante pendant toute la durée de l'empire romain. Après la destruction d'Adané, ce fut Mouza qui devint la métropole commerciale de cette contrée. La description que nous avons donnée plus haut s'applique encore pour l'essentiel à l'époque de Vespasien. Cette ville nous est alors signalée comme exclusivement arabe, habitée par des armateurs et des marins, et pleine d'une activité commerciale très vive. Sur leurs navires les gens de Mouza parcourent toute la côte orientale de l'Afrique et la côte occidentale de l'Inde; non seulement ils exportent les produits de leur pays, mais encore ils vendent aux Orientaux les étoffes de pourpre et les broderies d'or fabriquées par l'industrie occidentale suivant le goût des peuples de l'Orient, les vins fins de la Syrie et de l'Italie; aux Occidentaux ils apportent les marchandises précieuses de l'Orient. Dans le commerce de l'encens et des autres aromates Mouza et le port de l'empire voisin d'Hadramaout, Kane, à l'Est d'Aden, doivent avoir conservé toujours une sorte de monopole effectif. L'encens, dont on usait dans l'antiquité beaucoup plus que de nos jours, se cultivait sur la côte méridionale de l'Arabie, et sur la côte africaine depuis Adulis jusqu'à la Pointe des Aromates (cap Guardafoui); mais c'étaient les négociants de Mouza qui allaient l'y chercher et qui le lançaient dans le commerce du monde. Dans l'île des Dioscorides, dont nous avons déjà parlé, était établi un comptoir commercial commun aux trois grands peuples maritimes de ces régions, les Hellènes, c'est-à-dire les Egyptiens, les Arabes et les Indiens. Mais, dans le pays du Yémen, on ne trouve aucune trace de relations avec l'hellénisme, comme nous en avons découvert chez les Axômites sur la côte opposée; les monnaies arabes étaient frappées au même coin que celles d'Occident; mais cette marque était connue dans tout l'Orient. Au contraire, l'écriture, la langue et l'art se sont développés dans ce pays aussi indépendamment que le commerce et la navigation, autant que nous en pouvons juger; il en est résulté certainement que les Axômites, après avoir soumis politiquement les Homérites, abandonnèrent l'hellénisme pour la civilisation arabe. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Les routes de terre et les ports de l'EgliseRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAuguste d'abord, puis sans doute tous les empereurs intelligents se sont occupés en Egypte même des routes commerciales, dans le même sens, mais avec plus de succès qu'ils n'avaient fait pour l'Afrique méridionale et les états de l'Arabie. Le système de routes et de ports, organisé sur le modèle des Pharaons par les premiers Ptolémées, avait été ruiné, comme toute leur administration, pendant les troubles qui signalèrent le règne des derniers Lagides. Personne ne nous dit expressément qu'Auguste ait rétabli les routes de terre et de mer et les ports de l'Egypte; mais il n'en est pas moins certain que cette oeuvre fut accomplie. Koptos est restée pendant tout l'empire le noeud de ces communications1. Un document récemment découvert nous démontre que dans les premiers temps de l'empire les deux routes qui conduisaient de Koptos aux ports de Myos-Hormos et de Béréniké furent réparées par les soldats romains et pourvues dans les meilleurs endroits des citernes indispensables2'. Le canal, qui faisait communiquer la mer Rouge avec le Nil et par conséquent avec la mer Méditerranée, ne joua qu'un rôle secondaire à l'époque romaine; il servit surtout probablement au transport des blocs de marbre et de porphyre que l'on dirigeait de la côte orientale de l'Egypte vers la mer Méditerranée; mais il resta navigable pendant tout l'empire. Trajan l'a réparé et même élargi; peut-être est-ce lui qui l'a dirigé vers Babylone (près du Caire), où le Nil coule encore dans un lit unique, et qui a par conséquent augmenté le volume des eaux; peut-être est-ce aussi Trajan qui lui a donné le nom de fleuve Trajan ou de l'empereur (Augustus amnis), d'où cette partie de l'Egypte s'est plus tard appelée Augustamnica. 1. Aristide (Or., 48, p. 485, ed. Dindorf) dit que Koptos est l'étape sur la route qui mène vers l'Inde et l'Arabie. Dans le roman de l'éphésien Xénophon (IV, 1) les pillards de Syrie se dirigent sur Koptos : car là passe une foule de marchands qui se rendent en Ethiopie et dans l'Inde. 2. Plus tard Hadrien construisit la nouvelle route d'Hadrien, qui conduisait de sa chère ville d'Antinoüs près d'Hermoupolis, sans doute à travers le désert jusqu'à Myos-Hormos et de Myos-Hormos à Bérénike, le long de la mer; il y fit creuser des puits; il installa des gites d'étapes (50.0) et des postes militaires (cf. une inscription publiée dans la Revue archéol., nouvelle série, XXI, 1870, p. 314). Mais plus tard il n'est pas question de cette route et l'on peut se demander si elle a subsisté. |
||||
30 av. J.C.-476 |
La piraterieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAuguste s'est encore occupé très sérieusement et très activement d'écraser la piraterie dans la mer Rouge et dans la mer des Indes; longtemps après sa mort, les Egyptiens le remerciaient d'avoir chassé de leur mer les voiles des pirates et d'avoir assuré la route aux navires de commerce. Il est vrai que ces mesures étaient loin de suffire. Le gouvernement envoya bien de temps en temps une escadre dans ces parages, mais il n'y fit jamais stationner une flotte permanente; les navigateurs romains, qui se rendaient dans la mer des Indes, durent prendre à leur bord des troupes, pour repousser les attaques des pirates; tout cela nous étonnerait, si nous ne savions pas que le gouvernement impérial, ou plutôt le gouvernement romain se désintéressa toujours relativement, par une négligence coupable, des dangers que l'on courait sur toutes les mers, aussi bien dans la région dont nous nous occupons que sur les côtes de la Belgique ou sur celles de la mer Noire. Sans doute les états d'Axômis et de Sapphar étaient destinés par leur situation géographique, plutôt que les Romains de Béréniké et de Leuke-Komé, à réprimer la piraterie; c'est pourquoi probablement Rome est restée généralement en bonne intelligence avec ces voisins plus faibles ou dont le concours lui était indispensable. |
||||
30 av J.C.-476 |
Extension de l'activité commerciale des Egyptiens en OrientRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNous avons montré plus haut que, pendant la période qui précéda immédiatement la domination romaine, les relations commerciales entre l'Egypte et, sinon Adulis, du moins l'Arabie et l'Inde, n'étaient pas entre les mains des Egyptiens eux-mêmes. C'est grâce aux Romains que l'Egypte fit le grand commerce avec l'Orient. Sous les Ptolémées, dit un contemporain d'Auguste, il n'y avait pas vingt vaisseaux égyptiens par an, qui osassent sortir du golfe Arabique; maintenant du seul port de Myos Hormos, cent vingt navigateurs partent annuellement pour l'Inde. Les bénéfices, que jusqu'alors le commerçant romain avait dû partager avec l'intermédiaire perse ou arabe, lui appartinrent entièrement depuis l'ouverture des communications directes avec l'extrême Orient. Il est probable que l'on a d'abord obtenu ce résultat, non pas en interdisant par une loi l'accès des ports égyptiens aux bâtiments arabes et indiens, mais en leur imposant des droits différentiels, qui leur enfermaient réellement l'entrée1; la situation commerciale ne peut avoir été aussi subitement modifiée que par un tel acte de navigation, en faveur des négociants indigènes. Mais on ne se contenta pas de donner à la vie commerciale une activité puissante; le chiffre des affaires fut augmenté en lui-même, soit parce que l'Occident voulut acheter plus de produits orientaux, soit parce que le transit à travers l'Arabie et la Syrie coûtait plus cher que par l'Egypte. Cette nouvelle route apparut de plus en plus comme la plus courte et la plus commode pour le commerce de l'Arabie et de l'Inde avec l'Occident. L'encens, qui jadis venait presque toujours par les routes de terre qui traversaient l'Arabie centrale et aboutissaient à Gaza, fut désormais transporté le plus souvent par mer en Egypte. A l'époque de Néron le commerce avec l'Inde prit un nouvel essor, lorsque le savant et hardi capitaine égyptien Hippalos, au lieu de longer les côtes très développées, eut osé, en sortant du golfe Arabique, se diriger droit vers l'Inde à travers la pleine mer; il connaissait la mousson, nommé plus tard l'Hippalos par les navigateurs qui suivirent la même route. Désormais non seulement le voyage était beaucoup plus court, mais encore les vaisseaux étaient moins exposés aux attaques des pirates de terre et de mer. La sécurité et le luxe toujours croissant firent augmenter considérablement en Occident la consommation des produits orientaux : ce qui le prouve, c'est que, sous Vespasien, on se plaignait amèrement que des sommes aussi importantes sortissent ainsi de l'empire. Pline évalue le total des sommes payées chaque année aux Arabes et aux Indiens à 100 millions de sesterces, pour l'Arabie seule à 55 millions de sesterces, dont une partie, il est vrai, était balancée par l'exportation des produits de l'Occident. Les Arabes et les Indiens achetaient aux Romains des métaux, fer, cuivre, étain, zinc, arsenic, les articles égyptiens énumérés plus haut, le vin, la pourpre, des ustensiles d'or et d'argent, puis des pierres précieuses, du corail, du baume de safran; mais ils approvisionnèrent toujours le luxe étranger beaucoup plus qu'ils ne demandèrent aux autres pays pour le leur. C'est pourquoi l'or et l'argent monnayés des Romains se répandirent en quantités considérables dans les ports de l'Arabie et de l'Inde. La monnaie romaine fut même si abondante sous Vespasien dans l'Inde, qu'on l'y vendait avec prime. La plus grande partie de ce commerce avec l'Orient fut faite par l'Egypte; si cette prospérité économique profita au trésor impérial en augmentant les recettes de la douane, elle ne fut pas moins utile à l'industrie privée en la forçant à construire des vaisseaux et à envoyer elle-même des expéditions commerciales. Ainsi le gouvernement romain limita sa domination en Egypte à un espace restreint; il ne dépassa pas le point où le Nil commence à être navigable; soit par crainte, soit par sagesse, en tout cas avec une persévérance remarquable, il refusa de conquérir la Nubie et l'Arabie; mais en même temps il ne poursuivait pas moins énergiquement la conquête du grand commerce avec l'Arabie et l'Inde; il réussit au moins à diminuer, dans une forte mesure, la puissance de ses concurrents. Le souci suprême des intérêts commerciaux caractérise la politique du principat, surtout en Egypte, comme celle de la République. 1. Nulle part cela n'est dit expressément; mais le fait lui-même ressort du Périple de l'Egyptien. Il parle en plusieurs endroits du commerce de l'Afrique non romaine avec l'Arabie (c. 7, 8) et réciproquement du commerce des Arabes avec l'Afrique non romaine (c. 17, 21, 31; cf. Ptolemee, 1, 17, 6), avec la Perse (c. 27, 33) et l'Inde (c. 21, 27, 49); il mentionne de même le commerce des Perses avec l'Inde, celui des navigateurs indiens avec l'Afrique non romaine (c. 14, 31, 42), avec la Perse (c. 36) et l'Arabie (c. 32). Mais il ne dit nulle part que ces négociants étrangers viennent aussi à Bérénike, à Myos-Hormos, à Leuke-Komè; il remarque même, à propos de Mouza, la ville de commerce la plus importante de toute cette région, que ces négociants gagnent avec leurs vaisseaux la côte africaine en dehors du détroit de Bab-el-Mandeb (c'est pour lui to tepar) et l'Inde. Il est impossible que dans cette énumération l'Egypte ait été oubliée par hasard. |
||||
30 av J.C.-476 |
Relations commerciales de Rome avec l'IndeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteOn ne peut déterminer qu'approximativement jusqu'où le commerce direct des Romains s'est étendu dans l'Orient. Il s'est d'abord dirigé sur Barygaza (Barôtch, dans le golfe de Cambaye, au-dessus de Bombay); cette grande place de commerce a dû rester pendant tout l'empire le centre du commerce indo-égyptien; plusieurs villes de la péninsule de Goudjerat portent chez les Grecs des noms grecs, comme Naustathmos et Théophila. A l'époque des Flaviens, où l'on avait déjà pris l'habitude de profiter des moussons pour se rendre dans l'Inde, toute la côte occidentale de l'Inde antérieure était alors ouverte aux négociants romains jusqu'à la côte de Malabar; ils allaient y chercher le poivre très estimé et très cher, dans les ports de Mouziris (probablement Mangalourou) et de Nelkynda (en indien Nîlakantha, d'après un surnom du dieu Chiva - aujourd'hui sans doute Nilêsvara). Beaucoup plus au Sud, à Kananor, on a trouvé de nombreuses pièces d'or romaines de l'époque julio-claudienne, contre lesquelles on avait échangé jadis les épices destinées aux cuisines romaines. Sous Claude, un fonctionnaire romain, éloigné par la tempête des côtes d'Arabie, avait été jeté dans l'île de Salike, la Taprobanè des anciens navigateurs grecs, aujourd'hui Ceylan; le roi du pays lui fit un accueil amical; puis étonné, comme dit l'auteur ancien, de ce que les pièces romaines eussent toutes le même poids sans porter la même effigie, il envoya avec le naufragé des ambassadeurs à son collègue romain. C'est alors que pour la première fois s'élargit le cercle des connaissances géographiques; dans la période qui suivit, semble-t-il, les navigateurs se dirigèrent vers cette île vaste et fertile, où l'on a trouvé plusieurs fois déjà des monnaies romaines. Pourtant de pareilles découvertes sont exceptionnelles au-delà du cap Comorin et de Ceylan1; il est peu probable que la côte de Coromandel et la région des embouchures du Gange, à plus forte raison la péninsule indo-chinoise et la Chine, aient entretenu avec l'Occident des relations commerciales permanentes. Sans doute la soie de Chine apparut de très bonne heure dans l'Ouest; mais elle vint exclusivement, semble-t-il, par la voie de terre, et par l'intermédiaire soit des Indiens de Barygaza, soit surtout des Parthes; les peuples que les Occidentaux appelaient producteurs de la soie ou Sères (du nom chinois de la soie, Sr), sont les habitants des bords du Tarim, au Nord-Ouest du Tibet, où les Chinois apportaient leur soie; et les marchands parthes gardaient jalousement le monopole de ce commerce. Quelques navigateurs, accidentellement ou après informations, ont atteint par mer la côte orientale de l'Indo-Chine et peut-être des rivages plus éloignés. Le port de Kattigara, que les Romains connaissaient au commencement du deuxième siècle après J.-C., est une des villes maritimes de la Chine, sans doute Hang-tchau-fou, à l'embouchure du Yang-tse-kiang. Les annales chinoises rapportent qu'en l'an 166 après J.-C. une ambassade, envoyée par l'empereur Antoun de Ta- (c'est-à-dire Grand) Tsin (Rome), débarqua dans le Ji-nan (Tongking), et que de là elle atteignit par voie de terre la capitale Lo-yang (ou Ho-nan-fou sur le moyen Hoang-ho) où résidait l'empereur Houan-ti; tous ces détails peuvent être considérés avec raison comme relatifs à Rome et à l'empereur Marc-Aurèle. Nous savons de plus, par les sources chinoises, que les Romains apparurent souvent dans ces contrées pendant le cours du troisième siècle : il ne faut considérer aucune de ces expéditions comme mission officielle, car, en ce cas, il ne serait pas possible que les sources romaines n'en parlassent pas; mais les divers capitaines qui se sont présentés à la cour chinoise peuvent avoir passé pour des ambassadeurs de leur gouvernement. La seule conséquence importante qu'aient eue ces relations, ce fut de substituer peu à peu des connaissances précises aux antiques légendes qui couraient sur la production de la soie. 1. A Bamanghati (district de Singhbhoum) à l'Ouest de Calcutta, il semble qu'on ait trouvé un trésor considérable de pièces d'or à l'effigie des empereurs romains (Gordien et Constantin sont spécifiés) (Beglar, dans Cunningham Archaeological survey of India, vol. XIII, p. 72); mais une découverte isolée de ce genre ne prouve pas que les relations suivies se soient étendues jusque-là. Au Nord de la Chine, dans la province de Chenzi, à l'Ouest de Pékin, on a, paraît-il, exhumé récemment des monnaies romaines qui appartiennent au règne de Néron et de ses successeurs jusqu'à Aurélien; mais aucune autre trouvaille analogue n'a été faite ni dans l'Indo-Chine ni dans la Chine. |
||||