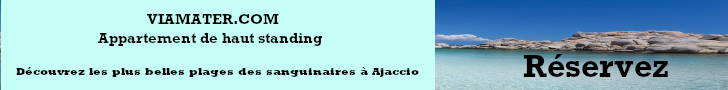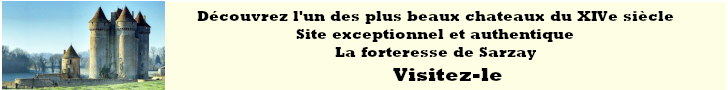|
|||||
L'Asie mineureSources historiques : Théodore Mommsen Vous êtes dans la catégorie : Empire Chapitre suivant : Frontière de l'Euphrate-Les Parthes Chapitre précédent : L'Europe grecque Dans ce chapitre : 35 rubriques; 18 612 mots; 98 784 caractères (espaces non compris); 117 189 caractères (espaces compris) Format 100% digital de cette rubrique (via l'espace membre) | |||||
27 av. J.C.-476 |
Les indigènes et les colonsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa grande péninsule que baignent les trois mers Egée, Noire, Méditerranée et qui est rattachée à l'Est au continent asiatique proprement dit, fera, en tant que province frontière de l'empire, le sujet du prochain chapitre, qui traitera du bassin de l'Euphrate et des relations de Rome avec les Parthes. Ici nous exposerons l'histoire pacifique des pays de l'Ouest sous le gouvernement impérial. La population primitive, ou du moins celle qui a précédé les Grecs dans ces vastes régions, est en beaucoup d'endroits restée très importante jusqu'au temps de l'empire. La plus grande partie de la Bithynie était certainement occupée par le peuple thrace dont nous avons déjà parlé; en Phrygie, en Lydie, en Cilicie, en Cappadoce apparaissent des traces nombreuses d'anciens dialectes difficiles à comprendre, qui se sont conservés pour la plupart jusqu'à l'époque romaine; on rencontre partout des noms de divinités, d'hommes, de lieux, qui appartiennent à des langues étrangères. Mais aussi loin que notre regard puisse atteindre, et à la vérité il ne pénètre pas bien profondément dans l'histoire de ce pays, ces divers éléments nous apparaissent dans un état d'affaiblissement et de décadence, et essentiellement comme la négation de la civilisation, ou, ce qui nous semble être la même chose, de l'hellénisme. Nous reviendrons sur les divers groupes de cette catégorie à leur place particulière. Dans le développement historique de l'Asie Mineure sous l'empire, deux peuples seulement jouèrent un rôle actif; c'étaient deux peuples immigrées, au début des temps historiques, les Hellènes, et, pendant les troubles de l'époque des Diadoques, les Celtes. |
||||

|
|||||
27 av. J.C.-476 |
Civilisation hellénique et hellénistiqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste
Nous avons déjà raconté l'histoire des Hellènes d'Asie Mineure, en tant qu'elle fait partie de l'histoire romaine. A l'époque lointaine où les côtes de la mer Méditerranée avaient été pour la première fois visitées et occupées, et où le monde avait été partagé entre les peuples aventureux aux dépens des peuples timides, le flot de l'émigration hellénique s'était répandu sur tous les rivages de la mer Méditerranée; mais nulle part, pas même en Italie et en Sicile, il ne fut aussi abondant que dans les nombreuses îles de la mer Egée et sur la côte voisine d'Asie Mineure, si agréable et si riche en ports. Les Grecs de l'Asie Mineure ont ensuite pris part plus activement que tous les autres à la conquête du monde: Milet colonisa les côtes de la mer Noire; Phocée et Cnide les rivages de la Méditerranée occidentale. En Asie, la civilisation hellénique atteignit les habitants de l'intérieur, Mysiens, Lydiens, Cariens, Lyciens, et son influence s'exerça même sur le puissant royaume des Perses. Mais les Hellènes ne possédaient que la côte; tout au plus occupaient-ils le bassin inférieur des plus grands fleuves et les îles. Ils ne purent pas faire de conquêtes sur le continent et acquérir de grands territoires en face des puissants rois du pays; d'ailleurs le plateau élevé et peu propre à la culture, qui constitue le centre de l'Asie Mineure, n'invitait pas, comme le rivage, les colons à s'y fixer et les communications avec l'intérieur étaient assez difficiles. C'est à cause de cette situation même que les Hellènes d'Asie réussirent moins encore que les Grecs d'Europe à acquérir l'unité intérieure et une véritable puissance; ils apprirent bientôt à se soumettre aux souverains du continent. Athènes leur fit sentir pour la première fois qu'ils appartenaient à la nation hellénique; mais ils ne furent ses alliés qu'après la victoire, et ils l'abandonnèrent à l'heure du danger. Ce qu'Athènes avait voulu et n'avait pas pu donner à ces Grecs qu'elle protégeait, Alexandre le leur accorda pleinement: quoique vainqueur de la Hellade, en Asie Mineure il apparut comme un libérateur. En effet, la victoire d'Alexandre non seulement assura l'existence de l'hellénisme en Asie, mais encore elle lui ouvrit une longue carrière presque illimitée; la colonisation du continent, qui marque, après celle du littoral, la seconde étape de la conquête du monde par les Grecs, fut très active dans l'Asie Mineure. Cependant aucune des anciennes villes grecques de la côte ne fut le centre de la nouvelle organisation politique1. Une autre époque réclamait, comme il arrive toujours, une autre constitution et surtout des villes neuves, qui fussent à la fois les résidences des rois grecs et les capitales de populations qui jusque-là n'étaient pas grecques et que l'on introduisait dans le monde hellénique. Le grand développement politique se produisit autour de villes fondées par les rois dont elles portaient le nom, Thessalonique, Antioche, Alexandrie. C'est contre les maîtres de ces cités que les Romains eurent à lutter. Ils acquirent l'Asie Mineure à peu près comme on reçoit un immeuble en héritage d'un parent ou d'un ami, par disposition testamentaire; et quoique par moments la domination romaine ait pesé lourdement sur les provinces ainsi conquises, dans ce pays on n'en sentit pas le poids. Il est vrai que l'Achéménide Mithridate opposa aux Romains une résistance nationale en Asie Mineure, et que les Hellènes se jetèrent dans ses bras pour se délivrer de la souveraineté de Rome; mais ils n'ont jamais tenté d'eux-mêmes pareille entreprise. Aussi avons-nous peu de choses à dire de cette grande, riche et importante province au point de vue purement politique, d'autant plus que les observations du chapitre précédent relatives aux rapports nationaux des Hellènes avec les Romains s'appliquent également aux Grecs d'Asie Mineure. 1. Il en aurait peut-être été autrement si l'état de Lysimaque avait subsisté. Alexandrie de Troade et Lysimachie fondées par lui, Ephèse (Arsinoé) agrandie par l'immigration des habitants de Colophon et de Lébédos, se trouvaient dans la direction voulue. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Les provinces de l'Asie mineureRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'administration romaine ne fut jamais systématiquement organisée dans l'Asie Mineure; les différentes provinces, à mesure qu'elles entraient dans l'empire, devenaient des districts administratifs romains, sans que leurs frontières subissent de modification essentielle. Les Etats qu'Attale III, roi de Pergame, avait légués aux Romains formèrent la province d'Asie; le royaume de Nicomède, que Rome avait de même acquis par héritage, fut plus tard la province de Bithynie; les pays enlevés à Mithridate Eupator constituèrent la province du Pont qui fut réunie avec celle de Bithynie. La Crète fut occupée par les Romains à l'occasion de la grande guerre des Pirates; Cyrène, que nous pouvons citer aussi, leur fut donnée par son chef mourant. C'est en vertu des mêmes droits que la République s'empara de l'île de Chypre: là s'ajoutait la nécessité de réprimer la piraterie. Cette nécessité provoqua aussi la fondation du gouvernement de Cilicie. La région fut complètement rattachée à Rome par Pompée en même temps que la Syrie, et pendant le premier siècle ces deux pays furent soumis à une administration commune. Toutes ces conquêtes avaient été faites par la République. Sous l'empire elles furent accrues de plusieurs territoires, qui jusque-là n'étaient pas sujets immédiats de Rome: en l'an 729=25 av. J.-C., du royaume de Galatie, auquel on avait réuni une partie de la Phrygie, la Lycaonie, la Pisidie, la Pamphylie; en l'an 747 = 7 av. J.-C., les pays soumis au roi Dejotarus, fils de Kastor, qui comprenaient Gangra en Paphlagonie, probablement aussi Amaseia et d'autres villes voisines; en l'an 17 ap. J.-C., du royaume de Cappadoce; en l'an 43, du territoire de la Confédération des villes lyciennes; en l'an 63, du Nord-Est de l'Asie Mineure, depuis la vallée de l'Iris jusqu'à la frontière de l'Arménie. La petite Arménie et quelques principautés moins importantes de Cilicie furent soumises sans doute par Vespasien. Ainsi s'étendit dans toute l'Asie Mineure la domination immédiate de Rome. En fait de principautés vassales, il ne resta que le Bosphore Taurien, dont nous avons déjà parlé, et la grande Arménie. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Gouvernement sénatorial et gouvernement impérialRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLorsque, à l'origine de l'empire, l'administration des provinces fut partagée entre l'empereur et le sénat, tous les pays de l'Asie Mineure qui dépendaient directement de l'empire furent soumis à l'administration sénatoriale; l'île de Chypre, qui avait été d'abord réservée à l'empereur, fut rendue quelques années plus tard au sénat. Ainsi furent établis les quatre gouvernements sénatoriaux d'Asie, de Bithynie et de Pont, de Chypre, de Crète et de Cyrène. Seule au début, la Cilicie, considérée comme partie de la province syrienne, fut administrée par l'empereur. Quant aux régions qui ne tombèrent que plus tard sous la domination immédiate de Rome, elles reçurent, là comme dans tout l'empire, des légats impériaux. C'est ainsi que sous Auguste la province de Galatie fut formée de la partie continentale du royaume galate; le littoral ou Pamphylie fut soumis à un autre gouverneur, qui fut chargé sous Claude d'administrer en outre la Lycie. Sous Tibère, la Cappadoce devint une province impériale. La Cilicie, lorsqu'elle reçut un gouverneur particulier, resta naturellement territoire impérial. Hadrien échangea l'importante province de Bithynie et de Pont contre le pays insignifiant de Lycie et de Pamphylie: à part ce fait, l'organisation du pays resta la même jusqu'à la fin du troisième siècle, où elle fut réduite à quelques lambeaux de terre. Dans les premiers temps de l'empire, la frontière de l'Asie Mineure était formée surtout par les principautés vassales; après leur annexion, la Cappadoce fut la seule de toutes ces divisions administratives, Cyrène exceptée, qui atteignit la frontière. On l'avait agrandie à cette époque de toute la région située sur la frontière du Nord-Est jusqu'à Trapézonte1; et encore ce gouvernement n'était-il pas voisin d'étrangers proprement dits : vers le Nord il touchait aux peuplades dépendantes du Phase, plus loin au royaume vassal d'Arménie, rattaché en droit et dans une certaine mesure en fait à l'empire. Pour donner une idée de la situation et du développement de l'Asie Mineure dans les trois premiers siècles de notre ère, autant que cela nous est possible en l'absence de toute tradition historique relative au pays, il faudra tenir compte du caractère conservateur du gouvernement romain dans les provinces et nous rattacher aux anciennes divisions de la contrée et à l'histoire intérieure de ces différentes régions. 1. Les frontières des Etats vassaux et même des provinces n'ont varié nulle part plus que dans le Nord-Est de l'Asie Mineure. En l'an 63 les pays du roi Polémon, où se trouvaient Zéla, Néocésarée, Trapézonte, furent directement soumis au gouvernement impérial; nous ne savons pas exactement à quelle date la petite Arménie y fut assujettie; mais c'est probablement au commencement du règne de Vespasien. Le dernier roi vassal de la petite Arménie, dont il soit fait mention, est Aristobule, fils d'Hérode (Tacite, Ann., XII, 7; XIV, 26; Josèphe, Ant. Jud., XX, 8, 4), qui possédait encore sa couronne en l'an 60; en 75 le pays était romain (Corp. insc. lat., III, 306) et probablement l'une des légions qui occupèrent la Cappadoce depuis Vespasien fut mise en garnison dès le début dans Satala, ville de la petite Arménie. Vespasien avait réuni en un grand gouvernement les pays nommés plus haut avec la Galatie et la Cappadoce. A la fin du règne de Domitien la Galatie et la Cappadoce furent séparées l'une de l'autre et les provinces du Nord-Est rattachées à la Galatie. Sous Trajan ce vaste district fut de nouveau confié à une seule main; plus tard, il fut encore divisé, et la côte du Nord-Est annexée à la Cappadoce. Ce qu'il y eut de permanent au milieu de tous ces changements, c'est que Trapezonte et par conséquent la petite Arménie resterent toujours sous l'autorité du gouverneur de Cappadoce. Ainsi, sauf une courte interruption sous Domitien, le légat de Galatie ne s'occupa jamais de la défense des frontières: cette charge, comme d'ailleurs la situation le comporte, incomba au gouverneur de la Cappadoce et aux légions qui occupaient le pays. |
||||
27 av. J.C.-476 |
L'AsieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa province d'Asie était l'ancien royaume des Attalides; elle comprenait l'Asie antérieure jusqu'à la Bithynie au Nord, jusqu'à la Lycie au Sud; le pays de l'Est, la grande Phrygie, qui en avait été d'abord séparée, lui avait déjà été réunie sous la République, et depuis cette époque la province s'étendait jusqu'au royaume des Galates et jusqu'aux montagnes de la Pisidie. Rhodes et les autres îles moins importantes de la mer Egée dépendaient aussi de ce district. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Les villes de la côteRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes premiers établissements grecs s'étaient élevés non seulement dans les îles et sur la côte proprement dite, mais dans les vallées inférieures des plus grands fleuves; Magnésie du Sipyle dans la vallée de l'Hermos, l'autre Magnésie et Tralles dans la vallée du Méandre, avaient été fondées par des Grecs avant Alexandre ou bien étaient devenues des villes grecques. Les Cariens, les Lydiens, les Mysiens furent de bonne heure au moins à moitié Hellènes. La domination grecque s'établit sans difficulté dans la région côtière; Smyrne, qui plusieurs siècles auparavant avait été détruite par les barbares de l'intérieur du pays, se releva alors de ses ruines pour redevenir une des cités les plus brillantes de l'Asie Mineure. La reconstruction d'Ilion, près du tombeau d'Hector, fut plutôt une oeuvre de piété que de politique; néanmoins la situation d'Alexandrie sur la côte de la Troade garda longtemps une grande importance. Pergame dans la vallée du Kaïkos fut la résidence florissante des Attalides. |
||||
27 av. J.C.-476 |
L'intérieur du paysRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteTous les princes helléniques, Lysimaque, les Séleucides, les Attalides, suivant les intentions d'Alexandre, luttèrent de zèle pour helléniser la partie continentale de cette province. La tradition historique nous renseigne moins encore sur les diverses fondations de villes que sur les guerres de cette époque; nous ne pouvons raisonner que sur des noms et des surnoms de cités, mais ces indices nous suffisent pour reconnaître dans ses traits généraux l'activité qui dura pendant des siècles, et qui fut néanmoins homogène et consciente du but qu'elle visait. Plusieurs localités de l'intérieur, Stratonikeia en Carie, Peltae, Blaundos, Dokimeion, Kadoi, en Phrygie, les Myso-Macédoniens du district d'Ephèse, Thyateira, Hyrkania, Nakrasa dans le bassin de l'Hermos, les Askylakes des environs d'Adramytion sont désignés dans les sources ou dans d'autres témoignages dignes de foi comme des cités macédoniennes; mais les mentions qu'on en trouve sont tellement accidentelles et ces villes sont pour la plupart si peu importantes que la même désignation s'est étendue sûrement à beaucoup d'autres localités du même pays. Nous pouvons en conclure que les régions citées plus haut furent colonisées par des soldats envoyés en même temps pour protéger l'Asie antérieure contre les Galates et les Pisidiens. En outre, les monnaies de Synnada, cité phrygienne importante, portent, à côté du nom de la ville, celui des Ioniens, des Doriens, et même celui du Jupiter commun aux peuples; sans doute un des successeurs d'Alexandre aura engagé des Grecs, sans distinction de patrie, à s'établir dans cette ville. Ce n'est certainement pas là un cas isolé. Ce n'est pas le lieu de citer ici les nombreuses villes, situées surtout dans l'intérieur du pays, dont les noms nous rappellent les maisons royales des Séleucides ou des Attalides, ou sont grecs d'ailleurs. Parmi les villes fondées ou réorganisées par les Séleucides, il s'en trouve plusieurs qui ont été plus tard très florissantes et très civilisées, par exemple dans la Phrygie méridionale Laodicée et surtout Apamée, l'ancienne Kelaenae, sur la grande route militaire qui conduit de la côte occidentale de l'Asie Mineure au moyen Euphrate: cette cité avait été sous les Perses l'entrepôt du commerce de cette région; au temps d'Auguste, elle était, après Ephèse, la ville la plus importante de la province d'Asie. Quoique la présence d'un nom grec ne soit pas l'indice certain d'une colonisation grecque, nous devons cependant considérer une grande partie de ces villages comme des localités d'origine grecque. En outre, les anciennes villes non grecques d'origine, que les successeurs d'Alexandre trouvèrent dans leurs royaumes, entrèrent bientôt elles-mêmes dans la civilisation hellénique, Sardes, par exemple, l'ancienne résidence du satrape perse, qui fut organisée par Alexandre comme une cité grecque. Cette évolution des cités était accomplie, lorsque la domination romaine s'établit sur l'Asie antérieure; les Romains ne l'ont pas beaucoup favorisée. Si, dans la partie orientale de la province, un grand nombre de villes comptaient leurs années à partir de l'an 670 de Rome = 84 av. J.-C., c'est que, à cette époque, Sylla, après avoir terminé la guerre de Mithridate, avait directement soumis la contrée à l'administration romaine. Ces villes n'obtinrent que plus tard le droit de cité. Auguste peupla avec les vétérans de son armée la ville de Parium sur l'Hellespont, et Alexandrie de Troade, dont nous avons déjà parlé; il leur donna à toutes deux les privilèges des municipalités romaines; Alexandrie fut désormais, comme Corinthe en Grèce et Béryte en Syrie, une île italique au milieu de l'Asie grecque. Mais ce n'était là que de la colonisation militaire; il est peu question, sous les empereurs, de véritables fondations de villes dans la province romaine d'Asie. Parmi les cités peu nombreuses qui portent des noms d'empereurs, les plus anciennes sont peut-être Sébastè et Tibérioupolis, toutes deux en Phrygie, et Hadrianoi, sur la frontière de Bithynie. Là, dans la région montagneuse située entre l'Ida et l'Olympe, vivaient, à l'époque des triumvirs, Cléon et, sous Hadrien, un certain Tilliboros, moitié chefs de bandits, moitié princes, dont le premier même a joué quelque rôle dans la politique. Hadrien fit une bonne action en établissant une municipalité avec une organisation régulière, au milieu de cet asile de brigands. Dans cette province où les cités étaient plus nombreuses que dans toute autre région de l'empire, - il y en avait cinq cents, il n'était plus besoin d'en fonder beaucoup; tout au plus fallait-il les séparer, c'est-à-dire dissoudre les antiques confédérations de ces villages qui se groupaient en cités et les rendre indépendants les uns des autres. Nous pouvons citer un fait de cette nature qui se passa en Phrygie sous Constantin I. Mais la civilisation hellénique proprement dite n'avait pas encore pénétré dans les régions d'accès difficile, lorsque la domination romaine commença dans le pays; en Phrygie surtout on parlait encore l'idiome local, de même famille peut-être que la langue arménienne. L'absence de monnaies et d'inscriptions grecques ne permet pas de conclure avec certitude à l'absence de toute civilisation hellénique1, mais, en fait, les monnaies phrygiennes datent presque toutes de l'époque impériale et la plupart des inscriptions de Phrygie sont des derniers temps de l'empire; en outre, dans les parties isolées et peu accessibles à la civilisation, les coutumes helléniques, si répandues ailleurs, ne pénétrèrent pour la première fois que sous l'empire. L'établissement immédiat de l'administration impériale fut peu favorisé par ce développement silencieux, et nous ne pouvons guère en retrouver les traces. Il est vrai que l'Asie était une province sénatoriale, et nous ne devons pas oublier que le gouvernement sénatorial manquait entièrement d'initiative. 1. La numismatique et l'épigraphie des villes ont subi des conditions si diverses qu'on ne peut pas conclure de l'absence ou de l'abondance des documents de l'une et de l'autre sorte à l'absence ou à l'intensité d'une civilisation ayant un caractère particulier. Pour l'Asie Mineure surtout il faut considérer que cette province était la terre classique de la vanité municipale; et les monuments que nous possédons, même les monnaies, doivent pour la plupart leur existence à ce que le gouvernement des empereurs romains laissa libre cours à cette vanité. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Rivalités des villesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa Syrie et plus encore l'Egypte s'absorbent tout entières dans leurs métropoles. Dans la province d'Asie et dans l'Asie Mineure en général, aucune ville ne peut être comparée à Antioche et à Alexandrie; mais c'est le grand nombre des villes moyennes qui fait la prospérité du pays. Les cités furent divisées en trois classes qui se distinguent par leur droit de suffrage à l'assemblée provinciale, par leur participation aux charges de toute la province, par le nombre même des médecins et des professeurs municipaux1; c'est là une organisation particulière à cette contrée. Les rivalités des villes y étaient très violentes, souvent puériles et quelquefois haineuses. C'est ainsi que la lutte de Sévère et de Niger en Bithynie fut à proprement parler une guerre entre les deux capitales rivales Nicomédie et Nicée. Il y a là une caractéristique des cités helléniques, et surtout de celles d'Asie Mineure. Nous parlerons plus loin de l'émulation avec laquelle on construisait les temples des empereurs; de même la question de rang aux fêtes communes de l'Asie Mineure était pour les délégations des villes une question vitale. Magnésie du Méandre s'appelle sur ses monnaies la septième ville de l'Asie; la première place était si convoitée que le gouvernement résolut de l'accorder à plusieurs villes à la fois. Le titre de métropole était disputé avec autant d'acharnement. La véritable métropole de la province était Pergame, résidence des Attalides et siège de l'assemblée provinciale; mais Ephèse, la capitale réelle, où le gouverneur était obligé d'inaugurer ses fonctions, et qui se glorifie sur ses monnaies de ce droit de débarquement, Smyrne, toujours en lutte avec sa voisine Ephèse, et qui, malgré la préséance légitime des Ephésiens, s'appelle sur ses monnaies la première ville pour la grandeur et la beauté, l'antique Sardes, Cyzique et d'autres encore aspiraient au même titre honorifique. Les doléances que les habitants de l'Asie Mineure envoyaient régulièrement à ce sujet à l'empereur et au sénat; ces niaiseries grecques, comme on avait coutume de dire à Rome, agaçaient les principaux Romains et provoquaient des railleries continuelles2. 1. "Cette ordonnance", dit le juriste Modestinus, qui la signale (Dig., XXVII, 1, 6, 3), intéresse toutes les provinces, quoiqu'elle ait été faite seulement pour les Asiatiques. En fait elle ne peut être appliquée que dans les pays où les villes sont réparties en classes; le jurisconsulte nous apprend en outre de quelle façon on l'accommodait aux provinces organisées autrement. Ce que le biographe d'Antonin (c. 11) nous dit des distinctions et des appointements accordés par cet empereur aux professeurs de rhétorique, n'a aucun rapport avec cette ordonnance. 2. Dans ses discours aux habitants de Nicomédie et de Tarse, Dion de Pruse montre très bien qu'un homme de goût ne voudrait pas pour lui-même d'aussi vaines distinctions, et qu'il est impossible de comprendre pourquoi des villes recherchent un titre avec autant d'ardeur; que les cités qui se font décerner de telles distinctions prouvent par là combien elles sont petites, et que le plus mauvais gouverneur trouve toujours une excuse dans cette rivalité des villes, puisque Nicée et Nicomédie ne s'entendent jamais : Les Romains vous traitent comme des enfants auxquels on donne un petit jouet; en échange d'un nom, vous êtes accablés d'avanies; Rome appelle votre ville la première, mais se conduit avec elle comme avec la dernière des cités. Vous êtes devenus la risée des Romains qui parlent sans cesse des niaiseries grecques. |
||||
Devenez membre de Roma LatinaInscrivez-vous gratuitement et bénéficiez du synopsis, le résumé du portail, très pratique et utile; l'accès au forum qui vous permettra d'échanger avec des passionnés comme vous de l'histoire latine, des cours de latin et enfin à la boutique du portail ! 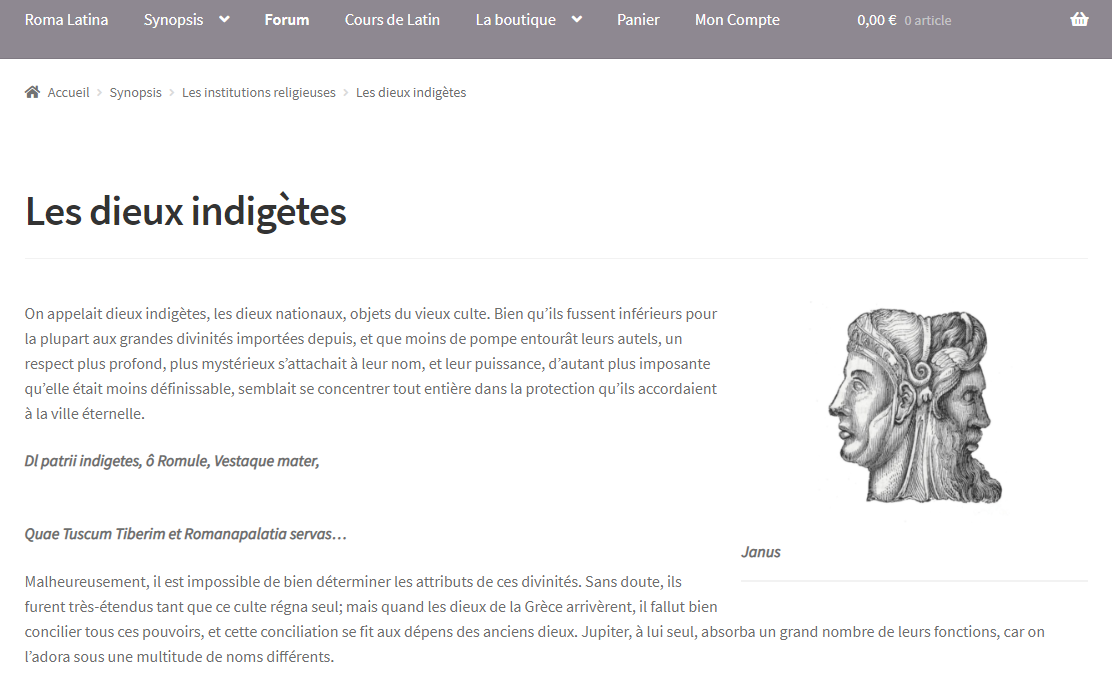 |
|||||
27 av. J.C.-476 |
La BithynieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa Bithynie n'atteignit jamais à la haute prospérité de l'empire des Attalides. Les anciens Grecs n'avaient réellement colonisé que la côte. A l'époque hellénistique, les conquérants macédoniens d'abord, puis la dynastie indigène qui les suivit complètement dans cette voie, après avoir donné aux villes une organisation qui fut presque partout purement nominale, ouvrirent aussi l'intérieur du pays, surtout par les deux fondations si heureuses de Nicée (Isnik) et de Pruse près de l'Olympe (Brousse). Nous avons déjà fait remarquer que les premiers habitants de Nicée furent d'origine macédonienne et hellénique. Mais le royaume de Nicomède profita beaucoup moins de la civilisation grecque que l'Etat des princes de Pergame: dans l'intérieur du pays, toute la région orientale n'a été que peu colonisée avant Auguste. Il en fut autrement sous l'empire. A l'époque d'Auguste, un heureux chef de bandits, redevenu honnête, releva sur la frontière de Galatie l'ancienne ville, complètement détruite, de Gordiou-Komé et lui donna le nom de Juliopolis; dans la même contrée les villes de Bithynion (Claudiopolis) et de Krateia (Flaviopolis) obtinrent, probablement dans le cours du premier siècle, le droit de cité grecque. En général, l'hellénisme a pris sous l'empire un grand essor en Bithynie, et il a été favorisé par la nationalité thrace des indigènes. Parmi les nombreuses inscriptions qui ont été relevées dans cette province, quatre seulement sont antérieures à l'occupation romaine. Ce n'est pas le seul fait qui nous révèle que l'ambition des cités ne s'était pas éveillée avant l'empire. Dans la littérature de la période impériale un certain nombre des meilleurs écrivains, de ceux qui ont été le moins victimes de la rhétorique en faveur, appartiennent à la Bithynie: ce sont le philosophe Dion de Pruse, les historiens Memnon d'Héraclée, Arrien de Nicomédie, Cassius Dion de Nicée. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Le PontRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa moitié orientale du rivage méridional de la mer Noire, la province romaine de Pont, avait été formée avec cette partie de l'empire de Mithridate, que Pompée, aussitôt après sa victoire, avait directement soumise à la domination romaine. Les nombreuses principautés qu'il avait épargnées à la même époque, dans l'intérieur de la Paphlagonie et à l'Est de ce pays jusqu'à la frontière de l'Arménie, furent, plus ou moins longtemps après, réunies soit à la même province, soit à la Galatie ou à la Cappadoce. L'antique empire de Mithridate avait subi beaucoup moins que l'Asie occidentale l'influence de l'ancien ou du nouvel hellénisme. Lorsque les Romains établirent sur ce territoire leur domination directe ou indirecte, il ne s'y trouvait pas à proprement parler de villes organisées sur le modèle des cités grecques : Amaseia, l'ancienne résidence des Achéménides de Pont, qui était toujours leur tombeau, n'était pas une ville hellénique; les deux anciens ports grecs, Amisos et Sinope, qui avait jadis dominé sur toute la mer Noire, étaient devenus des résidences royales, et les cités peu nombreuses, fondées par Mithridate, comme Eupatoria, ne peuvent guère être considérées comme villes grecques. Mais dans ce pays, ainsi que nous l'avons montré dans un volume précédent, la conquête romaine introduisit la civilisation hellénique : Pompée organisa la province, en donnant le rang de cité aux onze villages les plus importants et en leur partageant le pays. Ces villes artificielles, avec leurs immenses territoires, - celui de Sinope avait sur la côte un développement de 119 kilom. et était séparé par l'Halys du territoire d'Amisos, - ressemblaient plus aux tribus celtiques qu'aux villes helléniques et italiennes proprement dites. Il n'en est pas moins vrai qu'à cette époque Sinope et Amisos retrouvèrent leur ancienne prospérité et que, dans l'intérieur du pays, d'autres villes furent relevées, comme Pompéioupolis, Nikopolis et Mégalopolis, la future Sébasteia. Le dictateur César accorda le droit de colonie romaine à Sinope et lui envoya sans doute des colons italiens. Trapézonte, ancienne colonie de Sinope, joua un rôle plus important dans l'administration romaine; cette ville, qui fut réunie en l'année 63 à la province de Cappadoce, était à la fois la station de la flotte romaine du Pont et dans une certaine mesure la base d'opérations des troupes de la province, les seules qu'il y eût dans toute l'Asie Mineure. |
||||
|
|
|||||
27 av. J.C.-476 |
La CappadoceRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe centre de la Cappadoce était soumis à la puissance romaine, depuis que la Syrie et le Pont avaient été réduits en province; le pays fut annexé définitivement à l'empire au commencement du règne de Tibère, lorsque l'Arménie tenta de se soustraire à la suzeraineté de Rome. Nous en parlerons dans le chapitre suivant. La cour et ce qui s'y rattachait directement s'était hellénisé, à peu près autant que les cours allemandes du dix-huitième siècle étaient devenues françaises. La capitale Césarée, l'ancienne Mazaka, qui était, comme Apamée de Phrygie, une étape commerciale sur la grande route de la côte occidentale au pays de l'Euphrate, et qui fut à l'époque romaine, ce qu'elle est encore aujourd'hui, un des centres d'affaires les plus florissants de l'Asie Mineure, avait été après la guerre de Mithridate, non seulement rebâtie à l'instigation de Pompée, mais encore dotée probablement du droit de cité et organisée comme une ville grecque. La Cappadoce même, au commencement de l'empire n'était guère plus grecque que le Brandebourg et la Pomeranie n'étaient français sous Frédéric le Grand. Lorsque le pays devint romain, il fut divisé, d'après les renseignements du contemporain Strabon, non pas en circonscriptions de cités, mais en dix districts, dont deux seulement contenaient des villes, la capitale, que nous avons déjà nommée, et Tyana. Cette organisation fut aussi peu modifiée dans ses traits généraux que celle de l'Egypte, quoique certaines localités aient obtenu plus tard le droit de cité grecque: par exemple, l'empereur Marc-Aurèle fit du village de Cappadoce où sa femme mourut une ville qu'il appela Faustinopolis. Les Cappadociens parlaient le grec, il est vrai; mais on se moquait beaucoup à l'étranger des étudiants de Cappadoce, à cause de leur accent grossier et des fautes qu'ils commettaient dans la prononciation et l'intonation; lorsqu'ils apprenaient le dialecte attique, leurs compatriotes trouvaient leur langage affecté1. Ce fut seulement à l'époque chrétienne que les condisciples de l'empereur Julien, Grégoire de Naziance et Basile de Césarée donnèrent plus de réputation au nom de la Cappadoce. 1. Pausanias de Césarée, dans Philostrate (Vitae soph., II, 13) reproche à Hérode Atticus ses défauts : Ilayele tu vaccin ?. jadis sujette de Rhodes, mais devenue indépendante après la troisième guerre de Macédoine, fut transformée par Claude en une province romaine, à cause des rivalités interminables qui en divisaient les membres. L'hellénisme s'introduisit alors plus rapidement dans le pays et, sous l'empire, les Lyciens devinrent complètement Grecs. |
||||
27 av. J.C.-476 |
La LycieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIsolées dans leurs montagnes, les villes lyciennes n'avaient pas ouvert leur côte à la colonisation grecque, mais elles ne repoussèrent pas l'influence hellénique. La Lycie est le seul pays de l'Asie Mineure où la civilisation ait pénétré de bonne heure sans détruire la langue locale; les Lyciens, presque comme les Romains, entrèrent dans le monde grec, sans s'helléniser extérieurement. Ce qui nous indique quelle était leur situation, c'est que la confédération lycienne s'allia, en tant que confédération, à la ligue maritime d'Athènes et paya son tribut à l'hégémonie athénienne. Ce n'est pas seulement dans l'ordre artistique que les Lyciens ont imité les modèles grecs : de bonne heure ils avaient emprunté à la Grèce leur organisation politique. Cette ligue de villes, jadis sujette de Rhodes, mais devenue indépendante après la troisième guerre de Macédoine, fut transformée par Claude en une province romaine, à cause des rivalités interminables qui en divisaient les membres. L'hellénisme s'introduisit alors plus rapidement dans le pays et, sous l'empire, les Lyciens devinrent complètement Grecs. |
||||
|
|
|||||
27 av. J.C.-476 |
La Pamphylie et la CilicieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes villes de la côte pamphylienne, comme Aspendos et Pergè, fondations grecques d'une très haute antiquité, abandonnées ensuite à elles-mêmes, qui avaient prospéré, grâce à des circonstances favorables, avaient soit conservé, soit modifié à leur manière l'ancien hellénisme, de sorte que les Pamphyliens, par leur langue et leur écriture, ne ressemblaient pas moins que leurs voisins de Lycie à une nation indépendante. Lorsque les Hellènes conquirent l'Asie, les Pamphyliens revinrent peu à peu à la civilisation grecque générale, ainsi qu'à l'organisation politique commune. Les maîtres de ce pays comme de la côte voisine de Cilicie furent, dans la période hellénistique: les Egyptiens, dont la maison royale a donné son nom à plusieurs localités de Pamphylie et de Cilicie; les Séleucides, dont le souvenir survécut dans la ville la plus importante de la Cilicie occidentale, Séleucie ou Kalykadnos; et les Pergaméniens, dont la ville d'Attalie (Adalia) atteste la domination en Pamphylie. |
||||
27 av. J.C.-476 |
La Pisidie et l'IsaurieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste
Au contraire, les peuplades qui habitaient les montagnes de la Pisidie, de l'Isaurie et de la Cilicie occidentale, conservèrent en fait leur indépendance jusqu'au commencement de l'empire. La guerre ne cessait jamais chez elles. Non seulement les Etats civilisés devaient lutter continuellement sur le continent avec les Pisidiens et leurs alliés, mais encore ces peuples exerçaient la piraterie plus hardiment que le brigandage sur terre, surtout le long de la côte occidentale de la Cilicie, où le pied des montagnes plonge dans la mer. Après la chute de la marine égyptienne, la côte méridionale de l'Asie devint le refuge des écumeurs de la mer. Les Romains intervinrent alors et organisèrent, pour faciliter la répression de la piraterie, la province de Cilicie, qui comprenait, ou du moins qui devait comprendre la côte pamphylienne. Mais les mesures prises montrèrent ce qu'il y avait à faire, bien plus qu'elles n'amenèrent de résultats sérieux; leur intervention était trop tardive et trop intermittente. En vain une expédition fut conduite contre les corsaires; en vain des troupes romaines pénétrèrent jusque dans les montagnes de l'Isaurie et détruisirent au centre du pays les repaires des brigands; la république romaine ne put pas s'établir d'une façon vraiment durable au milieu de peuples qu'elle annexait malgré eux. L'empire eut tout à faire dans cette région. Antoine, lorsqu'il prit le gouvernement de l'Orient, chargea un habile officier galate, Amyntas, de soumettre les Pisidiens rebelles1; quand ce capitaine eut fait ses preuves2, Antoine le créa roi de la Galatie, la province de l'Asie Mineure la mieux organisée militairement et la mieux préparée à la guerre; il étendit son pouvoir jusqu'à la côte méridionale, sur la Lycaonie, la Pisidie, l'Isaurie, la Pamphylie et la Cilicie occidentale, tandis que la Cilicie orientale, plus civilisée, restait attachée à la Syrie. Lorsqu'Auguste, après la bataille d'Actium, étendit sa domination sur l'Orient, il laissa au prince celte sa royauté. Ce souverain continua d'écraser les corsaires dangereux cachés dans les repaires de la Cilicie occidentale, et d'exterminer les brigands; il tua de sa main un des chefs de bandits les plus redoutables, Antipatros, qui tenait Derbé et Laranda dans la Lycaonie méridionale; il bâtit sa résidence dans l'Isaurie et, non seulement il chassa les Pisidiens du territoire voisin de la Phrygie, mais encore il pénétra chez eux et s'empara de Kremna au coeur de leur pays. Quelques années plus tard (729 de Rome = 25 av. J.-C.), il périt dans une expédition contre une des tribus de la Cilicie occidentale, les Homonadenses: il avait emporté presque toutes leurs villes et renversé leur prince, lorsqu'il fut victime d'un complot dirigé contre lui par la femme de ce prince. Après ce malheur, Auguste entreprit lui-même l'oeuvre difficile de la pacification de l'Asie Mineure centrale. Nous avons déjà fait remarquer que la petite côte pamphylienne fut confiée à un gouverneur particulier et séparée de la Galatie; si Auguste agit ainsi, c'est évidemment parce que les montagnes situées entre la côte et la steppe galatico-lycaonienne étaient insoumises, et que ce rivage ne pouvait pas réellement être, pour l'administration, rattachée à la Galatie. Des troupes romaines ne furent pas cantonnées en Galatie; néanmoins il est probable que la levée des soldats fut plus importante dans cette province que dans la plupart des autres; en outre, comme la Cilicie occidentale dépendait alors de la Cappadoce, les troupes de cette principauté vassale durent aussi prendre part aux travaux nécessaires. L'armée de Syrie infligea d'abord aux Homonadenses le châtiment qu'ils avaient mérité; quelques années plus tard le gouverneur Publius Sulpicius Quirinius reparut dans leur pays, leur coupa les vivres, et les força à se soumettre en masse; ils furent dispersés dans les localités voisines et leur ancien territoire resta désert. On punit également en 36 et en 52 les Clites, autre tribu de la Cilicie occidentale, établie plus près de la côte : ils refusaient d'obéir au prince vassal que Rome leur avait imposé; ils pillaient la terre comme les mers, et les soi-disant maîtres du pays ne pouvaient en venir à bout; aussi les troupes impériales de Syrie vinrent-elles deux fois pour les soumettre. Ces renseignements se sont conservés par hasard; à coup sûr, le souvenir de beaucoup d'événements semblables a disparu. 1. En l'an 715 de Rome, avant le retour d'Antoine en Asie, Amyntas fut aussi chargé de gouverner les Pisidiens (Appien, Bel. civ., V, 75), sans doute parce qu'ils avaient entrepris quelque nouvelle piraterie. Ce qui explique qu'il établit sa résidence à Isaura, c'est qu'il avait commencé par gouverner cette région (Strabon, XII, 6, 3, p. 369). La Galatie fut donnée d'abord aux héritiers de Dejotarus (Dion, XLVIII, 33). Ce fut seulement en 718 qu'Amyatns reçut la Galatie, la Lycaonie et la Pamphylie (Dion, XLIX, 32). 2. Strabon, qui vécut au milieu de tous ces événements, dit expressément que ce fut là la cause pour laquelle cette contrée ne fut pas soumise à des gouverneurs romains (XIV, 5, 5, p. 671): (pour la repression des pirates et des brigands) (à cause des déplacements du conventus), ???? LEO? ot.wy (qui manquèrent plus tard aux légats de Galatie). |
||||
27 av. J.C.-476 |
Colonies de PisidieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAuguste accomplit aussi la pacification du pays en le colonisant. Les gouvernements hellénistiques l'avaient, pour ainsi dire, isolé; non seulement ils avaient gardé leurs positions ou conquis de nouvelles places sur la côte, mais dans le Nord-Ouest ils avaient fondé une série de villes, sur la frontière de Phrygie Apollonia, bâtie probablement par Alexandre lui-même, Seleukeia Siderus et Antiocheia, toutes deux du temps des Séleucides, en Lycaonie Laodikeia Katakekaumene, et la capitale du pays, Ikonion, dont la fondation remonte à la même époque. Mais dans la montagne proprement dite on ne trouve aucune trace d'établissement hellénique. Le sénat romain n'avait pas entrepris davantage cette tâche difficile. Auguste le fit; là, et là seulement dans tout l'Orient grec, on rencontre une série de colonies de vétérans romains, évidemment destinées à conquérir pacifiquement le pays. Parmi les anciennes colonies que nous avons nommées plus haut, Antioche fut peuplée de vétérans et réorganisée à la romaine; dans la Lycaonie méridionale Parlaïs fut reconstruite, en Pisidie même Kremna, dont nous avons déjà parlé, ainsi qu'Olbasa et Komama situées beaucoup plus au Sud. Les empereurs suivants ne poussèrent pas avec autant d'énergie l'oeuvre entreprise; pourtant, sous Claude, la ville forte de Séleucie en Pisidie fut transformée en colonie claudienne; dans la Cilicie occidentale Claudiopolis, et, non loin de là, peut-être à la même époque, Germanicopolis redevinrent prospères; enfin Ikonion, petit village au temps d'Auguste, prit un développement considérable. Les nouvelles cités restèrent, il est vrai, peu importantes; mais elles limitèrent sensiblement le champ d'action des montagnards libres, et la paix put enfin être établie dans le pays. Les plaines et les plateaux de la Pamphylie, les villes de la montagneuse Pisidie, par exemple Selge et Sagalassos, étaient très peuplées sous l'empire; l'agriculture était florissante dans la région; les restes de puissants aqueducs et d'immenses théâtres, constructions qui datent toutes de l'empire romain, pour n'être que des oeuvres de pratique manuelle, n'en prouvent pas moins que cette province jouissait d'une paix profonde et d'une grande prospérité. Sans doute le gouvernement ne triompha jamais complètement de la piraterie, et si dans les premiers temps de l'empire les incursions furent plus rares, les bandes de brigands reparurent comme une force militaire au milieu des troubles du troisième siècle. Ils portent alors le nom d'Isauriens et occupent surtout les montagnes de la Cilicie, d'où ils s'élancent pour piller la terre et la mer. On parle d'eux, pour la première fois, sous Alexandre Sévère. Le récit suivant lequel, sous Gallien, ils auraient proclamé leur chef empereur, doit être une fable, mais sous Probus, un brigand du nom de Lydios, qui avait ravagé pendant longtemps la Lycie et la Pamphylie, fut assiégé dans la colonie romaine de Kremna dont il s'était emparé et fut pris par une armée impériale après une longue et opiniâtre résistance. Plus tard un cordon de troupes fut placé tout autour du pays, et un général fut chargé spécialement du commandement des Isauriens. Leur bravoure sauvage, lorsqu'ils prirent du service à la cour de Byzance, leur créa pendant longtemps une situation analogue à celle que les Macédoniens avaient occupée à la cour d'Egypte: l'un d'entre eux, Zénon, mourut même sur le trône de Byzance1. 1. Au milieu des grandes ruines de Saradjik, dont on ignore le nom ancien, et qui sont situées dans la Lycie orientale, sur le haut Limyros (cf. Ritter, Erdkunde, XIX, p. 1172), se trouve un vaste tombeau en forme de temple, qui n'est certainement pas plus ancien que le troisième siècle de notre ère; sur ce tombeau on voit comme emblèmes des membres humains, têtes, bras, jambes, sculptés en relief; ce sont peut-être les armoiries d'un chef de bande civilisé (Communication de Benndorf). | ||||
27 av. J.C.-476 |
La galatieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteEnfin la Galatie, qui avait été jadis le noyau de la domination orientale sur l'Asie antérieure, et qui a conservé, dans les célèbres sculptures sur rocher de la moderne Boghazkeuï, l'ancienne ville royale de Pteria, les souvenirs d'une gloire presque disparue, était devenue dans le cours des siècles une île, celtique par la langue et par les moeurs, au milieu du flot des peuples d'Orient; elle a gardé cette physionomie dans son organisation intérieure, même au temps de l'empire. Les trois peuplades qui, lors de la grande émigration celtique, étaient arrivées en Asie Mineure, au temps où Pyrrhus combattait les Romains; qui, là, comme les Francs au moyen âge en Orient, s'étaient réunies pour former un Etat militaire fortement constitué, et qui, après avoir erré de différents côtés, s'étaient définitivement établies sur les deux rives de l'Halys, n'en étaient plus au temps où elles pillaient de là l'Asie Mineure et faisaient la guerre aux rois d'Asie et de Pergame, lorsqu'elles ne se mettaient pas à leur solde. Mais elles aussi avaient été vaincues par la puissance romaine et les Gaulois d'Asie ne lui étaient pas moins soumis que leurs pères du Pô, du Rhône et de la Seine. Pourtant, malgré leur long séjour en Asie Mineure, ces Occidentaux étaient encore séparés des Asiatiques par un abîme profond. Ce n'était pas seulement parce qu'ils avaient conservé leur idiome et leur nationalité, parce que chacune des trois tribus était toujours gouvernée par ses quatre princes héréditaires, ou parce que l'assemblée fédérale qui réunissait dans le bois de chênes sacrés les députés de toutes les tribus, représentait encore l'autorité la plus haute de la terre Galate; ce n'était pas non plus à cause de leur indomptable grossièreté et de leur vaillance militaire, qui les distinguaient de leurs voisins en bien et en mal: dans l'Asie Mineure il y avait d'autres contrastes de cette nature entre la civilisation et la barbarie, et l'hellénisation toute superficielle et extérieure qu'entraînaient le voisinage, les relations commerciales, la conversion des immigrants à la religion phrygienne, ou le service de mercenaire fait en commun, ne s'était pas produite en Galatie beaucoup plus tard que dans le pays limitrophe de la Cappadoce, par exemple. La différence est d'autre sorte. Les Celtes et les Hellènes ont envahi l'Asie Mineure en même temps; à la rivalité nationale s'est ajoutée la lutte de deux peuples conquérants. C'est ce qui apparut clairement dans la guerre de Mithridate: lorsque ce roi donna l'ordre de tuer tous les Italiens, il fit en même temps massacrer la noblesse galate; aussi, pendant les guerres que Rome soutint contre ce libérateur oriental des Hellènes, elle n'eut pas d'alliés plus fidèles que les Galates de l'Asie Mineure. La victoire des Romains fut celle des Galates; elle leur donna pour longtemps une situation prépondérante dans la contrée. L'antique gouvernement des quatre princes fut aboli par Pompée, semble-t-il. Un des nouveaux rois, qui avait fait ses preuves dans les guerres de Mithridate, Déjotarus, ajouta à ses possessions la petite Arménie et quelques autres lambeaux de l'ancien empire de Mithridate; il fut pour les autres princes galates un voisin bien incommode, et il devint le plus puissant dynaste de l'Asie Mineure. Après la victoire de César qu'il avait combattu, et dont il ne put pas reconquérir la faveur en lui envoyant des secours contre Pharnace, les territoires qu'il avait acquis, avec ou sans l'autorisation du gouvernement romain, lui furent presque tous enlevés; le Césarien Mithridate de Pergame, qui se rattachait par sa mère à la maison royale de Galatie, reçut la plus grande partie des terres que Déjotarus avait perdues, et fut même placé en Galatie auprès de lui. Mais il mourut bientôt dans la Chersonèse Taurique; César lui-même fut assassiné peu de temps après. Déjotarus rentra alors en possession de tout ce qui lui avait été ravi; il eut l'habileté de soutenir le parti des Romains chaque fois qu'ils dominaient en Orient et de les abandonner toujours à temps. Aussi lorsqu'il mourut très âgé, en l'an 714 (40 av. J.-C.), était-il maître de toute la Galatie. On donna à ses successeurs, pour les désintéresser, un petit royaume en Paphlagonie; mais son empire, auquel s'étaient ajoutées vers le Sud la Lycaonie et toutes les régions qui s'étendent jusqu'à la côte de Pamphylie, fut en 718 (36 av. J.-C.) confié par Antoine à Amyntas, comme nous l'avons déjà dit. Cet Amyntas, qui avait été le secrétaire et le général de Déjotarus dans les dernières années de son règne, paraît avoir eu alors une grande autorité; c'est à ce titre qu'avant la bataille de Philippes il abandonna les chefs républicains et se déclara pour les triumvirs. Nous avons exposé plus haut son histoire. Egal à son prédécesseur en prudence et en courage, il fut, sous la direction d'abord d'Antoine, puis d'Auguste, le principal instrument de pacification des régions de l'Asie Mineure qui n'étaient pas encore soumises, jusqu'au moment où il mourut (729= 25 av. J.-C.). Avec lui disparut le royaume de Galatie, qui fut transformé en province romaine. Les Romains appelaient déjà les Galates Gallo-Grecs dans les dernières années de la République; Tite-Live ajoute que c'est un mélange de deux nations, comme son nom l'indique, et qu'ils sont bien dégénérés. Une bonne partie de ces Galates devait descendre des Phrygiens qui habitaient autrefois la contrée. Ce qui est plus important, c'est que la religion très vivace dans le pays et le sacerdoce local n'ont rien de commun avec les institutions sacrées des Celtes d'Europe: non seulement la Magna Mater, dont les Romains, à l'époque d'Hannibal, demandèrent l'image sainte aux Tolistobogii qui la leur envoyèrent, était d'origine phrygienne, mais encore les prêtres de cette divinité appartenaient presque tous à la noblesse galate. Néanmoins, même après que la Galatie fut devenue une province romaine, l'organisation intérieure demeura surtout celtique; ainsi, sous Antonin le Pieux, la puissance paternelle, demeurée étrangère à toute influence du droit hellénique, était encore très étroite: voilà une preuve tirée du droit privé. De même pour la constitution politique du pays: il n'existait pas d'autres divisions que celles qui correspondaient aux anciennes tribus, Tektosages, Tolistobogii, Trokmi; mais celles-ci ajoutaient à leurs noms les noms des trois capitales, Ancyre, Pessinonte et Tavion; nous retrouvons là la tribu gauloise, bien connue de nous, avec son chef-lieu de civitas. Si chez les Celtes d'Asie la conception de la communauté sous forme de ville apparut plutôt que chez les Celtes d'Europe1; si le nom d'Ancyre remplaça plus vite celui des Tektosages, que le nom de Bordeaux en Europe celui des Bituriges; si Ancyre même, en tant que la première de toutes les villes du pays, prit le titre de ville-mère (untpotches), c'est que le voisinage des Grecs exerça sur les Galates une réelle influence, ce qui était inévitable, et que ceux-ci commencèrent à se laisser assimiler aux Hellenes; mais nous ne pouvons pas distinguer nettement les diverses phases de cette évolution, nos renseignements étant trop superficiels. Les noms celtiques subsistent jusqu'à l'époque de Tibère; plus tard on ne les trouve plus qu'isolés dans les principales familles. Lorsque la Gaule fut réduite en province romaine, les Romains n'y tolérèrent pour les relations commerciales que l'usage de la langue latine; en Galatie, ils n'autorisèrent à côté de la langue latine que la langue grecque, et cela se comprend facilement. Nous ne savons pas quelle langue on parlait autrefois dans le pays: on n'y a trouvé aucun monument épigraphique antérieur à la conquête romaine. L'idiome celtique resta longtemps en Asie la langue usuelle2; néanmoins le grec prit peu à peu le dessus. Au quatrième siècle Ancyre était l'un des centres de civilisation grecque. Les petites villes de la Galatie grecque, dit le littérateur Thémistios, qui consacra toute sa vie à parler devant le public lettré, ne peuvent certes pas se comparer à Antioche; mais leurs habitants s'instruisent avec plus de zèle que les vrais Hellènes : sitôt qu'apparaît un manteau de philosophe, ils s'y attachent comme le fer à l'aimant. Néanmoins jusqu'à cette époque, et surtout au-delà de l'Halys, chez les Trokmi qui furent hellénisés les derniers3, le langage populaire a dû se conserver dans les basses classes. Nous avons déjà dit que, d'après le témoignage du Père de l'Eglise saint Jérôme, qui avait tant voyagé, les Galates d'Asie, à la fin du quatrième siècle, parlaient une langue corrompue sans doute, mais qui ressemblait beaucoup à celle des habitants de Trèves. Comme soldats, les Galates ne peuvent pas être comparés à leurs frères d'Occident, mais ils étaient beaucoup plus aptes au service militaire que les Asiatiques grecs; la preuve en est que le roi Déjotarus put recruter parmi ses sujets une légion qu'il organisa sur le modèle des légions romaines. Auguste s'en empara en même temps que du royaume, et la fit entrer dans l'armée romaine sous le nom qu'elle avait porté jusqu'alors. En outre, dans le recrutement oriental de l'empire, on choisissait de préférence les Galates comme en Occident les Bataves4. 1. Dans la fameuse liste des dons faits à la commune d'Ancyre, qui date de l'époque de Tibère (Corp. insc. graec., 4039), les communes galates sont appelées le plus souvent sovos, quelquefois trois. Plus tard, la première de ces deux dénominations n'est plus employée; mais lorsqu'on rencontre la suite complète des noms d'Ancyre, par exemple dans une inscription du second siècle (Corp. insc. graec., 4011), on y remarque toujours le nom de la tribu. 2. D'après Pausanias (X, 36, 1), chez les l'adatal unip opuylas, por tn eriyoplo op!! la graine de kermes s'appelle us; et Lucien (Alex., 51), nous raconte les perplexités d'un devin paphlagonien, auquel on avait posé des questions, et qui n'avait pas sous la main de gens connaissant cette langue. 3. Dans l'inscription du temps de Tibère citée p. 116, n. 1, les dépenses sont attribuées rarement à trois peuples, le plus souvent à deux peuples ou à deux villes. Perrot (de Galatia; p. 83) a fait remarquer avec raison que les deux villes nommées presque toujours étaient Ancyre et Pessinonte, et que Tavion des Trokmi reste bien loin derrière elles, pour le chiffre des dépenses. Peut-être n'y avait-il alors dans cette tribu aucune localité, qui pût être considérée comme une ville. 4. De même Cicéron (ad Att., VI, 5, 3) parlant de son armée de Cilicie : exercitum infirmum habebam, auxilia sane bona, sed ea Galatarum, Pisidarum, Lyciorum : haec enim sunt nostra robora. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Les îles grecquesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteParmi les établissements helléniques extra-européens, il faut encore compter les deux grandes îles de la Méditerranée orientale, Crète et Chypre et les nombreuses îles de l'archipel échelonnées entre la Grèce et l'Asie Mineure. La Pentapole Cyrénaïque, située en face de la Grèce sur la côte africaine, est si complètement séparée de l'intérieur du pays par les déserts environnants, qu'on peut la comparer, dans une certaine mesure, aux îles grecques. D'ailleurs ces éléments de la masse immense réunie sous le sceptre des empereurs n'apportent aucun caractère nouveau à la conception générale de l'histoire. Les petites îles, qui furent hellénisées plus tôt et plus complètement que le continent, se rattachent mieux par leur nature à la Grèce d'Europe qu'aux colonies d'Asie Mineure; nous avons déjà cité plusieurs fois la métropole hellénique de Rhodes dans le chapitre précédent. A cette époque les îles sont surtout nommées, parce que ce fut une habitude sous l'empire d'y exiler les hommes du plus haut rang. On choisissait, dans les cas les plus graves, des écueils comme Gyaros et Donussa; mais Andros, Kythnos, Amorgos, jadis centres florissants de civilisation grecque, étaient aussi devenus des lieux de relégation, tandis qu'à Lesbos et à Samos de riches Romains et même des membres de la famille impériale venaient souvent de leur plein gré passer plusieurs mois. Sous la domination persane ou dans leur complet isolement, la Crète et Chypre, depuis longtemps hellénisées, avaient rompu toute relation avec la mère patrie. Chypre, dépendance de l'Egypte, et les villes de la Crète, cités autonomes, s'étaient organisées, à l'époque hellénistique et plus tard au temps des Romains, sur le modèle général des constitutions grecques. Dans les villes de la Cyrénaïque prévalut le système des Lagides; nous y trouvons non seulement, comme dans les cités grecques proprement dites, des citoyens helléniques et des métèques, mais encore, à côté de ces deux classes, les paysans, c'est-à-dire les Africains indigènes, comme à Alexandrie les Egyptiens; et parmi les Métèques, les Juifs forment, encore comme à Alexandrie, une classe nombreuse et privilégiée. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Confédérations des Hellènes en Asie MineureRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe gouvernement romain n'a jamais accordé aux Grecs une représentation générale. L'Amphictionie d'Auguste ne comprenait, comme nous l'avons vu, que les Hellènes de l'Achaïe, de l'Epire et de la Macédoine. Les Panhellènes d'Hadrien, réunis à Athènes, se considéraient comme les représentants de tous les Grecs, mais leur intervention dans les autres provinces grecques se bornait à nommer quelques villes d'Asie pour ainsi dire membres honoraires de l'Hellénisme; ce qui prouve avant tout que les communes grecques situées hors de Grèce ne figuraient pas parmi ces Panhellènes. Lorsqu'on parle de la représentation ou des représentants des Hellènes en Asie Mineure, on a en vue l'assemblée des deux provinces complètement hellénisées, l'Asie et la Bithynie, et le président de cette assemblée, en tant qu'elle se compose des députés des villes appartenant à chacune de ces deux provinces, et dotées toutes de la constitution grecque1; ou bien, dans la province non grecque de Galatie, les représentants des Grecs établis dans le pays, qui siégeaient à côté de l'assemblée des Galates, et étaient désignés sous le nom de chefs des Grecs2. 1. Cf. des décrets des eni tnis (Corp. insc.graec., 3487, 3957); un Lycien honoré (Benndorf, Lyk. Reise, I, 122); lettres adressées à des Hellènes en Asie (Corp. insc. graec., 3832, 3833); dans un discours prononcé à l'assemblée de Pergame (Aristide, p. 517); (Perrot, Expl. de la Galatie, p. 32); une lettre de l'empereur Alexandre au même (Dig., XLIX, 1, 25); - enfin Dion, LI, 20. 2. Outre les Galatarques (Marquardt, Staatsverw., I, p. 515), on rencontre dans la Galatie, sous Hadrien même, des Helladarques (Bulletin de corr. hell., VII, p. 18) qui ne peuvent être comparés qu'aux Hellénarques de Tanaïs (p. 84, note 2). |
||||
27 av. J.C.-476 |
Assemblées et les fêtes de la provinceRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteEn Asie Mineure Rome n'avait aucune raison de s'opposer énergiquement aux confédérations des villes. A l'époque romaine comme auparavant, neuf villes de la Troade se sont associées pour accomplir des cérémonies et célébrer des fêtes religieuses communes1. Les assemblées des diverses provinces de l'Asie Mineure, qui furent rétablies, là comme dans tout l'empire, par Auguste, sous la forme d'une institution permanente, ne diffèrent pas en elles-mêmes des autres assemblées provinciales. Mais elles ont suivi dans cette région un développement particulier, ou plutôt elles se sont dénaturées. Le but principal de ces réunions annuelles de députés, envoyés par les villes de chaque province2, était de porter à la connaissance du gouverneur ou de l'autorité: impériale les désirs des habitants et d'être les organes de leur province; il s'y joignait l'obligation de célébrer par une fête annuelle le culte de l'empereur régnant et l'empire lui-même. En l'an 725 (29 av. J.-C.) Auguste permit aux assemblées d'Asie et de Bithynie de lui élever un temple et de lui rendre les honneurs divins dans les villes où elles siégeaient, à Pergame et à Nicomédie. Ce nouveau culte s'étendit bientôt à tout l'empire; la confusion des institutions religieuses et des institutions administratives fut un des fondements de l'organisation impériale des provinces. Mais nulle part, à ce sujet, les fêtes, les cérémonies, les rivalités des villes n'ont pris autant de développement que dans la province d'Asie et dans les autres régions de l'Asie Mineure; nulle part on n'a vu autant se produire, à côté et au-dessus de l'ambition municipale, l'ambition provinciale des villes plus encore que des individus; nulle part elle n'a autant dominé la vie publique. 1. Le (Schliemann, Troie, 1884, p. 256) s'appelle ailleurs (ibid., p. 254). Voir dans Droysen (Hellenismus, II, 2, p. 382 et suiv.), un autre document relatif à la même ligue et datant de l'époque d'Antigone. On doit même croire à l'existence d'autres zolva, embrassant un territoire moins étendu qu'une province, comme l'ancienne ligue des treize villes ioniennes, comme celle des Lesbiens (Marquardt, Staalsverw., I, p. 515), comme celle des Phrygiens qui nous est connue par les monnaies d'Apamée. Ces confédérations ont été aussi présidées par des magistrats; dernièrement on a retrouvé les traces d'un Lesbiarque (Marquardt, lot. cit.) et le chef des Hellènes de Mésie portait le titre de Pontarque (p. 73). Il est probable que les confédérations, dont le président s'appelait archonte, étaient plus que des associations religieuses. Les Lesbiens et les cinq villes de Mésie ont eu sans doute une assemblée particulière, que présidaient ces magistrats. Au contraire le 20(Ramsay, Cities and bishoprics of Phrygia, p. 10), situé auprès de plusieurs ozuo!, est une quasi-commune privée du droit de cité. 2. La réunion des assemblées provinciales de l'Asie Mineure est formellement citée par Strabon, lorsqu'il nous parle de la Lykiarchie (XIV, 3, 2, p. 664) et par Aristide (Or., 26, p. 344), quand il nous raconte son élévation à l'un des sacerdoces provinciaux de l'Asie. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Les prêtres des provinces et les asiatiquesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNon seulement le grand-prêtre du nouveau temple (apzlepkis), nommé pour un an, est le premier dignitaire de la province, mais encore, dans tout le pays, l'année est désignée par son nom1. Les fêtes et les jeux, organisés sur le modèle des cérémonies d'Olympie, qui se répandaient de plus en plus, comme nous l'avons vu, chez tous les Hellènes, furent rattachés en Asie Mineure aux fêtes et aux jeux du culte provincial de l'empereur. La direction en était confiée au président de l'assemblée provinciale, en Asie à l'Asiarque, en Bithynie au Bithyniarque, etc.; c'était lui qui en supportait presque tous les frais, quoiqu'une partie de ces dépenses, comme toutes celles que nécessitait ce culte divin aussi brillant qu'officiel, fût couverte par des dons et des contributions volontaires ou répartie entre les différentes villes. Aussi les gens riches seuls pouvaient-ils aspirer à cette dignité; la ville de Tralles était considérée comme très prospère parce qu'elle put toujours fournir des Asiarques le titre survivait à la charge; à Ephèse on jugea la valeur de l'apôtre Paul par les relations qu'il avait avec plusieurs Asiarques originaires du pays. Malgré les frais qu'elle entraînait, cette magistrature honorifique n'en était pas moins très briguée, plus encore à cause de son éclat extérieur que pour les avantages qu'elle procurait, comme, par exemple, l'affranchissement de la tutelle; pour un Asiatique, entrer en triomphe dans la ville, revêtu d'une robe de pourpre, la couronne sur la tête, escorté par une procession d'enfants qui balancent l'encensoir, était un idéal aussi beau que pour un Hellène celui d'obtenir à Olympie le rameau d'olivier. Maintes fois tel ou tel Asiatique se vante non seulement d'avoir été Asiarque lui-même, mais encore d'être issu d'Asiarques. Au début ce culte n'était célébré que dans les capitales des provinces; mais l'ambition municipale qui prit, surtout en Asie, des proportions extraordinaires, dépassa bientôt cette limite. Dès l'année 23 la province d'Asie décréta qu'un second temple serait construit en l'honneur de l'empereur régnant, Tibère, de sa mère et du sénat; après une longue lutte entre les villes, le sénat décida qu'il serait élevé à Smyrne. Les autres grandes cités suivirent plus tard cet exemple2. Jusqu'alors la province n'avait eu qu'un temple, qu'un président et qu'un grand-prêtre; désormais il dut y avoir autant de grands-prêtres que de temples provinciaux; et comme la direction des fêtes religieuses et l'organisation des jeux incombaient non pas au grand-prêtre, mais au président de l'assemblée; comme d'ailleurs les grandes villes rivalisaient surtout pour les fêtes et les jeux, il fallut donner à tous les grands prêtres le titre et les droits de président d'assemblée; si bien qu'en Asie, au moins, l'Asiarchie et le sacerdoce des temples provinciaux furent réunis dans les mêmes mains3. Il en résulta que l'assemblée et les affaires administratives, qui avaient été l'origine de cette institution, furent reléguées au second plan; l'Asiarque ne fut bientôt plus que l'organisateur des fêtes populaires rattachées à la religion des empereurs passés et présents; sa femme, qui portait le même titre que lui, put prendre part à cette cérémonie, et elle s'en occupa très activement. 1. Exemples, pour l'Asie : Corp. insc. graec., 3487; pour la Lycie: Benndorf, Lyk. Reise, I, p. 71. Mais la confédération lycienne donne aux années le nom du Lykiarque et non de l'Archiereus. 2. Tacite, Ann., IV, 25, 55. La ville, qui possède un temple dédié par l'assemblée de la province porte le titre honorifique de "gardienne du temple" (de l'empereur) et si l'une de ces villes peut montrer plusieurs temples de ce genre, elle ajoute à son titre le nombre des temples. Cette institution nous fait voir clairement que le culte impérial a atteint en Asie Mineure son plein développement. En fait le néocorat est général; il peut être appliqué à toute divinité et à toute ville; considéré comme un titre, comme un surnom honorifique de cité, on ne le rencontre, à quelques exceptions près, qu'en Asie Mineure; - seules quelques villes grecques des provinces voisines, Tripoli en Syrie, Thessalonique en Macédoine, ont joui de ce privilège. 3. On ne peut guère mettre en doute que le président de l'assemblée et le grand-prêtre provincial de l'empereur ne fussent primitivement deux personnages distincts; pourtant non seulement, en Asie Mineure, le premier de ces deux fonctionnaires perd complètement son caractère de magistrat, qui survit dans la Hellade, où est née l'organisation des souva, mais encore il semble qu'en fait se soient confondus là où le avait plusieurs centres religieux. Le président du en Asie Mineure ne porte jamais le titre de , qui accentuerait nettement le caractère civil de sa fonction; de même on rencontre rarement ? (p. 120, note 1) ou (Corp. insc. graec., 4380, k", p. 1168); les mots composés , analogues au d'Achaïe, sont, déjà au temps de Strabon, les termes usités. Dans les provinces moins importantes comme la Galatie et la Lycie, l'Archonte et l'Archiereus de la province sont restés certainement distincts. Mais en Asie, les inscriptions prouvent l'existence d'Asiarques pour Ephèse et Smyrne (Marquardt, Staatsverw., I, p. 514), quoiqu'il ne put y avoir, d'après la nature même de cette institution, qu'un seul Asiarque dans toute la province. L'agonothésie (présidence des jeux) de l'Archiereus est aussi assurée (Galien à Hippocrate, De part., XVIII, 2, p. 507, ed. Kuhn), quoique ce fit une attribution spéciale de l'Asiarque. Selon toute apparence ce sont les rivalités des villes qui ont provoqué ces modifications; lorsqu'il y eut, dans différentes cités, plusieurs temples dédiés à l'empereur par la province, l'agonothésie fut enlevée au président effectif de l'assemblée, et fut donnée ainsi que le titre d'Asiarque au grand-prêtre de chaque temple. Sur les monnaies des treize villes ioniennes (Mionnet, III, p. 61, 1) on trouve ?, et dans des inscriptions d'Ephèse, le même personnage T. Julius Reginus peut être appelé tantôt (Wood, Inscr. from the great theatre, 18) tantôt (ibid., 8 et 14; de même, 9). C'est seulement de cette manière que l'on peut comprendre les institutions du quatrième siècle. A cette époque on rencontre dans chaque province un grand-prêtre qui porte en Asie le titre d'Asiarque, en Syrie, celui de Syriarque et ainsi de suite. C'est dans la province d'Asie que l'Archonte et l'Archiereus se confondirent d'abord, mais rien ne fut plus facile désormais que de réunir partout ces deux magistratures, surtout lorsque les provinces devinrent peu importantes. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Surveillance exercée sur le culte des prêtresRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteDans chaque province le grand-prêtre du culte impérial acquit aussi une puissance matérielle, grâce à la surveillance religieuse qu'il devait exercer; cette puissance fut d'autant plus grande en Asie Mineure que le grand-prêtre y était plus considéré. Lorsque l'assemblée provinciale eut décrété le culte de l'empereur, et lorsque le gouvernement eut approuvé cette décision, les assemblées municipales suivirent naturellement cet exemple; dès l'époque d'Auguste toutes les localités importantes de la province d'Asie avaient leur Caesareum et leur fête de l'empereur1. Le droit et le devoir du grand-prêtre étaient de surveiller dans son ressort l'exécution de ces décrets tant provinciaux que municipaux et l'exercice du culte. Ce qui prouve quelle importance avaient ces questions religieuses, c'est que, sous Tibère, la ville libre de Cyzique, en Asie, fut privée de son autonomie, entre autres choses parce qu'elle avait négligé de construire le temple dédié par la province au dieu Auguste, sans doute pour affirmer son indépendance en face de l'assemblée provinciale. Cette surveillance supérieure, limitée d'abord au culte impérial, s'étendit probablement à toutes les affaires de religion2. Plus tard, lorsque l'ancienne et la nouvelle religion commencèrent à se disputer la prépondérance dans l'empire, ce fut surtout sous l'influence des grands-prêtres de province que leur rivalité devint un conflit. Ces prêtres, choisis par l'assemblée provinciale parmi les principaux habitants du pays, étaient appelés et disposés, beaucoup plus que les fonctionnaires impériaux, par leurs traditions et par les devoirs de leur charge, à constater l'abandon dans lequel on laissait la religion officielle; lorsque les remontrances ne suffisaient pas, comme ils n'avaient pas par eux-mêmes le droit de punir, ils avaient à dénoncer aux autorités locales ou impériales les actes qui tombaient sous le coup du droit civil, à recourir au bras séculier, et surtout à faire valoir contre les chrétiens les prétentions du culte impérial. Dans les derniers temps de l'empire, les souverains attachés au paganisme prescrivaient expressément à ces grands-prêtres de châtier par eux-mêmes, et par l'intermédiaire des prêtres des villes qui leur étaient subordonnés, toutes les contraventions à la religion établie; ils leur donnaient le même rôle que les empereurs chrétiens ont donné aux métropolitains et aux évêques des villes3. Sans doute ce ne sont pas les païens qui ont copie dans cette province les institutions chrétiennes : c'est, au contraire, l'église chrétienne victorieuse qui a emprunté sa hiérarchie au culte rival. Tout cela se retrouve dans tout l'empire, nous l'avons déjà dit, mais l'Asie Mineure a éprouvé plus qu'un autre pays les conséquences pratiques de l'organisation régulière donnée dans les provinces au culte de l'empereur, la surveillance religieuse et la persécution des croyances étrangères. 1. Dion de Pruse (Or., 35, p. 66 R.) appelle les Asiarques et les Archontes du même genre ? lepéwy (il signale nettement leur agonothésie, et c'est à eux qu'il faut rapporter ces mots corrompus ?, au lieu desquels il faut écrire ). Leur titre de prêtres de la province n'est presque jamais accompagné de celui de prêtres de l'empereur qui y était lié s'ils devaient jouer dans leur ressort le même rôle que le Pontifex Maximus à Rome; cette absence est tout à fait justifiée. 2. C'est dans ce but que Maximin donna un soutien militaire au grand-prêtre de chaque province (Eusèbe, Hist. eccles., VIII, 14, 9); et la célèbre lettre de Julien au Galatarque de son temps (Ep., 49, cf. 63) nous donne une idée très nette des devoirs de ce fonctionnaire. Il doit surveiller dans sa province tout ce qui est relatif à la religion, conserver son indépendance en face du gouverneur, ne pas faire antichambre à sa porte, lui défendre d'entrer dans le temple avec une escorte militaire, le recevoir non pas devant le temple mais dans l'intérieur, où il est le maître et où le gouverneur n'est plus qu'un simple particulier; des 30,000 boisseaux de blé et des 60,000 setiers de vin que le gouvernement donne en subvention à la province, la cinquième partie doit être réservée aux pauvres qui forment la clientèle des prêtres païens, et le reste consacré à des oeuvres charitables; dans chaque ville de la province il faut rétablir, quand on le pourra, avec l'aide des particuliers, des hospices, non seulement pour les païens, mais pour tout le monde, et ne pas laisser plus longtemps aux chrétiens le monopole des bonnes oeuvres. Le Galatarque doit, par son exemple et par ses discours, exhorter tous les prêtres de la province à mener une vie pieuse, à fuir les théâtres et les cabarets, et surtout à fréquenter assidûment les temples avec leurs familles et leur suite; s'ils ne peuvent se corriger, les destituer. C'est là une lettre pastorale des meilleures; il n'y a que l'adresse de changée et des citations d'Homère au lieu du texte de la Bible. Ces recommandations témoignent de la décadence du paganisme; elles n'avaient jamais été données si expressément dans les premiers temps de l'empire; mais la base de cette organisation, la surveillance générale que le grand-prêtre doit exercer sur les affaires religieuses de sa province, n'est pas une institution nouvelle. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Etat religieuxRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteA côté du culte de l'empereur, la religion proprement dite jouit en Asie Mineure d'une situation des plus propices; tous ses excès y trouvèrent un refuge. Les désordres auxquels donnaient lieu le droit d'asile et les cures merveilleuses y avaient libre carrière. Sous Tibère, le droit d'asile fut limité par le sénat romain; le dieu sauveur Esculape ne fit nulle part plus de miracles extraordinaires que dans sa ville chérie de Pergame, où on l'honorait sous le nom de Zeus Asklepios, et qui lui dut en partie sa prospérité sous l'empire. Les thaumaturges les plus puissants de l'époque impériale, le Cappadocien Apollonius de Tyane, qui fut plus tard canonisé, le Paphlagonien Alexandre d'Abonouteichos, l'homme au serpent, étaient tous deux originaires d'Asie Mineure. Si la défense générale de former des associations fut plus strictement appliquée dans ce pays, comme nous le verrons, la cause doit en être cherchée dans l'état religieux de la province qui faisait sentir plus particulièrement le danger de pareilles réunions. |
||||
27 av. J.C.-476 |
La sécurité publiqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa sécurité publique dépendait principalement du pays lui-même. Au début de l'empire, il n'y avait dans toute l'Asie Mineure, abstraction faite du commandement de Syrie qui comprenait la Cilicie orientale, qu'un détachement de cinq mille auxiliaires, cantonnés dans la province de Galatie1, avec une flotte de quarante navires; ce commandement militaire était destiné en partie à maintenir dans l'obéissance les Pisidiens remuants, en partie à défendre la frontière impériale du Nord-Est et à surveiller la côte de la mer Noire jusqu'à la Crimée. Vespasien augmenta l'effectif d'occupation : il en fit un corps d'armée de deux légions, qu'il posta dans la province de Cappadoce, sur l'Euphrate supérieur. En dehors de ces troupes chargées de protéger la frontière, on ne rencontre en Asie Mineure aucune garnison importante; par exemple, dans la province impériale de Lycie et de Pamphylie, il n'y avait qu'une cohorte de cinq cents hommes; dans les provinces sénatoriales se trouvaient seulement quelques soldats tirés de la garde impériale ou des provinces impériales voisines et détachés pour des missions spéciales2. En un sens, cet état de choses prouve formellement que la paix régnait à l'intérieur de ces provinces et nous montre quelle différence énorme il y avait entre les cités de l'Asie Mineure et les grandes villes sans cesse troublées de la Syrie et de l'Egypte; mais, d'autre part, il nous explique pourquoi le brigandage a persisté, comme nous l'avons déjà montré ailleurs, au milieu de ce pays montagneux et presque désert à l'intérieur, principalement sur les frontières de la Mysie et de la Bithynie et dans les hautes vallées de la Pisidie et de l'Isaurie. Il n'y avait pas à proprement parler de milices municipales en Asie Mineure. Malgré la prospérité des gymnases où s'exerçaient les enfants, les jeunes gens et les hommes faits, les Hellènes d'Asie étaient aussi peu militaires, à cette époque, que ceux d'Europe3. 1. D'après Josèphe (Bell. Jud., II, 16, 4), cette troupe ne peut avoir été placée qu'en Galatie, entre les deux provinces d'Asie et de Cappadoce, où ne se trouvait aucune garnison. Comme il est naturel, elle fournissait aussi les détachements qui campaient dans les territoires soumis du Caucase, et à cette époque, sous Néron, ceux qui occupaient le Bosphore; il est vrai que cette région recevait aussi des soldats de Mésie (p. 88). 2. Un prétorien stationarius Ephesi (Eph. epigr., IV, 70); un soldat in statione Nicomedensi (Pline, ad Trajan., 74); un centurion légionnaire à Byzance (id., ibid., 77, 78). 3. Dans l'organisation municipale de l'Asie Mineure tout existait, sauf l'armée. Le otpatnyos de Smyrne n'est plus qu'un souvenir, comme le culte d'Hercule (Corp. insc. graec., 3162). |
||||
27 av. J.C.-476 |
IrénarquesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteOn se contentait, pour garantir la sécurité publique, de créer des irénarques municipaux, des gardiens de la paix, auxquels on donnait un certain nombre de gendarmes, en partie montés, troupe salariée de modeste apparence, mais qui a dû être utile, puisque l'empereur Marc-Aurèle, lorsqu'il y eut pénurie de soldats dans la guerre des Marcomans, ne dédaigna pas d'enrôler dans les troupes impériales ces soldats municipaux de l'Asie Mineure1. 1. L'irénarque de Smyrne envoie ses gendarmes pour s'emparer de Polycarpe :? (Acta mart., ed. Ruinart, p. 39). Nous savons d'ailleurs qu'ils n'avaient pas le véritable équipement militaire (Ammien, XXVII, 9, 6: adhibilis semiermibus quibusdam contre les Isauriens quos diogmitas appellant). C'est le biographe de Marc-Aurèle qui nous signale leur présence dans la guerre des Marcomans, ch. 26: armavit et diogmilas; nous le savons aussi par une inscription d'Aezani en Phrygie (Corp. insc. graec., 3031 a 8 = Lebas-Waddington, 992): ?. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Administration de la justiceRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMême à cette époque, la justice n'était encore rendue, aussi bien qu'on pouvait le désirer, ni par les autorités municipales ni par les gouverneurs; cependant l'établissement de l'empire fut le signal d'un progrès dans cette voie. Sous la République, l'intervention du pouvoir central se bornait à l'exercice d'un contrôle avec droit de punitions sur les fonctionnaires; dans les derniers temps ce contrôle était devenu faible et partial, ou même ne s'exerçait plus du tout. Non seulement les empereurs tinrent à Rome les rênes plus serrées, cette dictature militaire était forcée de surveiller très sévèrement tous les magistrats, - et le Sénat impérial lui-même dut contrôler plus sérieusement la conduite publique de ses mandataires, mais on put aussi ou bien, grâce à l'institution nouvelle de l'appel, réparer les fautes des tribunaux de province, ou bien, lorsque l'on était certain de la partialité du jugement, évoquer le procès à Rome devant le tribunal de l'empereur1. Ces deux procédés furent très avantageux, même pour les provinces sénatoriales, et, selon toute apparence, on les considéra comme un grand bienfait. 1. A Cnide, en l'an de Rome 741/2 = 13/12 av. J.-C., quelques citoyens, notables comme il semble, avaient attaqué durant trois nuits la maison d'un de leurs ennemis personnels (Bull. de corr. hellen., VII, p. 62); en se défendant, un esclave de la maison assiégée tua l'un des assaillants, sur lequel il avait jeté un vase du haut d'une fenêtre. Les propriétaires de la maison furent accusés de meurtre; ayant contre eux l'opinion publique, ils redoutèrent l'arrêt du tribunal de Cnide et obtinrent d'être jugés par l'empereur Auguste. Celui-ci fit faire une enquête par un commissaire; il acquitta les accusés et signifia sa sentence aux juges de Cnide; il leur reprocha en même temps de s'être montrés partiaux dans la circonstance, et leur ordonna de se conformer à son arrêt. Cnide était une ville libre; en agissant ainsi, Auguste empiétait sur les droits souverains de la cité. Il en fut de même à Athènes, lorsqu'on y introduisit sous Hadrien l'appel à l'empereur et même au proconsul (p. 15, note 2). Mais si l'on considère quel était à cette époque l'état de la justice dans une ville grecque, on ne peut douter que si des empiétements de ce genre ont peut-être provoqué quelques sentences injustes, ils en ont empêché un plus grand nombre encore. |
||||
27 av. J.C.-476 |
L'organisation municipale en Asie MineureRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLogistae. Gerousia. Neoi. - En Asie Mineure, comme dans la Grèce d'Europe, la province romaine ne fut qu'une réunion de municipalités. Les anciennes formes de la constitution démocratique y furent en général conservées ainsi que dans la Hellade: par exemple les magistrats étaient toujours élus par des assemblées de citoyens; mais partout l'influence prépondérante appartenait aux riches: les caprices de la foule pas plus que les ambitions politiques sérieuses ne pouvaient se développer librement. Parmi les restrictions qui furent apportées à l'autonomie municipale, il est un fait qui caractérise les cités d'Asie Mineure : l'irénarque, dont nous avons parlé plus haut, le chef de la police municipale était choisi, au second degré, par le gouverneur sur une liste de dix personnes qui lui était présentée par le conseil de chaque cité. L'autorité centrale intervenait aussi dans l'administration financière des villes : l'empereur nommait un curateur étranger à la cité (curator rei publicae), dont les autorités locales devaient obtenir le consentement pour toutes les affaires importantes qui concernaient le maniement des deniers municipaux. Ce n'était pas là une organisation générale, mais une disposition temporaire appliquée à telle ou telle ville suivant les nécessités; mais cette institution fut introduite en Asie de très bonne heure, c'est-à-dire dès le commencement du second siècle et appliquée dans de grandes proportions, à cause du développement considérable des villes dans la province. Au troisième siècle au moins, dans cette partie de l'empire comme dans toutes les autres, les décisions importantes de l'administration municipale durent être soumises à la confirmation du gouverneur. Le gouvernement romain n'a établi dans aucune province et dans les pays helléniques moins que partout ailleurs une constitution municipale uniforme. A cet égard, une grande variété régnait dans l'Asie Mineure; il arrivait même que plus d'une cité suivait en cela ses volontés, bien que le décret qui organisait une province prescrivît des règles générales communes à toutes les villes de cette province. Les institutions qui étaient répandues dans toute l'Asie Mineure et qui peuvent être considérées comme particulières à cette contrée, n'ont aucun caractère politique; elles ne sont importantes qu'au point de vue social. Telles furent les associations, nombreuses dans le pays, soit des plus vieux, soit des plus jeunes citoyens, la Gerousia et les Neoi, sociétés de distraction pour les hommes de ces deux âges, avec des gymnases et des fêtes appropriées1. A l'origine il y avait en Asie Mineure beaucoup moins de cités autonomes que dans la Grèce proprement dite; les villes les plus importantes de ce pays n'ont jamais joui de cet avantage douteux, ou en ont été privées de bonne heure, comme Cyzique sous Tibère et Samos sous Vespasien. L'Asie Mineure était depuis longtemps une terre soumise; elle s'était habituée à l'organisation monarchique sous les maîtres perses comme sous les maîtres helléniques; de vains souvenirs, de vagues espérances n'emportaient pas les habitants de cette région, comme les Grecs d'Europe, au-delà de l'horizon étroit de la vie municipale, et rien de tel ne venait troubler le paisible bonheur dont ils pouvaient jouir dans la situation qui leur était faite. 1. La Gerousia souvent citée dans les inscriptions d'Asie Mineure n'a rien de commun avec l'institution politique du même nom, fondée à Ephèse par Lysimaque (Strabon, XIV, 1, 21, p. 640; Wood, Ephesus, inscr. from the temple of Diana, 19). Le caractère qu'elle eut sous les Romains est indiqué et par Vitruve (II, 8, 10): Croesi (domum) Surdiani civibus ad requiescendum aetatis otio seniorum collegio gerusiam dedicaverunt, et par l'inscription trouvée dernièrement dans la ville lycienne de Sidyma ( Benndorf, Lyk. Reise, I, p. 71); d'après cette inscription, le conseil et le peuple décident, comme la loi le réclame, de fonder une gerousia et d'y faire entrer cinquante conseillers et cinquante autres citoyens, qui doivent désigner ensuite le gymnasiarque de la nouvelle gerousia. Ce gymnasiarque, que l'on rencontre ailleurs, ainsi que l'Hymnode de la gerousia (Menadier, Qua condic. Ephesii usi sint, p. 51) sont, parmi les fonctionnaires connus de cette corporation, les seuls dont la situation soit bien caractérisée. Les collèges des Neoi, qui ont aussi leur gymnasiarque spécial, sont de même nature, mais beaucoup moins considérés. Les gymnasiarques des Ephèbes sont distincts des deux surveillants des gymnases où s'exercent les hommes faits (Menadier, p. 91). Les fêtes et les banquets communs, auxquels l'Hynode assistait, ne manquaient naturellement pas à 'la gerousia. Ce n'est pas une société de charité; ce n'est pas non plus un collège réservé il l'aristocratie municipale. Il nous montre ce qu'était la vie bourgeoise des Grecs, pour qui le gymnase était ce qu'est le cercle dans nos petites villes. |
||||
27 av. J.C.-476 |
La vie municipaleRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe paisible bonheur, le gouvernement le donna à l'Asie Mineure dans toute sa plénitude. Aucune province, dit un écrivain qui vivait à Smyrne sous les Antonins, ne renferme autant de villes que la nôtre; aucune n'en contient de semblables à nos plus grandes cités. Ce qui lui donne une si grande prospérité, c'est le charme de son site, l'excellence de son climat, la variété de ses productions, sa situation au centre de l'empire et au milieu de peuples pacifiés, sa bonne organisation, la rareté des crimes, le sort adouci des esclaves, les égards et la bienveillance des maîtres. L'Asie s'appelait, comme nous l'avons déjà dit, la province des cinq cents villes; et, si l'intérieur de la Phrygie, de la Lycaonie, de la Galatie et de la Cappadoce n'était qu'un désert sans eau, en partie habitable seulement pour des troupeaux, et où la population était très clairsemée, le reste de la côte ne le cédait pas de beaucoup à la province d'Asie. Au reste la prospérité constante des régions agricoles de l'Asie Mineure n'était pas limitée aux villes qui portaient un nom glorieux, comme Ephèse, Smyrne, Laodicée, Apamée; lorsque nous découvrons un coin de pays indemne des ravages que cette région a subit pendant les dix-sept cents ans qui nous séparent de l'antiquité, le premier et le plus vif sentiment que nous éprouvons est l'effroi, on pourrait presque dire, la honte; tant le contraste est grand entre les misères pitoyables du présent et l'éclatante richesse de l'époque romaine ! |
||||
27 av. J.C.-476 |
Kragos-SidymaRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteSur un sommet isolé situé non loin de la côte lycienne, où la légende grecque plaçait la demeure de la Chimère, s'élevait l'antique Kragos, construite probablement en bois et en torchis, puisqu'elle a complètement disparu, ainsi que les remparts cyclopéens situés au pied de la colline. Au-dessous de la montagne s'étend une plaine agréable et fertile, fraiche comme un vallon des Alpes, mais avec la végétation luxuriante du midi, et entourée de montagnes boisées et giboyeuses. Lorsque la Lycie devint une province romaine sous l'empereur Claude, le gouvernement impérial transporta dans cette plaine la ville jadis perchée sur la montagne, la verte Kragos d'Horace. Sur la place publique de la nouvelle cité de Sidyma on voit encore les restes du temple à quatre colonnes élevé en cette circonstance à l'empereur, et d'un superbe portique, qu'un enfant du pays, enrichi comme médecin, construisit dans sa patrie. Le forum était orné des statues des empereurs et des citoyens qui avaient rendu de grands services à leur cité. Il y avait encore dans cette ville un temple élevé à ses dieux protecteurs, Artemis et Apollon, des bains, des gymnases (yupracea) pour les vieillards et pour les jeunes gens; hors des portes, sur les deux côtés de la grande route qui gravissait à pic la montagne, et qui redescendait ensuite vers le port de Kalabatia, se succédaient des tombeaux de pierre, plus magnifiques et plus riches que ceux de Pompéi et dont beaucoup subsistent encore, tandis que les maisons, bâties probablement comme celles de l'ancienne ville avec de mauvais matériaux, ont toutes disparu. Nous sommes renseignés sur l'état et la condition des anciens habitants du pays par un document récemment trouvé sur place, un décret municipal rendu probablement sous Commode et relatif à la constitution d'une société pour les citoyens âgés. Elle était composée de cent membres choisis la moitié parmi les conseillers, la moitié parmi les autres citoyens; elle ne comprenait que trois affranchis et un bâtard; tous les autres membres étaient de bonne naissance, et la plupart d'entre eux appartenaient certainement aux anciennes et riches familles de la cité. Quelques-unes de ces familles avaient obtenu le droit de cité romaine; l'une d'elles entra même dans le sénat de l'empire. Mais cette maison de sénateurs, comme d'autres familles originaires de Sidyma, ne put jamais retrouver une patrie à l'étranger; des médecins mêmes de la cour impériale ne pouvaient oublier leur pays, et plusieurs d'entre eux revinrent y mourir. Dans un travail qui n'est certes pas excellent, mais qui est très érudit et plein de patriotisme, l'un de ces notables citoyens a réuni les légendes et les prophéties relatives à cette ville, et il a fait publier ces Mémorables. A l'assemblée de la petite province de Lycie, Sidyma ne votait pas parmi les villes de premier ordre; elle n'avait ni théâtre, ni titre honorifique; elle ne donnait pas de ces fêtes générales qui, dans la société de cette époque, caractérisaient une grande ville; dans l'esprit des anciens, c'était une petite ville de province, une fondation de l'empire romain; et pourtant actuellement, dans tout le vilayet d'Aïdin, il n'est aucune ville que l'on puisse comparer même de loin pour la civilisation à cette bourgade perchée dans la montagne. Tout ce qui frappe encore aujourd'hui nos yeux dans ce village isolé, a disparu complètement ou n'est plus réduit qu'à de faibles vestiges dans beaucoup d'autres villes qu'a dévastées la main de l'homme. Nous pouvons encore nous rendre compte de l'antique prospérité du pays par l'activité du monnayage de cuivre, dont l'empire avait accordé l'autorisation aux cités; aucune province ne peut se mesurer avec l'Asie pour le nombre d'ateliers et pour la variété des représentations gravées sur les pièces. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Défauts de l'administration municipaleRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCependant cette concentration de tous les intérêts dans la petite ville natale n'est pas sans inconvénients; l'Asie Mineure n'y échappa pas plus que la Grèce d'Europe. Ce que nous avons dit de l'administration municipale dans la Hellade est en général vrai pour l'Asie. Les finances des cités, qui ne sont pas sérieusement contrôlées, manquent de solidité; elles ne sont ni ménagées, ni souvent même gérées honorablement. Tantôt la construction des monuments ruine la cité, tantôt les dépenses indispensables ne peuvent pas être faites. Les citoyens pauvres s'habituent aux distributions de la caisse municipale ou des gens riches; ils s'accoutument à recevoir gratuitement de l'huile dans les bains, à prendre part aux fêtes et aux banquets publics, dont d'autres font les frais; les grandes maisons s'entourent d'une clientèle platement obséquieuse, mendiante, et toujours divisée; à l'exemple des villes qui rivalisent l'une avec l'autre, on voit rivaliser dans chaque cité les divers cercles et les diverses familles. Le gouvernement n'ose pas laisser créer en Asie Mineure des associations de pauvres ni des compagnies volontaires de pompiers, comme il en existe partout en Occident, parce que l'esprit factieux s'introduit aussitôt dans toute association. Un lac tranquille devient aisément marais; il en fut ainsi en Asie Mineure dont le calme plat ne fut jamais troublé par le mouvement des intérêts généraux. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Prospérité du paysRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'Asie Mineure, et surtout l'Asie antérieure, était une des régions les plus riches du vaste empire romain. Sans doute le mauvais gouvernement de la république, les catastrophes qui en avaient été la conséquence au temps de Mithridate, la piraterie, enfin les quatre ans de guerres civiles, dont les provinces asiatiques s'étaient ressenties plus que toute autre dans leurs finances, avaient complètement ruiné les villes et les particuliers si bien qu'Auguste dut recourir à un moyen extrême, l'abolition des dettes, remède dangereux dont, sauf les Rhodiens, tous les Asiatiques firent usage; mais la paix renaissante fit tout oublier. Lorsqu'Auguste mourut, on ne pensait déjà plus aux blessures ni aux remèdes, non pas partout, il est vrai, car les îles de la mer Egée ne se relevèrent pas de cette ruine, - mais presque partout; et le pays jouit de cette prospérité pendant trois siècles jusqu'aux guerres des Goths. Les sommes que les villes de l'Asie Mineure devaient fournir, qu'elles répartissaient et levaient elles-mêmes sous le contrôle du gouverneur, furent un des revenus les plus importants du budget impérial. Nous ne pouvons pas constater jusqu'à quel point les impôts étaient proportionnés aux moyens des citoyens, mais des charges continuelles trop lourdes ne sont guère compatibles avec l'heureuse situation dans laquelle ce pays resta jusqu'au milieu du troisième siècle. Si le gouvernement ne suscita pas trop d'entraves au commerce et ne pressura pas le pays de trop d'impôts, ce qui n'est pas pénible seulement pour le contribuable, ce fut peut-être par mollesse plutôt que par esprit de ménagement. Dans les grandes catastrophes, par exemple, lors des tremblements de terre, qui démolirent sous Tibère douze villes florissantes de la province d'Asie, entre autres Sardes, et qui, sous Antonin, ruinèrent beaucoup de villes cariennes et lyciennes, ainsi que les îles de Cos et de Rhodes, la charité privée et surtout la charité impériale s'exercèrent avec une grande générosité; l'Asie Mineure put apprécier alors l'avantage précieux des grands Etats, la solidarité générale. Les Romains s'étaient occupés de construire des routes, lorsqu'ils avaient organisé sous Manius Aquilius la province d'Asie; sous l'empire cette oeuvre ne fut continuée sérieusement en Asie Mineure que dans les régions où étaient postées de fortes garnisons, surtout en Cappadoce et dans la province voisine de Galatie, depuis que Vespasien avait établi un camp de légions sur le moyen Euphrate1. Dans les autres provinces on ne s'occupa guère des ponts et chaussées; ce fut sans doute la faute du gouvernement sénatorial, qui manquait d'énergie. Lorsque des routes furent construites par l'Etat, elles le furent sur un ordre de l'empereur2. Cette prospérité de l'Asie Mineure n'est pas l'oeuvre d'un gouvernement très intelligent et très actif. Les institutions politiques, l'impulsion donnée à l'industrie et au commerce, l'initiative littéraire et artistique doivent être attribuées en Asie Mineure aux anciennes villes libres ou aux Attalides. Ce que l'empire romain a donné au pays, c'est essentiellement une paix durable; il a laissé s'épanouir sa prospérité intérieure, sans agir comme ces gouvernements qui considèrent chaque paire de bras vigoureux et chaque pièce d'or mise de côté comme légalement réservés à leurs desseins immédiats : ce sont là des vertus négatives, inconnues aux hommes supérieurs, mais qui souvent sont plus utiles pour le bien-être général, que les grandes actions de ceux qui se posent en tuteurs de l'humanité. 1. Les plus anciens milliaires d'Asie datent de Vespasien (Corp. insc. lat., III, 306); ils sont assez nombreux depuis lors, surtout entre Hadrien et Domitien. 2. C'est ce que prouvent à l'évidence les constructions de routes faites dans la province sénatoriale de Bithynie par le procurateur impérial sous Néron et Vespasien (Corp. insc. lat., III, 346; Eph. epigr., V, 96). Dans les provinces sénatoriales d'Asie et de Chypre, le sénat n'est jamais nommé à propos des constructions de routes; ce fait peut s'expliquer de la même façon. Au troisième siècle, en Asie, comme partout ailleurs, la construction des routes impériales fut imposée aux communes (Smyrne, Corp. insc. lat., III, 471; Thyatire, Bull. de corr. hell., I, p. 101; Paphos, Corp. insc. lat., III, 218). |
||||
27 av. J.C.-476 |
Commerce et industrieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa prospérité de l'Asie Mineure provenait de l'industrie et du commerce autant que de la culture du sol. C'est dans les pays voisins de la côte que la nature s'était montrée le plus favorable; et plus d'un indice montre comment, par un travail assidu, même dans les circonstances difficiles, chaque morceau de terre cultivable était utilisé, par exemple dans la vallée rocheuse de l'Eurymedon, en Pamphylie, que les habitants de Selge surent rendre fertile. Les produits industriels de l'Asie Mineure sont trop nombreux et trop variés pour que nous nous arrêtions sur chacun d'entre eux1; rappelons seulement que les immenses pâturages de l'intérieur, peuplés de brebis et de chèvres, avaient mis ce pays au premier rang pour l'industrie de la laine et pour le tissage. Il suffit aussi d'attirer l'attention sur les laines de Milet et de Galatie, c'est-à-dire sur la laine d'Angora, sur les broderies d'or d'Attale, sur les draps tissés à la manière nervienne ou wallonne, dans les fabriques de Laodicée de Phrygie. L'on sait qu'une émeute fut sur le point d'éclater à Ephèse parce que les orfèvres craignaient de voir diminuer leur commerce d'images sacrées, si la nouvelle foi chrétienne se répandait. A Philadelphie, cité importante de la Lydie, nous connaissons les noms de deux quartiers de la ville sur sept : ce sont ceux des tisseurs de laine et des cordonniers. Nous trouvons probablement ici la preuve d'un fait, qui se dissimule dans les autres villes sous des noms plus anciens et mieux sonnants : les villes les plus importantes de l'Asie furent toujours peuplées, non seulement de commerçants, mais encore d'un grand nombre d'ouvriers de fabriques. C'était surtout la production locale qui alimentait les transactions commerciales et financières; le grand mouvement d'importation et d'exportation de la Syrie et de l'Egypte ne se faisait pas sentir dans l'Asie Mineure, quoiqu'il y vînt de l'Orient différents articles, entre autres un nombre considérable d'esclaves qu'amenaient les marchands galates2. Mais si les commerçants romains se trouvaient en nombre considérable, comme il semble, dans toute ville grande ou petite, et même dans des localités comme Ilion et Assos de Mysie, comme Prymnessos et Traianoupolis de Phrygie; si leurs corporations avaient coutume de prendre part aux cérémonies officielles, à côté de la municipalité locale; si, à Hiérapolis, dans l'intérieur de la Phrygie, un fabricant (soyastns) faisait écrire sur son tombeau, qu'il avait doublé soixante-douze fois dans sa vie le cap Malée pour aller en Italie; si un poète romain représente un négociant de la capitale se dirigeant en toute hâte vers le port pour ne pas laisser tomber entre les mains de ses concurrents le client qui arrive de Kibyra, ville peu éloignée d'Hiérapolis, c'est qu'il régnait dans le pays une véritable activité commerciale et industrielle et que cette activité n'existait pas seulement dans les ports. La langue même témoigne des relations constantes que les Asiatiques entretenaient avec l'Italie : parmi les mots latins qui ont passé dans la langue usuelle en Asie Mineure, un grand nombre a été importé par le commerce; c'est ainsi qu'à Ephèse, la corporation des tisseurs de laine porte un nom latin3. C'est surtout de ce pays que les professeurs de toutes sortes et les médecins venaient en Italie et dans les autres provinces de langue latine; non seulement ils y acquéraient souvent une fortune considérable, mais encore ils revenaient en jouir dans leur patrie; parmi les hommes auxquels les villes de la contrée sont redevables de monuments ou de fondations, les médecins enrichis4 et les professeurs tiennent une place importante. Enfin les grandes familles de l'Asie Mineure émigrèrent moins et plus tard vers l'Italie que celles des provinces occidentales; on quittait plus facilement Vienne et Narbonne que les villes grecques pour aller s'établir dans la capitale de l'empire. En outre, le gouvernement impérial ne cherchait pas dans les premiers temps à attirer à la cour et à faire entrer dans l'aristocratie romaine les principaux citoyens des villes de l'Asie Mineure. 1. Les chrétiens de la petite ville maritime de Korykos, dans la Cilicie montagneuse, inscrivaient d'habitude, contrairement à la coutume générale, leurs professions sur leurs tombeaux. Dans les inscriptions funéraires relevées par Langlois et plus récemment par Duchesne (Bull.de corr. hell., VII, p. 230 et suiv.) on trouve un écrivain public , un marchand de vin , deux marchands d'huile , un marchand de légumes, un fruitier , deux merciers , cinq orfèvres , dont l'un est prêtre, quatre chaudronniers , deux fabricants d'instruments , cinq potiers , dont l'un est cité comme patron et un autre comme prêtre, un marchand d'habits (watotaans), deux marchands de vêtements de lin (Aevotohans), trois tisseurs , un lainier , deux cordonniers , un pelletier un marinier (vabianpos), une sage-femme (latpuvr); plus loin se trouve un tombeau commun à tous les changeurs de haut rang. Tel était l'aspect du pays aux Ve et VIe siècles. 2. Ce commerce, qui est prouvé pour le quatrième siècle (Ammien, XXII, 7, 8; Claudien, in Eutrop., I, 59) est sans aucun doute plus ancien. D'ailleurs, comme Philostrate nous le dit (Vita Apoll., VIII, 7, 12), les habitants non grecs de la Phrygie vendaient leurs enfants aux marchands d'esclaves. 3. Suvepyasla (Wood, Ephesus city, 4). De même, sur les inscriptions de Korykos (p. 141, note) les métiers portent souvent des noms latins. Le degré s'appelle dans les inscriptions de Phrygie (Corp. insc. graec., 3900, 3902, i). 4. Un de ces médecins est Xénophon de Cos, fils d'Héraclite, que nous connaissons aussi par Tacite (Ann., XII, 61, 67), par Pline (Hist. nat., XXIX, 1, 7) et par une série de monuments retrouvés dans son pays natal (Bull. de corr. hellen., V, p. 468). Médecin ordinaire (titre qui se rencontre ici pour la première fois) de l'empereur Claude, il acquit une telle influence, qu'il joignit à sa charge de médecin l'importante situation de secrétaire particulier de l'empereur pour la correspondance grecque (? cf. Suidas au mot ); non seulement il fit donner à son frère et à son oncle le droit de cité romaine et le grade d'officier de rang équestre; non seulement il acquit lui-même la dignité de chevalier, le rang d'officier, et la décoration de la couronne d'or et de la haste à l'occasion du triomphe de Bretagne, mais encore il fit exempter d'impôts sa patrie. Un tombeau lui fut construit dans son île; ses compatriotes reconnaissants lui élevèrent des statues, à lui et aux siens; en souvenir de ses bienfaits, ils frappèrent des monnaies à son effigie. Ce fut lui sans doute qui hâta par l'empoisonnement la mort de Claude, malade et déjà condamné; il n'eut pas moins de crédit sous le successeur de ce prince. Sur ses monuments il ne porte pas seulement le titre ordinaire d'ami de l'empereur, mais il est appelé spécialement ami de Claude , et ami de Néron (d'après une restitution certaine). Son frère, auquel il avait succédé dans cette position, touchait un traitement de 500 000 sesterces, mais il assura à l'empereur qu'il n'avait accepté cette charge que par amour pour lui; dans sa patrie il gagnait 100000 sesterces de plus. Malgré les sommes considérables que les deux frères ont dépensées pour Cos et surtout pour Naples, ils laissèrent encore une fortune de 30 millions de sesterces. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Activité littéraireRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteSi l'on fait abstraction de l'antique période, merveilleusement féconde, pendant laquelle l'épopée ionienne et la poésie lyrique éolienne, les premiers essais de l'histoire et de la philosophie, de la sculpture et de la peinture se développèrent dans les cités de ce pays, la grande époque scientifique et artistique de l'Asie Mineure fut l'époque des Attalides, qui d'ailleurs restait fidèle au souvenir de la première période plus brillante encore. Si Smyrne rendit à Homère, son citoyen, un culte divin, si elle frappa des monnaies en son honneur et avec son nom, elle exprimait par là le sentiment qui régnait dans toute l'Ionie et dans toute l'Asie Mineure: les Grecs croyaient que l'art diyin était descendu sur la terre en Grèce, et surtout en lonie. |
||||
27 av. J.C.-476 |
EnseignementRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteUn décret de la ville de Téos ?, en Lydie, relatif à l'instruction élémentaire, nous apprend que l'on s'était officiellement occupé d'elle de bonne heure dans le pays et qu'elle avait reçu un grand développement. Suivant ce décret, un capital donné par un riche citoyen, et qui permet à la ville de faire face à ces nouvelles dépenses, doit être employé à entretenir, à côté de l'inspecteur des gymnases, un inspecteur des écoles; en outre, on institue trois professeurs d'écriture, répartis en trois classes, aux appointements de 600550 et 500 drachmes; tous les garçons et filles libres pourront ainsi apprendre à écrire. On crée de même deux maîtres de gymnastique aux appointements de 500 drachmes, un professeur de musique payé 700 drachmes, qui enseigne aux garçons des deux dernières années scolaires et aux jeunes gens déjà sortis de l'école à jouer du luth et à pincer de la cithare, un maître d'escrime aux appointements de 300 drachmes, enfin un maître qui enseignera à tirer de l'arc et à jeter la lance, aux appointements de 250 drachmes. Les professeurs d'écriture et de musique doivent tous les ans faire passer à leurs élèves un examen public dans la maison de ville. Telle était l'Asie Mineure au temps des Attalides, mais la république romaine n'a pas continué leur oeuvre. Elle ne fit pas perpétuer par le ciseau ses victoires sur les Galates; la bibliothèque de Pergame fut transportée à Alexandrie, peu de temps avant la bataille d'Actium; la plupart des meilleurs germes furent détruits et disparurent dans la lutte contre Mithridate et dans les guerres civiles. Ce fut seulement à l'époque impériale que l'Asie Mineure, redevenue prospère, put de nouveau s'occuper, au moins superficiellement, d'art et surtout de littérature. Mais aucune des villes nombreuses du pays ne doit revendiquer, dans quelque genre que ce soit, une réelle supériorité comme celles qu'Athènes possédait en tant que centre d'enseignement, dont Alexandrie jouissait dans l'ordre des recherches scientifiques, et que personne ne contestait à la frivole capitale de la Syrie dans l'organisation des spectacles et des ballets. Nulle part pourtant la culture générale ne paraît avoir été plus développée ni plus répandue. De bonne heure on prit l'habitude, dans l'Asie, d'exempter les professeurs et les médecins des charges et des fonctions municipales qui entraînaient de grandes dépenses; ce fut pour cette province que l'empereur Antonin rendit le décret qui établissait le nombre maximum de ces privilèges, afin de mettre des bornes à ces exemptions évidemment fort onéreuses pour les finances municipales: par exemple, les villes de première classe ne purent pas accorder cette immunité à plus de dix médecins, de cinq professeurs de rhétorique et de cinq professeurs de grammaire. 1. Ce document se trouve dans Dittenberger (n. 349). Attale II fonda quelque chose de semblable à Delphes (Bull. de corr. hell., V, p. 157). |
||||
27 av. J.C.-476 |
SophistiqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteSi l'Asie Mineure occupe une place prépondérante dans la littérature de l'empire, c'est grâce à la rhétorique, ou, selon l'expression usitée plus tard, à la sophistique de cette époque, dont nous, modernes, nous ne nous rendons pas compte facilement. Au lieu d'écrire des ouvrages, travail qui a alors perdu presque toute son importance, on compose des discours publics, dans le genre de nos lectures universitaires et académiques, productions qui se renouvellent sans cesse et ne se conservent que rarement, écoutées et applaudies un jour, puis à jamais oubliées. Le sujet en est fourni souvent par la circonstance, l'anniversaire de la naissance de l'empereur, l'arrivée du gouverneur, quelque événement public ou privé du même genre; plus souvent encore on se passe de ces occasions et l'on parle dans le vide sur tous les sujets possibles; ce qui n'a aucune importance pratique et n'est pas digne du nom d'enseignement. Il n'y a plus alors d'éloquence politique, même dans le sénat romain. L'éloquence judiciaire n'est plus pour les Grecs le but de l'art oratoire; auprès de l'éloquence qui n'a d'autre fin qu'elle-même, elle se tient à l'écart comme une soeur dédaignée et plébéienne, à laquelle les maîtres ne s'abaissent que par hasard. A la poésie, à la philosophie, à l'histoire on emprunte tout ce qui peut se traiter en lieux communs; elles-mêmes ne sont cultivées que fort peu dans tout l'empire et surtout en Asie Mineure; elles sont négligées pour la pure rhétorique, et même se corrompent à son contact. Ces rhéteurs considèrent pour ainsi dire le glorieux passé de leur nation comme leur bien propre; ils honorent et traitent Homère à peu près comme les rabbins les livres de Moïse, et même, en matière religieuse, ils affectent la plus stricte orthodoxie. On soutient ces discours par tous les moyens licites ou illicites qu'il est d'usage d'employer au théâtre pour réussir: l'art de conduire ses gestes et de moduler sa voix, l'éclat du costume, la science de la virtuosité, les cabales, la concurrence, la claque. Mais si l'orgueil de ces grands phraseurs est illimité, l'intérêt que le public prend à leurs comédies est considérable, - il les aime presque autant que les courses de chevaux, et cet intérêt, il le manifeste d'une manière tout à fait théâtrale. De telles exhibitions se produisaient continuellement dans les plus grandes villes devant les gens cultivés; elles entrèrent, comme les représentations dramatiques, dans les habitudes de la vie municipale. L'impression que produisent, dans les plus mouvementées de nos grandes villes, les discours obligés de leurs corps savants peut nous rappeler en quelque façon ce phénomène disparu et nous aider à le comprendre; mais ces manifestations n'ont pas, de nos jours, ce qui était l'essentiel dans l'antiquité, le caractère didactique, et les allocutions qu'on y prononce ne sont pas, comme était cette éloquence publique sans objet, en rapport étroit avec l'enseignement supérieur. A notre époque, cet enseignement fait, comme l'on dit, d'un jeune homme appartenant à la classe cultivée un professeur de philologie; jadis il formait des professeurs d'éloquence, et de cette éloquence spéciale dont nous parlons. En effet, les maîtres cherchaient de plus en plus à rendre leurs élèves capables de prononcer des discours comme ceux que nous avons signalés, et même de les prononcer en deux langues, lorsque c'était possible: ceux qui avaient terminé leurs classes avec succès applaudissaient dans les harangues de ce genre tout ce qui leur rappelait leurs années d'école. Cette production littéraire existait, il est vrai, en Occident comme en Orient; mais c'est l'Asie Mineure qui marchait en tête et qui donnait le ton. Lorsque, sous Auguste, la rhétorique d'école s'introduisit à Rome dans l'instruction de la jeunesse latine, à côté des Italiens et des Espagnols, les promoteurs de cette réforme furent deux Grecs d'Asie Mineure, Arellius Fuscus et Cestius Pius. Dans cette ville même, où la sévère éloquence du barreau subsista au début de l'empire auprès de l'autre éloquence parasite, un avocat plein d'esprit de l'époque flavienne signale la distance considérable qui sépare Nikétès de Smyrne et les autres maîtres d'éloquence applaudis à Ephèse et à Mitylène de Demosthène et d'Eschine. En outre la plupart et les plus célèbres des orateurs de ce genre viennent de l'Asie antérieure. Nous avons déjà montré de quelle importance était pour les finances des villes d'Asie Mineure les envois de maîtres d'école qu'elles faisaient dans tout le monde romain. Pendant le cours de l'empire, le nombre et l'autorité de ces sophistes s'accrut sans cesse: de plus en plus ils gagnèrent du terrain, même en Occident. Une des causes de cette prospérité fut sans doute la nouvelle attitude du gouvernement qui, au deuxième siècle, surtout depuis l'époque d'Hadrien, où le mauvais cosmopolitisme triompha bien plutôt que l'hellénisme, se montra beaucoup moins sévère pour la Grèce et l'Orient qu'au premier siècle; mais ce fut surtout parce que l'on acquit en général une instruction plus étendue et parce que l'on multiplia rapidement les établissements d'enseignement supérieur. C'est principalement en Asie Mineure et dans l'Asie Mineure des second et troisième siècles que se développa la sophistique; pourtant cette supériorité littéraire ne présente aucun caractère particulier aux Grecs ou à cette époque; elle n'a pas non plus une physionomie nationale. La sophistique se ressemble partout; elle est à Smyrne et à Athènes ce qu'elle est à Rome et à Carthage. Pareils aux types de lampes et aux articles de fabrique, les maîtres d'éloquence sont expédiés dans tout l'empire, en modèles uniformes, grecs ou latins à volonté; la production augmente suivant les commandes. Pourtant les régions grecques, plus prospères et plus savantes, fournissaient les meilleurs et les plus nombreux de ces articles d'exportation; le fait est vrai de l'Asie Mineure aussi bien à l'époque de Sylla et de Cicéron que sous Hadrien et sous les Antonins. |
||||
40-201 |
Galien. Dion de PruseRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugustePourtant tout n'est pas ombre dans ce tableau. Outre les sophistes de profession, ce pays produisit, parmi les littérateurs d'un autre genre, qui sont encore relativement nombreux, les plus brillants représentants de l'hellénisme que l'on puisse citer à cette époque, le professeur de philosophie Dion de Pruse (40-120), en Bithynie, qui vécut sous Vespasien et Trajan, et le médecin Galien de Pergame (129-201), qui fut le médecin de la famille impériale sous Marc-Aurèle et Septime Sévère. Chez Galien, la finesse de l'homme du monde et du courtisan était jointe à une culture générale littéraire et philosophique que possédaient d'ailleurs la plupart des médecins de cette époque?. Pour la pureté du sentiment et l'exacte connaissance de la situation générale, le Bithynien Dion ne le cède en rien au savant de Chéronée; il lui est de beaucoup supérieur pour la puissance de description, la finesse et la vigueur du style, pour l'expression délicate des idées sérieuses, pour l'énergie pratique. Ses meilleurs ouvrages sont les fantaisies. |
||||