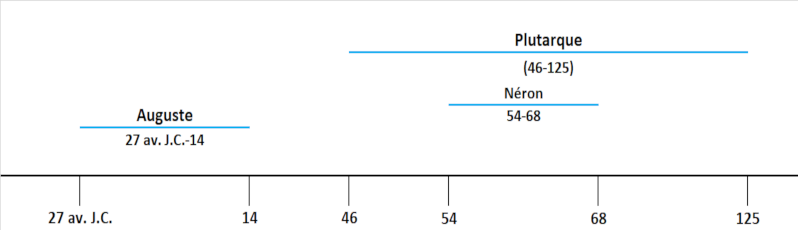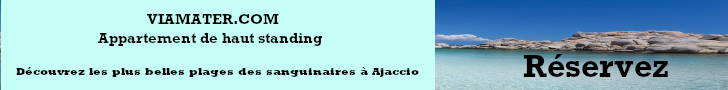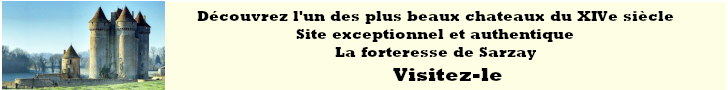|
|||||
L'Europe grecque
Sources historiques : Théodore Mommsen Vous êtes dans la catégorie : Empire Chapitre suivant : L'Asie mineure Chapitre précédent : La région du Danube Dans ce chapitre : 47 rubriques; 26 242 mots; 138 430 caractères (espaces non compris); 164 369 caractères (espaces compris) Format 100% digital de cette rubrique (via l'espace membre) | |||||
27 av. J.C.-476 |
L'hellénisme et le panhellénismeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste
Le développement politique des républiques grecques n'avait pas suivi le développement général de l'esprit hellénique, ou plutôt, comme une floraison trop puissante brise le calice d'une plante, cette prospérité intellectuelle n'avait permis à aucun Etat en particulier d'acquérir l'étendue et la stabilité, conditions indispensables du développement politique. Ces petites républiques, cités isolées ou confédérations de villes, devaient périr par elles-mêmes ou tomber sous les coups des barbares; seul le panhellénisme protégeait contre les peuples voisins de lignée étrangère l'existence même de la nation et les progrès de son développement. Le panhellénisme fut créé par le traité que Philippe, roi de Macédoine et père d'Alexandre, conclut à Corinthe avec les Etats de la Grèce. C'était nominalement un pacte d'alliance; en réalité, c'était l'assujettissement des républiques à la monarchie, mais un assujettissement qui n'était complet qu'en face de l'étranger: le commandement militaire illimité contre l'ennemi national était confié au général macédonien par presque toutes les villes grecques du continent, mais elles conservaient leur liberté et leur autonomie. Tel était, dans la situation de la Grèce, le seul moyen de réaliser le panhellénisme; telle était la forme de gouvernement la mieux appropriée à l'avenir du pays. Elle subsista sous Philippe et sous Alexandre, bien que les idéalistes grecs, comme toujours, ne voulussent pas reconnaître que leur idéal était réalisé. Mais lorsque l'empire d'Alexandre se disloqua, avec lui périt le panhellénisme même et l'union des cités grecques sous la protection de la monarchie; les villes perdirent, au milieu de luttes inutiles qui durèrent plusieurs siècles, les derniers restes de leur prospérité intellectuelle et matérielle; elles furent tiraillées entre la domination éphémère de royautés plus puissantes qu'elles, et les vaines tentatives faites pour restaurer l'ancien particularisme à la faveur des discordes qui éclataient entre ces royautés. |
||||

|
|||||
27 av. J.C.-476 |
La Grèce et RomeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais lorsque la puissante république de l'Occident fut intervenue dans les luttes, jusqu'alors sans résultat, qui divisaient les monarchies de l'Orient, et eut prouvé bientôt qu'elle était plus forte que chacun des états grecs rivaux, la politique panhellénique fut modifiée par l'établissement de cette puissance redoutable. Ni les Macédoniens ni les Romains n'étaient des Hellènes au sens complet du mot: le développement de la Grèce a eu cette destinée tragique, que l'empire maritime d'Athènes fut moins une réalité qu'une espérance, et que le pays ne put pas se donner à lui-même son unité. Si, au point de vue national, les Macédoniens étaient plus proches parents des Grecs que les Romains, le gouvernement de Rome se rapprochait, beaucoup plus que la royauté héréditaire de Macédoine, de la constitution politique des Etats grecs. Ce qui est essentiel, c'est que les citoyens romains subirent l'influence de l'esprit hellénique plus longtemps et plus profondément que les hommes d'Etat macédoniens, précisément parce qu'ils en étaient plus éloignés. Rome désira s'helléniser, au moins intérieurement, s'initier aux moeurs, à la culture, aux arts et aux sciences de la Grèce; elle voulut, à la suite du grand conquérant macédonien, devenir le bouclier et l'épée des Grecs de l'Orient, et donner à cet Orient une civilisation non pas italienne, mais hellénique. Cette tendance se manifesta pendant les derniers siècles de la république et pendant la plus belle période de l'empire avec une force et un caractère idéal, qui ne sont pas moins tragiques que les vains efforts politiques des Hellènes. Des deux côtés on recherchait l'impossible: le panhellénisme grec ne pouvait pas durer, et l'hellénisme romain ne pouvait pas tout embrasser. Cette ambition n'en a pas moins caractérisé la politique de la république romaine comme celle des empereurs. Les Grecs, surtout au dernier siècle de la république, ont montré aux Romains qu'ils perdaient leurs efforts et leur passion; cela n'a diminué ni les efforts ni la passion des Romains. |
||||
27 av.J.C.-14 |
L'Amphictionie d'AugusteRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Grecs d'Europe furent réunis par la république romaine en un seul gouvernement auquel fut donné le nom du pays le plus important, la Macédoine. Cette province fut divisée administrativement dès le début de l'empire; mais, à la même époque, l'unité grecque fut représentée par une assemblée religieuse qui se rattachait à l'ancienne Amphictionie de Delphes, créée d'abord pour assurer la trêve sacrée, et devenue plus tard un instrument politique. Au temps de la république romaine cette institution fut rétablie, pour les points essentiels, sur ses bases primitives; la Macédoine et l'Etolie, qui s'y étaient introduites par usurpation, en furent écartées, et l'Amphictionie comprit de nouveau, non pas tous les peuples de la Thessalie et de la Grèce proprement dite, mais la plupart d'entre eux. Auguste donna entrée, dans ce collège, à l'Epire et à la Macédoine et en fit en réalité le représentant de l'hellénisme, dans le sens large du mot, le seul d'ailleurs qui convienne à cette époque. A côté de l'antique sanctuaire de Delphes, les deux villes d'Athènes et de Nicopolis prirent dans l'assemblée une place prépondérante: la première était l'ancienne capitale de la Hellade, la seconde, dans la pensée d'Auguste, celle de la nouvelle Hellade impériale1. Cette nouvelle Amphictionie avait certains rapports avec l'assemblée provinciale des trois Gaules; comme l'autel de l'empereur à Lyon, le temple d'Apollon Pythien était le centre religieux des provinces grecques. Cependant l'assemblée de Lyon avait une certaine puissance politique; les Amphictions de cette époque, au contraire, en dehors des fêtes purement religieuses, s'occupaient simplement d'administrer le sanctuaire de Delphes et ses revenus encore considérables2. Si leur président s'attribue plus tard la Helladarchie, cette domination sur la Grèce était purement idéale3. Mais le maintien officiel de la nationalité grecque montre bien quelle fut l'attitude, à cet égard, de l'empire romain nouvellement établi, et prouve que le philhellénisme était plus à la mode encore à cette époque que sous la République. 1. C'est une inscription de Delphes (Corp. insc. lat., III, p. 987; cf. Bulletin de corr. hellen., VII, p. 427 sq.) qui nous renseigne le mieux sur l'organisation de l'amphictionie delphique à l'époque de la république romaine. L'assemblée était alors composée de dix-sept peuples qui avaient ensemble vingt-quatre voix et qui appartenaient tous à la Grèce proprement dite ou à la Thessalie; l'Etolie, l'Epire, la Macédoine n'y étaient pas représentées. Après la réforme d'Auguste (Pausanias, X, 8), cette organisation subsista dans ses traits généraux; mais on limita le nombre trop grand des tribus thessaliennes, et les peuples représentés jusqu'alors dans l'assemblée n'eurent plus que dix-huit voix; on y ajouta deux nouveaux éléments, Nicopolis d'Epire qui eut six voix, et la Macédoine qui en eut six également. Les six voix de Nicopolis durent lui être données une fois pour toutes, comme cela se passa pour les deux voix de Delphes et pour la voix d'Athènes; il n'en était pas de même pour les suffrages accordés aux autres membres de l'assemblée : par exemple, la voix unique dont disposaient les Doriens du Péloponnèse passait d'Argos à Sicyone, à Corinthe, à Mégare. Le collège des Amphictions pas à cette époque une assemblée générale des Hellènes d'Europe, puisque les peuples de la Grèce proprement dite qui en avaient été exclus autrefois, une partie des Péloponnésiens, et les Etoliens qui ne se rattachaient pas à Nicopolis, n'y étaient pas représentés. 2. On continua de se réunir à Delphes et aux Thermopyles (Pausanias, VII, 24, 3; Philostrate, Vita Apoll., 4, 23); naturellement les jeux pythiques étaient toujours célébrés et les prix distribués par le collège des Amphictions (Philostrate, Vitae Soph., II, 27); ce même collège administrait les tributs et revenus du temple (Inscription de Delphes: Rhein. Mus., nouvelle série, II, p. 111); il les consacrait, par exemple, à fonder une bibliothèque à Delphes (Lebas, II, 845) ou à élever des statues. 3. Les membres du collège des Auoutlovas ou, comme ils s'appellent à cette époque, des 'Aupextuoves, sont nommés par les villes de la manière indiquée plus haut, tantôt de temps en temps (voir un exemple d'itération: Corp. insc. lat., 1058), tantôt à vie (Plutarque, An seni, etc., 20) selon que la voix dont elles disposaient était permanente ou alternative (Willamowitz). Le président des Amphictions porte le titre de slueAnths (Inscriptions de Delphes, Rhein. Mus., nouvelle série, II, p. 111; Corp. insc. graec., 1713), et plus tard de ??? (ibid., 1124). |
||||
27 av. J.C.-476 |
La province d'AchaïeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa division administrative du gouvernement gréco-macédonien, tel qu'il existait sous la République, marcha de pair avec la réunion religieuse de tous les Grecs d'Europe. Cette division n'a aucun lien avec la répartition des provinces qui fut faite entre l'empereur et le sénat, puisque le pays tout entier, ainsi que les régions danubiennes qui le couvraient en avant, furent attribués au sénat, dans le partage primitif; la question militaire est encore moins intervenue, toute la péninsule jusqu'à la frontière de la Thrace étant considérée comme défendue soit par cette contrée, soit par les garnisons du Danube, et figurant toujours comme telle au nombre des territoires pacifiés. Si le Péloponnèse et la région attico-béotienne furent alors soumis à un proconsul spécial et séparés de la Macédoine, ce que César avait peut-être eu déjà l'intention de faire, ce fut d'abord pour se conformer à l'habitude que l'on avait de ne pas constituer des provinces sénatoriales trop vastes, et aussi probablement pour établir une démarcation entre les régions purement helléniques et les pays à moitié grecs. Autrefois la province d'Achaïe se terminait à l'Oeta; plus tard, même lorsque les Etoliens y eurent été annexés1, la frontière ne dépassa pas l'Acheloos ni les Thermopyles. 1. Les frontières primitives sont fixées par Strabon (XVII, 3, 25, p. 840) dans son énumération des provinces sénatoriales: le reste de Epire semble avoir été rattaché à la province d'Illyricum (dont Strabon fait une province sénatoriale, ce qui est une erreur pour son temps). Abstraction faite des arguments de fond, il n'est pas possible de donner au mot peype le sens de inclusivement, puisque, d'après les derniers mots de la phrase, les territoires nommés plus haut dépendent de la Macédoine. C'est plus tard seulement que nous trouvons les Etoliens réunis à l'Achaïe (Ptolemee, III, 14). Il se peut que l'Epire ait fait aussi partie de cette province pendant longtemps, non pas tant à cause d'un passage de Dion (LII, 12), également difficile à justifier et pour le temps d'Auguste et pour celui de l'auteur, que parce que Tacite, en l'an 17 (Ann., II, 53), compte Nicopolis parmi les villes de l'Achaïe. Mais, au moins depuis Trajan, l'Epire forme avec l'Acarrianie une province procuratorienne à part (Ptolemee, III, 13; Corp. insc. lat., III, 536; Marquardt, Staatsverwaltung, I, p. 331). La Thessalie et tout le pays situé au Nord de l'Oeta n'ont jamais été séparés de la Macédoine. |
||||
509-27 av. J.C. |
Les villes grecques sous la République romaineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteTelle était l'organisation générale du pays. Nous allons maintenant rechercher la situation faite aux municipalités grecques sous la domination romaine. Les Romains avaient d'abord eu l'intention de rattacher à leur propre système municipal la totalité des communes grecques, comme ils l'avaient fait pour celles d'Italie; mais ce projet avait subi des modifications essentielles, à la suite de la résistance que les Grecs avaient opposée à l'établissement de cette organisation, surtout après que la ligue achéenne se fut soulevée, en l'an 608, et après que la plupart des cités grecques eurent pris fait et cause pour le roi Mithridate en 666. Les confédérations de villes, qui avaient été la base de tout le développement politique en Grèce comme en Italie, et que les Romains avaient épargnées au début, furent dissoutes, surtout la plus importante d'entre elles, la ligue péloponnésienne, ou, comme elle s'appelait, la ligue achéenne, et chaque cité dut se donner à elle-même son organisation municipale. Plus tard Rome imposa aux municipalités certaines règles générales, et elles furent réorganisées sur ce modèle dans un sens anti-démocratique. C'est seulement avec ces restrictions que les communes gardèrent leur autonomie et leurs magistratures particulières. On leur laissa leurs lois, mais, en même temps, le Grec était juridiquement soumis aux verges et à la hache du préteur; on pouvait au moins le condamner, pour tout crime qui paraissait être une révolte contre le pouvoir supérieur, à une amende, au bannissement, ou même à la mort1. Les municipalités s'imposaient elles-mêmes; mais elles devaient toujours envoyer à Rome une somme déterminée, en général peu élevée, semble-t-il. Les villes ne reçurent pas de garnison, comme au temps de la domination macédonienne; les troupes campées dans la Macédoine étaient prêtes, en cas de besoin, à envahir la Grèce. Mais la destruction de Corinthe pèse plus lourdement sur l'aristocratie romaine que la démolition de Thebes sur la mémoire d'Alexandre. Les autres mesures, quelque odieuses ou exaspérantes qu'elles pussent être pour la plupart, surtout parce qu'elles étaient imposées par la domination étrangère, furent pourtant, en général, nécessaires et souvent bonnes: c'était l'inévitable rétractation de la politique primitive des Romains envers les Grecs, politique en partie si impolitique, faite de pardon et de faiblesse; au contraire, lors de la destruction de Corinthe, l'égoïsme commercial, dans son cynisme, l'emporte sur l'amour de la Grèce. 1. Rien ne nous instruit mieux sur la situation de la Grèce au dernier siècle de la république romaine, que la lettre écrite par un des gouverneurs de la province à la commune achéenne de Dymé (Corp. insc. graec., 1543). Cette cité s'était donné des lois en contradiction avec la liberté généralement accordée aux Grecs et avec l'organisation imposée par les Romains aux Achéens probablement avec le concours de Polybe (Pausanias, VIII, 30, 9); quelques révoltes avaient même éclaté; le gouverneur annonce à la cité qu'il a fait mettre à mort les deux chefs du complot, et qu'un troisième conjuré moins coupable sera exilé à Rome. |
||||
509-27 av. J.C. |
Les cités libres sous la République romaineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCependant, Rome n'abandonnait pas sa pensée fondamentale, qui était de rattacher les cités grecques au système italique des confédérations de villes. Alexandre n'avait jamais voulu soumettre la Grèce au même régime que l'Illyrie et que l'Egypte; de même ses successeurs romains n'ont jamais considéré la Grèce comme une province entièrement sujette, et déjà au temps de la République Rome n'a pas appliqué les lois strictes de la guerre aux Grecs qu'elle avait été obligée de combattre. C'est surtout à l'égard d'Athènes qu'on suivit cette politique. Aucune ville grecque ne s'est montrée plus coupable envers Rome, au point de vue romain; son attitude pendant la guerre de Mithridate aurait inévitablement amené la destruction de toute autre cité. Mais pour ceux qui aimaient la Grèce, Athènes était la reine du monde; à elle se rattachaient les sympathies et les souvenirs de tout ce qu'il y avait de grand hors de l'Italie. Cette considération l'emporta alors comme auparavant. Athènes n'a jamais vu les haches d'un gouverneur romain; elle n'a jamais payé d'impôts à Rome; elle a toujours été regardée comme une alliée; elle n'a fourni de contingents aux Romains que dans des circonstances extraordinaires et par une décision volontaire, au moins dans la forme. La capitulation qui suivit le siège d'Athènes par Sylla apporta bien quelque changement dans l'organisation municipale; mais l'alliance fut renouvelée, les possessions étrangères d'Athènes lui furent rendues, même l'île de Délos, qui avait abandonné sa métropole quand celle-ci s'était déclarée pour Mithridate, qui s'était constituée en commune indépendante, et qui, pour prix de sa fidélité envers Rome, avait été pillée et ravagée par la flotte du roi de Pont1. Dans leur conduite envers Sparte, les Romains furent inspirés par les mêmes sentiments: ils eurent aussi égard à la grandeur de son nom. Quelques autres villes, appartenant à des confédérations libres dont nous parlerons plus loin, obtinrent ces privilèges dès l'époque républicaine. Sans doute il y avait dans toutes les provinces des exceptions de ce genre; mais ce qui a caractérisé dès le début la province grecque, c'est que les deux cités les plus importantes n'ont jamais été réduites à l'état de sujettes, et que les plus petites villes seules y ont été soumises. 1. Dans les fouilles de Delos, faites ces années dernières, on a trouvé la preuve que l'île, après avoir été donnée à Athènes par les Romains, resta constamment athénienne, et ne s'organisa en commune delienne qu'après la défection des Athéniens (Eph. epigr., V, p. 604); puis qu'elle était redevenue athénienne six ans après la capitulation d'Athènes (Eph. epigr., V, n. 184; Homolle, Bull. de corr. hellen., VIII, p. 142). |
||||
509-27 av. J.C. |
Les Confédérations de villes sous la RépubliqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa république adoucit également la condition des cités grecques assujetties; les confédérations de villes, d'abord interdites, reparurent peu à peu; les moins étendues et les moins puissantes, comme la confédération béotienne, furent très promptement rétablies1. On s'habitua peu à peu à la domination étrangère, et l'on abandonna les idées d'opposition, qui avaient provoqué la dissolution de ces confédérations; les liens étroits qui les rattachaient à l'antique religion, soigneusement épargnée, leur ont été d'un grand profit. Nous avons déjà fait remarquer, à ce propos, que la république romaine avait rétabli l'Amphictionie dans ses fonctions primitives qui n'avaient rien de politique, et qu'elle l'avait protégée. Vers la fin de l'époque républicaine, le gouvernement semble même avoir permis aux Béotiens de former une confédération générale avec les petites peuplades qui les bornaient au Nord et les habitants de l'île d'Eubée2. Le fait capital de l'époque républicaine fut la réparation de la destruction de Corinthe par le plus grand de tous les Romains et de tous les Philhellènes, par le dictateur César, et la réapparition de cette étoile de la Hellade sous la forme d'une commune indépendante de citoyens romains et sous le nom de Laus Julia, Gloire julienne. 1. On ne sait pas si le , qui naturellement ne se rencontre pas à l'époque républicaine proprement dite, a été reconstitué à la fin de cette période, ou seulement après que les empereurs eurent réorganisé l'administration provinciale. Des inscriptions comme celle du proquaestor Q. Ancharius. Q. f., à Olympie (Arch. Zeitung, 1878, p. 38, n 1114) viennent à l'appui de la première hypothèse; mais on ne peut pas la dater certainement de l'époque antérieure à Auguste. Le plus ancien témoignage précis que l'on ait de l'existence de cette confédération, est l'inscription d'Olympie dédiée par elle à Auguste (Arch. Zeitung, 1877, p. 36, n 33). Peut-être fut-elle organisée par le dictateur César et doit-on établir un certain rapport entre elle et le gouverneur de la Grèce sans doute de l'Achaïe impériales qu'on rencontre à cette époque (Ciceron, Ad famil., VI, 6, 10). D'ailleurs déjà sous la république plusieurs cités avaient élu, après avoir obtenu chaque fois l'approbation du gouverneur, des députés qui se réunissaient pour traiter des sujets déterminés et qui pouvaient prendre des décisions: le des Siciliens avait voté une statue à Verrès (Cicéron, Verr., II, 46, 114); il y eut en Grèce quelque chose de semblable sous la République. Mais les assemblées provinciales ne furent organisées régulièrement avec leurs magistrats et leurs prêtres permanents que sous l'empire. 2. C'est le ?, signalé dans une remarquable inscription, probablement peu antérieure à la bataille d'Actium (Corp. insc. atlic., III, 568). Il est impossible d'appliquer, comme le veut Dittenberger (Arch. Zeitung, 1876, p. 220), à cette confédération le passage de Pausanias (VII, 16, 10), suivant lequel les Romains, peu d'années après la destruction de Corinthe, auraient eu pitié des Hellènes et leur auraient permis de reconstituer leurs confederations Iocales (??); cette phrase désigne des confédérations plus petites. |
||||
27 av. J.C.-476 |
L'Achaïe sous les EmpereursRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteTelle était la situation de la Grèce au commencement de l'empire; le gouvernement impérial alla plus loin encore dans la même voie. Les villes, soustraites à l'autorité directe de l'administration provinciale, et exemptes de tout impôt public, semblables sur beaucoup de points aux colonies de citoyens romains, formaient la plus grande et la meilleure partie de la province d'Achaïe. Dans le Péloponnèse, se trouvait Sparte avec son territoire, diminué sans doute, mais embrassant encore la moitié septentrionale de la Laconie1; Sparte, l'éternelle rivale d'Athènes aussi bien par ses institutions surannées et comme pétrifiées que par l'organisation et l'attitude qu'elle avait conservées au moins extérieurement. Il y avait encore les dix-huit cités libres de Laconie, qui occupaient la moitié méridionale du pays, autrefois sujettes de Sparte, organisées par les Romains en confédération indépendante depuis la guerre contre Nabis, et dotées par Auguste de la liberté qui les rendait égales à Sparte2. Enfin dans le pays des Achéens étaient Dymè, où Pompée avait installé des pirates prisonniers, et qui avait reçu au temps de César de nouveaux colons romains3; Patrae surtout, bourg déchu, dont Auguste avait remarqué la belle situation commerciale et qui était devenue, soit par l'annexion des petites localités environnantes, soit par la colonisation de nombreux vétérans italiens, la ville la plus peuplée et la plus florissante de toute la péninsule; elle était constituée comme une colonie de citoyens, et Naupaktos (en italien Lepanto) située en face d'elle sur la côte de Locride, lui était soumise. Corinthe avait été victime de sa belle position sur l'isthme. Après sa reconstruction, elle prospéra rapidement, comme Carthage; elle devint la plus riche et la plus peuplée des cités de la Grèce; elle fut la résidence ordinaire des gouverneurs. Les Corinthiens avaient été parmi les Grecs les premiers à reconnaître les Romains comme compatriotes en les admettant aux jeux isthmiques; aussi conservèrent-ils, quoique citoyens romains, la présidence de cette grande fête nationale des Hellènes. Aux districts libres du continent appartenaient non seulement Athènes et son territoire, qui comprenait toute l'Attique et des îles nombreuses dans la mer Egée, mais encore Tanagre et Thespies, les deux villes les plus considérables de la Béotie ainsi que Platées4; en Phocide, Delphes, Abae, Elatée, avec Amphissa, la plus importante cité de la Locride. Auguste termina l'oeuvre commencée par la République; il créa, du moins dans ses traits principaux, l'organisation que nous venons de décrire, et qui subsista après lui dans ses parties essentielles. Les villes soumises au proconsul étaient certainement les plus nombreuses, et leur population totale l'emportait peut-être sur celle des villes libres; mais Rome avait montré son esprit vraiment philhellénique en laissant leur liberté aux villes grecques les plus considérables par leur prospérité matérielle ou par leurs glorieux souvenirs '. 1. A ce territoire appartenait non seulement la ville voisine d'Amyklae, mais aussi Kardamyle (donation d'Auguste; Pausanias., III, 26, 7), Pherae (id., IV, 30, 2), Thuria (id., IV, 31, 1); pendant longtemps y furent aussi rattachées Coronée (Corp. insc. graec., 1258; cf. Lebas-Foucart, II, 305) sur le golfe de Messénie et l'île de Cythère (Dion, LIV, 7). 2. A l'époque républicaine, ce district apparaît comme to (Foucart, note à Lebas, II, p. 110). Pausanias (III, 21, 6) se trompe donc, lorsqu'il prétend que ces villes ne furent séparées de Sparte que par Auguste. Mais elles ne portent le nom d'Encu que depuis Auguste; c'est bien lui par conséquent qui leur a donné la liberté. 3. On trouve des monnaies de cette ville avec la légende colonia) Iulia) Dume) et la tête de César, d'autres avec la légende colonia) 3 I(ulia) A(ugusta) Dum(e) et la tête d'Auguste à côté de celle de Tibère (Imhoof-Blumer, Monnaies grecques, p. 165). Pausanias (VII, 17, 5) doit donc être dans l'erreur lorsqu'il prétend qu'Auguste a réuni Dymè à la colonie de Patrae; il se peut pourtant qu'Auguste l'ait fait dans ses dernières années. 4. Cela est prouvé, au moins pour l'époque d'Antonin, par une inscription d'Afrique (Corp. insc. lat., VIII, 7059. Cf. Plutarque, Arist., 21). Les renseignements que les historiens nous donnent sur les cités libres ne nous permettent pas de compléter avec certitude la liste de ces villes. Probablement il faut leur adjoindre Elis, qui n'avait pas souffert de la ruine des Achéens, et qui datait encore ses actes postérieurement, non par l'ère de la province, mais par les Olympiades. Il est tout à fait impossible d'admettre que la ville des jeux olympiques n'ait pas joui des droits les plus considérables. |
||||
Devenez membre de Roma LatinaInscrivez-vous gratuitement et bénéficiez du synopsis, le résumé du portail, très pratique et utile; l'accès au forum qui vous permettra d'échanger avec des passionnés comme vous de l'histoire latine, des cours de latin et enfin à la boutique du portail ! 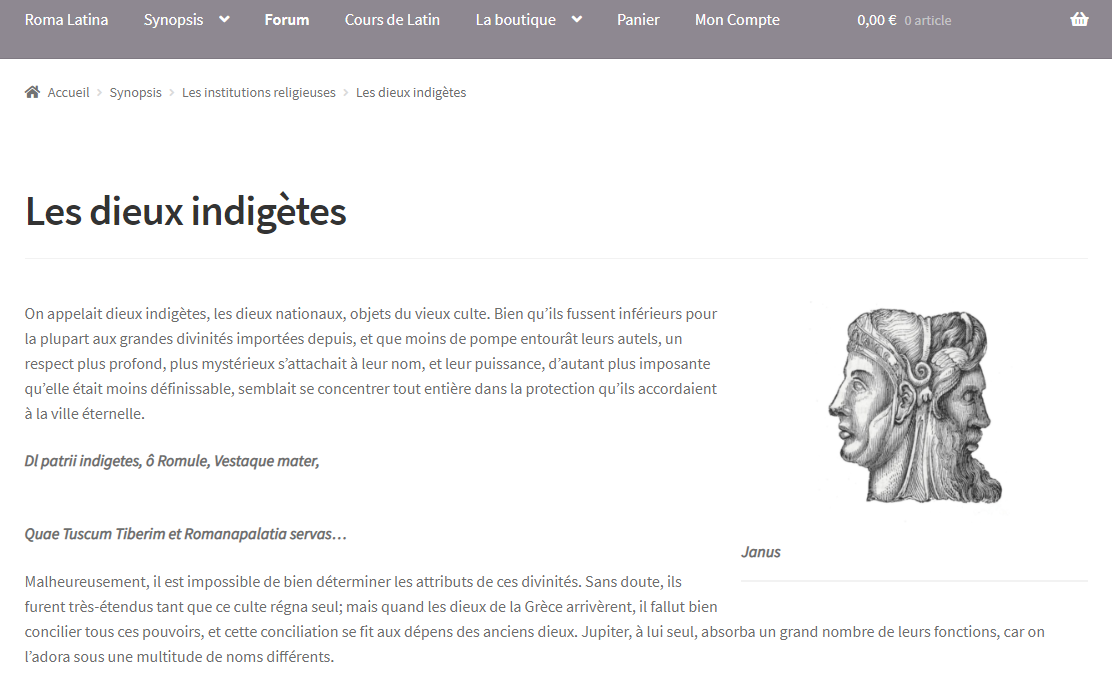 |
|||||
54-68 |
Affranchissement des Grecs par NéronRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe dernier empereur de la maison Claudienne alla plus loin dans cette voie qu'Auguste lui-même; c'était un mauvais poète, mais à coup sûr un philhellène de naissance. Comme autrefois Titus Flamininus, pour remercier les Grecs de l'accueil que son talent d'artiste avait trouvé dans la patrie des Muses, à Corinthe, aux jeux isthmiques, il déclara les Grecs libres de la domination romaine; il leur remit tout tribut et les proclama indépendants de tout gouverneur, comme les Italiens. Aussitôt éclatèrent en Grèce des mouvements qui seraient devenus des guerres civiles, si les Grecs avaient pu aller au-delà de rixes. Quelques mois plus tard Vespasien déclara sèchement que les Grecs ne savaient plus être libres et rétablit dans toute sa rigueur l'administration provinciale. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Les droits des villes libresRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa situation légale des villes libres resta, dans son essence, la même que sous la République. Tant qu'il ne s'agissait pas de citoyens romains, elles avaient le droit de pleine justice; il semble seulement qu'elles aient participé, comme les autres cités, aux dispositions générales intéressant les appels à l'empereur ou aux tribunaux du sénat1. Avant tout elles pouvaient décider leurs affaires et s'administrer elles-mêmes. Athènes, par exemple, a joui pendant l'époque impériale du droit de battre monnaie, sans mettre sur ses pièces une tête d'empereur; il en fut de même pour les monnaies de Sparte dans les premiers temps de l'empire. Athènes conserva aussi l'ancien usage de compter par drachmes et par oboles; mais la drachme attique locale n'était guère à cette époque qu'une monnaie de billon propre au pays; elle était employée comme monnaie courante, comme obole de la drachme attique officielle ou du denier romain. L'exercice du droit de paix et de guerre fut même garanti formellement dans les traités particuliers que Rome conclut avec les Etats libres?. Rome laissa ainsi subsister beaucoup d'institutions absolument contraires à l'organisation des cités italiques, par exemple le changement annuel des membres du Conseil, et le paiement quotidien des conseillers et des jurés, que l'on retrouve aussi sous l'empire, au moins à Rhodes. Le gouvernement romain n'en conserva pas moins, cela s'entend, une certaine influence permanente sur la constitution des cités libres. Ainsi l'organisation d'Athènes fut modifiée, soit à la fin de la république, soit par César ou par Auguste: le droit de proposer des motions à l'assemblée des citoyens ne fut plus laissé à tous indistinctement, mais réservé à certains fonctionnaires, comme cela se passait à Rome; parmi les nombreux magistrats purement décoratifs, un seul, le stratège, eut entre les mains la direction des affaires. Il est certain qu'on alla plus loin dans cette voie et que des réformes plus importantes furent accomplies; nous en constatons partout la trace, dans les états sujets comme dans les cités indépendantes, mais nous ne savons ni quand ni pourquoi l'organisation fut ainsi transformée. Le droit d'asile, qui n'était que la négation du droit, vestige d'une époque sans justice, grâce auquel la religion pouvait sauver les grands coupables et les meurtriers, fut, sinon tout à fait aboli, du moins très limité dans cette province. Il en fut de même de la proxénie, dont le but était primitivement comparable à celui de nos consulats, mais qui avait pris une grande extension, et était devenue politiquement très importante, lorsque l'on eut accordé aux étrangers amis le plein droit de cité, et souvent aussi le privilège d'être exemptés de l'impôt: le gouvernement romain la fit disparaître dans les premiers temps de l'empire, semble-t-il. Elle fut remplacée par une institution toute italique, le patronat des villes, qui n'avait aucune portée en ce qu'elle ne touchait en rien à la question financière. Enfin l'empire, souverain suprême des républiques dépendantes comme des princes clients, a toujours revendiqué et exercé le droit de détruire les constitutions des villes libres, à la suite d'une mauvaise administration, et de prendre en main le gouvernement de ces villes. Néanmoins, d'une part le traité juré, d'autre part la faiblesse de ces états nominalement confédérés ont donné à cette organisation plus de stabilité que l'on n'en rencontre dans les relations de Rome avec les princes clients. 1. Strabon (XIV, 3, 3, p. 605) nous dit de la confédération lycienne, autonome à son époque, qu'elle ne pouvait déclarer la guerre, signer des traités ou conclure des alliances qu'avec l'autorisation des Romains ou dans leur intérêt. Ces conditions durent être établies de suite pour Athènes. |
||||
|
|
|||||
27 av. J.C.-476 |
Les assemblées des villes grecquesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste
Si les communes libres de l'Achaïe gardèrent sous l'empire leur ancienne organisation, Auguste accorda aux cités grecques qui n'avaient pas encore été déclarées libres et qui ne devaient pas l'être une constitution nouvelle et meilleure. En réorganisant l'amphictionie de Delphes, il avait donné aux Grecs d'Europe un centre commun; de même il permit à toutes les villes de la province d'Achaïe, qui étaient soumises à l'administration romaine, de former une confédération générale, et de tenir une assemblée provinciale annuelle à Argos, la cité la plus considérable de la Grèce dépendante1. Non seulement la ligue achéenne, dissoute après la guerre d'Achaïe, fut reconstituée, mais encore on lui adjoignit la confédération béotienne que nous avons déjà citée et dont l'importance était augmentée. Il est probable que l'étendue de la province d'Achaïe a été déterminée par la réunion de ces deux territoires. La nouvelle ligue des Achéens, Béotiens, Locriens, Phocidiens, Doriens et Eubéens2, ou simplement la ligue des Achéens, suivant le nom qu'on lui donne habituellement ainsi qu'à la province, n'a eu probablement ni plus ni moins de droits que les autres assemblées provinciales de l'empire. Les fonctionnaires romains durent exercer un certain contrôle sur cette assemblée; mais les villes qui ne dépendaient pas du proconsul, comme Athènes et Sparte, ne furent pas soumises à cette surveillance. En outre cette diète, comme toutes les réunions du même genre, s'occupa surtout de la religion commune, répandue dans tout le pays, et en devint le centre. Mais tandis que dans les autres provinces, le culte local était étroitement rattaché à la religion romaine, au contraire l'assemblée d'Achaïe fut le foyer de l'hellénisme, et elle devait l'être. Déjà, sous les empereurs Juliens, les membres de cette assemblée se considéraient comme les représentants de la nation grecque tout entière: ils donnaient à leur président le nom d'Helladarque, et s'appelaient eux-mêmes Panhellènes3. La réunion oubliait ainsi son origine provinciale, et rejetait au dernier plan ses modestes attributions administratives. 1. Tous les présidents du , que l'on connaît jusqu'à présent, et dont on a pu déterminer certainement la patrie, sont originaires d'Argos, de Messène, de Coronée en Messénie (Foucart-Lebas, II, 305); non seulement on n'a pas encore trouvé parmi eux des citoyens des villes libres, comme Athènes et Sparte, mais on n'en a pas rencontré non plus qui fissent partie de la confédération des Béotiens et de leurs alliés. Peut-être ce n'embrassait-il en droit que le territoire appelé par les Romains République d'Acha&ium;e, c.-a-d. le pays occupé par la ligne achéenne lors de sa chute; les Béotiens et leurs alliés, ainsi que le proprement dit des Achéens, ont sans doute été réunis à cette confédération plus vaste dont les inscriptions d'Akraephia (voir la note suivante) nous signalent l'existence et dont l'assemblée se tenait à Argos. En outre, à côté de ce des Achéens, il y avait encore une ligue plus étroite du pays d'Achaïe, au sens propre du mot, dont les représentants se réunissaient à Aegion (Pausanias, VII, 24, 4); il avait de même le (Arch. Zeit., 1879, p. 139, no 374), et beaucoup d'autres confédérations semblables. D'après Pausanias (V, 12, 6) of Travtes Enres avaient élevé une statue a Trajan dans Olympie, Toels en avaient dédié une à Hadrien; s'il n'y a pas là quelque erreur, ce second monument doit avoir été inauguré à l'assemblée d'Aegion. 2. C'est ainsi que la confédération est désignée par l'inscription d'Akraephia (Keil, Syll. inscr. boeot., 31); seul le nom des Doriens fait défaut (cf. p. 11, note 1). Ce document, joint à un autre de la même époque (Corp. insc. graec., 1625), prouve que sous l'empereur Gaius la confédération, au lieu de porter ce nom purement officiel, s'appelait tantôt confédération des Acheens, tantot ou encore. Au reste, cette jactance n'est pas aussi choquante que celle de la petite ligue béotienne; pourtant à Olympie, où la confédération construisait de préférence ses monuments, elle prenait, il est vrai, le plus souvent le titre de mais manifestait fréquemment ses prétentions, par exemple dans le texte suivant: ?? (Arch. Zeit., 1880, p. 86, n 344). De même à Sparte o "Elanvez élèvent une statue à l'empereur Marc-Aurèle (Corp. insc. graec., 1318). 3. En Asie, en Bithynie, dans la Mésie-Inférieure, le chef des villes grecques, qui appartenaient à chacune de ces provinces, portait aussi le titre de : ce nom servait tout simplement à distinguer les Grecs des non-Grecs. Mais en Grèce nom de Hellènes était opposé, pour ainsi dire, dans la pratique, au nom officiel d'Achéens; c'était une manifestation de cette même tendance, qui s'exprimait si clairement dans les Panhellenea d'Argos. Ainsi on trouve (Arch. Zeit., 1877, p. 192, n 98), ou, sur un autre document relatif au même personnage, (LebasFoucart, 305); on releve aussi un (Arch. Zeit., p. 195, no 106), (ibid., 1877, p. 40, no 42), (ibid., 1876, n 8, p. 226), tous d'ailleurs sur des inscriptions du . Quand même ce xolvov n'aurait embrassé que le Péloponnèse (p. 18, note 1), il est facile de comprendre que l'esprit panhellénique ne s'y serait pas moins manifesté. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Décadence de la HelladeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe gouvernement impérial trouva l'empire tout entier désolé par vingt ans de guerres civiles; dans beaucoup de contrées les conséquences de ces luttes n'ont jamais complètement disparu, mais aucune région n'a été plus durement éprouvée que la péninsule grecque. Le sort avait voulu que les trois grandes batailles décisives de cette époque, Pharsale, Philippes, Actium se livrassent sur le territoire de la Grèce ou en vue de ses côtes, et les Grecs surtout avaient souffert, dans leurs vies et dans leurs fortunes, des opérations militaires qui avaient précédé les grands combats. Plutarque entendit son grand-père raconter que les officiers d'Antoine avaient forcé les habitants de Chéronée, qui n'avaient plus d'esclaves ni de bêtes de somme, à porter leurs derniers grains sur leurs épaules jusqu'au port le plus voisin pour approvisionner l'armée; au moment où le second transport de ce genre allait partir, la nouvelle de la bataille d'Actium arriva comme un heureux message de délivrance. Le premier soin d'Octave après sa victoire fut de distribuer aux populations grecques affamées les approvisionnements des ennemis qui tombèrent entre ses mains. |
||||
|
|
|||||
27 av. J.C.-476 |
Décroissance de la populationRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCette misère noire frappait une population qui n'avait aucune force de résistance. Déjà, plus d'un siècle avant la bataille d'Actium, Polybe avait raconté que de son temps les mariages étaient stériles dans la Grèce entière, et que la population diminuait sans que le pays fût atteint d'une épidémie ou décimé par des guerres meurtrières. Dans la suite, ces fléaux firent plus de ravages encore, et la Grèce resta dépeuplée pour toujours. Sur toute l'étendue de l'empire romain, dit Plutarque, la dépopulation fut une conséquence des guerres sanglantes de l'époque; mais la Grèce en souffrit plus que tout autre pays, puisque les Etats les plus puissants qu'elle renfermait ne pouvaient plus mettre sur pied les trois mille hoplites que Mégare, la plus petite des cités grecques, avait envoyés jadis au combat de Platées1. César et Auguste ont essayé de remédier à cette dépopulation dangereuse pour le gouvernement lui-même, par l'envoi de colons italiens, et, en fait, les deux villes les plus prospères de la Grèce furent précisément ces colonies; mais les empereurs qui suivirent n'imitèrent pas leur exemple. Dans la gracieuse idylle des paysans eubéens, composée par Dion de Pruse, le fond du tableau est une ville dépeuplée; beaucoup de maisons sont abandonnées, les troupeaux paissent dans la salle du Conseil et dans celle des archives municipales; les deux tiers du territoire restent inoccupés faute de bras; or si le narrateur nous donne cette peinture comme un spectacle auquel il a lui-même assisté, c'est qu'il nous représente certainement l'état d'un grand nombre de petites cités grecques à l'époque de Trajan. Thebes en Béotie, écrit Strabon, contemporain d'Auguste, est à peine digne du nom de gros bourg, et l'on peut en dire autant de toutes les villes béotiennes, à l'exception de Tanagre et de Thespies.. Non seulement le nombre des habitants diminuait, mais encore le peuple dégénérait. Il y a bien encore de belles femmes, dit à la fin du premier siècle un observateur très délicat, mais on ne voit plus de beaux hommes; les vainqueurs olympiques de la basse époque paraissent petits et communs, à côté des vainqueurs d'autrefois, en partie sans doute par la faute des artistes, mais aussi parce qu'ils le sont en réalité. Dans cette glorieuse patrie des éphèbes et des athlètes, on développait maintenant l'éducation corporelle de la jeunesse, comme si le but de la constitution politique était de transformer les enfants en gymnastes et les hommes en boxeurs. Mais, si aucune province de l'empire romain ne fournissait autant d'artistes au cirque, aucune n'envoyait aussi peu de soldats à l'armée impériale. Même à Athènes, où autrefois les jeunes gens apprenaient à jeter la lance, à tirer de l'arc, à se servir de toutes les armes de trait, à faire de longues marches et à construire des camps, on n'enseignait plus aux enfants, sous l'empire, ces jeux militaires. Les villes grecques ne comptaient presque pas pour le recrutement des troupes, soit parce que leurs contingents paraissaient physiquement trop faibles, soit parce que l'on croyait dangereux d'introduire cet élément dans l'armée; ce fut par une pure fantaisie impériale, que Sévère Antonin, l'Alexandre au carrick2, au moment de partir pour la guerre contre les Perses, renforça l'armée romaine de quelques compagnies spartiates ?. L'ordre et la sûreté de cette province durent être garantis par les différentes cités elles-mêmes, puisqu'il n'y avait pas en Grèce de troupes romaines: Athènes, par exemple, entretenait une garnison dans l'île de Délos, et sur l'acropole campait probablement quelque détachement militaire'. Pendant les crises du troisième siècle, la milice locale d'Elatée (t. IX, p. 310) et celle d'Athènes (t. IX, p. 314) repoussèrent avec bravoure les Kostoboci et les Goths; comme les petits-fils des soldats des Thermopyles l'avaient fait dans la guerre contre les Perses, sous Caracalla, les descendants des vainqueurs de Marathon, pendant la guerre des Goths, inscrivirent dignement leur nom une dernière fois dans les annales de l'histoire ancienne. Mais, quoiqu'une pareille attitude eût dû protéger les Grecs de cette époque contre les bandits qui devenaient de plus en plus puissants, la diminution et l'affaiblissement de la dynastie ne s'arrêtèrent pas un seul instant pendant les plus belles années de l'empire; puis, à la fin du second siècle, les épidémies cruelles qui ravagèrent le pays, les incursions des pirates de terre et de mer qui attaquaient surtout la côte orientale, enfin l'anéantissement de la puissance impériale au temps de Gallien transformèrent en une crise aiguë cette maladie chronique. 1. -A coup sûr Plutarque veut dire par là (De defectu orac., 8) non pas qu'il n'y avait plus en Grèce 3000 hommes en état de porter les armes, mais qu'on n'aurait pas pu lever 3000 hoplites, si les armées des villes avaient dû être constituées comme elles l'étaient autrefois. En ce sens, son assertion est parfaitement admissible, autant que peuvent l'être des plaintes générales de cette nature. Dans toute la province il y avait peu près cent villes. 2. On sait que l'empereur Caracalla était ainsi appelé du nom d'un vêtement gaulois qu'il affectionnait. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Les sentiments des GrecsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa décadence de la Grèce et les sentiments qu'elle éveillait chez les meilleurs citoyens se trouvent exprimés en termes saisissants dans le discours que l'un d'entre eux, Dion de Bithynie, adressa aux Rhodiens à l'époque de Vespasien. Ceux-ci passaient à juste titre pour les plus puissants des Grecs. Dans aucune cité on ne s'était occupé davantage des classes inférieures de la population, non pas en distribuant des aumônes, mais en donnant du travail aux pauvres. Quand Auguste, après la grande guerre civile, accorda aux peuples de l'Orient l'amnistie pour tous les crimes privés, les Rhodiens seuls refusèrent ce dangereux privilège. Si la grande époque du commerce rhodien était passée, il y avait encore beaucoup de comptoirs prospères, beaucoup de maisons de commerce florissantes1. Mais les vices s'étaient introduits en grand nombre dans cette cité; le philosophe demande qu'ils disparaissent, non pas tant, comme il le dit lui-même, pour l'amour des Rhodiens que dans l'intérêt de tous les Hellenes. Autrefois l'honneur de la Grèce reposait sur un grand nombre de citoyens; un grand nombre accroissaient sans cesse sa gloire: vous, les Lacédémoniens, les Athéniens, les Thébains, Corinthe pendant longtemps, et antérieurement Argos. Mais aujourd'hui les autres Etats ne sont plus rien : quelques-uns sont en pleine décadence et même ont été détruits; d'autres se conduisent comme vous le savez: ils se déshonorent et ruinent leur antique gloire. Vous seuls survivez; vous seuls êtes encore quelque chose et jouissez de quelque considération; s'il n'y avait eu que les autres peuples, les Hellenes seraient depuis longtemps tombés plus bas que les Phrygiens et les Thraces. Lorsqu'une grande et puissante famille n'est plus représentée que par un homme, les fautes commises par ce dernier descendant déshonorent tous ses ancêtres : telle est votre situation en Grèce. Ne croyez pas que vous soyez les premiers des Grecs; vous êtes les seuls. A regarder ces misérables coquins, on ne comprend pas les grands événements du passé; les pierres et les ruines des villes témoignent plus clairement de l'orgueil et de la grandeur de la Grèce, que ces descendants qui seraient indignes même d'ancêtres mysiens; les cités qu'ils habitent sont plus malheureuses que les villes en ruines, dont le souvenir reste au moins honoré, et dont la gloire bien acquise est sans tâche: il vaut mieux brûler les cadavres que les laisser pourrir. 1. Vous ne manquez pas de ressources, leur dit Dion (Orat., 31, p. 366) vous étes des milliers et des milliers, qui gagneriez à être moins riches, et plus loin (p. 670): Vous êtes les plus riches de toute la Grèce. Vos ancêtres n'avaient pas plus de biens que vous; votre île est restée aussi fertile; la Carie une partie de la Lycie vous rapportent; un grand nombre de villes vous payent des impôts; beaucoup de citoyens font toujours à votre ville de riches donations. Il continue, en montrant que les dépenses, loin de s'augmenter, ont plutôt diminué, par exemple les frais d'entretien de l'armée et de la flotte: les Rhodiens n'avaient plus qu'à envoyer tous les ans à Corinthe, pour la flotte romaine sans doute, un ou deux petits navires. |
||||
27 av. J.C.-476 |
L'ancienne civilisationRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe n'est pas s'élever contre ces nobles pensées d'un lettré, qui comparait le présent si obscur à l'antiquité si brillante et qui voyait, comme il est naturel, l'un avec des yeux prévenus, l'autre dans toute la splendeur de son passé, que de montrer l'ancienne civilisation hellénique vivant encore à cette époque; elle vécut même longtemps après, non seulement à Rhodes, mais en beaucoup d'autres lieux. L'indépendance morale, le sentiment intime que les Grecs avaient et qu'ils pouvaient avoir d'être encore la nation la plus civilisée du monde ne disparut pas chez les Hellènes de ce temps, malgré leur état humiliant de sujets et leur condition méprisable de parasites. Les Romains empruntèrent aux anciens Grecs leurs dieux, aux Alexandrins leur administration publique; ils cherchèrent à se rendre maîtres de la langue grecque et à helléniser l'idiome latin par l'harmonie et le style. Les Hellenes de l'époque impériale n'agirent pas de même; les divinités nationales de l'Italie, comme Silvain et les dieux lares, ne furent pas honorées en Grèce; aucune ville hellénique ne songea à s'approprier l'organisation politique que Polybe, un Grec pourtant, avait vantée comme la meilleure de toutes. La connaissance du latin était indispensable pour parcourir la carrière des hautes dignités et des fonctions inférieures; c'est ce qui fit que les Grecs qui les briguaient apprirent le latin; car, si l'empereur Claude seulement songea à priver du droit de cité romaine les Grecs qui ne comprendraient pas la langue latine, il n'en est pas moins vrai qu'on ne pouvait exercer réellement les droits et remplir les devoirs attachés à ce privilège, que si l'on possédait la langue d'empire. Mais, en dehors de la vie publique, les Grecs n'ont jamais appris le latin autant que les Romains ont appris le grec. Un écrivain, qui littérairement a marié ensemble les deux moitiés de l'empire, et dont les biographies parallèles des grands hommes de la Grèce et de Rome se recommandent et valent surtout par leur comparaison, Plutarque, ne comprenait pas le latin plus que Diderot n'entendait le russe, et savait à peine le parler, comme il le dit lui-même; les littérateurs grecs qui possédaient réellement la langue latine étaient, ou des fonctionnaires comme Appien et Dion Cassius, ou des étrangers qui n'étaient ni Grecs ni Latins, comme le roi Juba. En fait, la Grèce était bien moins changée en elle-même que dans sa situation extérieure. La constitution d'Athènes était mauvaise sans doute; mais elle n'avait guère été parfaite, même au temps de la grandeur athénienne. C'est toujours, dit Plutarque, la même race, les mêmes agitations, la même gravité et le même enjouement, la même grâce et la même malice qu'autrefois. A cette époque, la vie du peuple grec présente encore certains caractères qui sont dignes de sa domination civilisatrice. Les combats de gladiateurs, qui s'étaient répandus hors de l'Italie dans toutes les contrées, principalement en Asie Mineure et en Syrie, ont pénétré en Grèce plus tard que partout ailleurs: pendant longtemps ils ne furent admis que dans la ville semi-italienne de Corinthe; et lorsque les Athéniens, pour ne pas rester en arrière des Corinthiens, les introduisirent chez eux, malgré les prières d'un des meilleurs citoyens qui leur demandait s'ils ne pourraient pas auparavant élever un autel au dieu de la pitié, plusieurs des plus nobles habitants quittèrent à regret leur patrie qui se déshonorait. Dans aucune région du monde ancien, les esclaves n'ont été traités avec autant d'humanité qu'en Grèce: ce n'était pas une loi, mais une simple coutume, qui défendait aux Grecs de vendre leurs esclaves à qui n'était pas Grec, et qui éloignait ainsi de ce pays la véritable traite des esclaves. Sous l'empire, nous ne trouvons qu'en Grèce les gens de lignée servile admis aux banquets des citoyens libres et aux distributions d'huile1. C'est en Grèce seulement qu'un esclave pouvait, comme Epictète sous Trajan, dans la situation extérieure plus que modeste qu'il occupait à Nicopolis d'Epire, entretenir avec des hommes considérables de rang sénatorial les mêmes relations que Socrate avec Critias et Alcibiade; ils écoutaient son enseignement oral comme des élèves écoutent leur maître; ils notaient par écrit et ils publiaient ses conversations. Il faut rapporter l'honneur des adoucissements que le droit impérial introduisit dans la condition des esclaves, à l'influence des idées grecques, sur Marc-Aurèle, par exemple, qui considérait cet esclave de Nicopolis comme son maître et comme son modèle. L'auteur d'un dialogue, qui s'est conservé parmi les oeuvres de Lucien, fait admirablement connaître l'attitude du fin bourgeois athénien, dans les rapports étroits qu'il avait avec le public de voyageurs nobles et opulents, d'une éducation douteuse ou plutôt d'une grossièreté qui ne l'était pas : on y dissuade le riche étranger de se rendre aux bains publics avec une armée de serviteurs, comme si la vie n'était pas sûre à Athènes ou comme si la paix n'existait pas dans le pays; on lui conseille de ne pas se montrer dans la rue avec une toge de pourpre, tandis que les passants se demandent en riant s'il ne porte pas la robe de sa maman. L'auteur trace un parallèle entre la vie de Rome et celle d'Athènes : là ce sont des festins accablants et des débauches plus accablantes encore, des bandes d'esclaves et un luxe domestique d'une commodité qui n'est qu'incommode; là ce sont les ennuis du libertinage, les tourments de l'ambition, tout l'excès, toute la variété, toute l'agitation de la vie des capitales; ici c'est le charme de l'indigence, la liberté de la parole dans un cercle d'amis, l'oisiveté qui permet de goûter les plaisirs de l'esprit, la faculté de vivre dans le calme et la joie. Comment pourrais-tu, demandait à Rome un Grec à l'un de ses compatriotes, abandonner pour tout ce bruit la lumière du soleil, la Grèce, sa douceur et sa liberté? Tous les esprits délicats et purs s'unissaient alors dans la même pensée; même les meilleurs des Hellènes n'auraient pas voulu être Romains. A peine trouve-t-on dans la littérature de l'époque impériale quelque chose d'aussi charmant que cette idylle eubéenne de Dion, dont j'ai déjà parlé : c'est l'histoire de deux familles de chasseurs qui vivent dans une forêt déserte; leur fortune se compose de huit chèvres, d'une vache sans cornes, d'un joli veau, de quatre faucilles et de trois épieux de chasse; elles ne connaissent ni l'argent ni les impôts; amenées devant la bruyante assemblée des citoyens de la ville voisine, elles sont renvoyées finalement, sans être tracassées, à leur bonheur et à leur indépendance. 1. Un riche citoyen d'Akraephia, en Béotie, invita les esclaves adultes aux fêtes publiques qu'il donna sous Tibère, et sa femme invita les femmes esclaves (Corp. insc. graec., 1625). Lorsqu'on résolut de faire des distributions d'huile dans le gymnase de Gytheion, en Laconie, il fut décidé que six jours par an les esclaves pourraient y être admis (LebasFoucart, 243 a). On trouve, à Argos, la trace de semblables libéralités (Corp. insc. graec., 1122, 1123). |
||||
46-125 |
PlutarqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCette vie, poétisée par Dion, Plutarque la mène dans la réalité, Plutarque de Chéronée, l'un des écrivains anciens les plus agréables, les plus souvent lus, et aussi l'un des plus féconds. Issu d'une famille riche de cette petite ville béotienne, il y habita d'abord; puis il acquit à Athènes et à Alexandrie une instruction complètement hellénique; par ses études, par ses nombreuses relations personnelles, et par ses voyages en Italie, il apprit à connaître le génie romain; il refusa, suivant l'habitude des Grecs aisés, d'entrer au service de l'Etat ou d'embrasser la carrière de professeur; il resta fidèle à sa patrie; avec son excellente femme, avec ses enfants, ses amis et ses amies, il sut jouir de la vie domestique dans le plus beau sens du mot; il se contenta des dignités et des honneurs qu'il pouvait acquérir dans sa chère Béotie et de la modeste fortune que ses pères lui avaient laissée. Dans ce Chéronien se marque la différence qui séparait le monde hellénique du monde hellénisé; on ne pouvait pas être Grec de cette façon à Smyrne, ni à Antioche : l'hellénisme était un produit du sol comme le miel de l'Hymette. Il y eut sans doute des talents plus puissants, des esprits plus profonds que Plutarque; mais aucun écrivain ne supporta avec tant de modération et d'enjouement le sort qui lui était réservé, et ne sut faire revivre dans ses écrits, comme il l'a fait, la paix de son âme et le bonheur de sa vie. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Inconvénients de l'administration provincialeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'influence toute-puissante de l'hellénisme ne peut pas se manifester dans le domaine de la vie publique avec autant de pureté et de beauté que dans le silence de la vie domestique, dont l'histoire ne se soucie pas et qui ne se soucie pas de l'histoire, ce qui est plus heureux encore. Si nous considérons la situation politique de la Grèce, nous devons signaler les inconvénients plutôt que les avantages de la domination romaine comme de l'autonomie grecque. Ce n'étaient pourtant pas les bonnes intentions qui manquaient, puisque le philhellénisme romain fut encore plus marqué sous le principat que sous la République. Il se manifeste partout, en grand comme en petit; on continue à helléniser les provinces de l'Orient; on n'hésite pas à reconnaître comme langues officielles les deux langues grecque et romaine; le gouvernement ne se départit pas des formes les plus courtoises dans ses relations avec les moindres cités grecques; et il recommande la même courtoisie à ses fonctionnaires1. En outre, les empereurs ont prodigué à cette province les dons et les monuments. La plus grande part de ces libéralités revint à Athènes, mais Corinthe fut dotée par Hadrien d'un très bel aqueduc et Antonin bâtit l'hopital d'Epidaure. Cependant, si l'on traita les Grecs en général avec beaucoup de considération, et si le gouvernement impérial se montra très bienveillant envers la Grèce proprement dite, que l'on regardait dans un certain sens comme la mère patrie tout autant que l'Italie elle-même, il n'en résulta aucun avantage pratique ni pour l'administration ni pour le pays. Les hauts fonctionnaires changeant tous les ans et le contrôle central étant peu sérieux, tant que dura le régime des proconsuls, les provinces sénatoriales sentirent les inconvénients plus que les bienfaits d'une administration unique; le mal était deux fois plus grand pour les provinces petites et pauvres. Sous Auguste lui-même, les désavantages étaient si marqués qu'un des premiers actes de son successeur fut de prendre sous son autorité particulière la Grèce et la Macédoine2, provisoirement, disait-il, mais, en réalité, pour toute la durée de son règne. L'empereur Claude, lorsqu'il monta sur le trône, rétablit l'ancienne organisation; cette réforme, pour être constitutionnelle, n'était peut-être pas très sage. Depuis lors on ne modifia plus l'administration de la province; l'Achaïe fut gouvernée par des fonctionnaires tirés au sort et non pas nommés, jusqu'au moment où cette organisation disparut complètement. 1. Les petites cités de l'Asie Mineure rivalisaient entre elles au sujet de leurs titres et de leur rang, et elles importunaient le gouvernement de leurs plaintes incessantes. Antonin répondait ainsi aux griefs formulés par les Ephésiens (Waddington, Aristide, p. 51) : Je sais bien que les habitants de Pergame vous ont donné votre nouveau titre; ceux de Smyrne n'ont pu l'oublier que par accident, et ils vous rendront justice à l'avenir, mais à la condition que vous, Ephésiens, vous leur donniez aussi leur véritable titre. Une petite ville lycienne vient trouver le proconsul pour obtenir la confirmation d'un traité qu'elle a signé: celui-ci-répond (Benndorf, Lykische Reise, I, 71) que d'excellentes mesures n'ont besoin que d'éloges et nullement de confirmation; la confirmation est une conséquence toute naturelle. Les écoles de rhéteurs de cette époque fournissent aussi des formules à la chancellerie impériale; mais cela ne suffit pas. Il est de l'essence même du principat de ne pas accentuer, vis-à-vis des sujets, les marques extérieures de leur subordination, surtout quand il s'agit des villes grecques. 2. Ce changement ne provoque pas de modification formelle dans l'administration financière; d'ailleurs Tacite n'en signale pas (Ann., I, 76); si une réforme fut réclamée, parce que les provinciaux se plaignaient d'être accablés d'impôts (onera deprecantes), de meilleurs gouverneurs purent y remédier par des répartitions plus équitables, et en accordant provisoirement la remise de l'impôt. L'édit de Claude, relatif à Tégée (Eph. epig., V, p. 69), montre que l'établissement de la poste impériale fut considéré, surtout dans cette province, comme une charge très lourde. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Décadence des villes libresRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais beaucoup plus mauvaise encore était la situation des villes grecques soustraites à la domination du gouverneur. On avait voulu favoriser les cités indépendantes en les exemptant du tribut et du recrutement et en limitant le moins possible leurs droits d'Etats souverains; mais dans la plupart des cas on avait obtenu des résultats contraires à ceux que l'on attendait. Cette organisation, qui manquait d'unité intérieure, ne porta que de mauvais fruits. Il est vrai que dans les cités moins privilégiées, ou mieux administrées, l'autonomie communale a peut-être atteint son but; tout au moins nous ne savons pas que Sparte, Corinthe, Patrae surtout, en aient beaucoup souffert. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Administration d'AthènesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais Athènes n'était pas capable de s'administrer elle-même; elle offre le spectacle désolant d'une cité gâtée par sa toute-puissance, et dont les finances comme les moeurs étaient perdues. Et pourtant elle aurait dû se trouver dans une situation prospère. Si ce fut un malheur pour les Athéniens d'établir leur hégémonie sur la nation tout entière, du moins Athènes est la seule cité de Grèce et d'Italie, qui ait réalisé l'unité provinciale : aucune ville de l'antiquité n'a possédé en propre un territoire comme l'Attique, de quelque quarante milles carrés, deux fois grand comme l'île de Rügen. Les Athéniens avaient même conservé ce qu'ils occupaient en dehors de l'Attique; Sylla le leur avait laissé après la guerre de Mithridate et César, après la bataille de Pharsale, où ils avaient combattu dans les rangs de Pompée; celui-ci leur avait demandé seulement combien de fois ils voulaient ainsi se perdre eux-mêmes, pour être sauvés par la gloire de leurs ancêtres. Athènes possédait encore non seulement l'ancien territoire de la ville d'Haliarte en Béotie, mais même sur le rivage de l'Attique, Salamine, le point de départ de sa domination maritime, dans la mer de Thrace les îles riches de Skyros, Lemnos et Imbros, dans la mer Egée, Délos. Il est vrai que cette île n'était plus, depuis la fin de la république, le centre des relations commerciales avec l'Orient; les ports de la côte occidentale d'Italie attiraient maintenant tout le trafic, et les Athéniens avaient subi là un dommage irréparable. Par leurs flatteries, ils avaient su obtenir d'Antoine de nouvelles concessions; Auguste, contre lequel ils avaient pris parti, leur enleva Egine et Erétrie d'Eubée ; mais ils purent garder les petites îles de la mer de Thrace, Ikos, Peparetos, Skiathos, et même Céos, en face du promontoire de Sunium; plus tard Hadrien leur donna la meilleure partie de la grande île de Céphallénie, dans la mer Ionienne. Ce fut l'empereur Sévère, mal disposé contre eux, qui le premier les dépouilla d'une partie de leurs possessions étrangères. Hadrien, de plus, avait garanti aux Athéniens la livraison d'une certaine quantité de blé aux frais de l'Etat; par l'extension de ce privilège, qui avait été jusqu'alors réservé à la capitale du monde romain, il reconnaissait Athènes comme une des métropoles impériales. De même les bienfaits de l'institution alimentaire, dont l'Italie jouissait depuis Trajan, furent introduits à Athènes par Hadrien, qui donna certainement aux Athéniens, sur sa propre cassette, le capital nécessaire. Un aqueduc, dédié par le même empereur à sa chère Athènes, fut achevé après sa mort par Antonin. Ajoutez à cela que les voyageurs et les étudiants affluaient dans cette ville, et que les riches Romains, comme aussi les princes étrangers, lui faisaient des donations de plus en plus considérables. Athènes n'en était pas moins dans de continuels embarras. Avec le droit de cité s'étaient introduits non seulement ce trafic de la main à la main, commun à toutes les villes, mais encore un brocantage public et formel. Auguste dut intervenir pour le prohiber. Plusieurs fois le conseil municipal n'hésita pas à vendre l'une ou l'autre des îles athéniennes et il ne rencontra pas toujours un riche bienfaisant, comme ce Julius Nicanor, qui sous Auguste racheta pour les Athéniens faillis l'île de Salamine; le conseil lui décerna en retour le titre honorifique de nouveau Thémistocle et, comme il faisait des vers, celui de nouvel Homère; mais le public ne manqua pas de lui décocher, ainsi qu'aux nobles conseillers, quelques railleries bien méritées. Les monuments splendides, dont la ville d'Athènes continuait à s'orner, furent tous construits par des étrangers, entre autres par les riches souverains Antiochus de Commagène et Hérode de Judée, mais surtout par l'empereur Hadrien, qui bâtit sur l'Ilissus une ville complètement neuve (novae Athenae); après avoir fait élever un grand nombre de palais, parmi lesquels nous avons déjà cité le Panhellenion, il termina magnifiquement le temple colossal de l'Olympeion, cette merveille du monde, commencé sept siècles auparavant par Pisistrate, avec ses 120 colonnes dont une partie existe encore et qui sont les plus grandes de toutes les colonnes aujourd'hui restées debout. Athènes n'avait pas d'argent, non seulement pour relever les murs du Pirée, qui n'étaient plus utiles, mais même pour entretenir son port. Au temps d'Auguste, le Pirée n'était qu'un petit village de quelques maisons; on ne le visitait plus que pour admirer les chefs-d'oeuvre de la peinture dans les portiques de ses temples. Il n'y avait presque plus de commerce ni d'industrie à Athènes; ou plutôt la ville en général, et chaque citoyen en particulier, ne connaissaient plus qu'un seul genre de gain, la mendicité. Les embarras financiers ne furent même pas le seul inconvénient de cette administration. La paix régnait bien dans le monde, mais non pas dans les rues ni dans les places d'Athènes. Sous Auguste, une émeute des Athéniens avait pris de telle proportions que le gouvernement romain dut envoyer des troupes contre cette ville libre1. Une pareille sédition est sans doute un fait isolé; mais chaque jour les Athéniens s'attroupaient dans la rue à cause du prix du pain ou pour d'autres motifs. Les autres villes ne devaient pas offrir un spectacle beaucoup plus beau; la différence est qu'on en parle moins. On peut à peine comprendre que Rome ait abandonné la justice criminelle à une pareille bourgeoisie; mais elle appartenait légalement aux villes comme Athènes et Rhodes, admises à former une fédération internationale. A l'époque d'Auguste, l'aréopage d'Athènes refusa, malgré l'intercession d'un noble Romain, d'accorder sa grâce à un Grec condamné comme faussaire; c'était son droit; mais lorsque les habitants de Cyzique emprisonnaient sous Tibère des citoyens romains, lorsque les Rhodiens en crucifiaient un autre à l'époque de Claude, ils violaient formellement la légalité; une pareille conduite coûta aux Thessaliens leur autonomie, sous le règne d'Auguste. L'impuissance n'exclut pas l'outrecuidance ni les empiètements sur le terrain d'autrui; assez souvent même les plus faibles des pupilles sont les plus audacieux. Quelque respect que l'on puisse avoir pour un passé glorieux et des traités jurés, tout gouvernement consciencieux devait considérer ces Etats libres comme des éléments de trouble dans l'organisation générale, à peu près autant que le droit d'asile dans les temples, qui était pourtant d'une antiquité beaucoup plus vénérable encore. 1. L'émeute d'Athènes sous Auguste est confirmée certainement par la notice d'Eusèbe, pour l'année d'Abraham 2025, tirée de Jules l'Africain (Orose s'en est inspiré, VI, 22, 2). Les rassemblements contre les stratèges sont souvent signalés: Plutarque, Quaest. conviv., VIII, 3 au début.; Lucien, Demonax, 11, 64; Philostrate, Vit. soph., I, 23; II, 1, 11. |
||||
27 av. J.C.-476 |
CorrecteursRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteRome se décida à user d'autorité; l'administration intérieure des villes libres fut soumise à la surveillance de fonctionnaires nommés par l'empereur, qui eurent d'abord le caractère de commissaires extraordinaires pour corriger les inconvénients inhérents aux villes libres et qui, plus tard, reçurent le titre officiel de Correcteurs. Les débuts de cette institution se placent pour nous à l'époque de Trajan; à la fin du troisième siècle les correcteurs d'Achaïe nous apparaissent comme fonctionnaires permanents. Ils sont nommés par l'empereur et exercent leurs fonctions à côté des proconsuls. On ne les rencontre d'aussi bonne heure dans aucune partie de l'empire romain; nulle part ils ne sont devenus aussi vite permanents que dans l'Achaïe, où la moitié des villes étaient des cités libres. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Fidélité aux souvenirs du passéRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Hellènes avaient conscience de leur supériorité intellectuelle : ce sentiment, parfaitement justifié en soi-même et entretenu par l'attitude du gouvernement, peut-être davantage encore par celle du public romain, fit renaître le culte du passé, où se mêlent un attachement fidèle aux souvenirs d'époques plus grandes et plus heureuses, et le recul étrange d'une civilisation développée jusqu'à ses débuts, le plus souvent très primitifs. |
||||
27 av. J.C.-476 |
ReligionRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteExcepté le culte des divinités égyptiennes et surtout d'Isis, introduit de bonne heure en Grèce à la faveur des relations commerciales, les Grecs de la Hellade proprement dite ont constamment repoussé les religions étrangères; si cette affirmation n'est pas très juste de Corinthe, c'est que Corinthe est la moins grecque des cités helléniques. Ce n'était pourtant pas la foi intime qui soutenait l'ancienne religion nationale; depuis longtemps on n'y croyait plus en Grèce; mais les coutumes du pays et les souvenirs du passé s'y attachaient de préférence. Aussi, non seulement elle fut conservée avec ténacité, mais encore on la voit, grâce surtout à une sorte de reconstitution archaïque, de jour en jour plus froide et plus antique, devenir l'apanage des érudits. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Familles noblesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl en est de même pour le culte des familles nobles: les Hellènes s'y sont consacrés avec une ardeur extraordinaire, et ont laissé bien loin en arrière les nobles romains les plus orgueilleux. A Athènes la dynastie des Eumolpides joua sous Marc-Aurèle un rôle prépondérant dans la réorganisation des fêtes d'Eleusis. Le fils de cet empereur, Commode, accorda au chef de la famille des Kerykes le droit de cité romaine, et cette lignée donna naissance au brave et savant Athénien qui, presque comme Thucydide, combattit les Goths et raconta ensuite la guerre qu'il avait faite contre eux. Le professeur et le consulaire Hérode Atticus, contemporain de Marc-Aurèle, appartenait à la même maison; son panégyriste le chante comme un des plus nobles Athéniens, comme un descendant de Hermès et de Hersé, fille de Cécrops, auquel le brodequin rouge des patriciens romains convient à merveille; un de ses admirateurs en prose le célèbre comme un Eacide et en même temps comme un petit-fils de Miltiade et de Cimon. Mais Athènes était encore surpassée par Sparte: on trouve de nombreux Spartiates qui se vantent de descendre des Dioscures, de Heraclès, de Poseidon, et qui rappellent avec orgueil que le sacerdoce de ces ancêtres divins est héréditaire dans leur famille depuis plus de quarante générations. Ce qui caractérise cette noblesse, c'est qu'elle n'apparaît guère avant la fin du second siècle: les auteurs héraldiques qui ont composé ces arbres généalogiques n'ont dû soumettre, ni dans Athènes ni dans Sparte, leurs documents à une critique sérieuse. |
||||
27 av. J.C.-476 |
La langueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteArchaïsme et barbarismes. La même tendance se manifeste dans les modifications que la langue ou plutôt les dialectes subirent. Tandis que le grec dit vulgaire, essentiellement dérivé de l'idiome attique, domine dans les autres régions où l'on parle la langue grecque, et même est employé dans la Hellade pour les relations quotidiennes, on veut à cette époque purger la langue littéraire des solécismes et des néologismes qui s'y sont introduits; en outre on reprend souvent les idiotismes dialectaux disparus de la langue usuelle, et l'on fait visiblement revivre l'ancien particularisme, là où il était le moins justifié. Les Thespiens ayant élevé des statues aux Muses dans le bois sacré de l'Hélicon, on y grave, en bon béotien, les noms d'Orania et de Thalea; les épigraphes de ces mêmes statues, composées par un poète de nom romain, les appellent en bon ionien Uranié et Thaleié, et les Béotiens non érudits, qui les connaissaient, leur donnaient, comme tous les autres Grecs, les noms d'Urania et de Thaleia. Les Spartiates firent en ce genre des choses incroyables et bien souvent on écrivait plutôt pour l'ombre de Lycurgue que pour les AElii ou les Aurelii contemporains1. D'ailleurs, à cette époque, la correction du langage disparaissait en Hellade; les documents de l'époque impériale fourmillent d'archaïsmes et de barbarismes qui s'accordent parfaitement ensemble. La population d'Athènes, très mêlée d'étrangers, ne s'est jamais spécialement distinguée par la pureté de sa langue2; et, quoique le dialecte attique se soit conservé relativement correct dans les actes officiels de la ville, la corruption du langage, qui régnait partout, s'y faisait déjà sentir dès l'époque d'Auguste. Les grammairiens rigoureux du temps ont rempli des livres entiers avec les solécismes commis par le rhéteur Hérode Atticus, nommé plus haut, dont on a souvent fait l'éloge, et par les autres professeurs de rhétorique célèbres au second siècle3; je laisse de côté l'affectation raffinée et les pointes maniérées qui remplissent leurs discours. La véritable décadence de la langue et de la littérature commença à Athènes et dans toute la Grèce, comme à Rome, avec Septime Sévère. 1. Une pièce curieuse est l'inscription (Lebas-Foucart, II, p. 142, ?. 162 ), un contemporain d'Antonin et de Marc-Aurèle, qui fut des Dioscures et de leurs femmes, filles de Leucippos, mais qui, mêlant le nouveau à l'ancien, était en outre. Il avait été dans sa jeunesse, littéralement bouvier des petits, c'est-à-dire maître des enfants de trois ans. Les troupes d'enfants de Lycurgue ne devaient être formées que d'enfants âgés de sept ans; mais ses descendants, pour réparer le temps perdu, avaient commencé à enrôler les enfants dès l'âge d'un an et à les confier à des conducteurs. Ce même homme était vainqueur. Ce que cela signife, Lycurgue le sait peut-être. 2. L'intérieur de l'Attique, dit un habitant de ce pays dans Philostrate (Vitae sophist., II, 7) est une bonne école pour qui veut apprendre à parler; au contraire, les habitants d'Athènes même, qui louent des logements à des jeunes gens venus de Thrace, de Pont et d'autres contrées barbares, laissent corrompre par eux leur langue plutôt qu'ils ne leur apprennent à bien parler. Mais dans l'intérieur du pays, où les habitants ne sont pas en contact avec des barbares, les expressions et le langage sont corrects. 3. Karl Keil (Pauly, Realencyclop., I, 2e ed., p. 2100) cite ????? au lieu dans l'inscription relative à la femme d'Hérode (Corp. insc. lat., VI, 1342). |
||||
27 av. J.C.-476 |
Les grandes famillesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa dégradation de la vie hellénique tient à ce qu'elle était enfermée dans un cercle trop étroit; les hautes ambitions n'avaient pas d'objet digne d'elles et cédaient la place aux convoitises basses et humiliantes. Or il ne manquait pas en Grèce de familles riches et influentes1. En général le pays était pauvre, mais il y avait encore des maisons qui possédaient de grandes propriétés foncières et qui jouissaient depuis longtemps d'une fortune solide. A Sparte, par exemple, la famille Lacharès, depuis Auguste jusqu'à l'époque d'Hadrien tout au moins, avait occupé une situation qui ressemblait vraiment à celle d'une maison princière. Antoine avait fait périr Lacharès pour confisquer ses biens. Aussi Eurykles, fils de Lacharès, fut-il un des plus chauds partisans d'Auguste et l'un des plus braves capitaines qui le secondèrent dans le combat décisif; il faillit faire prisonnier le général vaincu. Entre autres riches dons, le vainqueur lui donna l'île de Cythère (Cérigo), en propriété privée. Plus tard Eurykles joua un rôle prépondérant et dangereux, non seulement dans sa patrie, où il devait jouir d'une autorité constante, mais même aux portes de Jérusalem et de Césarée; la considération que les Orientaux avaient pour les Spartiates a dû le favoriser en cette circonstance. Souvent appelé devant le tribunal d'empire pour rendre compte de sa conduite, il fut enfin condamné et banni; mais la mort l'enleva à temps aux suites de sa condamnation. Son fils Lakon hérita de sa fortune, et surtout de sa puissance, dont il usa avec plus de circonspection. La famille de cet Hérode, que nous avons déjà souvent nommé, jouissait à Athènes de la même situation; nous pouvons en suivre la trace et remonter à travers quatre générations jusqu'à l'époque de César. Le grand-père d'Hérode, comme le Spartiate Eurykles, vit tous ses biens confisqués, parce qu'il avait, à Athènes, une puissance considérable. Les immenses propriétés foncières que son petit-fils possédait dans sa patrie ruinée, les vastes terrains qu'il destinait aux tombeaux de ses esclaves favoris, excitaient l'envie même chez les gouverneurs romains. Il y avait sans doute des familles aussi puissantes dans la plupart des pays de la Grèce; et si d'habitude elles étaient les maîtresses de l'assemblée provinciale, elles avaient aussi à Rome des attaches et de l'influence. 1. Tacite (pour l'année 62 : Ann., XV, 20) trace le portrait d'un de ces provinciaux riches et influents, Claudius Timarchides de Crète, qui est tout-puissant dans son pays (ut solent praevalidi provincialium et opibus nimiis ad injurias mi norum elati): il dispose de l'assemblée provinciale, et par conséquent du décret de remerciement que l'on est obligé d'adresser au proconsul qui part, et que celui-ci désire vivement, parce qu'on peut lui demander de rendre ses comptes (in sua potestate situm, an proconsulibus, qui Cretam obtinuissent, grales agerentur). L'opposition propose de refuser ces décrets; mais cette motion n'est pas votée. D'autre part ces Grecs puissants nous sont dépeints par Plutarque (Praec. ger. reip., c. 19, 3). |
||||
27 av. J.C.-476 |
La carrière des fonctions publiquesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes obstacles légaux qui empêchaient un Alexandrin ou un Gaulois d'entrer au sénat de l'empire, même après avoir obtenu le droit de cité, n'existaient pas en fait pour ces riches Hellenes; surtout sous les empereurs, la carrière politique et militaire que les Italiens pouvaient parcourir était de même ouverte en droit aux Grecs; pourtant ils ne sont entrés au service de l'Etat qu'à une époque reculée et en petit nombre. D'une part, le gouvernement romain, dans les premières années de l'empire, considérait, malgré lui, les Grecs comme des étrangers; d'autre part, les Grecs eux-mêmes ne voulaient pas se transporter à Rome, comme l'exigeait l'entrée dans cette carrière politique, et aimaient mieux rester les premiers dans leur patrie que devenir à Rome l'un quelconque des nombreux sénateurs. A l'époque de Trajan, l'arrière-petit-fils de Lacharés, Herklanos, et probablement le père d'Hérode Atticus furent admis les premiers dans le sénat romain1. L'autre carrière, qui ne date que de l'empire, le service personnel des empereurs, procurait la richesse et l'influence aux gens que le sort favorisait; elle fut de bonne heure et très souvent parcourue par des Grecs; mais comme la plupart et les plus importantes de ces situations étaient liées au service d'officier, les Italiens paraissent avoir joui, pendant très longtemps, d'un véritable avantage; là aussi la voie directe était en quelque sorte barrée aux Grecs. Cependant à la cour impériale beaucoup d'Hellenes occupèrent toujours des positions subalternes; ils obtenaient souvent par des chemins détournés la confiance de l'empereur et une grande influence. Mais ces personnages venaient plutôt des pays hellénisés que de la Grèce propre; encore moins appartenaient-ils aux grandes familles helléniques. L'ambition légitime d'un jeune homme de bonne et haute naissance, quand il était Grec, ne pouvait s'exercer sous l'empire romain que dans un cercle très restreint. 1. Hérode était éto (Philostrate, Vitae Sophist., I, 25, 5, p. 536), (ibid., II, au début, p. 54). On ne sait pas autre chose des consulats de ses ancêtres; mais certainement son grand-père Hipparchos ne fut pas sénateur. Peut-être ne s'agit-il ici que de ses ascendants maternels. La famille d'Hérode ne possédait pas le droit de cité romaine sous les Jules (cf. Corp. insc, lat., II, 489); elle ne l'obtint que sous les Claude. |
||||
27 av. J.C.-476 |
L'administration municipaleRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl lui restait sa patrie, où c'était d'ailleurs son devoir et son honneur de travailler au bien public. Mais le devoir était modeste et les honneurs plus modestes encore. Votre tâche, dit Dion à ses Rhodiens, n'est plus la même que celle de vos ancêtres. Ils pouvaient exercer leur activité de tous les côtés à la fois, aspirer à la domination, secourir les opprimés, acquérir des alliés, fonder des villes, combattre et triompher; de tout cela vous ne pouvez plus rien faire. Ce qui vous reste à vous, c'est de bien gérer vos maisons, d'administrer votre ville, de distribuer les honneurs et les distinctions avec choix et mesure, de siéger au conseil et dans le tribunal, c'est le culte des dieux, ce sont les cérémonies des jours de fête; par là vous pouvez vous élever au-dessus des autres cités. Il ne faut pas pourtant non plus oublier de signaler la bienséance de votre attitude, le soin que vous prenez de vos cheveux et de votre barbe, la gravité de votre démarche dans la rue, qui fait que les étrangers accoutumés à courir perdent, chez vous, cette habitude, votre costume de bon ton, et, si risible qu'elle paraisse, votre bande de pourpre étroite et effilée, votre calme au théâtre et la mesure que vous apportez dans vos applaudissements; tout cela fait l'honneur de votre ville; là, plus que dans vos ports, vos murs et vos docks, se retrouvent les bonnes manières de l'ancienne Grèce. Par là, le barbare qui ne connaît pas le nom de votre cité s'aperçoit néanmoins qu'il est en Grèce, et non en Syrie ou en Cilicie. Ces affirmations sont justes; mais si l'on ne demandait plus aux citoyens de mourir pour leur patrie, ils pouvaient bien se demander eux-mêmes s'il valait la peine de vivre pour elle. Plutarque nous décrit la situation des magistrats municipaux de la Grèce à son époque, et il la juge avec l'équité et la modération qui lui sont propres. Il était tout aussi difficile qu'autrefois de bien administrer les affaires publiques avec des majorités de citoyens mobiles, capricieux, plus occupés de leurs profits particuliers que de l'intérêt général, ou bien avec les membres très nombreux des assemblées délibérantes; le Conseil d'Athènes comprit sous l'empire d'abord 600, puis 500 et plus tard 750 membres. Le devoir du bon magistrat, c'est d'empêcher le peuple de faire tort à l'individu, d'attirer illégalement à lui les fortunes privées, et de se partager les richesses publiques; devoir difficile à remplir, car le magistrat ne peut employer que les exhortations raisonnables ou les artifices du démagogue; il ne faudra pas non plus qu'il se montre trop ferme dans les petits détails et, si les citoyens demandent, à l'occasion d'une fête municipale, une modique distribution de blé, il ne voudra pas se brouiller avec ses administrés pour une pareille vétille. Au reste la situation avait complètement changé; désormais le magistrat devait apprendre à s'y conformer. Il lui incombe avant tout d'avoir toujours devant les yeux et de mettre sans cesse devant ceux de ses concitoyens l'impuissance des Hellènes. La liberté de la ville s'étend aussi loin que les maîtres le permettent; et ce serait un mal de désirer l'accroître. Lorsque Péricles revêtait le costume officiel, il avait soin de se rappeler qu'il commandait à des hommes libres et à des Grecs; aujourd'hui le magistrat doit se dire qu'il ne commande que sous les ordres d'un maître, à une ville soumise à des proconsuls et à des procurateurs impériaux; qu'il ne peut pas, qu'il ne doit pas être autre chose que l'organe du gouvernement; et qu'un trait de plume du gouverneur suffit pour annuler chacun de ses décrets. Aussi le premier devoir d'un bon magistrat est-il de vivre en parfaite intelligence avec les Romains, et de se créer, s'il le peut, des relations influentes à Rome, pour le plus grand avantage de son pays. Sans doute l'homme intègre recule énergiquement devant la servilité; il est nécessaire que le magistrat résiste courageusement à un mauvais gouverneur, et la plus grave décision que puisse prendre une ville, c'est de porter un conflit de cette nature à Rome devant l'empereur. Mais Plutarque, et ceci est caractéristique, blâme fortement les Grecs, qui font intervenir, comme au temps de la ligue achéenne, le gouvernement romain dans la moindre querelle locale; il leur conseille de régler les affaires municipales au sein même de la ville, et de ne pas se livrer, par un appel imprudent, non pas tant à l'autorité supérieure qu'aux agents d'affaires et aux avocats qui la représentent. Tout cela est sensé et patriotique, aussi sensé et aussi patriotique que l'avait été jadis la politique de Polybe, dont Plutarque parle à dessein. A cette époque, où le monde jouissait d'une paix complète, où il n'y avait plus de guerres ni contre les Grecs, ni contre les barbares, où le gouvernement des villes, les traités de paix et les alliances des cités sont devenus des événements historiques, on aurait dû abandonner aux maîtres d'école les souvenirs de Marathon et de Platées, au lieu d'exciter par de grands mots de cette nature les membres de l'Ecclesia; la meilleure attitude était de se renfermer dans le cercle étroit des libertés qu'on accordait encore. Mais c'est la passion, et non la raison, qui gouverne le monde. Le citoyen hellénique pouvait encore faire son devoir envers sa patrie; mais pour l'ambition purement politique qui aspire aux grandes choses, pour les hautes visées d'un Périclés et d'un Alcibiade, il n'y avait plus de place en Grèce, excepté peut-être dans le cabinet de travail d'un homme de lettres. Au lieu de ces nobles sentiments pullulaient ces passions vénimeuses qui empoisonnent la poitrine et corrompent le coeur de l'homme, lorsque les grandes aspirations lui sont interdites. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Les jeuxRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAussi la Grèce fut-elle le foyer de ces ambitions sans but et avortées, le plus général et certainement l'un des plus pernicieux parmi les nombreux fléaux qui ont sévi sur l'antique civilisation en décadence. Au premier rang doivent se placer, à ce sujet, les fêtes populaires et les assauts de magnificence auxquelles elles donnaient lieu. Les combats d'Olympie plurent à la nation encore jeune des Hellenes; dans cette fête de gymnastique, à laquelle prenaient part toutes les tribus et toutes les villes grecques, la couronne tressée de branches d'olivier, qui était décernée au meilleur coureur d'après la sentence du juge de la Grèce, exprimait naïvement et simplement l'homogénéité d'un peuple nouveau. Mais on n'en resta pas à cette aurore, quand le pays eut reçu un développement politique. Déjà, à l'époque de la confédération maritime d'Athènes et assurément sous la monarchie d'Alexandre, cette fête hellénique était un anachronisme, un jeu d'enfant conservé pendant l'âge mûr; le possesseur de la couronne d'olivier ne passait pas plus, à ses propres yeux et aux yeux de ses concitoyens, pour le premier de tous les Grecs, que de nos jours, en Angleterre, on ne songe à mettre les vainqueurs des régates d'étudiants sur la même ligne que Pitt et Beaconsfield. Cet empire imaginaire de la couronne d'olivier exprime bien l'unité idéale et la dislocation réelle du peuple grecque, lorsqu'elle se fut répandue par la colonisation et l'hellénisation. La politique toute pratique, que l'on suivit sous les Diadoques, s'occupa fort peu, comme il était naturel, des jeux olympiques. Mais lorsque l'empire s'appropria l'idée panhellénique, lorsque les Romains s'arrogèrent les droits et s'imposèrent les devoirs des Grecs, Olympie resta ou devint le vrai symbole du panhellénisme romain: sous Auguste, pour la première fois, un Romain est vainqueur à Olympie, et ce n'est rien moins que le beau-fils d'Auguste, le futur empereur Tibère1. L'alliance impure que l'hellénisme tout entier avait contractée avec le démon du jeu fit de ces fêtes une institution puissante et durable, mais pernicieuse en général et surtout pour la Grèce. Le monde hellénique et hellénisant tout entier y prenait part, en les célébrant et en les imitant; partout sortaient de terre dans les contrées helléniques des fêtes semblables; l'enthousiasme des masses, l'intérêt que tous portaient à chaque combattant, l'orgueil du vainqueur et surtout de ses amis et de sa patrie faisaient presque oublier pourquoi l'on avait lutté. Le gouvernement romain non seulement accorda toute liberté aux combats de gymnastique et aux autres jeux, mais encore participa lui-même à ces fêtes; le droit que le vainqueur avait d'être solennellement reçu dans sa patrie ne dépendit plus sous l'empire du bon plaisir de la ville intéressée; il fut donné par privilège impérial aux différents centres de jeux2; dans ce cas la pension annuelle (clonces) servie au vainqueur fut prélevée sur le trésor impérial, et les jeux les plus importants furent considérés comme des institutions d'empire. Cet amour des jeux s'étendait à toutes les provinces de l'empire, mais la Grèce proprement dite était toujours le centre idéal de ces combats et de ces victoires: c'est là qu'était leur patrie, sur les bords de l'Alphée; c'est là que se célébraient les plus anciens jeux, organisés sur le modèle des fêtes d'Olympie, les Pythiques, les Isthmiques, les Néméens, dont la fondation remonte à la grande époque de la Grèce, et qui furent chantés par ses poètes classiques; c'est là encore que se donnaient d'autres fêtes de création plus récente, mais aussi splendides, les Euryclées, fondées sous Auguste par le chef spartiate dont nous avons parlé plus haut, les Panathénées athéniennes, les Panhellénies également athéniennes et dotées par Hadrien avec une munificence impériale. On pouvait trouver bizarre que tous les habitants du vaste empire romain parussent se presser à ces fêtes de gymnastique; mais il était assez naturel de voir les Hellènes boire à cette coupe magique étrange, plus qu'à toute autre, et animer par ces distractions malsaines, par ces distributions de couronnes, de statues, de privilèges aux vainqueurs de ces fêtes, le calme plat politique que les meilleurs d'entre eux leur recommandaient. 1. Le premier Romain vainqueur à Olympie que nous connaissions est Ti. Claudius, Ti. filius, Nero, sans aucun doute le futur empereur, qui remporta le prix de la course en quadriges (Arch. Zeitung, 1880, p. 53); cette victoire tombe probablement dans l'Olympiade 195 (1 ap. J.-C.), et non dans l'Olympiade 199 (17 ap. J.-C.), comme le porte le texte de l'Africain (Eusèbe, I, p. 214, edit. Schone). A cette dernière date le vainqueur fut plutôt son fils Germanicus, également pour la course en quadriges (Arch. Zeitung, 1879, p. 36). Parmi les vainqueurs du stade, qui étaient les vainqueurs éponymes d'Olympie, ne se trouve aucun Romain; il semble qu'on ait voulu éviter ainsi de blesser le patriotisme grec. 2. Un centre de jeux ainsi privilégié s'appelle dywy lapos, certamen sacrum (c.-a-d. pensionné, Dion, II, 1), ou apeby sidedaotixos, certamen iselasticum (cf. par exemple Pline, Ep. ad Traj., 118, 119; Corp. insc. lat., X, 515). La Xystarchie était aussi accordée par l'empereur, au moins dans certains (Dittenberger, Hermes, XII, p. 17 et suiv.). Ce n'est pas à tort que ces jeux s'appellent jeux universels. |
||||
27 av. J.C.-476 |
L'ambition municipaleRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa marche des institutions municipales fut la même dans tout l'empire, mais surtout en Grèce. Tant qu'il resta place à de hautes visées pour l'ambition, ce fut autour des fonctions et des dignités municipales que se livrèrent, dans la Hellade, comme à Rome, les combats politiques, dont l'issue, quelquefois vaine, ridicule et nuisible, avait souvent été des plus heureuses et des plus nobles. Sous l'empire le fruit avait disparu, l'écorce seule restait; à Panope, en Phocide, les maisons étaient sans toit, les habitants logeaient dans des huttes, mais c'était encore une cité, un Etat, et les Panopéens avaient leur place dans le cortège des villes phocidiennes. Dignités et sacerdoces, décrets élogieux proclamés par la voix du héraut, places d'honneur aux assemblées publiques, vêtements de pourpre et diadème, statues à pied et à cheval, tout cela était pour ces villes affaire de vanité et d'argent, dont elles trafiquaient plus honteusement que le moindre principicule des temps modernes, qui vend ses décorations et ses titres. Assurément à cette époque de véritables services ont été rendus, des récompenses méritées ont été décernées; mais, le plus souvent, c'était un marché de la main à la main, ou plutôt, suivant le mot de Plutarque, un traité entre une courtisane et ses pratiques. De nos jours la richesse privée, qui sait être libérale, est d'abord décorée, puis anoblie; de même autrefois on lui donnait la pourpre sacerdotale et on lui élevait des statues sur la place publique. Mais ce n'est pas impunément qu'un Etat bat fausse monnaie avec ses dignités. En pareille matière le monde moderne est resté bien en arrière de l'antiquité; il n'a adopté ni l'insolence de ses procédés, ni le cynisme de leurs formes; c'est tout naturel: l'autonomie de ces cités n'était pas suffisamment réprimée par la notion de l'Etat et s'exerçait sans obstacle sur ce terrain, et les autorités législatives étaient, le plus souvent, la bourgeoisie ou les assemblées des petites villes. Les conséquences de ces abus furent doublement funestes; les fonctions municipales furent données plutôt à qui pouvait les payer qu'à des citoyens compétents; les banquets et les distributions ruinaient presque toujours les donataires, sans enrichir ceux qui recevaient. Cette coutume pernicieuse a puissamment contribué à faire haïr le travail et à dissiper la fortune des grandes familles. L'administration des villes eut aussi beaucoup à souffrir de l'adulation croissante. Sans doute, les honneurs que la cité reconnaissante accordait à l'un de ses bienfaiteurs étaient le plus souvent décernés suivant ce principe raisonnable d'équité qui préside aujourd'hui à la distribution des mêmes récompenses; et quand ce n'était pas le cas, le bienfaiteur était souvent disposé, par exemple, à donner lui-même l'argent nécessaire pour élever sa statue. Mais il n'en était pas de même pour les distinctions honorifiques que la cité décernait aux riches étrangers, surtout aux gouverneurs, aux empereurs et aux membres de la famille impériale. A cette époque où l'on désirait les hommages même vides et officiels, la cour impériale et les sénateurs romains avaient pour eux un goût non pas aussi vif que les ambitieux de province, mais cependant bien prononcé; naturellement les honneurs et les hommages augmentaient au fur et à mesure qu'on avait intérêt à les accorder, et dans la même proportion que la faiblesse des personnages qui gouvernaient ou qui participaient au gouvernement. Dans ces conditions l'offre était toujours plus forte que la demande, cela se comprend; et ceux qui estimaient de pareils hommages à leur juste valeur étaient obligés, pour s'en exempter, de les refuser, ce qui paraît être assez souvent arrivé dans des cas isolés1, mais rarement plusieurs fois de suite, - le petit nombre des statues élevées à Tibère doit être compté peut-être parmi ses titres de gloire. - Les dépenses pour ces monuments, beaucoup plus considérables parfois qu'une simple statue, et pour les ambassades honorifiques2, ont été la plaie toujours croissante de l'administration provinciale. Mais aucune province n'a dépensé inutilement autant d'argent, en proportion de ses faibles ressources, que la Grèce, cette patrie des honneurs olympiques et municipaux, la plus remarquable de toutes à cette époque pour l'humilité des fonctionnaires et la déférence obséquieuse. 1. L'empereur Gaïus, par exemple, se plaint, dans une lettre qu'il adresse à l'assemblée d'Achaïe, du grand nombre des statues qui lui sont dédiées, et déclare se contenter des quatre qui lui ont été élevées à Olympie, à Némée, à Delphes et à l'isthme (Keil, Inscr. boeot., 31). Cette même assemblée décide d'élever, dans chacune de ses villes, une statue à l'empereur Hadrien, le piedestal de la statue d'Abea, en Messénie, a été conservé (Corp. insc. graec., 1387). L'autorisation impériale était toujours nécessaire en pareil cas. 2. Lorsque Pline révisa les comptes municipaux de Byzance, il trouva que 12000 sesterces étaient consacrés annuellement à l'envoi d'une ambassade spéciale qui portait à l'empereur les souhaits de nouvelle année, et 3000 sesterces à une députation qui se rendait auprès du gouverneur de Mésie pour le même motif. Pline ordonne aux magistrats de transmettre désormais leurs souhaits seulement par lettres, ce que Trajan approuve (Ep. ad Traj., 43, 44). |
||||
27 av. J.C.-476 |
Commerce et industrieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl est à peine besoin d'exposer en détail que la situation économique de la Grèce n'était pas bonne. Le pays en général est d'une fertilité médiocre; les plaines arables n'y sont pas très étendues; sur le continent la culture de la vigne n'est pas importante; celle de l'olivier l'est davantage. Les célèbres carrières de marbre, du marbre blanc si brillant de l'Attique et du marbre vert de Karystos, appartenaient comme presque toutes les autres au domaine impérial; elles étaient exploitées par les esclaves de l'empereur, ce qui ne rapportait guère aux indigènes. La plus industrielle des contrées grecques était l'Achaïe, où survivait l'ancienne fabrication des étoffes de laine; dans la ville la plus peuplée de ce pays, à Patrae, de nombreuses manufactures transformaient en vêtements et en bonnets le lin de l'Elide renommé pour sa finesse. L'art et l'industrie artistique restent encore le monopole des Grecs; parmi les blocs nombreux de marbre pentélique que l'empire employa, la plupart ont dû être travaillés dans le pays même. Mais autrefois les Grecs fournissaient surtout à l'étranger, tandis que l'on parle peu à cette époque de l'exportation jadis si considérable des oeuvres d'art grecques. C'est à Corinthe que le commerce était le plus actif, dans cette ville des deux mers, commune à tous les Hellènes, métropole fourmillant sans cesse d'étrangers, comme l'appelle un orateur. Dans les deux colonies romaines de Corinthe et de Patrae, dans la cité d'Athènes, toujours remplie de voyageurs et d'érudits, s'étaient concentrées les plus grandes maisons de banque de la province, qui le plus souvent, sous l'empire comme sous la république, étaient entre les mains d'Italiens établis dans le pays. Dans les villes de second ordre, comme Argos, Elis, Mantinée du Péloponnèse, les négociants romains formaient des corporations spéciales au sein même de la cité. En général, les affaires s'étaient arrêtées dans l'Achaïe, surtout depuis que Rhodes et Délos n'étaient plus les étapes commerciales entre l'Asie et l'Europe et que le commerce se dirigeait vers l'Italie. La piraterie était réprimée et les routes de terre suffisamment sûres1; mais l'antique prospérité n'était pas revenue. J'ai déjà parlé de la déchéance du Pirée; c'était un événement, lorsqu'un des grands vaisseaux égyptiens chargés de blé s'égarait par hasard dans ces parages. Nauplie, le port d'Argos, la ville la plus peuplée de la côte péloponnésienne après Patrae, était de même déserte2. 1. Nous ne savons pas qu'en Grèce les routes de terre soient devenues particulièrement dangereuses : le soulèvement de l'Achaïe sous Antonin (Vita, 5, 4) est tout à fait obscur. Le chef de voleurs en général et non pas le chef de voleurs grec - joue un rôle prépondérant dans la basse littérature de l'époque; mais c'est là un procédé commun aux mauvais romanciers de tous les temps. Le désert d'Eubée peint par le délicat Dion n'est pas un nid de voleurs: ce sont les ruines d'une grande propriété, dont le possesseur a été condamné par l'empereur parce qu'il était trop riche, et qui depuis lors a été abandonnée. D'ailleurs, et cela est évident sans qu'on ait besoin de le prouver au moins au public non érudit, cette histoire est aussi vraie que la plupart de celles où l'auteur raconte au début qu'il les tient de ceux qui y ont joué un rôle : si la confiscation dont parle Dion était historique, le domaine serait revenu au fisc, et non à la ville voisine, que l'écrivain se garde bien d'ailleurs de nommer. 2. On peut citer ici la description naïve de l'Achaïe que nous a laissée un négociant égyptien du temps de Constance. En Achaïe, Grèce et Laconie, on est savant; mais le pays est dépourvu de toute autre qualité : c'est une province petite et montagneuse, qui ne saurait produire beaucoup de blé, qui donne seulement un peu d'huile et du miel attique; on peut l'estimer pour ses écoles et sa science, mais elle est stérile tous les autres égards. Les seules villes sont Corinthe et Athènes. Corinthe a un fort commerce et un beau monument, l'Amphithéâtre. Athènes a son passé (historias antiquas) et un remarquable édifice, l'Acropole, rempli de statues qui rappellent merveilleusement les exploits guerriers des ancêtres (ubi multis statuis mirabile est videre dicendum antiquorum bellum). En Laconie on ne peut citer que le marbre de Krokeae, que l'on appelle "marbre de Lacédémone." La barbarie de l'expression est imputable, non pas à l'écrivain lui-même, mais à un traducteur très postérieur. |
||||
27 av. J.C.-476 |
RoutesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl s'ensuit que l'empire ne s'est presque pas occupé des routes de cette province: on n'a retrouvé des milliaires romains que dans le voisinage immédiat de Patrae et d'Athènes; encore datent-ils des empereurs de la fin du troisième siècle et du quatrième. Il est manifeste que les gouvernements précédents avaient négligé de rétablir en Grèce les communications. Hadrien seul entreprit de transformer en une route carrossable, au moyen de digues puissantes jetées dans la mer, le chemin aussi important que court qui conduisait de Corinthe à Mégare, par la gorge difficile des roches scironiennes. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Percement de l'isthmeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteDepuis longtemps on projetait de percer l'isthme de Corinthe : le dictateur César en avait conçu le projet; l'oeuvre fut entreprise d'abord par l'empereur Gaïus, puis par Néron. Ce dernier donna même, pendant son séjour en Grèce, le premier coup de pioche au canal, et, plusieurs mois durant, fit travailler au percement six mille prisonniers juifs. De notre temps ces travaux ont été repris, et l'on a mis au jour les restes considérables d'anciennes constructions qui prouvent que l'oeuvre était assez avancée lorsqu'on l'abandonna, non pas à cause de la révolution qui éclata dans l'Ouest quelque temps après, mais parce que, là comme en Egypte, pour un travail identique, on avait mal calculé la différence de niveau des deux mers et qu'on redoutait, pour le moment où le canal serait achevé, la destruction d'Egine et d'autres malheurs plus grands encore. Sans doute ce canal, s'il avait été terminé, aurait raccourci le chemin entre l'Asie et l'Italie; mais la Grèce elle-même n'en aurait pas retiré beaucoup de profit. |
||||
27 av. J.C.-476 |
L'EpireRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNous avons déjà fait remarquer que les pays situés au Nord de la Hellade, la Thessalie, la Macédoine et l'Epire, étaient à l'époque impériale, au moins depuis Trajan, séparées de la Grèce au point de vue administratif. La petite province d'Epire, administrée par un gouverneur impérial de second ordre, ne s'était jamais relevée de la ruine qu'elle avait subie pendant la troisième guerre de Macédoine. Dans l'intérieur du pays, montagneux et pauvre, il n'y avait aucune ville importante, et la population était clair-semée. Le rivage n'était pas moins désolé. Auguste essaya de lui rendre la prospérité en fondant deux villes : il acheva la création projetée par César d'une colonie de citoyens romains à Buthrotum, en face de Corcyre, colonie qui ne fut jamais très florissante, et il fonda la ville grecque de Nicopolis, à l'endroit même où il avait établi son quartier général avant la bataille décisive d'Actium, au point le plus méridional de l'Epire, à une lieue et demie au Nord de Prevesa. |
||||
27 av. J.C.-476 |
NicopolisRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAuguste voulait en faire à la fois un monument durable de sa grande victoire navale et le centre d'une nouvelle vie hellénique. Cette fondation est, dans son genre, une nouveauté de la part des Romains. A la place d'Ambracie et d'Argos amphilochienne, à la place de Thyreion et d'Anactorion, à la place de Leucade, et de toutes les villes d'alentour que la lance de Mars furieux a renversées, César fonde la ville triomphale, la ville sainte, pour remercier le roi Phoebus Apollon de la victoire d'Actium. Ces paroles d'un poète grec contemporain expriment simplement ce qu'Auguste a fait dans le pays: il réunit en un seul territoire de cité toute la contrée environnante, l'Epire méridionale, l'Acarnanie située en face, avec l'île de Leucade et même une partie de l'Etolie; il transporta dans la nouvelle ville de Nicopolis tous les habitants des villages pauvres qui existaient dans la région, et en face de cette ville, sur la côte d'Acarnanie, il rebâtit magnifiquement et agrandit l'ancien temple d'Apollon à Actium. Jamais ville romaine n'avait été fondée de cette manière; c'est le synoekismos des successeurs d'Alexandre. Ainsi avaient été créées par le roi Cassandre les villes macédoniennes de Thessalonike et de Kassandreia, par Demetrius Poliorcete, la ville thessalienne de Demetrias, par Lysimaque la ville de Lysimacheia dans la Chersonèse de Thrace: ils avaient réuni un certain nombre de villages voisins, qu'ils avaient privés de leur indépendance. Pour répondre à ce caractère grec de sa fondation, Nicopolis devait, dans la pensée d'Auguste, devenir une grande ville grecque1. Elle conserva sa liberté et son autonomie comme Athènes et Sparte; elle obtint même, nous l'avons déjà montré, la cinquième partie des voix dans l'Amphictionie qui représentait la Grèce tout entière, et, comme Athènes, elle n'eut pas à échanger ces vois avec d'autres villes. Le nouveau sanctuaire d'Apollon à Actium fut organisé sur le modèle du sanctuaire d'Olympie, avec une fête quatriennale qui portait même le nom d'Olympique accolé au sien; il obtint même rang et mêmes privilèges; il eut ses Actiades comme l'autre avait ses Olympiades2. La ville de Nicopolis était avec ce temple dans les mêmes rapports que la ville d'Elis avec le temple d'Olympie3. Tout élément purement italique fut soigneusement écarté de l'organisation municipale comme de l'organisation religieuse, tant on voulait donner une physionomie romaine à cette ville triomphale si intimement liée à la fondation de l'empire. Celui qui examine dans leur ensemble les réformes accomplies par Auguste en Grèce, et surtout cette fondation remarquable qui en est comme la clef de voûte, se convainct facilement qu'Auguste a cru possible et a voulu tenter de réorganiser la Grèce sous la protection de l'empire romain. L'emplacement de Nicopolis était au moins bien choisi, puisque, avant la fondation de Patrae, il n'y avait aucune ville importante sur toute la côte occidentale de la Grèce. Mais Auguste n'a pas atteint le but qu'il s'était proposé au début de son principat; il a peut-être abandonné lui-même ses projets, plus tard, le jour où il donna à Patrae la constitution d'une colonie romaine. Nicopolis resta, comme le prouvent ses ruines considérables et de nombreuses monnaies, relativement peuplée et florissante4, mais ses habitants ne paraissent s'être distingués ni dans le commerce et l'industrie ni autrement. L'Epire septentrionale, comme l'Illyricum limitrophe de la Macédoine, était en grande partie habitée par des peuplades albanaises, et ne dépendait pas de Nicopolis: elle est restée sous l'empire dans son ancienne situation, et elle la conserve relativement encore aujourd'hui. L'Epire et l'Illyricum�, dit Strabon, sont presque partout déserts; là où l'on rencontre des hommes, ils habitent dans des villages et sur les ruines des villes d'autrefois; l'oracle de Dodone lui-même - détruit par les Thraces pendant la guerre de Mithridate, - a disparu comme tout le reste5. 1. Tacite (Ann., V, 10) appelle Nicopolis une colonia Romana; l'expression est mauvaise, mais l'idée n'est pas complètement fausse. Pline, au contraire, se trompe absolument lorqu'il dit (Hist. Nat., IV, 1, 5): Colonia Augusti Actium cum... civitate libera Nicopolitana; la ville d'Actium n'a pas plus existé que la ville d'Olympie. 2. Les quatre grandes fêtes nationales de la Grèce forment ce qu'on appellen Teploos; le vainqueur couronné dans toutes les quatre porte le titre de Teplooovinns. De même, dans une inscription (Corp. insc. graec., 4472), on trouve tais Teplowou, à côté de la mention des jeux de Nicopolis, mais l'autre periodos y est désignée comme l'ancienne (xoxala). Les concours des jeux s'appellent souvent solut!x; on rencontre pareillement l'expression ayisy koiztio; (Corp. insc. graec., 4472) ou certamen ad exemplar Actiacae regionis (Tac., Ann., XV, 23). 3. Un Nicopolitain se donne le titre de Bouans (Delphes, Rhein. Mus., nouvelle série, II, p. 111), comme Elis porte le nom de Bouan (Arch. Zeit., 1876, p. 57; cf. ibid., 1877, p. 40, 41 et alias). En outre les Spartiates, qui seuls de tous les Grecs avaient combattu à Actium dans l'armée d'Auguste, obtinrent la direction (Stuche!) des jeux d'Actium (Strabon, VII, 7, 6, p. 325); nous ne savons pas quelle était leur situation vis-à-vis de la de Nicopolis. 4. Puisque la décadence de Nicopolis est signalée à l'époque de Constance (Paneg.., XI, 9), c'est qu'auparavant cette ville était prospère. 5. Les fouilles de Dodone ont confirmé ce renseignement; toutes les trouvailles, excepté quelques monnaies, sont d'une époque antérieure à la domination romaine. On a distingué les traces d'une restauration, mais on ne peut en fixer la date; peut-être est-elle tout à fait tardive. Si Hadrien, qui est appelé Zeu; Aw wyalos (Corp. insc. graec., 1822), a visité Dodone (Durr, Reisen Hadrians, p. 56), c'est en archéologue. L'empereur Julien (Theodoretus, Hist. eccles., III, 21) nous parle d'une consultation de l'oracle sous l'empire; mais ce renseignement n'est guère digne de foi. |
||||
27 av. J.C.-476 |
La ThessalieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa Thessalie, région tout aussi hellénique par elle-même que l'Etolie et l'Acarnanie, fut, à l'époque impériale, séparée administrativement de la province d'Achaïe et soumise au gouverneur de la Macédoine. Ce qui est vrai de la Grèce septentrionale l'est aussi de la Thessalie. La liberté et l'autonomie que César avait accordées aux Thessaliens en général, ou plutôt qu'il leur avait laissées, semblent leur avoir été enlevées par Auguste, parce qu'ils en avaient mal usé; seule la ville de Pharsale conserva son ancienne constitution. Des colons romains n'ont jamais été établis dans le pays. Les Thessaliens gardèrent leur assemblée provinciale à Larissa, et leur administration municipale indépendante, comme les Grecs sujets de l'Achaïe. La Thessalie est de beaucoup la région la plus fertile de toute la péninsule; au quatrième siècle elle exportait encore du blé; Dion de Pruse n'en raconte pas moins que le Pénée traversait un pays désert, et au temps de l'empire, on n'a frappé dans cette province que très peu de monnaies. Hadrien et Dioclétien se sont occupés de réparer les routes de terre, mais ce furent les seuls de tous les empereurs romains, autant que nous pouvons le savoir. |
||||
27 av. J.C.-476 |
La MacédoineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe district administratif de l'empire romain, appelé Macédoine, était beaucoup moins vaste que la Macédoine de l'époque républicaine. Sans doute il s'étend encore de l'une à l'autre mer; il comprend la côte de la mer Egée, depuis la Thessalie, pays rattaché à la Macédoine, jusqu'à l'embouchure du Nestos (Nesta), et la côte de l'Adriatique depuis l'Aoos jusqu'au Drilon (Drin)1 - ce dernier territoire, qui n'est pas à proprement parler macédonien, mais illyrien, dépendait déjà, sous la République, du gouverneur de Macédoine, et fit encore partie de la province à l'époque impériale, mais les pays grecs situés au Sud de l'Oeta en furent séparés, comme nous l'avons déjà dit. La frontière orientale dans la direction de la Mésie, et la frontière septentrionale dans la direction de la Thrace restèrent les mêmes : la province s'étend aussi loin sous l'empire que la Macédoine proprement dite sous la République, c'est-à-dire, au Nord jusqu'à la vallée de l'Erigon, à l'Est jusqu'au fleuve Nestos; pourtant, au temps de la République, les Dardanes, les Thraces, toutes les peuplades au Nord et au Nord-Est, voisines du territoire macédonien, avaient affaire au gouverneur de cette province pour régler leurs relations, en paix comme en guerre, et l'on a pu dire que le territoire de Macédoine s'étendait jusqu'où s'avançaient les armes romaines; sous l'empire, au contraire, le gouverneur de la Macédoine n'administrait que le district qui lui était assigné, et qui ne confinait plus nulle part à des peuples à demi ou complètement indépendants. Comme la défense de la frontière fut confiée d'abord au royaume de Thrace sujet des Romains, puis au gouverneur de la nouvelle province de Mésie, celui de la Macédoine fut dès le début relevé de son commandement militaire. Bien peu de combats furent livrés dans cette province à l'époque impériale; seule la tribu barbare des Dardanes, établie sur l'Axios supérieur (Vardar), pilla quelquefois encore cette région paisible. On ne parle pas non plus de soulèvements locaux dans le pays. Cette contrée septentrionale de la Grèce diffère des parties plus méridionales autant par l'ethnographie que par le degré de civilisation. Tandis que sur le cours inférieur de l'Haliakmon (Vistritza) et de l'Axios (Vardar) jusqu'au Strymon, les Macédoniens proprement dits étaient un peuple d'origine hellénique, distinct, il est vrai, des Grecs du Sud, mais sans que cette différence ait la moindre importance à l'époque qui nous occupe; tandis que la colonisation hellénique avait conquis les deux côtes, la côte occidentale avec Apollonie et Dyrrachium, la côte orientale avec les villes fondées dans la péninsule chalcidique, l'intérieur du pays était occupé par une foule mélangée de peuplades non grecques, qui devaient différer de la population actuelle du même pays par ses éléments bien plus que par sa situation. Lorsque les généraux de la République romaine eurent refoulé des Celtes qui avaient pénétré jusque-là, les Scordisques, l'intérieur de la Macédoine se couvrit de tribus surtout illyriennes à l'Ouest et au Nord, thraces à l'Est. Nous avons déjà parlé de ces deux peuples; s'il en est de nouveau question ici, c'est qu'il nous faut montrer que l'organisation grecque, au moins l'organisation municipale, n'a pénétré que fort peu chez ces peuplades, à l'époque impériale aussi bien qu'antérieurement2. L'intérieur de la Macédoine n'a jamais vu se produire une poussée énergique de villes. Les régions isolées n'étaient guère peuplées, au moins en fait, que par des villages. La constitution grecque ne s'est pas établie d'elle-même dans ce royaume comme dans la Hellade proprement dite; elle y a été introduite par les princes, qui étaient plus hellènes que leurs sujets. On ne sait guère quelle forme elle a eue dans le pays; cependant la prépondérance municipale des Politarques, qui se retrouve régulièrement à Thessalonique, à Edesse, à Létè et qu'on ne rencontre dans aucune autre ville, nous permet de conclure qu'il y avait une différence sensible et très vraisemblable d'ailleurs entre l'organisation municipale de la Macédoine et celle de la Hellade. Les villes grecques que les Romains trouvèrent en Macédoine conservèrent leur administration et leurs droits; la plus importante d'entre elles, Thessalonique, garda même sa liberté et son autonomie. Il y eut en Macédoine, comme en Achaïe et en Thessalie, une confédération et une assemblée (xorvov) des villes. Ce qui prouve que le souvenir du passé glorieux survivait, c'est qu'au milieu du IIe siècle après J.-C. l'assemblée de Macédoine et quelques cités macédoniennes frappèrent des monnaies où la tête et le nom de l'empereur régnant étaient remplacés par ceux d'Alexandre le Grand. Les colonies assez nombreuses de citoyens romains qu'Auguste a établies en Macédoine, Byllis non loin d'Apollonie, Dyrrachium près de la mer Adriatique, sur l'autre côté Dium, Pella, Kassandrea, sur le territoire thrace Philippes, sont toutes d'anciennes villes grecques, qui reçurent un certain nombre de nouveaux citoyens et une autre constitution municipale; on leur rendit la vie en les forçant de donner asile, au milieu d'une province civilisée et peu peuplée, à des vétérans italiens, qui ne trouvaient plus de place en Italie. On ne leur accorda même le droit de cité italique, que pour dorer aux vieux soldats retraités l'exil qu'on leur imposait. Jamais on ne songea à introduire en Macédoine la civilisation italique; ce qui le prouve, abstraction faite de tout autre argument, c'est que Thessalonique resta une ville grecque et la capitale du pays. Auprès d'elle prospéra Philippes, ville d'ouvriers fondée pour l'exploitation des mines d'or voisines, cité choyée par l'empereur parce qu'elle avait été le théâtre de la bataille qui fonda définitivement la monarchie, et parce que de nombreux vétérans, qui avaient pris part à cette bataille, s'y étaient ensuite établis. L'organisation municipale romaine, et non celle d'une colonie, fut donnée dès les premiers temps de l'empire à Stobi, que nous avons déjà nommée, la ville la plus septentrionale de la Macédoine du côté de la Mésie, au confluent de l'Erigon et de l'Axios, dans une situation commerciale et militaire très importante, et qui avait reçu peut-être une constitution grecque dès l'époque macédonienne. Au point de vue économique, aucune réforme officielle ne fut faite en Macédoine sous l'empire; du moins on ne voit se manifester nulle part la sollicitude des empereurs pour cette province, qui n'était pas soumise à leur autorité personnelle. La route militaire, déjà construite sous la République, qui traversait le pays depuis Dyrrachium jusqu'à Thessalonique, était une des artères commerciales les plus importantes de tout l'empire; c'est seulement au 11e siècle, d'après nos renseignements, que les empereurs, et surtout Sévère Antonin, ont commencé à s'en occuper. Les villes situées sur cette voie, Lychnidos sur le lac d'Ochrida et Herakleia Lynkestis (Bitolia) n'ont jamais eu beaucoup d'importance. Pourtant la Macédoine était plus favorisée que la Grèce au point de vue économique. Elle est beaucoup plus fertile; aujourd'hui la province de Thessalonique est relativement bien cultivée et bien peuplée. De même la Macédoine est comptée parmi les régions les plus prospères, dans une description de l'empire faite sous Constance, lorsque Constantinople était déjà fondée. Si les documents qui concernent le recrutement de l'armée romaine sont muets sur l'Achaïe et la Thessalie, il n'en est pas de même pour la Macédoine qui devait fournir, surtout pour la garde impériale, un nombre important de soldats, plus considérable que n'en donnaient la plupart des pays grecs. Il faut remarquer, en effet, que les Macédoniens avaient l'habitude de servir régulièrement à la guerre, qu'ils y étaient merveilleusement aptes, et que la vie des villes était relativement peu développée dans leur pays. Thessalonique, la métropole de la province, la plus peuplée et la plus industrielle des cités qu'il y eût alors à cette époque, fut la patrie de plusieurs écrivains; elle s'est fait aussi une place honorable dans l'histoire politique en résistant avec courage aux barbares lors de la terrible invasion des Goths. 1. Sous la république Skodra semble avoir fait partie de la Macédoine; sous l'empire cette ville et Lissus sont des cités de Dalmatie, et la frontière est déterminée sur la côte par l'embouchure du Drin. 2. Les fondations de villes dans cette région, en dehors de la Macédoine proprement dite, ont tout à fait le caractère de colonies: telles sont celle de Philippes en Thrace et surtout celle de Derriopos en Péonie (Tite-Live, XXXIX, 53); pour cette dernière ville l'existence de politarques, magistrats propres à la Macédoine, est attestée épigraphiquement par l'inscription de l'an 197 après J.-C.: ??? ???? pioro TON!Tapzov (Duchesne et Bayet, Mission au Mont Athos, p. 103). |
||||
27 av. J.C.-476 |
La ThraceRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteSi la Macédoine n'était qu'à moitié grecque, la Thrace ne l'était pas du tout. Nous avons déjà parlé de ce peuple thrace, important, mais disparu pour nous. L'hellénisme n'a pénétré dans son domaine que par l'extérieur. Il ne sera pas superflu de revenir d'abord un peu en arrière pour montrer que l'hellénisme est resté longtemps à la porte de la région la plus méridionale qu'occupait ce peuple, dont le nom a survécu dans la contrée, et qu'il s'est introduit bien peu dans l'intérieur du pays; nous verrons plus clairement par là quelle oeuvre Rome avait à accomplir et a accomplie en effet dans cette province. Philippe, le père d'Alexandre, soumit le premier la Thrace et fonda non seulement Kalybe dans le voisinage de Byzance, mais, au coeur même du pays, la ville qui porte encore aujourd'hui son nom. Alexandre, qui fut en cela le précurseur de la politique romaine, pénétra jusqu'au Danube, le dépassa et fit de ce fleuve la frontière septentrionale de son empire; les Thraces, dans son armée, jouèrent un rôle assez important lors de l'expédition d'Asie. Après sa mort, l'Hellespont parut être un des grands centres autour desquels se formèrent les nouveaux Etats : le vaste territoire qui s'étend de là jusqu'au Danube1 fut sur le point de devenir la moitié septentrionale d'un empire grec et la résidence de l'ancien gouverneur de Thrace, Lysimaque, la nouvelle ville de Lysimacheia, fondée sur la Chersonèse de Thrace, faillit avoir les mêmes destinées que les capitales des généraux de Syrie et d'Egypte. Mais il n'en fut pas ainsi; l'indépendance de cet empire ne dura pas plus longtemps que son premier chef (281 av. J.-C.=473 de Rome). Depuis ce moment jusqu'à l'époque où Rome établit sa domination en Orient, tantôt les Séleucides, tantôt les Ptolemées, tantôt les Attalides cherchèrent à mettre la main sur les possessions européennes de Lysimaque; mais ils échouèrent tous. Le royaume de Tylis, dans l'Hémus, que les Celtes avaient fondé en Mésie et en Thrace peu de temps après la mort d'Alexandre et presque au moment où ils s'établissaient d'une façon permanente en Asie Mineure, détruisit dans le pays tous les germes de la civilisation grecque et fut lui-même renversé, pendant la guerre d'Hannibal, par les Thraces, qui exterminèrent ces envahisseurs jusqu'au dernier. Désormais il n'y eut plus en Thrace de puissance prépondérante; les relations qui existaient entre les villes grecques de la côte et les chefs des diverses tribus, et qui sans doute étaient de même nature qu'avant Alexandre, nous sont décrites par Polybe, dans l'histoire qu'il a faite de la plus importante de ces villes. Les barbares thraces récoltaient ce que les Byzantins avaient semé; ni l'épée ni l'or ne pouvaient rien contre eux; si les Byzantins battaient l'un des chefs, trois autres envahissaient leur territoire; éloignaient-ils l'un d'eux à prix d'argent, cinq autres réclamaient aussitôt le même tribut. Les derniers souverains de la Macédoine s'efforcèrent de raffermir leur puissance en Thrace et surtout de soumettre à leur autorité les villes grecques de la côte méridionale; mais les Romains s'y opposèrent, soit pour arrêter le développement de la puissance macédonienne, soit pour ne pas laisser tomber entre les mains des Macédoniens l'importante route royale qui conduisait vers l'Orient, celle que suivirent Xerxés pour envahir la Grèce, et les Scipions pour marcher contre Antiochus. Après la bataille de Cynoscéphales, la frontière fut fixée à peu près comme elle est restée depuis lors. Les deux derniers rois de Macédoine cherchèrent souvent soit à s'établir réellement en Thrace, soit à s'attacher par des traités les divers princes de ce pays. Le dernier, Philippe, avait même reconquis Philippopolis; mais la garnison qu'il y avait installée en fut bientôt chassée par les Odryses. Ni lui ni son fils ne purent occuper longtemps la contrée; et lorsque, après la chute de la Macédoine, Rome eut déclaré les Thraces indépendants, ce qui restait encore de civilisation hellénique disparut. La Thrace elle-même fut transformée dès la République, mais surtout à l'époque impériale, en une principauté vassale des Romains; puis, en l'an 46 ap. J.-C., elle fut réduite en province romaine; mais l'hellénisation du pays ne dépassa guère la ligne des colonies grecques, fondées sur la côte à une époque très reculée et qui depuis lors avaient déchu plutôt que prospéré. Tandis que la colonisation macédonienne était puissante et durable en Orient, elle fut en Thrace faible et éphémère. Philippe et Alexandre2 semblent même n'avoir entrepris qu'à contre-coeur de fonder des établissements dans le pays et s'y être montrés peu favorables. Sous l'empire, la Thrace resta longtemps entre les mains des indigènes, et les villes grecques de la côte, isolées au milieu d'une région barbare, tombèrent presque toutes en décadence. Cette ceinture de cités helléniques échelonnées sur la côte depuis la frontière de la Macédoine jusqu'à la Chersonese Taurique, était d'une largeur très inégale. Au Sud elle se continuait depuis Abdère jusqu'à Byzance sur les Dardanelles; mais aucune de ces villes n'a joué plus tard un rôle considérable, sauf Byzance, qui dut à la fertilité de son territoire, à ses riches pêcheries de thon, à sa situation commerciale particulièrement avantageuse, à son activité industrielle comme à la valeur croissante de ses habitants toujours exposés aux attaques du dehors, d'avoir traversé les temps difficiles de l'anarchie hellénique. Les colonies grecques s'étaient développées beaucoup moins brillamment sur la côte occidentale de la mer Noire; sur le rivage qui devait appartenir plus tard à la province romaine de Thrace, Mesembria seule avait quelque importance. Dans la future province de Mésie, il n'y avait qu'Odessos (Varna) et Tomis (Kustendje). Au-delà des bouches du Danube et de la frontière de l'empire romain, au Nord du Pont-Euxin, Tyra3 et Olbia se trouvaient en plein pays barbare; plus loin les deux antiques et grandes villes grecques de commerce, Herakleia ou Chersonesos et Pantikapaeon dans la Crimée moderne, formaient un solide noyau. Toutes ces colonies furent protégées par Rome, surtout depuis que les Romains eurent établi leur empire sur le continent gréco-asiatique; et la main puissante, qui souvent parut bien lourde à la Grèce proprement dite, les sauva tout au moins de catastrophes telles que la destruction de Lysimacheia. La sauvegarde des Grecs de cette région était sous la République un des devoirs soit du gouverneur de Macédoine, soit du gouverneur de Bithynie, quand ce pays fut devenu romain; Byzance fut dans la suite rattachée à la Bithynie4. Enfin à l'époque impériale, après l'organisation du gouvernement de Mésie et plus tard de celui de Thrace, ce fut aux nouveaux gouverneurs qu'il incomba de protéger ces villes. De tout temps les Romains furent les défenseurs et les amis de ces colons grecs, mais l'extension de l'hellénisme n'a préoccupé ni la république ni les premiers empereurs5. Lorsque la Thrace fut devenue romaine, on la divisa en cercles6, et jusqu'à la fin du premier siècle il n'y a presque aucune fondation de villes à signaler, sauf celle de deux colonies de Claude et de Vespasien, Apri dans l'intérieur de la contrée, non loin de Périnthe, et Deultus, sur la côte la plus septentrionale7. C'est Domitien, qui, le premier, introduisit dans l'intérieur l'organisation municipale de la Grèce en commençant par la capitale du pays, Philippopolis. Sous Trajan d'autres villages thraces obtinrent le même droit de cité : Topeiros non loin d'Abdère, Nikopolis sur le Nestos, Plotinopolis sur l'Hèbre, Pautalia près de Kostendil, Serdica, aujourd'hui Sofia, Augusta Trajana près d'Alt-Zagora, une seconde Nikopolis sur le versant septentrional de l'Hémus8, sans compter Trajanopolis, située sur la côte près de l'embouchure de l'Hèbre, et plus tard sous Hadrien Adrianopolis, aujourd'hui Andrinople. Ces villes n'étaient pas des colonies d'étrangers, mais des cités organisées d'après le système grec sur le modèle de Nikopolis d'Epire, qu'Auguste avait fondée: on voulait civiliser et helléniser la province du haut en bas. Dès lors une assemblée thrace se tint à Philippopolis comme dans les autres pays grecs proprement dits. Ce dernier rejeton de l'hellénisme n'est pas le plus faible. Le pays est riche et agréable une monnaie de la ville de Pautalia célèbre la fécondité de la Thrace en épis, en pampres, en or et en argent; c'est à Philippopolis et dans la belle vallée de la Tundja, que l'on cultive les roses et qu'on en fabrique des essences; et le peuple thrace n'avait rien perdu de sa force. La population était dense et prospère; j'ai déjà rappelé que la Thrace fournissait au recrutement des contingents considérables, et ce pays fut un de ceux où les villes frappèrent à cette époque le plus de monnaies. Lorsque Philippopolis fut prise en 251 par les Goths, elle devait avoir cent mille habitants. Les Byzantins prirent vivement parti pour Pescennius Niger, l'empereur de l'Orient grec, et après sa mort résistèrent, durant plusieurs années, à son vainqueur; tout cela prouve que ces villes thraces étaient riches et puissantes. Sans doute Byzance déchut et fut même pendant longtemps privée du droit de cité, mais, grâce à la prospérité de la Thrace, le temps allait bientôt venir où Byzance devait être la nouvelle Rome hellénique, et la capitale de l'empire transformé. (La Mésie inférieure) La province voisine de Mésie Inférieure s'est développée à peu près de la même façon, mais dans de moindres proportions. 1. Il ressort de Pausanias (I, 9, 6) que le Danube fut aussi la frontière de l'empire de Lysimaque. 2. D'après Strabon (VII, 6, 2, p. 320) Kalybe près de Byzance fut fondée, Gavtos. Philippopolis doit même, d'après le récit de Théopompe (fr. 122, ed. Muller), avoir été fondée comme Ilovnpotoals, et avoir reçu des colons en rapport avec cette situation. Si peu dignes de foi que paraissent ces renseignements, ils font bien comprendre dans leur ensemble que ces établissements avaient le même caractère que Botany-bay. 3. Pourtant la ligne septentrionale des fortifications de la Bessarabie, qui est peut-être romaine, atteint Tyra. 4. Il ressort de la correspondance de Pline et de Trajan que Byzance dépendait encore sous Trajan du gouverneur de Bithynie. Les Byzantins envoyaient leurs félicitations aux légats de Mésie; mais cela ne suffit pas à prouver qu'ils étaient rattachés à ce gouvernement trop éloigné de leur cité; les rapports qu'ils entretenaient avec le gouverneur de Mésie s'expliquent par les relations commerciales de Byzance avec les ports mésiens. En 53 Byzance était une ville soumise à l'administration du sénat, et ne faisait pas partie de la Thrace, selon Tacite (Ann., XII, 62;. Cicéron (in Pis., 35, 86; de prov. cons., '1, 6) ne nous dit pas qu'elle dépendît de la Macédoine sous la République, puisqu'elle était alors une ville libre. Cette liberté semble lui avoir été souvent donnée et souvent enlevée, comme cela se passait à Rhodes. Cicéron (loc. cit.) la déclare libre; en l'an 53, elle est tributaire; Pline (Hist. nat., IV, 11, 46) la cite comme une ville libre; Vespasien lui enleva sa liberté (Suetone, Vesp., 8). 5. Ce qui le confirme, c'est que l'on n'a trouvé, dans les villes thraces de l'intérieur, aucune monnaie pouvant, d'après le métal et le style, être attribuée à une époque reculée. Un certain nombre de princes thraces, surtout odryses, ont déjà de bonne heure frappé des monnaies; cela prouve seulement qu'ils étaient les maîtres des villes de la côte peuplées ou à moitié peuplées de Grecs. La même explication s'applique aux tetradrachmes, tout à fait isolés, des Thraces (Sallet, Num. Zeitschrift, III, p. 241). Les inscriptions découvertes dans l'intérieur de la Thrace sont en général de la période romaine. Le décret relatif à une ville sans nom, trouvé à Bessapara, aujourd'hui Tatar Bazardjik, à l'Ouest de Philippopolis, par Dumont (Inscr. de la Thrace, p. 7) date peut-être de la bonne époque macédonienne, mais on n'en peut juger que par le caractère de l'écriture, qui trompe quelquefois. 6. Les cinquante stratégies de la Thrace (Pline, Hist. nat, IV, 11, 40; Ptolemee, III, 11, 6) ne sont pas des circonscriptions militaires, mais, comme il ressort nettement surtout de Ptolemee, des divisions géographiques qui concordent avec les tribus et qui s'opposent aux cités. Le nom de otpatnyos, comme celui de praetor, perdit son sens originairement militaire. On saisit bien là une analogie fondamentale avec l'Egypte, qui était de même partagée en territoires de villes soumis à des magistrats municipaux et en cercles administrés par des stratèges. Il y a un otpatnyos de l'époque romaine (Eph. epigr., II, p. 252). 7. A Deultus, la colonia Flavia Pacis Deullensium, furent établis des vétérans de la VIII. légion (Corp. insc. lat., VI, 3828). Flaviopolis, sur la Chersonèse, l'ancienne Coela, n'est certainement pas une colonie (Pline, IV, 11, 47): c'est un établissement d'un genre particulier, situé sur le territoire domanial, où l'on envoyait les serviteurs de la maison impériale (Eph. epigr., V, p. 82). 8. Cette ville appelée ?? dans Ptolemée (III, 11, 7), et Nezoroas facos "Iotpoy sur les monnaies, aujourd'hui Nikup sur la Jantra, appartient géographiquement à la Basse-Mésie; elle fut rattachée administrativement à cette province depuis Sévère, comme le prouvent les noms de gouverneurs inscrits sur les monnaies. Mais ce n'est pas seulement Ptolémée qui la place en Thrace; l'emplacement des bornes-frontières d'Hadrien semble aussi le confirmer (Corp. insc. lat., III, 736, cf. p. 992). Cette ville grecque de l'intérieur ne faisait partie ni des communautés latines de la Basse-Mésie, ni du du Pont mésien; elle fut sans doute, lorsqu'on organisa ces provinces pour la première fois, comprise dans le des Thraces. Plus tard elle doit avoir été rattachée à l'une ou à l'autre des deux confédérations mésiennes citées plus haut. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Tomis et la confédération des villes de la rive gauche du Pont-EuxinRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes villes grecques de la côte, dont la métropole était, au moins à l'époque romaine, Tomis, furent réunies, problablement lorsqu'on organisa la province romaine de Mésie, en une confédération appelée : Confédération des cinq villes de la rive gauche de la mer Noire, ou, comme elle se nommait elle-même, Confédération des Grecs, c'est-à-dire des Grecs de la province. Plus tard une sixième ville, Markianopolis, fondée par Trajan, non loin de la côte, près de la frontière de Thrace et organisée comme les cités grecques du pays, fut rattachée à la Confédération1. Nous avons fait remarquer plus haut que les places militaires du Danube, et surtout les villes de l'intérieur ressuscitées par les Romains, avaient été organisées sur le modèle des cités italiques. La Mésie Inférieure est la seule province romaine dont les frontières aient été déterminées par la différence des langues: la confédération de Tomis parlait le grec, les villes du Danube comme Durostorum et Escus, le latin. D'ailleurs, tout ce que nous avons dit de la Thrace est, pour les points essentiels, également vrai de ces villes mésiennes. Nous avons une description de Tomis, telle qu'elle était dans les dernières années du règne d'Auguste, faite, il est vrai, par un exilé, mais certainement digne de foi. La population se compose en grande partie de Gètes et de Sarmates; ils portent, comme les Daces de la colonne Trajane, des peaux de bêtes et des culottes; leurs longs cheveux sont flottants et leur barbe n'est pas rasée; ils se montrent dans la rue à cheval et armés de leur arc, le carquois sur l'épaule et le couteau à la ceinture. Les quelques Grecs qui vivent au milieu d'eux ont adopté les coutumes, et même les culottes des Barbares; ils savent s'exprimer aussi bien et mieux en gétique qu'en grec; celui qui ne peut pas se faire comprendre dans la langue locale est un homme perdu; car personne ne sait un mot de latin. Aux portes de la ville sont campées des bandes pillardes, qui appartiennent à différentes peuplades, et dont les flèches volent souvent au-dessus des remparts qui protègent la cité; l'habitant qui ose aller cultiver son champ expose sa vie et laboure tout armé. Sous la dictature de César, lors de l'expédition de Burebista, la ville était tombée entre les mains des Barbares, et, quelques années avant que l'exilé dont nous parlons fût arrivé à Tomis, pendant l'insurrection dalmatico-pannonienne, la furie de la guerre avait sévi de nouveau dans cette région. Ces récits sont confirmés par les monnaies et des inscriptions de cette ville. En effet, la métropole de la Confération de la rive gauche du Pont n'a frappé aucune monnaie d'argent avant l'époque romaine, ce que faisaient plusieurs autres de ces villes; en outre, les monnaies et les inscriptions antérieures à Trajan ne se rencontrent qu'isolément. Mais au IIe et au IIIe siècle Tomis fut métamorphosée, et on peut l'appeler une fondation de Trajan avec autant de raison que Markianopolis, qui acquit si rapidement un développement considérable. Les retranchements de la Dobrudcha, dont nous avons parlé plus haut, servaient de rempart à la ville de Tomis. Derrière ces murs prospéraient le commerce et la navigation. Il y avait dans la cité une association de négociants alexandrins avec leur chapelle de Sérapis2. La libéralité et l'ambition municipales étaient aussi développées à Tomis que dans n'importe quelle ville grecque de moyenne importance. Là aussi on parlait encore deux langages: à côté du grec, qui seul trouvait place sur les monnaies, la langue latine fut souvent employée sur les monuments officiels, dans cette région où les deux langues d'empire se touchaient. 1. Se trouve sur une inscription d'Odessos (Corp. insc. lat., 2056), que l'on peut dater avec raison des premiers temps de l'empire; l'Hexapole du Pont est nommée dans deux inscriptions de Tomis qui sont probablement du second siècle après J.-C. (Marquardt, Staatsverw., I, 2e edit., p. 305; Hirschfeld, Arch. epigr. Mitth., VI, p. 22). En tout cas, l'Hexapole, et vraisemblablement aussi la Pentapole doivent avoir concordé avec les limites des provinces romaines, c.-à-d. avoir compris les villes grecques de la Mésie Inférieure. Ces villes se trouvent aussi sur les documents les plus certains, les monnaies de l'époque impériale. En faisant abstraction de Nikopolis (p. 73, note) il y avait en Basse-Mésie six villes où l'on frappait des monnaies : Istros, Tomis, Kallatis, Dionysopolis, Odessos et Markianopolis; comme cette dernière a été fondée par Trajan, le nom de Pentapole s'explique facilement. Tyra et Olbia n'ont pas fait partie de la confédération; du moins les monuments nombreux et très explicites d'Olbia ne mentionnent nulle part un lien quelconque qui la rattachât à ce groupe de cités. La Confédération porte le nom de ? dans une inscription de Tomis que je reproduis ici, parce qu'elle n'a été imprimée que dans la Pandora d'Athènes (1er juin 1868). 'Ayaln tuxn. Kata. 2. C'est ce que prouve la curieuse inscription signalée par Allard (La Bulgarie orientale, Paris, 1863): Osu peyarw Sape?. La colonie des armateurs de Tomis est souvent nommée dans les inscriptions de la ville. |
||||
27 av. J.C.-476 |
TyraRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAu-delà de la frontière impériale, entre les bouches du Danube et la Crimée, la côte avait été peu colonisée par les marchands de la Grèce. Il ne s'y trouvait que deux villes grecques importantes, fondées depuis longtemps par Milet, Tyra, à l'embouchure du fleuve du même nom, aujourd'hui le Dniester; et Olbia, sur le golfe où viennent se jeter le Borysthène (Dniéper) et l'Hypanis (Bug). Nous avons montré plus haut combien la situation de ces Hellènes, perdus au milieu des Barbares qui les pressaient de tous côtés, fut périlleuse, aussi bien à l'époque des Diadoques que sous la domination de la république romaine. Les empereurs leur portèrent secours. En l'an 56, pendant les premières années si exemplaires du principat de Néron, Tyra fut rattachée à la province de Mésie. |
||||
27 av. J.C.-476 |
OlbiaRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteOlbia, plus éloignée, nous a été décrite à l'époque de Trajan1; la ville saignait toujours de ses anciennes blessures; de misérables murs entouraient des maisons aussi misérables, et le quartier habité remplissait une partie minime de l'ancienne enceinte considérable, dont quelques tours isolées se dressaient encore au milieu de la campagne déserte. Dans les temples il n'y avait plus une seule statue de dieu qui ne portât les traces de la violence des barbares. Les habitants n'avaient pas oublié leur origine hellénique, mais ils vivaient et se conduisaient comme les Scythes, qu'ils étaient obligés de combattre sans cesse. Ils prenaient, aussi souvent que des noms grecs, des noms scythes, c'est-à-dire des noms usités dans les tribus sarmates parentes des Iraniens; dans la maison même du roi, Sauromates était un nom habituel. Ces villes durent leur existence beaucoup moins à leur force propre qu'à la bienveillance, ou plutôt à l'égoïsme des indigènes. Les peuplades qui habitaient cette côte n'étaient pas capables de faire elles-mêmes, dans leurs ports, du commerce extérieur et elles ne pouvaient s'en passer; elles achetaient dans les cités grecques du rivage du sel, des vêtements, du vin; aussi les princes un peu civilisés défendirent-ils dans une certaine mesure les étrangers contre les attaques des tribus plus sauvages. Les premiers empereurs romains doivent avoir hésité à prendre sous leur protection ces colonies lointaines; Antonin envoya pourtant à leur secours des troupes romaines, lorsqu'elles furent attaquées de nouveau par les Scythes; les barbares furent forcés de demander la paix et de donner des otages. Depuis le règne de Sévère, Olbia frappa des monnaies à l'effigie des empereurs romains : sous ce prince elle a dû être incorporée à l'empire. Il va de soi qu'on annexa seulement le territoire des villes grecques; jamais il ne fut question de soumettre à la domination romaine les barbares voisins de Tyra et d'Olbia. Nous avons déjà dit que ces villes furent attaquées les premières, probablement sous Alexandre (+ 235) par les Goths envahisseurs. 1. Dion (Borysth., p. 75 R) nous raconte que, cent cinquante ans environ avant l'époque où il écrivait, c'est-à-dire avant l'année 100 de l'ère chrétienne, probablement lors de l'expédition de Burebista, la ville d'Olbia, toujours en guerre et souvent détruite, subit un dernier et terrible assaut. Dion rencontre ensuite un jeune et noble citoyen, à la physionomie nettement ionienne, qui a battu ou pris un grand nombre de Sarmates, qui ne connaît certes pas Phocylide, mais qui sait Homère par coeur; il porte, comme les Scythes, un manteau, des culottes et un couteau à la ceinture. Tous les habitants de la ville gardent leur barbe et leurs cheveux longs; un seul les a fait couper, et on lui reproche de s'être montré par là servile envers les Romains. Ainsi, un siècle après Ovide, Olbia avait le même aspect que Tomis.
|
||||
27 av. J.C.-476 |
Le BosphoreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Grecs ne s'étaient établis qu'en petit nombre sur le continent situé au Nord du Pont; mais depuis longtemps la grande presqu'île qui s'avance au Sud de cette côte, la Chersonèse Taurique, aujourd'hui la Crimée, était presque tout entière occupée par eux. Séparés l'un de l'autre par la chaîne de montagnes qui traverse le pays des Tauriens, les deux centres de la colonisation grecque dans la péninsule étaient, à la pointe occidentale la cité dorienne libre d'Herakleia ou Chersonesos (Sébastopol), à l'extrémité orientale la principauté de Pantikapeon ou Bosporus (Kertch). Le roi Mithridate, à l'apogée de sa puissance, les avait réunies, et avait fondé un second empire du Nord qui fut, après la chute de sa domination, laissé, comme un dernier reste de l'héritage paternel, à son fils et meurtrier Pharnace. Lorsque celui-ci, pendant la guerre entre César et Pompée, chercha à reconquérir en Asie Mineure l'empire de son père, César le vainquit et le déclara déchu du royaume de Bosphore.
|
||||
27 av. J.C.-476 |
AsandrosRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteSur ces entrefaites, le gouverneur laissé par Pharnace dans cette région, Asandros, lui refusait l'obéissance, dans l'espoir d'arriver lui-même à la royauté, grâce au service qu'il rendait à César. Lorsque Pharnace battu revint dans son royaume de Bosphore, il reprit bien sa capitale, mais il finit par succomber et mourut vaillamment dans la dernière bataille, égal à son père au moins comme soldat. Sa succession fut disputée par Asandros, qui tenait de fait le pays, et par Mithridate de Pergame, un habile officier de César, qui avait reçu de son chef l'investiture de la principauté. Les deux rivaux firent tous leurs efforts pour se rattacher à l'ancienne dynastie des rois de la contrée et au grand Mithridate; Asandros épousa la fille de Pharnace, Dynamis, et Mithridate, issu d'une famille bourgeoise de Pergame, se présenta comme un bâtard du grand Mithridate Eupator, soit pour déterminer le choix des habitants, soit pour le justifier. Comme César lui-même dut s'occuper d'affaires plus importantes, ce furent les armes qui décidèrent entre le césarien légitime et le césarien illégitime. Ce dernier l'emporta : Mithridate périt dans la lutte et Asandros resta seul maître du royaume. Au début il évita, sans doute parce qu'il n'avait pas encore obtenu la confirmation de son suzerain, de prendre le nom de roi; il se contenta du titre d'Archonte qu'avaient porté les anciens princes de Pantikapaeon; mais bientôt il reçut, probablement de César même, la confirmation de son pouvoir et le titre de roi1. Après sa mort (737/8 de Rome=17/16 av. J-C.), il laissa la couronne à sa femme Dynamis. L'influence du principe de succession et du nom de Mithridate était encore si considérable, qu'un certain Scribonianus, qui tenta de prendre la place d'Asandros, et, après lui, le roi Polémon de Pont, auquel Auguste avait donné le royaume de Bosphore, épousèrent Dynamis en même temps qu'ils prenaient le pouvoir; en outre Scribonianus se faisait passer pour un petit-fils de Mithridate, tandis que le roi Polémon, après la mort de Dynamis, se mariait avec une petite-fille d'Antoine et se rattachait ainsi à la maison impériale. Après sa mort prématurée il mourut dans un combat contre les Aspurgiens, sur la côte d'Asie - ses fils mineurs ne lui succédèrent pas, et son petit-fils, appelé aussi Polémon, auquel l'empereur Gaius rendit en l'an 38, malgré son jeune âge, les deux royaumes de son aïeul, ne conserva pas longtemps la couronne de Bosphore. 1. Asandros compta sans doute les années de son archontat à partir du moment où il trahit Pharnace, c'est-à-dire depuis l'été de l'an 707 = 47; or il porte déjà le titre de roi dans la quatrième année de son gouvernement; on doit admettre que cette année est celle qui commença vers l'automne de 709/710-45/44; la confirmation fut donc accordée par César. Antoine ne peut pas l'avoir donnée puisqu'il ne vint en Asie qu'à la fin de l'année 712 42; quant à Auguste, il n'y faut pas songer. Le Pseudo-Lucien (Macrob., 15), qui le nomme en cette occasion, confond le père et le fils. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Les EupatoridesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'empereur Claude mit à sa place un descendant réel ou prétendu de Mithridate Eupator, et il semble que cette dynastie soit depuis lors restée sur le trône1. 1. Mithridate, que Claude fit roi du Bosphore en l'année 41, prétendait descendre d'Eupator (Dion, X, 8; Tacite, Ann., XII, 18); son frère Kotys lui succéda (Tacite, loc. cit.). Leur père s'appelait Aspurgos (Corp. insc. graec., II, p. 95), sans être pour cela un Aspurgien (Strabon, XI, 2, 19, p. 415). Nous ne savons pas s'il y eut plus tard un changement de dynastie: le roi Eupator, contemporain d'Antonin, appartient toujours à la même famille (Lucien, Alex., 57; Vita Pii, 9). D'ailleurs ces rois postérieurs du Bosphore, comme les successeurs immédiats de Polémon, dont les noms ne nous sont même pas connus, étaient probablement apparentés aux Polémonides; Polémon de son côté avait épousé une petite-fille d'Eupator. Les noms de rois thraces, comme Kotys et Rhask uporis, qui sont fréquents dans la dynastie de Bosphore, ont été introduits par le beau-fils de Polémon, le roi thrace Kotys. Le nom de Sauromatès, qui apparait souvent depuis la fin du premier siècle, provient sans doute d'alliances matrimoniales contractées avec les dynasties sarmates, mais ne prouve nullement que les princes ainsi nommés fussent eux-mêmes sarmates. Zosime (I, 31) reproche aux rois impuissants et sans dignité qui occupèrent le trône après l'extinction de l'ancienne famille royale, d'avoir laissé les Goths, à l'époque de Valérien, faire leurs pirateries sur les vaisseaux du Bosphore; ce reproche est assez fondé et s'adresse surtout à Phareansès, dont les monnaies sont datées des années 254 et 255. Mais ces monnaies mêmes portent l'effigie de l'empereur romain, et plus tard nous trouvons encore les anciens noms de famille (tous les rois du Bosphore sont des Tiberii Julii) et les anciens surnoms comme Sauromatès et Rhaskuporis. Au total, les vieilles traditions et Etendue du royaume de Bosphore. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Etendue du royaume de BosphoreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteTandis que, dans l'empire romain, les principautés clientes disparaissent partout ailleurs, à la fin de la première dynastie, et que depuis Trajan le principe du gouvernement direct est appliqué dans toute l'étendue des pays romains, on rencontre, jusqu'au IVe siècle, le royaume de Bosphore, sous la suzeraineté de Rome. Ce fut seulement lorsque Constantinople devint le centre de gravité du monde romain, que ce pays fut incorporé à l'empire1, pour être bientôt abandonné par lui et pour devenir au moins en grande partie la proie des Huns2. En réalité le Bosphore fut et resta plutôt une cité qu'un royaume; il ressemble plus aux territoires de Tyra et d'Olbia qu'aux royaumes de Cappadoce et de Numidie. Les Romains n'ont protégé dans ce pays que la ville hellénique de Pantikapaeon; ils ne se sont pas plus occupés là qu'à Tyra et à Olbia d'étendre les frontières et de soumettre l'intérieur du pays. Le domaine du prince de Pantikapaeon comprenait, il est vrai, les colonies grecques de Theudosia dans la péninsule même, et de Phanagoria (Taman) sur la côte asiatique opposée; mais Chersonesos ne lui était pas soumise3, ou ne dépendait de lui que comme Athènes relevait du gouverneur de l'Achaïe. Cette ville avait été déclarée autonome par les Romains; elle considérait le prince comme son protecteur le plus voisin, mais non comme son maître; sous l'empire même, en tant que cité libre, elle n'a jamais frappé de monnaies à l'effigie d'un roi ou d'un empereur. Sur le continent, la ville appelée Tanaïs par les Grecs, marché très actif situé à l'embouchure du Don, mais qui n'était pas d'origine grecque, dépendait pas non plus du prince vassal de Rome4. Parmi les tribus plus ou moins barbares répandues dans la péninsule elle-même ou sur les côtes d'Europe et d'Asie au Sud de Tanaïs, les plus voisines seules étaient réellement soumises5. 1. La dernière monnaie du Bosphore est datée de l'an 631 (ère des Achéménides), 335 ap. J.-C.; or la même année le neveu de Constantin I, Hanniballianus, était couronné roi; il y a certainement un rapport entre ces deux faits, quoique le royaume d'Hanniballianus comprît surtout l'Asie Mineure orientale, et eût pour capitale Césarée de Cappadoce. Lorsque, après la mort de Constantin, ce roi et son royaume disparurent dans une sanglante catastrophe, le Bosphore passa sous l'autorité directe de Constantinople. 2. Le Bosphore appartenait encore aux Romains en l'an 366 (Ammien, XXVI, 10, 6); peu de temps après les Grecs de la côte septentrionale de la mer Noire durent être abandonnés à eux-mêmes jusqu'au moment où Justinien reprit la péninsule (Procope, Bell. Goth., IV, 5). Dans l'intervalle Pantikapaeon avait été détruite par les Huns. 3. Les monnaies de la ville de Chersonesos portent à l'époque impériale la légende : Xepsov sou hudecas, une fois même Baoldeuotons; mais jamais on ne voit le nom ni l'effigie d'un roi ou d'un empereur (1. von Sallet, Zeitschrift fur Numismatik, I, p. 27; IV, p. 273). Ce qui prouve encore l'indépendance de cette ville, c'est qu'elle frappait des monnaies d'or comme les rois de Bosphore. L'ère de la cité semble fixée avec raison à l'année 36 avant J.-C. (Corp. insc. graec., 8621), époque où la liberté lui fut accordée, probablement par Antoine; la monnaie d'or de la ville régnante datée de l'an 109 fut donc frappée en l'an 73 après J.-C. 4. D'après Strabon (XI, 2, 11, p. 495) les chefs de Tanaïs sont distincts et indépendants des princes de Pantikapaeon; les tribus qui habitent au Sud du Don sont sujettes tantôt des uns, tantôt des autres. L'auteur ajoute que plusieurs princes de Pantikapaeon, notamment les derniers, Pharnace, Asandros, Polémon, ont étendu leur puissance jusqu'au Tanaïs; mais cela paraît être l'exception plutôt que la règle. Dans l'inscription citée agrave; la note suivante, les Tanaïtes sont comptés parmi les tribus sujettes; ce fait est confirmé par une série d'inscriptions de Tanaïs pour la période qui s'étend de Marc-Aurèle à Gordien; mais les à côté souvent nommés, prouvent qu'à cette époque la ville n'était pas encore hellénisée. 5. Dans le seul récit vivant que nous ayons sur l'histoire du Bosphore, Tacite (Ann., XII, 15-21), en nous décrivant la rivalité des deux frères Mithridate et Kotys, nous apprend que les tribus voisines, Dandarides, Siraci, Aorsi, ont des chefs particuliers qui ne dépendent pas régulièrement des princes romains de Pantikapaeon. - Dans leurs titres les anciens princes de Pantikapaeon ont l'habitude de se nommer Archontes du Bosphore, c'est-à-dire de Pantikapaeon et Theudosia, rois des Sindes, de tous les Maïtes et d'autres peuplades non grecques. De même, parmi les inscriptions royales de l'époque romaine, la plus ancienne. On ne peut tirer de la simplification du titre aucune conclusion formelle sur l'étendue du territoire. Dans les inscriptions de l'époque postérieure, on trouve une fois, sous Trajan, le titre, qui n'est qu'une flatterie, de Ecolheds (Corp. insc. graec., 2123). Depuis Asandros on ne trouve guère plus sur les monnaies d'autre titre que Baothsus, tandis que Pharnace s'appelait. Ce changement fut introduit sans doute sous l'influence de la suzeraineté romaine qui ne pouvait admettre qu'un prince vassal commandât à d'autres princes. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Organisation militaire du BosphoreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe territoire de Pantikapaeon était trop vaste et surtout trop important sous le rapport des relations commerciales, pour être soumis, comme Olbia et Tyra, à l'autorité de fonctionnaires changeants et d'un gouverneur trop éloigné; aussi fut-il confié à des princes héréditaires. D'ailleurs on comprit qu'il n'était guère avantageux de transporter directement à l'empire les relations que ce royaume entretenait avec les tribus voisines. Malgré leur origine et leur ère achéménides, les princes de la dynastie du Bosphore se considéraient comme des princes grecs; selon l'habitude hellénique, ils rattachaient leur famille à Héraclés et aux Eumolpides. Ces Grecs du royaume de Pantikapaeon et de la république de Chersonesos acceptaient la domination romaine comme un fait tout naturel; ils n'ont jamais songé à se révolter contre l'empire qui les protégeait; une seule fois, sous Claude, les troupes romaines durent marcher contre un prince du Bosphore insoumis1. Mais, même dans le bouleversement terrible du milieu du III siècle, ce pays, quoique durement éprouvé, ne fit jamais défection à l'empire qui se disloquait2; c'est que les villes de commerce assez prospères, qui, entourées par le flot des peuplades barbares, avaient certainement besoin d'une protection militaire, étaient attachées à Rome comme les avant-postes au corps d'armée principal. Leur garnison était recrutée surtout dans le pays lui-même, et le premier devoir du roi de Bosphore était certainement de lever et de commander ces troupes. Les monnaies frappées pour célébrer l'investiture d'un de ces princes portent bien le siège curule et les autres présents honorifiques accordés en pareille occasion, mais à côté l'on voit aussi un bouclier, un casque, une hache de combat et un cheval de bataille; ce n'était donc pas d'une dignité purement civile que ce prince était revêtu. Le premier souverain qu'Auguste établit sur le trône du Bosphore lutta continuellement contre les barbares, et ses successeurs, par exemple le roi Sauromatès, fils de Rhoemetalkes, combattit, au début du règne de Sévère, les Siraci et les Scythes; ce n'est peut-être pas sans raison qu'il caractérise ses monnaies par la reproduction des travaux de Héraclès. Il ne fut pas moins actif sur mer; il eut à détruire la piraterie, qui n'avait jamais cessé dans le Pont-Euxin; c'est aussi à ce Sauromatès qu'on rapporte l'honneur d'avoir rétabli l'ordre chez les Tauriens et d'avoir fait la chasse aux pillards de la mer. Il y avait néanmoins dans la péninsule des troupes romaines, peut-être un détachement de la flotte du Pont et un autre de Mésie. Malgré le petit nombre de ces soldats, leur présence montrait aux barbares que le légionnaire romain se tenait derrière les Grecs du pays. L'empire les protégeait encore d'une autre façon: à la basse époque tout au moins, les princes du Bosphore recevaient régulièrement des sommes d'argent prélevées sur la caisse impériale; ils en avaient besoin; car, dans cette contrée qui n'était pas directement soumise à l'empire, on prit, plus tôt que partout ailleurs, l'habitude de payer un tribut annuel pour repousser les invasions des barbares. 1. C'était le roi Mithridate établi par Claude en l'an 41, qui fut détrôné quelques années plus tard et remplacé par son frère Kotys; il vécut depuis lors à Rome, et mourut au milieu des troubles de l'année des quatre empereurs (Plutarque, Galba, 13, 15). Mais les circonstances de l'événement ne sont clairement exposées ni dans Tacite (Ann., XII, 25; cf. Pline, Hist. Nat., VI, 5, 17), ni dans le récit de Pierre le Patrice (fr. 3, où sont confondus les deux Mithridate du Bosphore et d'Ibérie). Nous ne tenons naturellement aucun compte des fables de la Chersonèse racontées plus tard par Constantin Porphyrogenète (De adm. imp., c. 53). Le mauvais roi du Bosphore Sauromates, qui combattit avec les Sarmates contre les empereurs Dioclétien et Constance et contre la ville de Cherson restée fidèle à l'empire, est certainement issu d'une confusion entre le nom des rois du Bosphore et celui d'une peuplade; la victoire du petit Chersonésien Pharnacos sur le puissant roi du Bosphore, Sauromates, n'est pas plus historique que les variations sur l'histoire de Goliath et de David. Il nous suffit de connaître les noms des rois; par exemple, outre les princes déjà cités, celui d'Asandros qui monta sur le trône après que la dynastie des Sauromatès eut disparu. Les privilèges et le caractère particulier des villes, que l'on a cherché à expliquer en inventant toutes ces belles histoires, méritent d'ailleurs notre attention. 2. Toutes les monnaies d'or vraies ou fausses du Bosphore portent l'effigie d'un empereur romain, et toujours du prince reconnu par le Sénat. En 263 et en 265, années où après la prise de Valérien, Gallien était reconnu officiellement comme seul maître de tout l'empire, les monnaies du Bosphore portent néanmoins deux effigies: c'était peut-être par ignorance ou parce que le Bosphore avait fait un autre choix parmi les nombreux prétendants à l'empire. A cette époque les noms ne sont plus placés à côté des images et les effigies sont assez difficiles à distinguer. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Situation des princes vassauxRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCes rois eux-mêmes se ressentirent de la centralisation du gouvernement impérial: en face du César romain, ils n'avaient guère plus de pouvoir que le bourgmestre d'Athènes. Plusieurs faits le prouvent. Il faut aussi remarquer que le roi Asandros et la reine Dynamis frappaient des monnaies d'or à leur nom et à leur effigie, tandis que le roi Polémon et ses successeurs immédiats, tout en conservant le droit de battre monnaie d'or, parce que depuis longtemps leurs sujets et les barbares voisins ne connaissaient pas d'autre monnaie d'or courante, durent inscrire sur leurs pièces le nom et l'image de l'empereur régnant. De même, après Polémon, le roi du pays fut grand-prêtre à vie de l'empereur et de la famille impériale. Pour le reste, l'administration et la cour restèrent ce qu'elles étaient depuis Mithridrate, qui les avait organisées sur le modèle de la royauté perse: mais le secretaire intime et le grand chambellan de la cour de Pantikapaeon ressemblaient aux principaux fonctionnaires de la cour du Grand-Roi, comme l'ennemi des Romains Mithridate Eupator ressemblait à son successeur Tiberius Julius Eupator, qui vint à Rome justifier devant l'empereur Antonin ses droits à la couronne du Bosphore. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Le commerce et les affaires dans le BosphoreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCette Grèce du Nord resta importante pour l'empire sous le rapport des relations commerciales. Quoiqu'elles ne fussent pas aussi étendues à cette époque que dans les périodes précédentes1, le négoce n'en continua pas moins d'être très actif. Au temps d'Auguste les tribus de la steppe apportaient à Tanaïs des pelleteries et des esclaves2, les marchands du monde civilisé des vêtements, du vin et d'autres articles de luxe; plus encore que Tanaïs, Phanagoria était l'entrepôt pour l'exportation des produits indigènes, Pantikapaeon celui des importations grecques. Les troubles qui agitèrent le Bosphore sous le règne de Claude portèrent un coup sensible au commerce de Byzance. Nous avons dit plus haut que les Goths commencèrent leurs pirateries au IIIe siècle en forçant les armateurs du Bosphore à leur venir en aide malgré eux. Grâce aux relations que les habitants du pays étaient obligés d'entretenir avec les barbares voisins, les Chersonésiens purent se maintenir après le départ des garnisons romaines, et plus tard, lorsque sous Justinien la puissance impériale se fit de nouveau sentir dans ces contrées, rentrer comme Grecs dans l'empire grec. 1. En ce qui concerne l'exportation des céréales, les renseignements donnés par Plautius (p. 198) sont dignes de foi. 2. Une localité du pays des Siraci (près de la mer d'Azov), assiégée par les troupes romaines, offrait de livrer dix mille esclaves (Tacite, Ann., XII, 17); on peut en conclure qu'il se faisait dans cette région une traite importante. |
||||