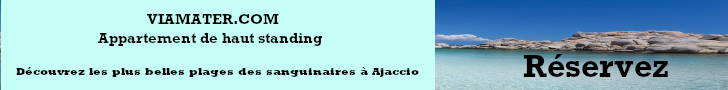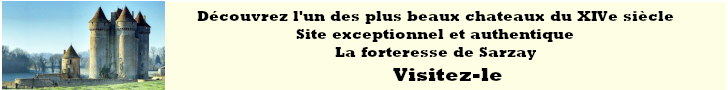|
|||||
Les provinces d'AfriqueSources historiques : Théodore Mommsen Vous êtes dans la catégorie : Empire Chapitre suivant : Tibère (18 septembre 14-16 mars 37) Chapitre précédent : L'Egypte Dans ce chapitre : 26 rubriques; 17 055 mots; 89 547 caractères (espaces non compris); 106 433 caractères (espaces compris) Format 100% digital de cette rubrique (via l'espace membre) | |||||
30 av. J.C.-476 |
L'Afrique septentrionale et les BerbèresRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'Afrique septentrionale et les berbères. Par ses caractères physiques et ethnographiques, l'Afrique septentrionale ressemble à une île. La nature l'a isolée de tous côtés, soit par l'Océan Atlantique et la mer Méditerranée, soit par l'immense plaine sablonneuse et stérile de la grande Syrte qui s'étend au-dessous du Fezzan actuel, et par le désert fermé à toute culture qui sépare au Sud le pays des steppes et les oasis du Sahara. Ethnographiquement, la population de ce vaste territoire forme un grand peuple, très nettement distincte des tribus du Sud, et profondément différente des Egyptiens eux-mêmes, avec lesquels elle a peut-être une commune origine. Ces peuples se donnent le nom d'Amazigh dans le Rif près de Tanger, et celui d'Imôchag dans le Sahara : la même dénomination se retrouve souvent appliquée chez les Grecs et les Romains, à des tribus isolées, aux Maxyes, à l'époque de la fondation de Carthage, et aux Mazices de l'époque romaine établis sur différents points de la côte septentrionale de Mauretanie; ces appellations identiques restées aux débris dispersés de ce peuple prouvent qu'il a été jadis homogène, et que, si cette homogénéité a disparu, il en a gardé un sentiment durable. Les nations qui sont entrées en contact avec lui ne se rendirent pas compte de cet état de choses, car les différences qui existent entre les diverses familles de ce peuple n'ont pas attendu jusqu'à nos jours pour apparaître, après une promiscuité de plusieurs milliers d'années avec les peuples voisins, surtout avec les tribus au Sud et les Arabes au Nord; déjà, avant ces influences étrangères, ces différences étaient importantes, l'étendue même des régions occupées par ce peuple les ayant rendues inévitables. On ne trouve, dans aucune autre langue que la sienne, une expression générale pour désigner ce peuple comme formant une nation : lorsqu'un nom est appliqué au peuple lui-même1, il ne la comprend pas tout entière. Celui de Libyens, dont se servaient les Egyptiens et après eux les Grecs, est propre, à l'origine, aux tribus les plus orientales, voisines de l'Egypte; il est toujours resté attaché de préférence aux habitants de la région orientale. Celui de Nomades, de provenance grecque, n'exprime tout d'abord que l'absence de vie sédentaire; plus tard, quand les Romains transformèrent le pays, ce nom fut donné, sous la forme de Numides, aux habitants du territoire que le roi Massinissa réunit sous sa domination. Celui de Maures, d'origine indigène, puis employé par les derniers Grecs et par les Romains, désigne exclusivement les habitants des régions occidentales : il fut porté à la fois par les royaumes qui s'y formèrent et par les provinces romaines qui leur succédèrent. Les peuples du Sud sont réunies sous le nom de Gétules, qui, pourtant, dans son sens le plus strict, n'est appliqué qu'aux peuples habitant le long de l'Océan atlantique, au Sud de la Maurétanie. Pour nous, d'habitude, nous désignons ce peuple par le nom de Berbères, sous lequel les Arabes désignent les tribus du Nord. Ces peuples se rapprochent beaucoup plus des peuples indo-germaniques que des peuples sémitiques, et forment encore aujourd'hui, après l'invasion musulmane qui a mis la lignée sémitique en possession de l'Afrique septentrionale, un contraste frappant avec les Arabes. Ce n'est pas sans raison que plusieurs géographes de l'antiquité n'ont pas voulu considérer l'Afrique comme une troisième partie de la terre, mais ont rattaché l'Egypte à l'Asie et le territoire berbère à l'Europe. La flore et la faune de l'Afrique septentrionale ressemblent par leurs caractères principaux à celles de la côte de l'Europe méridionale qui lui fait face : de même la lignée indigène, là où elle s'est conservée pure de tout mélange, semble regarder vers le Nord; elle a les cheveux blonds, les yeux bleus, en grande partie, la stature haute, la taille élancée, les muscles forts; la monogamie y existe toujours, la femme y est respectée; les hommes ont un tempérament vif et remuant, ils aiment la vie sédentaire; chaque communauté est basée sur l'égalité des droits de tous les hommes adultes, et sert habituellement de fondement, par la réunion de plusieurs communes en confédération, à une forme politique plus élevée. Cette lignée, opprimée par les tribus du Sud, les Phéniciens, les Egyptiens, les Romains, les Arabes, n'est jamais parvenue à un développement vraiment politique et à une civilisation complète; ce doit être sous le gouvernement de Massinissa qu'elle s'en est le plus approchée. L'alphabet, tiré du vocabulaire phénicien, dont les Berbères se servaient sous la domination romaine, et que les tribus du Sahara emploient encore aujourd'hui, le sentiment qu'ils ont eu jadis de l'unité nationale, et que nous avons déjà signalé, sont dus probablement à ce grand roi numide et à ses successeurs, que les générations postérieures honoraient comme des dieux2. Malgré toutes les invasions, ce peuple s'est maintenue très nombreux sur le territoire qu'il occupait jadis : dans le Maroc les deux tiers de la population, en Algérie la moitié sont d'origine berbère. (La colonisation phénicienne) L'immigration, qu'ont subie dès la plus haute antiquité toutes les côtes de la mer Méditerranée, a fait de l'Afrique septentrionale une terre phénicienne. Les Phéniciens ont enlevé aux peuplades indigènes la plus grande et la meilleure partie de la côte au Nord; ils ont soustrait toute cette région à la civilisation grecque. La grande Syrte forme une limite linguistique aussi bien que politique; à l'Est la Pentapole de Cyrène appartient au monde grec; à l'Ouest la Tripolitaine (Tripoli) de la Grande Leptis est devenue et est toujours restée phénicienne. Nous avons déjà raconté comment les Phéniciens, après une lutte qui dura plus d'un siècle, furent vaincus par les Romains. Nous avons maintenant à exposer quelles furent les destinées de l'Afrique, lorsque les Romains eurent conquis l'empire de Carthage et placé sous leur dépendance tous les pays environnants. 1. Le nom d'Afer n'appartient pas à cette série. Aussi loin que nous pouvons remonter dans l'histoire des langues, nous ne trouvons jamais ce nom appliqué aux Berbères pour les distinguer des autres peuples africains : il est donné à tous ceux qui habitent le continent situé en face de la Sicile, même aux Phéniciens; s'il a désigné quelquefois un peuple déterminé, ce ne peut être que les tribus avec lesquelles Rome est entrée d'abord en contact dans le pays (cf. Suetone, Vila Terent.). Beaucoup de raisons philologiques et historiques s'opposent à ce que l'on rattache ce mot au nom des Hébreux; l'on n'a pas encore trouvé d'étymologie satisfaisante. 2. Cyprien, Quod idola dii non sint, c. 2: Mauri manifeste reges suos colunt nec ullo velamento hoc nomen obtexunt; Tertullien, Apolog., 24: Mauretaniae (dei sunt) reguli sui; cf. Corp. insc. lat., VIII, 8831: Iemsali L. Percenius L. f. Stel. Rogatus V[s. I. a), inscription trouvée à Thubusuptu, dans les environs de Sitifis, village qui peut bien avoir fait partie de l'empire numide d'Hiem psal. L'inscription de Thubursicum; ibid., n. 7 (cf. Eph. epig., V, p. 651, n. 1478) a donc été à tort considérée comme fausse. En l'an 70, un prétendant au trône de Mauretanie donnait encore le nom de Juba (Tacite, Hist., II, 58). L'inscription trouvée à Thubusuptu, dans les environs de Sitifis, village qui peut bien avoir fait partie de l'empire numide d'Hiempsal. L'inscription de Thubursicum; ibid., n. 7 (cf. Eph. epig., V, p. 651, n. 1478) a donc été à tort considérée comme fausse. En l'an 70, un prétendant au trône de Mauretanie donnait encore le nom de Juba (Tacite, Hist., II, 58). |
||||

|
|||||
509-30 av. J.C. |
Le gouvernement de la République romaineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'absence de vues, l'étroitesse, on peut même dire l'absurdité et la brutalité du gouvernement romain dans les pays soumis, ne se sont fait sentir nulle part comme en Afrique. Dans le Sud de la Gaule et plus encore en Espagne, Rome cherche au moins à étendre son territoire par des conquêtes solides, et introduit, un peu malgré elle, la civilisation latine; dans l'Orient grec la domination étrangère est adoucie et souvent presque effacée par la puissance de l'hellénisme qui forçait la main à cette dure politique. Mais dans cette troisième partie du monde, la vieille haine nationale contre les Carthaginois paraît survivre encore au milieu des ruines de la patrie d'Hannibal : on occupe fortement le territoire que Carthage possédait lors de sa chute, mais moins pour en tirer parti que pour ne pas le laisser à d'autres; on ne cherche pas à y éveiller une vie nouvelle, on se contente de garder le cadavre. Ce n'est pas par amour de la domination ni des conquêtes, c'est par crainte et par jalousie que Rome a créé la province d'Afrique. Cette région n'a pas d'histoire sous la République. La guerre de Jugurtha n'est pas autre chose pour l'Afrique qu'une chasse au lion : elle n'a d'importance historique que par la part qu'elle prend aux luttes de partis qui marquent la fin de la République. La spéculation romaine, cela se comprend, épuisait le pays; mais la grande ville détruite ne pouvait pas se relever, et il était impossible qu'une ville voisine atteignit une aussi grande prospérité. Il n'y avait pas non plus dans la région de camps permanents comme en Espagne et en Gaule. La province enfermée dans d'étroites limites était entourée de tous côtés par le territoire relativement civilisé du roi vassal de Numidie, qui avait aidé à la destruction de Carthage, et qui maintenant recevait en récompense moins les dépouilles de son ennemie que le devoir de la protéger contre l'attaque des hordes sauvages de l'intérieur. Cette situation donna à la Numidie une importance politique et militaire que n'eut aucun autre état client des Romains; la politique romaine, uniquement attentive à conjurer l'ombre de Carthage, créait par là de ce côté un danger sérieux: ce qui le prouve, c'est la part que prit la Numidie aux guerres civiles de Rome; jamais, pendant les crises intérieures de l'empire, ni auparavant ni plus tard, un prince vassal n'a joué le rôle qu'a tenu le dernier roi de Numidie dans la lutte des républicains contre César. |
||||
100-44 J.C. |
Politique de César en AfriqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteQuand les armes eurent décidé entre les deux partis, la situation de l'Afrique fut nécessairement modifiée. Dans les autres provinces, ce fut le maître qui changea à la suite des guerres civiles; en Afrique, ce fut le système de gouvernement. L'occupation du pays par les Phéniciens n'avait pas amené une véritable domination; on peut en quelque sorte la comparer à l'occupation de l'Asie Mineure par les Hellènes avant Alexandre. Les Romains ne gardèrent ensuite qu'une petite partie de l'Afrique; ils ne s'emparèrent que du coeur de la plante. Mais avec César Carthage se relève; elle est bientôt en pleine floraison, comme si le sol n'avait attendu que la semence. Tout l'intérieur du pays, le vaste royaume des Numides, devient une province romaine, et les légionnaires défendent la frontière contre les barbares. Le royaume de Mauretanie est d'abord une dépendance, il sera bientôt une partie de l'empire. Avec le dictateur César, la civilisation et la latinisation de l'Afrique septentrionale prennent place parmi les soucis du gouvernement romain. Nous exposerons ici comment cette oeuvre fut accomplie, en montrant d'abord l'organisation extérieure, puis les mesures spéciales auxquelles on s'arrêta dans chaque partie du pays et enfin les résultats que l'on obtint. |
||||
30 av J.C.-476 |
Etendue de la domination romaineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste
La République romaine avait déjà revendiqué la suzeraineté territoriale sur toute l'Afrique du Nord, peut-être comme une portion de l'héritage de Carthage, peut-être parce que notre mer fut de bonne heure une des bases de l'Etat romain, et parce que toutes ses côtes furent considérées par les Romains comme leur propriété, quand la République se fut développée au dehors. Après la destruction de Carthage, cette prétention de Rome ne fut jamais sérieusement combattue par les grands états de l'Afrique septentrionale; si en beaucoup d'endroits les habitants n'acceptèrent pas le joug de Rome, c'est qu'ils n'obéissaient même pas à leurs maîtres locaux. Les monnaies d'argent de Juba I, roi de Numidie, et de Bogud, roi de Mauretanie, étaient frappées au coin romain; elles portaient toujours une légende latine, qui correspondait fort peu, il est vrai, à la langue et aux relations commerciales de l'Afrique du Nord : tout cela prouve que la domination romaine était reconnue dans le pays, et résulte sans doute de la nouvelle organisation que Pompée donna à cette province en l'an 674 de Rome = 80 av. J.C. Le peu de résistance que les Africains, abstraction faite de Carthage, opposèrent aux Romains, vint des successeurs de Massinissa. Lorsque le roi Jugurtha, et plus tard le roi Juba eurent été écrasés, les princes des régions occidentales se trouvèrent immédiatement dans l'état de dépendance qu'ils recherchaient. Les réformes des empereurs furent appliquées aussi bien sur le territoire soumis directement à Rome que dans les principautés vassales : c'est le gouvernement romain qui a régularisé les frontières dans toute l'Afrique du Nord, et qui a créé des communes sur le modèle romain, dans le royaume de Mauretanie comme dans la province de Numidie. Aussi ne peut-on pas dire que Rome ait fait réellement la conquête de l'Afrique septentrionale. Les Romains ne se sont pas emparés du pays comme les Phéniciens ou comme les Français : ils se sont établis en Numidie et en Maurétanie d'abord comme suzerains, puis comme successeurs des rois indigènes. Il s'agit alors de savoir si l'idée de frontière peut être appliquée à l'Afrique avec son sens habituel. Les Etats de Massinissa, de Bocchus, de Bogud, le territoire de Carthage, partaient du rivage septentrional, et toute la civilisation de l'Afrique du Nord avait son point d'appui sur cette côte. Mais, autant que nous pouvons nous en rendre compte, ces Etats ont considéré les tribus fixes ou nomades du Sud comme soumises, et comme rebelles lorsqu'elles secouaient le joug, à moins que l'éloignement et le désert, en les mettant hors de prise, ne les délivrât de toute domination. On distingue à peine, dans le Sud de l'Afrique septentrionale, les Etats voisins, avec lesquels auraient pu s'établir des relations et se signer des traités; lorsqu'on aperçoit l'un d'entre eux, comme le royaume des Garamantes, sa situation ne semble guère différer de celle des principautés vassales englobées dans le territoire civilisé. Il en est de même pour la province romaine d'Afrique; ce qui est vrai des anciens maîtres du pays l'est aussi de la civilisation romaine, mais on peut à peine déterminer jusqu'où s'avance vers le Sud la suzeraineté de Rome. Jamais on ne parle d'étendre ou de rétrécir les limites de l'empire en Afrique. Les insurrections sur le territoire romain et les incursions des peuplades voisines se ressemblent d'autant plus que, même dans les pays soumis sans aucun doute à la domination romaine, il y avait, plus encore qu'en Syrie et en Espagne, des districts éloignés et peu accessibles, qui ne connaissaient ni les impôts ni le recrutement romains. Il nous semble donc très juste d'ajouter à l'histoire de chaque province les quelques renseignements que nous fournissent la tradition historique ou les monuments qui sont restés debout sur les relations pacifiques ou guerrières des Romains avec leurs voisins du Sud. |
||||
146 av. J.C. |
La province d'Afrique et la NumidieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'ancien territoire de Carthage et la plus grande partie de l'ancien royaume de Numidie qu'y joignit le dictateur César, ou, comme on s'exprimait dans l'antiquité, l'ancienne et la nouvelle Afrique, formèrent jusqu'à la fin du règne de Tibère la province du même nom, qui s'étendait depuis la frontière de Cyrène jusqu'au fleuve Ampsaga, et qui comprenait l'état moderne de Tripoli, la Tunisie, et l'Algérie. Mais sous l'empereur Gaïus le gouvernement impérial divisa en deux parties cette province immense et qui réclamait une défense étendue des frontières, comme elle l'avait été au temps de la République : la région qui n'exigeait pas une protection spéciale de la frontière fut confiée au gouvernement civil; le reste du territoire fut couvert de garnisons et placé sous l'autorité d'un commandant militaire, indépendant de l'autre gouverneur. Voici pourquoi l'on fit cette réforme. Dans le partage des provinces entre l'empereur et le Sénat, l'Afrique avait été donnée au Sénat; mais un grand commandement était nécessaire dans l'état du pays; la présence simultanée d'un gouverneur nommé par le Sénat et d'un commandant militaire issu de l'empereur, qui, d'après la hiérarchie, devait être soumis au fonctionnaire sénatorial, devait donc amener et amena en réalité des conflits entre ces deux magistrats et même entre l'empereur et le Sénat. Aussi, en l'an 37, on mit fin à cette situation; la côte, depuis Hippo (Bône) jusqu'à la frontière de Cyrène, garda l'ancien nom d'Afrique et resta sous les ordres du proconsul; au contraire, la partie occidentale de la province avec la capitale Cirta (Constantine), l'intérieur du pays avec les grands camps militaires établis au Nord de l'Aurès, en un mot tout le territoire couvert de garnisons fut placé sous l'autorité du commandant de la légion africaine; ce fonctionnaire était de rang sénatorial; c'était non pas un consulaire, mais un ancien préteur. |
||||
180 av. J.C.-23 |
Les deux royaumes de MaurétanieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteA l'époque du dictateur César, la partie occidentale de l'Afrique du Nord était divisée en deux royaumes : celui de Tingi (Tanger), où régnait alors le roi Bogud, et celui d'Iol, plus tard Caesarea ( Cherchel), que gouvernait le roi Bocchus. Les deux princes s'étaient rangés aussi franchement au parti de César dans sa lutte contre les républicains que Juba, le roi de Numidie, avait soutenu ses ennemis; pendant les guerres d'Afrique et d'Espagne ils lui avaient rendu les plus grands services; aussi non seulement ils gardèrent tous les deux leur couronne, mais même le royaume de Bocchus et sans doute celui de Bogud furent agrandis par le vainqueur1. Lorsque la guerre s'éleva entre Antoine et le fils de César, seul en Occident le roi Bogud se déclara pour Antoine; poussé par le frère et la femme de celui-ci, il envahit l'Espagne pendant la guerre de Pérouse (714 de Rome = 40); mais son voisin Bocchus et sa capitale même, Tingi, prirent parti pour César et contre lui-même. Lorsqu'on signa la paix, Antoine abandonna Bogud; Octave donna son royaume au roi Bocchus et accorda à la ville de Tingi le droit de cité romaine. Lorsque quelques années plus tard les deux chefs de l'empire reprirent les armes, l'ex-roi se rejeta avec énergie dans la lutte; il espérait profiter de l'occasion pour reconquérir son royaume; mais lorsque Agrippa s'empara de la ville messénienne de Méthone, il fut fait prisonnier et mis à mort. Déjà quelques années auparavant (721=533) le roi Bocchus était mort; son empire, qui comprenait toute l'Afrique occidentale, passa entre les mains du fils du dernier roi de Numidie Juba II (729=25), le mari de Cléopâtre, fille d'Antoine et de l'Egyptienne1. Tous deux, dans leur jeunesse, avaient été exposés comme princes captifs aux regards du peuple romain, Juba au triomphe du grand César, Cléopâtre à celui d'Octave. Il était bizarre qu'ils fussent maintenant roi et reine de l'état tributaire le plus important de l'empire. Mais leur élévation s'expliquait par les circonstances; tous deux avaient grandi dans la famille impériale. Cléopâtre avait été élevée par la femme légitime de son père à l'égal de ses propres enfants; Juba avait servi dans l'armée de César. Les jeunes gens issus des dynasties vassales, qui se trouvaient en grand nombre à la cour impériale et qui jouaient un rôle important dans l'entourage des princes de la maison de César, étaient, dans les premiers temps de l'empire, destinés par un libre choix du souverain, au gouvernement des principautés dépendantes, comme les sénateurs de la première classe à l'administration des provinces de Syrie et de Germanie. Pendant cinquante ans environ (729-775 de Rome, 25 av. J.-C. - 23 ap. J.-C.), Juba, et après lui son fils Ptolémée exercèrent leur domination sur l'Afrique occidentale; il est vrai qu'un nombre considérable de cités très importantes et surtout de ports furent soustraits à son autorité, comme Tingi l'avait été sous son prédécesseur, par la concession du droit de cité romaine; en dehors de leur capitale, ces rois de Maurétanie ne commandaient pour ainsi dire qu'à des tribus berbères. 1. Dion (XL, 42) place, pour les deux princes, cet événement en l'année 705 (cf. Suetone, Caes., 54). En 707, Bogud secourt le gouverneur césarien de l'Espagne (Bell. Alex., 59, 60) et repousse une attaque du jeune Gnaeus Pompée (Bell. Afric., 23). Dans la guerre d'Afrique, Bocchus, de concert avec P. Sittius, fait une diversion heureuse contre Juba et prend même la ville importante de Cirta (Bell. Afr., 23; Appien, II, 96; Dion, XLIII, 3). Tous deux reçoivent de César, en récompense de leurs services, le royaume de Massinissa (Appien, IV, 54). Pendant la seconde guerre d'Espagne, Bogud figure dans l'armée de César (Dion, XLIII, 36, 38); il n'est pas vraisemblable que le fils de Bocchus ait combattu pour Pompée comme on l'a dit (Dion, loc. cit.); on l'a probablement confondu avec Arabion, fils de Massinissa, qui prit certainement parti pour les fils de Pompée (Appien, loc. cit.) Après la mort de César, Arabion rentra en possession de son royaume (Appien, loc. cit.); mais lorsqu'il fut mort lui-même en 714 (Dion, XLVIII, 22), l'autorité d'Octave dut se rétablir complètement dans ce pays. En ce qui concerne le présent fait à Bocchus et à Sittius, il faut bien comprendre que, dans la partie occidentale de l'ancien royaume de Numidie laissée à Bocchus, la colonie de Cirta, qui était abandonnée à Sittius, devait être considérée comme une ville romaine indépendante, de même que plus tard Tanger dans le royaume de Mauretanie. 2. Dion (XLIX, 43) raconte qu'Octave en l'an 721 = 33, après la mort de Bocchus, ne lui nomma aucun successeur, mais transforma la Mauretanie en province; puis (LI, 15) que, en l'année 724 = 30, après la mort de la reine d'Egypte, il fut question du mariage de sa fille avec Juba et du rétablissement de celui-ci sur le trône de son père; enfin (LIII, 26) que, pendant l'année 729=25, Juba, au lieu d'être investi du royaume tout entier, reçoit seulement une partie de la Gétulie avec les Etats de Bocchus et de Bogud. Ce dernier renseignement, confirmé par Strabon (XVII, 3, 7, p. 828), est exact; le premier manque au moins de précision, puisque la Maurétanie, en l'an 721 = 33, n'était certainement pas une province; seulement l'investiture en fut provisoirement suspendue; le second détail anticipe en partie sur les événements : il est impossible que Cléopâtre, née avant le triomphe vers 719 = 35 (Eph. epigr., I, p. 276), se soit mariée en 724 = 30; il est en partie faux, parce que Juba n'a certainement pas recouvré les états de son père à titre de royaume. S'il avait été roi de Numidie avant 729=25, et s'il n'avait fait alors que changer l'étendue de ses états, il faudrait compter les années de son règne à partir de sa première investiture, et non à partir de 729. |
||||
41 |
Création des provinces de caesarea et de TingiRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCette organisation subsista jusqu'en l'année 40 : à cette époque l'empereur Gaïus jugea bon d'appeler son parent à Rome, surtout à cause des riches trésors qu'il possédait, de le livrer au bourreau, et d'établir sur son royaume l'autorité directe de l'empire. Les deux princes n'étaient pas belliqueux. Le père, un érudit grec à la mode de son temps, compilait dans des livres sans fin de soi-disant curiosités historiques, géographiques ou relatives à l'histoire de l'art; remarquable par son activité littéraire internationale, pourrait-on dire, il était versé dans les littératures phénicienne et syrienne; mais surtout il s'efforçait de répandre parmi les Grecs la connaissance des moeurs romaines, et d'une prétendue histoire de Rome : en outre, il aimait avec passion l'art et le théâtre. Son fils était de la lignée ordinaire des princes : il passait son temps dans la vie de coeur et dans un luxe royal. Ils avaient peu d'influence sur leurs sujets, tant à cause de leur caractère personnel que de leur soumission à Rome; le roi Juba dut plusieurs fois demander aide au gouverneur romain contre les Gétules du Sud; et, lorsque le roi de Numidie, Tacfarinas, se souleva dans l'Afrique romaine, les Maures vinrent se ranger en foule sous ses drapeaux. Le pays n'en fut pas moins profondément impressionné par la chute de cette dynastie, et par l'introduction de l'administration provinciale romaine. Les Maures étaient fidèlement attachés à leur famille royale. Des autels ont été élevés en Afrique, même sous la domination romaine, aux princes qui descendaient de Massinissa. Ptolémée fut d'ailleurs l'héritier légitime de Massinissa au sixième degré et le dernier roi de cette antique dynastie. Un de ses fidèles serviteurs, Aedemon, appela aux armes, après la catastrophe, les montagnards de l'Atlas; après une guerre opiniâtre, la révolte fut enfin domptée en l'année 42 par le gouverneur Suetonius Paullinus, le même qui, plus tard, lutta contre les Bretons. Pour organiser ce nouveau territoire, on le divisa, comme autrefois, en une partie orientale et en une partie occidentale, ou, suivant les noms de leurs capitales, en deux provinces, celle de Caesarea et celle de Tingi; on conserva cette division; car, comme nous le montrerons plus loin, elle était imposée par l'état physique et politique de la région, dont la totalité devait pourtant être maintenue sous le même gouvernement, quelle qu'en fût la forme. Chacune de ces deux provinces reçut des troupes impériales de seconde classe, et fut placée sous l'autorité d'un gouverneur impérial qui ne dépendait pas du sénat. C'est la constitution physique de l'Afrique septentrionale qui a déterminé la fortune et le caractère de la civilisation latine dans ce territoire vaste et vraiment nouveau. Cette région se compose de deux grands massifs montagneux dont le plus septentrional tombe à pic dans la mer Méditerranée, tandis que le plus méridional, l'Atlas, s'incline lentement jusqu'au désert proprement dit, à travers la steppe du Sahara, parsemée de nombreuses oasis. Une steppe, qui ressemble au Sahara, stérile comme lui et couverte de lacs salés, s'étend au milieu, dans l'Algérie actuelle, entre le massif qui longe la côte septentrionale et le rebord montagneux du Sud. Il n'y a pas, dans l'Afrique du Nord, de vastes plaines cultivables; la côte de la mer Méditerranée n'offre qu'une bande étroite de pays plat. La région propre à la culture, le Tell, suivant l'expression moderne, se trouve essentiellement dans les nombreuses vallées et sur les coteaux situés à l'intérieur de ces deux grandes masses montagneuses; et elle s'étend au loin, surtout là où, comme dans le Maroc et la Tunisie actuels, il n'y a, entre l'extrémité septentrionale et la limite méridionale, aucune steppe intermédiaire. (Tripolitaine) Le pays de la Tripolitaine, dépendance politique de la province d'Afrique, n'appartient pas physiquement au même territoire, et ne s'y rattache que comme une sorte de presqu'île. Le massif montagneux qui s'abaisse dans la mer Méditerranée atteint le rivage auprès du golfe de Tacapae (Gabès); là, il se prolonge dans l'intérieur des terres par une bande de steppes coupées de lacs salés. Au Sud de Tacapae jusqu'à la grande Syrte, s'étend le long de la côte l'île cultivée de la Tripolitaine, séparée de la steppe par une ligne de hauteurs peu élevées; au-delà commence le désert avec ses nombreuses oasis. Il est très difficile en cet endroit de protéger la côte contre les habitants du désert, parce qu'il n'y a pas de chaîne montagneuse considérable : nous en trouvons la preuve dans les données qui nous sont parvenues sur les expéditions et les postes militaires de cette contrée. Elle fut le théâtre des guerres contre les Garamantes. |
||||
20 av. J.C.-211 |
Les guerres contre les GaramantesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLucius Cornelius Balbus qui, pendant sa jeunesse, avait combattu et administré sous César avec une audace extraordinaire et une sévérité des plus implacables, fut chargé par Auguste d'imposer la paix à ces voisins incommodes; pendant son proconsulat (735=19) il soumit l'intérieur du pays jusqu'à Cidamus (Ghadamès), à douze jours de marche de Tripoli, et jusqu'à Garama (Djerma) dans le Fezzan1; à son triomphe ce fut le dernier de cette sorte qu'un citoyen célébra, on vit défiler une longue série de villes et de tribus vaincues, dont on ne connaissait même pas le nom auparavant. Cette expédition est nommée une conquête; l'intérieur du pays a dû par conséquent tomber quelque peu dans la possession des Romains. Plus tard on combattit souvent dans cette région. Quelque temps après, encore sous Auguste, Publius Sulpicius Quirinius fit une expédition contre les peuplades de la Marmarique, c'est-à-dire du désert libyen situé au-dessus de Cyrène, et en même temps contre les Garamantes. Nous dirons que, sous Tibère, la guerre contre Tacfarinas s'étendit aussi dans cette contrée. Quand elle fut finie, le roi des Garamantes envoya des ambassadeurs à Rome, pour demander pardon de la part qu'il avait prise à la lutte. En l'an 70, ces mêmes Garamantes firent une incursion sur le territoire pacifié : la ville d'Oea en Tripolitaine (auj. Tripoli) avait appelé les Barbares à son secours, dans une querelle qu'elle avait eue avec la ville voisine de Leptis Magna (Lebda), et qui avait dégénéré en guerre: le gouverneur de l'Afrique battit encore une fois les Garamantes et les poursuivit jusque dans leur pays. Sous Domitien, la côte de la Grande Syrte, que les Nasamons habitaient depuis très longtemps, fut le théâtre d'un soulèvement des indigènes provoqué par les impôts écrasants; le gouverneur de Numidie dut le réprimer les armes à la main; ce pays déjà pauvre en hommes fut complètement dépeuplé par cette guerre que l'on mena avec beaucoup de cruauté. 1. Les fastes triomphaux nous montrent que Balbus conduisit cette expédition comme proconsul d'Afrique; mais le consul L. Cornelius de l'année 722 doit être un autre personnage, puisque d'après Velleius (II, 51) Balbus devint ex privalo consularis, c'est-à-dire obtint ce gouvernement sans avoir exercé une charge curule. Il se peut donc que sa nomination n'ait pas été, suivant l'usage ordinaire, le résultat d'un tirage au sort. Selon toute apparence, sa questure en Espagne (Drumann, II, p. 609) lui valut la disgrâce méritée d'Auguste, et ce fut seulement vingt années plus tard qu'il fut envoyé extraordinairement en Afrique, à cause de son incontestable capacité, pour accomplir cette tâche particulièrement difficile. |
||||
Devenez membre de Roma LatinaInscrivez-vous gratuitement et bénéficiez du synopsis, le résumé du portail, très pratique et utile; l'accès au forum qui vous permettra d'échanger avec des passionnés comme vous de l'histoire latine, des cours de latin et enfin à la boutique du portail ! 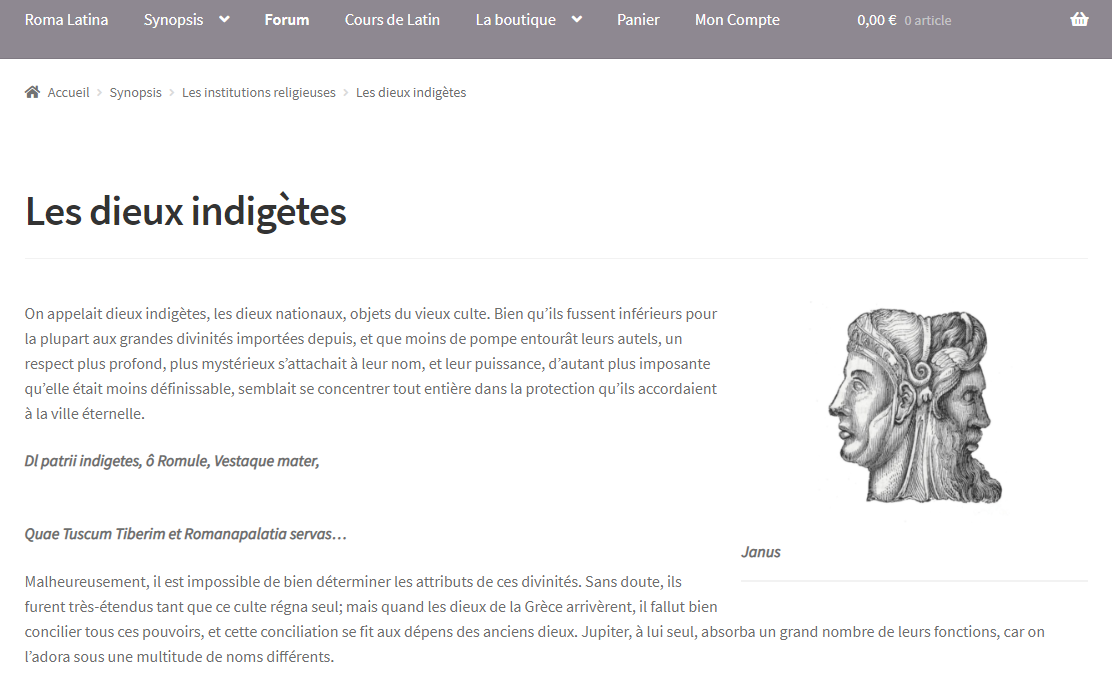 |
|||||
20 av. J.C.-211 |
Le territoire et l'armée africo-numidiensRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe fondement et le noyau de la domination romaine en Afrique est la province d'Africa, avec celle de Numidie qui en fut détachée. La civilisation romaine fut dans ce pays l'héritière en partie de Carthage, en partie des rois de Numidie, et si elle a obtenu quelque résultat important, il ne faut pas oublier qu'elle n'a fait autre chose que donner son nom et appliquer sa langue à ce qui existait déjà dans le pays. Ce sont Carthage et les rois de Numidie qui ont non seulement fondé de nombreuses villes sur lesquelles nous reviendrons, mais encore amené à une vie plus sédentaire les tribus berbères, qui d'ailleurs aimaient l'agriculture. Déjà au temps d'Hérodote, les Libyens, qui habitaient à l'Ouest du golfe de Gabès, n'étaient plus nomades, mais ils vivaient en paix et cultivaient la terre; la royauté numide fit pénétrer plus profondément encore dans l'intérieur du pays la civilisation et l'agriculture. D'ailleurs la nature du sol était plus favorable dans cette région à l'agriculture que dans la partie occidentale de l'Afrique du Nord; la dépression médiane entre les deux talus montagneux du Nord et du Sud y existe sans doute, mais les lacs salés et la steppe proprement dite y sont moins étendus que dans les deux Mauretanies. Les établissements militaires étaient surtout destinés à menacer par des troupes le puissant massif montagneux de l'Aurès, le Saint-Gothard du système méridional, et à protéger les territoires pacifiés de la province d'Afrique et de Numidie contre les incursions des peuplades turbulentes qui habitaient dans ces montagnes. C'est pourquoi Auguste fixa le quartier général de la légion à Theveste (Tebessa), sur le haut plateau qui sépare l'Aurès de l'ancienne province, et même au Nord de ce point, entre Ammaedara et Althiburus des postes romains ont été établis d'une façon permanente par les premiers empereurs. Nous savons peu de choses des diverses opérations militaires dont cette région fut le théâtre; la guerre y fut incessante; continuellement on repoussait les tribus limitrophes, qui pillaient non moins continuellement les provinces romaines. Nous n'avons des renseignements relativement précis que sur un seul épisode de ce genre, la guerre qui porte le nom du chef des Berbères, Tacfarinas. |
||||
17-24 |
Guerre contre TacfarinasRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteElle prit une importance extraordinaire et dura huit ans (17-24); aussi pendant les années 20-22 la garnison de la province, qui se composait d'une seule légion fut-elle renforcée par une seconde légion venue de Pannonie. La guerre éclata chez la grande tribu des Musulames, qui habitaient la pente méridionale de l'Aurès; déjà, sous Auguste, Lentulus avait dirigé une expédition contre eux, et, sous son successeur, ils élurent comme prince Tacfarinas. Ce fut l'Arminius africain : Numide de naissance, il avait servi dans l'armée romaine; après avoir déserté, il s'était rendu célèbre comme chef de bande. L'insurrection s'étendit, à l'Est, jusqu'au pays des Cinithiens voisins de la petite Syrte, et jusque chez les Garamantes dans le Fezzan; à l'Ouest elle embrasa une grande partie de la Mauretanie. Ce qui la rendait surtout dangereuse, c'est que Tacfarinas, suivant la méthode romaine, équipait une partie de ses gens à pied et l'autre à cheval et leur enseignait la tactique romaine : ces troupes donnaient de la consistance aux bandes légères des insurgés, et leur permettaient de livrer des combats et de faire des sièges réguliers. Après de longs efforts, le Sénat dut plusieurs fois renoncer au tirage au sort prescrit par la loi pour désigner le titulaire de cet important commandement, et choisir des hommes spéciaux au lieu des généraux ordinaires du genre de Cicéron. Quintus Junius Blaesus mit presque fin au soulèvement par une opération combinée; il envoya son aile gauche contre les Garamantes, pour protéger Cirta, et fit surveiller par son aile droite les débouchés de l'Aurès, tandis que lui-même pénétrait à la tête du gros de son armée sur le territoire des Musulames, et l'occupait d'une façon durable (22). Mais l'audacieux chef de bande recommença bientôt la guerre et quelques années plus tard, le proconsul Publius Cornelius Dolabella, après avoir réprimé dans son germe la révolte menaçante des Musulames soumis, par le supplice de tous leurs chefs, put, avec le secours des troupes du roi de Maurétanie, et dans son royaume même, près d'Auzia (Aumale), livrer une bataille dans laquelle Tacfarinas perdit la vie. Comme il arrive dans toutes les insurrections nationales, la mort du chef mit fin au mouvement. |
||||
|
|
|||||
24-476 |
Guerres postérieuresRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugustePour l'époque postérieure nous manquons de renseignements détaillés du même genre, nous ne pouvons que suivre à peu près le développement général de l'oeuvre pacificatrice accomplie par les Romains. Les peuplades qui habitaient au Sud de l'Aurès furent, sinon exterminées, du moins chassées de leur pays et transportées dans les districts du Nord : tel fut le sort des Musulames, contre lesquels on dirigea encore sous Claude une nouvelle expédition. Tacfarinas demandait qu'on l'établit lui et les siens au milieu du territoire civilisé; Tibère, comme il est juste, répondit à cette prétention en redoublant d'efforts pour anéantir l'audacieux prétendant; mais un peu plus tard il exauça son voeu d'une certaine manière par les mesures précédentes, qui sans doute contribuèrent beaucoup à affermir le régime romain. Les camps enfermèrent de plus en plus le massif de l'Aurès. Les garnisons s'avancèrent dans l'intérieur du pays; même, sous Trajan, le quartier général fut porté de Theveste plus loin vers l'Ouest; les trois établissements romains les plus importants, situés sur le versant septentrional de l'Aurès, Mascula (Khenchela), qui surveillait l'issue de la vallée de l'Arab, qui était la clef du massif, et qui fut une colonie au moins sous Marc-Aurèle et Verus; Thamugadi, fondée par Trajan; et Lambèse, qui fut depuis Hadrien le quartier général de l'armée d'Afrique, formèrent un ensemble comparable aux grands camps militaires du Rhin et du Danube; ces trois villes, placées sur les routes qui reliaient l'Aurès aux grandes cités du Nord et de la côte, Cirta (Constantine), Calama (Gelma), Hippo Regius (Bône), leur assuraient la paix. Les steppes intermédiaires, lors même qu'on ne pouvait pas les cultiver, étaient au moins traversées par des routes sûres. Vers l'Ouest les communications avec la Maurétanie étaient coupées par une chaîne de postes qui partait de Lambèse et qui contournait les pentes du massif en passant par les oasis de Calceus Herculis (el Kantara) et de Bescera (Biskra); plus tard même l'intérieur de ces montagnes devint romain; la guerre, qui fut faite en Afrique sous l'empereur Antonin et dont nous n'avons pas de récit détaillé, doit avoir eu pour résultat de soumettre l'Aurès à la puissance romaine. C'est à la même époque qu'une route militaire fut construite par une légion qui tenait garnison en Syrie et qui fut sans doute envoyée en Afrique à l'occasion de cette guerre; plus tard on trouve dans le pays des traces de garnisons et même de villes romaines, qui ont subsisté jusqu'à l'époque chrétienne; les montagnes de l'Aurès furent donc alors occupées et le restèrent constamment. L'oasis de Négrin, située sur la pente méridionale du même massif, avait déjà reçu des troupes romaines sous le règne de Trajan ou avant cet empereur; plus loin dans le Sud, à l'extrémité de la steppe, se trouvent près de Bir-Mohammedben-Younès, les ruines d'un poste romain; une route romaine longeait le pied méridional de cette montagne. Cette oasis est la dernière terrasse de la puissante déclivité qui, du plateau de Theveste, ligne de partage des eaux entre la mer Méditerranée et le désert, s'abaisse vers celui-ci par des étages de deux à trois cents mètres de hauteur; au pied de cette terrasse commence, contrastant vivement avec les montagnes découpées qui se dressent en arrière, le désert sablonneux du Souf, avec ses rangées de dunes jaunes semblables aux flots, avec ses masses de sable soulevées par le vent, désert terrible, sans accident de terrain, sans arbre, se perdant dans l'horizon sans limite. Dès cette époque Négrin fut, comme aujourd'hui, le point de ralliement et le dernier refuge des chefs de pillards et des indigènes qui voulaient échapper à la domination étrangère; c'est une position qui commande au loin le désert et ses routes commerciales. En Numidie la domination et même la colonisation romaine s'étendaient jusqu'à cette limite extrême. | ||||
24-476 |
La civilisation romaine en MaurétanieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa Mauretanie n'était pas un héritage comme l'Afrique et la Numidie. Nous ne savons rien de son histoire antérieure; aucune ville importante n'a probablement existé sur la côte à une époque reculée, et l'oeuvre civilisatrice n'a été accomplie dans cette région ni par l'influence phénicienne ni par les rois indigènes, comme l'a fait, en Numidie, Massinissa. Lorsque les derniers successeurs de ce prince eurent échangé la couronne de Numidie contre celle de Mauretanie, la capitale, abandonnant son nom d'Iol pour celui de Caesarea, devint la résidence d'une cour polie et luxueuse, ainsi qu'une place de navigation et de commerce. Mais la différence de l'organisation provinciale montre combien la possession de ce royaume était moins avantageuse que celle de la province voisine; les deux armées de Mauretanie n'étaient pas moins nombreuses que celle de l'Afrique et de la Numidie ?; pourtant elles n'avaient besoin que d'un gouverneur de rang équestre, et elles se composaient de soldats appartenant à la classe des pérégrins. Caesarea resta une importante ville de commerce; mais dans cette province la véritable colonisation ne dépassa pas les montagnes du Nord; c'est à l'Est seulement que l'on trouve dans l'intérieur du pays quelques villes assez considérables. Même dans la fertile vallée du plus important des fleuves de la province, le Cheliff, la vie urbaine se développe faiblement; plus à l'Ouest, dans les vallées de la Tafna et de la Malva elle disparaît complètement; et les noms des détachements de cavalerie qui y sont postés servent souvent de désignations locales. La province de Tingi (Tanger) n'embrasse pour ainsi dire que cette ville avec le territoire qui l'entoure, et le bord de la côte atlantique jusqu'à Sala, c'est-à-dire le moderne Rebât; dans l'intérieur du pays la colonisation romaine n'a jamais pénétré jusqu'à Fez. Aucune route de terre ne relie cette province à celle de Caesarea; pour franchir les 50 milles qui séparent Tingi de Rusaddir (Melilla), il fallait aller par mer, en longeant la côte déserte et insoumise du Rif. Cette région communiquait plus facilement avec la Bétique qu'avec la Maurétanie; et plus tard, lorsque l'empire fut divisé en districts administratifs plus considérables, la province de Tingi fut rattachée à l'Espagne. On ne faisait que consacrer extérieurement ce qui existait en fait depuis longtemps. La Tingitane était pour la Bétique ce que la Germanie était pour la Gaule; et peut-être, comme elle rapportait fort peu, ne fut-elle organisée et gardée, que parce que son abandon aurait déjà à cette époque amené une invasion de l'Espagne, comme celle des Musulmans après la chute de la puissance romaine. |
||||
|
|
|||||
24-476 |
Les guerres des GétulesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAu-delà des limites ainsi déterminées de la colonisation permanente, derrière la ligne des douanes et des postes frontières et dans maints districts encore barbares situés en-deçà dans les deux Mauretanies, le pays resta bien à l'époque romaine aux indigènes : mais ces peuplades étaient vassales de Rome; on exigeait d'eux autant que possible des tributs et le service militaire; mais la forme régulière de la perception des impôts et des levées de troupes ne leur fut pas appliquée. Par exemple, la tribu des Zimizes, établie sur la côte rocheuse à l'Ouest d'Igilgili (Djidjelli) dans la Maurétanie orientale, c'est-à-dire, au coeur même du territoire romain, reçut la mission d'occuper une forteresse que l'on avait construite pour couvrir la ville d'Igilgili, mais à la condition que ses bandes armées ne dépasseraient pas un rayon de 500 pas autour du poste1. On se servait donc de ces Berbères soumis dans l'intérêt des Romains; mais on ne les organisait pas à la romaine, et on ne les employait pas dans l'armée impériale. En outre, hors de la province proprement dite, les irréguliers de Mauretanie furent souvent employés, surtout comme cavaliers, à une époque postérieure2, ce qui n'arriva jamais pour les Numides. Nous ne pouvons pas déterminer jusqu'où s'étendaient les possessions et les routes impériales au-delà des villes et des garnisons romaines. Les vastes steppes situées à l'Ouest de Lambèse autour des lacs salés, la contrée montagneuse de Tlemsen jusqu'à Fez, qui comprend la côte du Rif, la belle et fertile région du rivage de l'Atlantique depuis Sala au Nord jusqu'au grand Atlas, dont la civilisation rivalisa avec celle de l'Andalousie pendant la grande époque de la puissance arabe, enfin le massif de l'Atlas, au Sud de l'Algérie et du Maroc, et son versant méridional, dont les pâturages de montagnes et de steppes offrent aux tribus de bergers d'abondantes subsistances, et dont les nombreuses oasis présentent une fertilité luxuriante, toutes ces régions sont restées en dehors de la civilisation romaine; mais il ne s'ensuit pas qu'elles aient été indépendantes de Rome, ni qu'elles aient été considérées comme situées en dehors du territoire de l'empire. Sous ce rapport la tradition ne nous fournit que peu de renseignements. Nous avons déjà raconté que les proconsuls de l'Afrique aidèrent le roi Juba à soumettre les Gétules, c'est-à-dire les tribus qui habitaient l'Algérie méridionale; l'on a même placé à Madère les teintureries de pourpre dont nous parlerons plus loin. Après la disparition de la dynastie maurétanienne et l'établissement de l'administration directe par les Romains, Suetonius Paullinus franchit l'Atlas, le premier de tous les généraux romains et porta ses armes dans le Sud-Est du Maroc, jusqu'au fleuve du désert qui porte encore aujourd'hui le nom de Ger. Son successeur Gnaeus Hosidius Geta continua cette expédition et écrasa complètement le chef des Maures, Salabus. Dans la suite, maint gouverneur audacieux des provinces mauretaniennes pénétra dans ces régions lointaines; il en fut de même des gouverneurs de la Numidie; car c'était sous leur autorité et non sous celle des gouverneurs de la Maurétanie qu'était placé le territoire montagneux qui bornait au Sud la province de Caesarea3. Mais il ne nous est resté aucun récit des campagnes militaires que l'on fit plus tard dans le Sud de la Mauretanie et de la Numidie. Il est peu probable que les Romains aient conquis toutes les régions qu'avaient possédées les rois de Mauretanie, avec les mêmes limites du côté du sud; cependant les expéditions entreprises après l'annexion du pays n'ont pas été sans conséquences durables. Tout au moins une partie des Gétules a été soumise pendant l'époque impériale à la conscription régulière, comme le prouve la levée qu'on fit chez eux de troupes auxiliaires; et si les tribus indigènes qui habitaient le Sud des provinces romaines avaient donné fort à faire aux Romains, les traces d'un pareil état de choses ne manqueraient certainement pas complètement4. Il est probable que tout le Sud jusqu'au grand désert comptait comme possession de l'empire5 ; l'autorité réelle de Rome s'est même étendue beaucoup plus loin que le domaine de la civilisation romaine; ce qui n'exclut pas, à la vérité, les pillages et les razzias que l'on commettait de part et d'autre. 1. Corp. insc. lat., VIII, 8369 (de l'an 129): Termini positi inter Igilgilitanos, in quorum finibus kastellum Victoriae positum est, et Zimiz(es), ut sciant Zimizes non plus in usum se habere ex auctoritate M. Vetti Latronis pro(curatoris) Aug(usti) qua(m) in circuitu a muro kast(elli) p(edes) D. La table de Peutinger place les Zimizes un peu à l'Ouest d'Igilgili. 2. Si le préfet d'une cohorte, qui tenait garnison en Numidie, avait en même temps sous ses ordres six tribus (nationes) Getules (Corp. insc. lat., V, 5267) en Mauretanie, on employait aussi des gens du pays comme irréguliers dans la province voisine. Les cavaliers maures irréguliers se rencontrent surtout en grand nombre à la fin de l'empire. Sous Trajan, Lusius Quietus, Maure de naissance et chef d'une troupe de Maures (Dion, LXVIII, 32), non pas Alous (Themistius, Or., 16, p. 250, ed. Dindorf), était sans doute un cheikh gétule, qui servait avec les siens dans l'armée romaine. Les paroles de Themistius n'indiquent pas que sa patrie fût formellement indépendante de l'empire; le territoire soumis est le territoire organisé suivant la méthode romaine, la tox aria de ce territoire est une frontière habitée par des tribus dépendantes. 3. Aux inscriptions, qui fournissent ce renseignement (Corp. insc. lat., VIII, p. xyii et 747), s'ajoute la remarquable dédicace du chef d'une colonne expéditionnaire de l'an 174, trouvée dans le voisinage de Geryville (Eph. ep., V, 1043). 4. Le tumultus Gaetulicus (Corp. insc. lat., VIII, 6958) est plutôt un soulèvement qu'une incursion. 5. Ptolémée prend comme limite de la province de Caesarea la ligne située au-dessus des chotts et n'y comprend pas la Gétulie; au contraire il étend la province de Tingi jusqu'au grand Atlas. Pline (Hist. nat., V, 4, 30) compte parmi les peuplades soumises de l'Afrique toute la Gétulie jusqu'au Niger et jusqu'à la frontière éthiopienne, ce qui conduit à peu près à Tombouctou. Cette dernière formule doit correspondre à la prétention officielle. |
||||
169-310 |
Les invasions des Maures en EspagneRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes attaques véritables sont celles que le territoire pacifié eut à essuyer de la part des tribus, qui habitaient le rivage dans le Rif et aux alentours, les Mazices et les Baquates; les assaillants passèrent même la mer et vinrent se jeter sur les côtes d'Espagne. Pendant tout l'empire nous avons des renseignements sur les invasions des Maures en Bétique1, et nous savons que les Romains, au lieu de prendre énergiquement l'offensive, se tinrent constamment dans ce pays sur la défensive; sans doute cette situation ne mettait pas l'empire en danger de vie où de mort, mais la riche et pacifique province d'Espagne ne fut jamais en sûreté et éprouva des désastres souvent terribles. Les territoires civilisés de l'Afrique paraissent avoir moins souffert des incursions des Maures, probablement parce que le quartier général de Numidie se trouvait placé tout près de la frontière de Mauretanie, et parce que les fortes garnisons qui surveillaient le Versant occidental de l'Aurès firent leur devoir. Mais au troisième siècle, lorsque la puissance impériale s'écroula de toute part, les invasions commencèrent aussi dans cette province. La guerre dite des cinq tribus, qui commenca vers l'époque de Gallien, et pour laquelle douze ans plus tard l'empereur Maximien vint lui-même en Afrique, éclata chez les tribus qui habitaient au-delà des chotts, sur la frontière de la Numidie et de la Maurétanie; elle atteignit surtout les villes de la Mauretanie orientale et de la Numidie occidentale, par exemple Auzia et Mileu2. 1. Déjà sous Néron, Calpurnius (Egl., IV, 40) appelle la côte de la Bétique trucibus obnoxia Mauris. Si les Maures sous Antonin le Pieux furent vaincus et refoulés jusqu'à l'atlas et même au-delà (Vita Pii, 5, Pausan., VIII, 43), l'envoi que l'on fit alors des troupes d'Espagne dans la Tingitane (Corp. insc. lat., III, 5212-5215) permet de croire que cette attaque des Maures atteignit la Bétique et que les troupes de la Tarraconaise qui marchèrent contre eux les poursuivirent au-delà du détroit. A la même époque sans doute une légion de Syrie combattit dans l'Aurès; il est donc très probable que cette guerre s'étendit aussi sur la Numidie. La guerre des Maures sous Marc-Aurèle (Vita Marci, 21, 22; Vita Severi; 2) se livra surtout en Bétique et en Lusitanie. Sous le règne de Sévère un gouverneur de l'Espagne citérieure eut à lutter contre les rebelles sur terre et sur mer (Corp. insc. lat., II, 4114). Au temps d'Alexandre Sévère (Vita, 58) on combattit dans la province de Tingi, sans que l'Espagne soit nommée à ce propos. - Pendant le règne d'Aurélien (Vita Saturnini, 9) il est question de guerre mauro-hispanienne. - Il est impossible de préciser l'époque à laquelle des troupes furent envoyées de Numidie en Espagne et contre les Mazices (Corp. insc. lat., VIII, 2786); il s'agit ici non pas des Mazices de la Césarienne, mais de ceux de la Tingitane dans le Rif (Ptolemée, V, 1, 10); c'est peut-être à ce propos que Gaius Vallius Maximianus remporta, comme gouverneur de la Tingitane, une victoire sur les Maures dans la Bétique (d'après Hirschfeld, Wiener Stud., VI, p. 123, sous Marc-Aurèle et Commode) et délivra des villes qu'ils assiégeaient (Corp. insc. lat., II, 1120, 2015). Ces événements prouvent au moins qu'on n'avait pas fini de lutter contre les Maures du Rif et contre leurs alliés qui venaient en grande affluence de l'intérieur du pays. Quand les Baquates, qui habitaient la même côte, assiégèrent dans la Césarienne la ville assez éloignée de Cartenna (Tenes) (Corp. insc. lat., VIII, 9663), ils vinrent par mer; on ne sait pas où eurent lieu les guerres des Maures sous Hadrien (Vita, 5, 12) et sous Commode (Vita, 13). 2. Les monuments épigraphiques (Corp. insc. lat., VIII, 2615, 8836, 9045, 9047) nous en apprennent plus sur ce sujet que les sèches narrations de Victor et d'Eutrope. D'après ces inscriptions on peut suivre les Quinquegentiani depuis Gallien jusqu'à Dioclétien. Au début ce sont les Baquates qui, appeles Transtagnenses, ont dû habiter au-delà des Chotts. Puis quatre rois font une expédition commune. L'adversaire le plus redouté est Faraxen avec ses gentiles Fraxinenses. Des villes comme Milev en Numidie, non loin de Cirta, et Auzia dans la Césarienne, sont attaquées, et les habitants doivent en grande partie se défendre eux-mêmes contre les ennemis. Après la fin de la guerre, Maximien établit de grands magasins à Thubusuctu, non loin de Saldae. Ces renseignements épars donnent au moins un aperçu des événements de cette époque. |
||||
24-476 |
Persistance de la langue berbèreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNous en venons maintenant à l'organisation intérieure du pays. Occupons-nous d'abord de la langue. L'idiome populaire fut traité comme l'idiome celtique l'avait été en Gaule et l'idiome ibérique en Espagne; cette méthode fut d'autant plus suivie en Afrique, qu'une domination étrangère s'y était établie de très bonne heure, et que certainement aucun Romain ne comprenait la langue indigène. Les tribus berbères ont eu non seulement une langue nationale, mais même une écriture nationale; autant que nous pouvons le savoir, on n'en a jamais fait usage dans les relations officielles; du moins elle n'a jamais été employée sur les monnaies. Même les dynasties indigènes des Berbères ne s'en sont jamais servies, soit parce que dans leurs royaumes les villes les plus importantes étaient phéniciennes plutôt que libyques, soit parce que la civilisation phénicienne avait pénétré profondément dans le pays. Cette langue, il est vrai, était écrite même sous la domination romaine; la plupart des inscriptions votives ou funéraires en langue berbère datent certainement de l'époque impériale; mais leur rareté prouve que, dans le cercle des possessions romaines, on en était arrivé, pour l'idiome indigène, à un usage restreint de l'écriture. Comme langue populaire il s'est naturellement conservé surtout dans les régions où les Romains ne pénétrèrent pas ou presque pas, comme le Sahara, les montagnes du Rif marocain, et les deux Kabylies; mais même dans l'île fertile et de bonne heure colonisée de Girba (Djerba), en Tripolitaine, siège de la fabrication de la pourpre carthaginoise, on parle encore aujourd'hui libyque. A tout prendre, l'ancien idiome populaire de l'Afrique s'est mieux défendu que ceux des Celtes et des Ibères. | ||||
30 av. J.C.-476 |
Persistance de la langue phénicienneRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa langue qui régnait en Afrique septentrionale, lors de l'occupation romaine, était celle des étrangers qui avaient envahi le pays avant les Romains. Leptis, non pas celle de la Tripolitaine, mais la cité voisine d'Hadrumete, est la seule ville africaine, dont les monnaies portent une légende grecque et qui ait ainsi donné à cette langue une place au moins secondaire dans la vie officielle. L'idiome phénicien dominait à cette époque dans tous les pays de l'Afrique septentrionale où la civilisation avait pénétré, depuis Leptis la Grande jusqu'à Tingi; on s'en servait beaucoup à Carthage et dans ses environs, mais on l'employait aussi en Numidie et même en Maurétanie1. Lorsque l'on modifia le système administratif du pays, on fit certaines concessions à cette langue, organe d'une civilisation très développée, quoique étrangère. Peut-être sous César, certainement sous Auguste et Tibère, la langue phénicienne fut parlée comme langue officielle dans les villes de la province romaine, telles que Leptis-la-Grande et Oea, dans celles du royaume de Mauretanie, comme Tingi et Lix, alors même que, comme Tingi, elles étaient devenues des cités de droit romain. Mais on n'alla pas aussi loin en Afrique que dans la partie grecque de l'empire. Dans les provinces grecques la langue grecque est usitée pour les relations commerciales, et pour les rapports avec le gouvernement impérial ou ses représentants; dans les villes organisées sur le modèle des cités grecques, les monnaies portent le nom de l'empereur écrit en grec. Au contraire, en Afrique, le nom de l'empereur ou ceux des fonctionnaires impériaux sont toujours écrits en latin sur les monnaies, quand même la ville parle une autre langue. Sur les monnaies des rois de Mauretanie, le nom de la reine grecque est en grec, mais celui du roi, considéré comme fonctionnaire impérial, est toujours en latin, même lorsque la reine est nommée à côté de lui. Cela prouve que le gouvernement ne toléra pas l'emploi de la langue phénicienne en Afrique dans ses rapports avec les municipalités et les individus : elle ne le permit que pour les relations quotidiennes. Cet idiome ne fut pas une troisième langue d'empire; ce fut une langue à part dont on reconnaissait l'existence dans son domaine propre. Mais cette reconnaissance même, quelque limitée qu'elle fut, ne dura pas longtemps. Nous n'avons aucun document qui atteste l'usage public du phénicien après Tibère, et il est difficile d'admettre que cette langue ait survécu à la première dynastie2. Nous ne savons pas comment ni quand le changement s'opéra. Le gouvernement, sous Tibère ou sous Claude, prononça sans doute le mot décisif; et l'annexion des Phéniciens d'Afrique, sous le rapport de la langue et de la nationalité, fut accomplie aussi complètement qu'une annexion de ce genre peut l'être par l'administration. Dans l'usage domestique, le phénicien survécut longtemps encore en Afrique, plus longtemps, semblet-il, que dans la mère-patrie. Au commencement du troisième siècle, les femmes des meilleures familles de Leptis-la-Grande parlaient si peu latin ou grec, qu'on aurait pu les croire étrangères à la société romaine; même à la fin du quatrième siècle on n'aimait pas à envoyer dans les environs d'Hippo regius (Bône) des prêtres qui n'auraient pas su s'adresser aux gens du pays en langue punique. Ils s'appelaient eux-mêmes Chananéens; les noms et les locutions puniques étaient encore d'un usage courant. Mais cette langue avait été bannie de l'école3; on ne l'écrivait plus, elle était devenue un dialecte populaire et ne se parlait probablement que dans le domaine de l'ancienne civilisation phénicienne, surtout dans ces vieilles villes puniques situées sur les côtes en dehors des grandes voies commerciales4. Lorsque les Arabes envahirent l'Afrique, ils y trouvèrent comme langue populaire l'idiome des Berbères; celui des Phéniciens avait disparu5. Les deux langues étrangères ont péri en même temps que la civilisation carthagino-romaine; le langage indigène leur a survécu et se parle encore anjourd'hui. Les dominations étrangères se succédèrent, amenant d'autres civilisations; les Berbères restèrent comme le palmier des oasis et le sable du désert. 1. Abstraction faite des monnaies, les inscriptions le prouvent. D'après le classement dont je suis redevable à M. Euting, la grande majorité des inscriptions écrites en vieux punique, c'est-à-dire sans doute avant la destruction de Carthage, appartient à Carthage elle-même (environ 2,500), les autres à Hadrumète (9), à Thugga (la célèbre inscription en phénicien et en berbère), à Cirta (5), à Jol-Caesarea (1). Les inscriptions néo-puniques sont très nombreuses à Carthage et aux alentours (30); elles ne sont pas rares dans la province consulaire, à Leptis la Grande (5), dans les îles de Gerba (1) et de Cossura (1); en Nuinidie, à Calama et dans ses environs (23), ` Cirta (15); en Mauretanie on n'en a trouvé jusqu'à présent qu'à Portus Magnus (2). 2. C'est en réalité sous Tibère que l'on cessa de frapper des monnaies en Afrique, et comme les inscriptions africaines du premier siècle après J.-C. sont très rares, les documents nous font défaut pour la période postérieure à cet empereur. Les monnaies de Babba, dans la Tingitane, qui commencent avec Claude et disparaissent sous Galba, portent des légendes exclusivement latines; mais la ville était une colonie. Les inscriptions latino-puniques de Leptis la Grande (Corp. insc. lat., VIII, 7) et de Naraggara (ibid., 4636) peuvent être postérieures à Tibère, mais leur caractère d'inscriptions bilingues prouve que la langue phénicienne était déjà en décadence, lorsqu'elles ont été gravées. 3. Dans son Epitome, Aurelius Victor prétend que l'empereur Sévère a été latinis lilteris sufficienter instructus, graecis sermonibus eruditus, punica eloquentia promptior, quippe genitus apud Leptim; il ne faudrait pas en conclure qu'il existait alors en Tripolitaine un cours de rhétorique punique: cet auteur, d'une basse époque et d'un rang secondaire, a sans doute transformé en une étude approfondie ce qui n'était qu'une connaissance pratique de la langue. 4. Il ne faut pas se fier aux affirmations d'Arnobe le Jeune qui écrivait en 460 (Ad psal., 104, p. 481, ed. Migne): Cham. vero secundus filius Noe a Rhinocoruris usque Gadira habens linguas sermone punico a parte Garamantum, latino a parte boreae, barbarico a parte meridiani, Aethiopum et Aegyptiorum ac barbaris interioribus vario sermone numero viginti duabus linguis in patriis trecentis nonaginta et quatluor; encore moins aux fables que Procope raconte Bello Vand., II, 10) à propos de la langue punique écrite et parlée à Tigisis. De pareils témoins ne pouvaient guère distinguer le berbère du phénicien. 5. Peut-être la langue phénicienne a-t-elle été parlée jusqu'au onzième siècle sur un point isolé de la grande Syrte (Movers, Die Phonizier, II, 2, p. 478). |
||||
30 av. J.C.-476 |
La langue latineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe fut le latin, et non le grec, qui hérita de la langue punique. Et pourtant ce n'était pas là le développement naturel des choses. Au temps de César le latin et le grec étaient dans l'Afrique septentrionale des langues étrangères; mais, comme les monnaies de Leptis le prouvent, le grec était beaucoup plus répandu que le latin; seuls les fonctionnaires, les soldats, les négociants italiens parlaient latin. Il aurait été sans doute plus facile à cette époque d'helléniser que de latiniser l'Afrique; ce fut pourtant le contraire qui arriva. On sent encore ici l'action de cette volonté qui ne laissa pas se développer en Gaule les germes de l'hellénisme, et qui annexa au domaine de la langue latine la Sicile grecque; cette volonté, qui avait tracé les limites entre l'Occident latin et l'Orient grec, rattacha l'Afrique à l'Occident. |
||||
30 av. J.C.-476 |
L'organisation phénicienne des villesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'organisation intérieure du pays fut établie dans le même esprit. Elle a pour base la municipalité phénicienne, comme en Italie elle repose sur la municipalité latine, et en Orient sur la municipalité grecque. Lorsque la domination romaine pénétra en Afrique, le territoire de Carthage comprenait trois cents communes, peu importantes pour la plupart, et administrées par leurs suffètes : la république ne modifia pas cette organisation. Le même état de choses se retrouve dans les différents royaumes du pays; les anciennes villes phéniciennes y avaient conservé, sous les princes indigènes, leurs institutions primitives et d'autres villes, comme Calama, cité située dans l'intérieur de la Numidie et qui ne peut guère être d'origine phénicienne, y étaient certainement administrées à la punique1; la civilisation que Massinissa voulut donner à son royaume consista surtout dans la transformation des villages berbères agricoles en villes constituées sur le modèle des municipalités phéniciennes. Il doit en être de même des quelques cités plus anciennes, qui existaient en Mauretanie avant Auguste. Autant que nous en pouvons juger, les deux suffètes, qui se renouvellent chaque année à la tête des communes africaines, sont tout à fait semblables aux deux magistrats suprêmes qui existaient dans l'organisation de la municipalité italique. D'autres particularités, par exemple la constitution des assemblées de la cité si connues à Carthage et qui y différaient totalement des institutions analogues de l'Italie - ont-elles conservé à l'organisation des municipalités phéniciennes à l'époque romaine quelque caractère national? C'est ce qu'il est au moins impossible d'établir2. Mais, en fait, on ne chercha pas à effacer le contraste, purement formel d'ailleurs, qui existait entre la cité phénicienne et la ville italique et on laissa subsister la langue punique; par là on reconnaissait la nationalité phénicienne, et on garantissait en quelque sorte son existence sous la domination romaine. Ce qui prouve que cette organisation administrative fut bientôt considérée comme étant la seule régulière en Afrique c'est que, César releva Carthage sous la forme d'une ville phénicienne; elle retrouva ses anciens suffètes3 et dans une certaine mesure ses anciens habitants, puisqu'une grande partie, peut-être la majorité des nouveaux citoyens fut prise dans les localités environnantes; de plus la cité fut placée sous la protection de la grande déesse de la Carthage punique, la reine du Ciel, Astarté, qui rentra ainsi avec son peuple dans son ancienne demeure. A la vérité, dans Carthage même, cette organisation fit bientôt place à l'administration propre aux colonies italiques, et la déesse protectrice Astarté devint Caelestis, divinité latine au moins de nom. Dans les autres régions de l'Afrique et en Numidie, le système municipal phénicien resta sans doute prépondérant pendant tout le premier siècle; il fut appliqué dans les localités auxquelles on avait reconnu le droit de cité, mais qui ne jouissaient ni de l'organisation romaine ni de l'organisation latine. Ce régime ne fut pas aboli à proprement parler, puisqu'il y avait encore des suffètes sous Antonin; mais partout ces magistrats cédèrent peu à peu la place aux duumvirs et le changement des principes de gouvernement entraîna, là comme ailleurs, ses dernières conséquences. 1. Les inscriptions latines trouvées en Afrique ne sont pas assez anciennes pour nous renseigner sur l'histoire de la province avant le second siècle de l'ère chrétienne; nous trouvons plus de détails dans les quatre contrats de patronage cités à la page suivante (note 1) qui datent du temps de Tibère et qui furent conclus entre deux petites localités de la province consulaire Apisa Majus et Siagu d'une part, et de l'autre deux villages voisins sans doute, mais qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs : Themetra et Thimiligi. Strabon paraît donc digne de foi (XVII, 3, 15, p. 833), quand il nous rapporte qu'au commencement de la dernière guerre, le territoire de Carthage comprenait encore 300 villes. Dans chacun de ces quatre petits villages il y avait des suffètes. D'ailleurs lorsque les inscriptions en vieux ou en nouveau punique nomment des magistrats, il s'agit régulièrement de deux suffètes. Telle était l'organisation générale de la province consulaire, Calama nous le prouve; l'administration phénicienne des villes s'y était développée. 2. Les contrats de patronage, du temps de César (Corp. insc. lat., VIII, 10525), d'Auguste (ibid., 68, cf. 69), et de Tibère (Corp. insc. lat., V, 4919-4922), conclus par le senatus populusque des communes (civitates) africaines de droit pérégrin avec de nobles romains, paraissent avoir été faits, à la manière romaine, par le conseil municipal, qui représente la commune et s'engage pour elle. 3. Sur une monnaie frappée certainement au temps de César (Muller, Num. de l'Afr., II, p. 149) on lit : Kar(thago) Veneris et Aristo Mutumbal Ricoce suf(etes), les deux premiers noms doivent être considérés comme un double nom gréco-phénicien: ce cas d'ailleurs n'est pas rare (cf. Corp. insc. lat., V, 4922: Agente Celere Imilchonis Gulalsae filio sufete). Or d'une part les suffètes ne peuvent pas être attribués à une colonie romaine; d'autre part il est bien établi qu'une colonie fut conduite à Carthage; il faut donc ou que César lui-même ait modifié plus tard la forme de la constitution municipale ou que l'établissement de la colonie sous le triumvirat ait été considéré comme l'exécution posthume de la volonté du dictateur (ainsi que le raconte aussi Appien, Pun., 136). On peut comparer, sous ce rapport, Curubis à Carthage: cette ville, au début de la dictature de César, était administrée par des suffètes (Corp. insc. lat., 10525) tandis qu'en l'an 709 de Rome c'était une colonie césarienne gouvernée par des duumvirs (ibid., 977): néanmoins le cas est différent, parce que cette cité ne doit pas comme Carthage, son existence à César. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Transformation des villes phéniciennes en cités italiquesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe droit municipal phénicien commença sous César à être remplacé par le droit italique. L'ancienne ville phénicienne d'Utique, qui avait précédé Carthage et qui lui succéda, avait été frappée dans ses intérêts par le rétablissement de l'ancienne capitale du pays, la première cité d'Afrique que l'on dotait de l'organisation italique; elle reçut en compensation peut-être du dictateur César le droit de cité latine, certainement de son successeur Auguste le titre de municipe romain. La ville de Tingi fut récompensée de la même manière, parce qu'elle était restée fidèle pendant la guerre de Pérouse. Ce privilège fut bientôt étendu à plusieurs autres villes; néanmoins le nombre des cités africaines de droit romain resta fort limité jusqu'à Trajan et Hadrien1. Depuis cette époque, on concéda le droit municipal ou même colonial aux villes demeurées jusque là phéniciennes, dans une grande proportion, mais en procédant isolément; le droit colonial fut même, plus tard, accordé régulièrement comme un titre, sans que des colons aient été conduits dans la nouvelle cité. Si les dédicaces et les monuments de toute sorte, rares en Afrique jusqu'au commencement du second siècle, deviennent dès lors abondants, c'est en grande partie parce que de nombreuses localités passèrent au rang des villes impériales qui jouissaient des droits les plus étendus. 1. Pour l'Afrique et la Numidie, Pline (Hist. nat., V, 4, 29 et suiv.) compte en tout 516 villes, parmi lesquelles 6 colonies, 15 cités de droit romain, 2 villes latines (car l'oppidum stipendiarium, d'après la place qui lui est attribuée, devait jouir du droit italique); les autres localités sont ou bien des villes phéniciennes (oppida), dont 30 sont indépendantes, ou bien des tribus libyennes (non civitates tantum, sed pleraeque etiam nationes jure dici possunt); on ne sait pas si ces chiffres se rapportent au règne de Vespasien ou à une époque antérieure: en aucun cas ils ne sont corrects; car en dehors des six colonies nommées par Pline, il y en avait six autres (Assuras, Carpi, Clupea, Curubi, Hippo Diarrhytos, Neapolis), qui remontent à César ou à Auguste, les unes certainement, les autres avec quelque vraisemblance. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Déductions de colonies italiennes en AfriqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIndépendamment de la transformation des villes phéniciennes en municipes ou en colonies italiques, beaucoup de cités de droit italique s'élevèrent en Afrique par suite de l'établissement de colons italiens. Le dictateur César avait pris l'initiative de cette colonisation; aucune province n'a peut-être été plus favorisée par lui en ce sens que l'Afrique, et les empereurs de la première dynastie suivirent son exemple. Nous avons déjà parlé de la fondation de Carthage; cette ville ne reçut pas immédiatement, mais très peu de temps après, des colons italiens qui apportèrent avec eux l'organisation italienne et le plein droit de cité romaine. Elle fut certainement destinée tout de suite à être la capitale de la province et bâtie comme une grande ville; elle le devint rapidement dans la réalité. Carthage et Lyon sont, outre la capitale de l'empire, les deux seules villes de l'Occident qui aient eu une garnison permanente de troupes impériales. De plus, soit le dictateur, soit le premier empereur créèrent toute une série de colonies, dans de petites villes de la côte d'Afrique la plus rapprochée de la Sicile; Hippo Diarrhytus, Clupea, Curubi, Neapolis, Carpi, Maxula, Uthina, Thuburbo majus, Assuras; elles furent établies non seulement en faveur de vétérans, mais aussi pour hâter la latinisation du pays. Si l'on constitua à cette époque dans l'ancien royaume de Numidie les deux colonies de Cirta avec ses dépendances, et de Cirta la Neuve ou Sicca, c'est parce que César avait fait des promesses spéciales au chef de bandes Publius Sittius de Nuceria et à ses troupes italo-africaines. La première de ces villes, située dans une région qui appartenait à un état client du peuple romain, conserva une organisation particulière et très indépendante, qui ne fut modifiée qu'en partie, même lorsque la ville devint une cité d'empire. Ces deux villes prospérèrent rapidement et devinrent deux foyers considérables de la civilisation romaine dans la nouvelle Afrique. |
||||
27 av. J.C.-54 |
Déduction de colonies italiennes en MaurétanieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa colonisation entreprise par Auguste et continuée par Claude dans le royaume de Juba présente un autre caractère. Dans la Maurétanie, encore très barbare à cette époque, les villes manquaient, ainsi que les éléments pour les fonder; l'établissement de soldats libérés qui avaient servi dans l'armée romaine introduisit la civilisation dans ce pays. C'est ainsi que dans la future province Césarienne, sur la côte, Igilgili, Saldae, Rusazu, Rusguniae, Gunugi, Cartenna (Tenès), plus loin de la mer, Thubusuptu et Zuccabar furent peuplées de vétérans d'Auguste, Oppidum novum de vétérans de Claude; de même dans la province de Tingi furent fondées, sous Auguste, Zilis, Babba, Banasa; sous Claude, Lix. Ces communes de droit romain ne dépendirent pas, comme nous l'avons déjà fait remarquer, des rois de Mauretanie, aussi longtemps qu'on les laissa régner; elles furent rattachées administrativement à la province romaine voisine; la création de ces établissements préluda à l'annexion de la Maurétanie1. La civilisation ne s'étendit jamais autant qu'Auguste et Claude l'avaient désiré, ou du moins ce ne fut que dans des limites très restreintes. Ce n'était pourtant pas l'espace qui manquait dans la partie occidentale de la province de Caesarea et dans celle de Tingi. Nous avons déjà dit que l'on accorda plus tard à certaines villes le titre de colonie romaine, sans que des colons y aient été conduits. 1. Pline dit bien (Hist. nat., V, 1, 2), en parlant de Zulil ou plutôt de Zili: regum dicioni exempla et jura in Baeticam petere jussa, et l'on pourrait appliquer ce mot au transfert de cette colonie en Bétique sous le nom de Julia Traducta (Strabon, III, 1, 8, p. 140); mais Pline ne donne probablement ce renseignement que pour Zili, parce qu'elle est la première colonie fondée hors de l'empire dont il fasse mention. Un citoyen d'une colonie romaine ne peut pas avoir été justiciable du roi de Mauretanie. |
||||
30 av. J.C.-476 |
La grande propriétéRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteA côté de l'organisation du municipe, il faut encore mentionner spécialement l'organisation de la grande propriété dans cette province. Dans le système romain la constitution de la grande propriété accompagne en règle générale celle de la municipalité; le développement des latifundia a porté à l'union de ces deux éléments moins de préjudice qu'on ne le croit volontiers, parce que habituellement, ces latifundia s'étendaient au loin et embrassaient souvent plusieurs territoires de cités. En Afrique, non seulement les grandes propriétés étaient plus nombreuses et plus importantes que partout ailleurs, mais elles possédaient une individualité analogue à celle des territoires de cités; autour de la maison du maître se formait un établissement qui ne le cédait en rien aux petites villes agricoles de la campagne; et quand le chef et le conseil municipal des bourgades dont dépendait ce grand propriétaire n'osaient pas, ou plus souvent encore ne pouvaient pas le contraindre à remplir toutes les charges municipales qui lui incombaient, on voyait se rompre les liens qui rattachaient ces grandes propriétés à la commune, surtout lorsqu'elles tombaient dans les mains de l'empereur1. Le fait se produisit fréquemment et de bonne heure en Afrique. Néron surtout confisqua, dit-on, la moitié des grandes propriétés africaines, et l'empereur avait l'habitude de garder ce qu'il avait pris. Les petits fermiers, auxquels on loua les terres du domaine, semblent avoir été pour la plupart des étrangers; l'établissement en Afrique de ces colons impériaux fait donc partie dans une certaine mesure de la colonisation italienne. 1. Frontin, dans le passage célèbre (p. 53, ed. Lachmann) où il raconte les procès entre des communes et des particuliers ou plutôt l'empereur, ne semble pas vouloir parler de grands domaines, légalement indépendants et semblables à des territoires de cités, ce qui est incompatible avec le droit romain; il parait faire allusion à la résistance qu'un grand propriétaire opposait aux prétentions d'une commune, relatives par exemple au recrutement ou aux corvées d'attelage qu'on réclamait de lui; ce propriétaire alléguait que le terrain en question était en dehors des limites du territoire communal. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Organisation des communautés berbèresRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNous avons fait remarquer plus haut que, pendant tout le temps de la domination romaine, les Berbères peuplaient en grande partie la Numidie et la Maurétanie. Quant à leur organisation intérieure, on n'en peut guère connaître que le groupement par tribus (gens)1, remplaçant l'organisation par villes, sous l'autorité de duumvirs ou de suffètes. Les confédérations indigènes ne furent pas rattachées, comme des sujets, ainsi qu'il arriva dans le Nord de l'Italie, à des municipalités isolées; elles furent soumises directement aux gouverneurs, à l'égal des cités constituées; là même où cela parut nécessaire, on mit à leur tête un officier romain (praefectus gentis), ou bien encore un fonctionnaire spécial2, un prince (princeps), qui plus tard se donna souvent le titre de roi, et onze notables : c'était là assurément une organisation monarchique qui était en opposition avec le système de collèges de magistrats, en vigueur dans les cités phéniciennes et latines. A côté du chef de la tribu se tenait un nombre limité d'Anciens, au lieu des nombreux décurions qui exerçaient dans les villes les fonctions de sénateurs. Par exception seulement les tribus indigènes de l'Afrique romaine furent rattachées plus tard à l'organisation italique. Les villes africaines de droit italique, qui ne devaient pas leur origine à l'immigration, avaient pour la plupart joui précédemment du droit municipal phénicien. Font exception à cette règle les tribus dont on changea de force la résidence, par exemple ces Numides expatriés qui fondèrent la ville de Thubursicum. Les tribus berbères habitaient surtout les montagnes et les steppes; elles obéissaient aux étrangers sans que les maîtres ni les étrangers sentissent le besoin d'entretenir des relations plus étroites. Les invasions se sont succédé dans le pays, mais la situation des indigènes est restée la même, en face des Vandales, comme en face des Byzantins, des Arabes et des Français. 1. L'expression technique de gens se rencontre dans le titre ordinaire de praefeclus gentis Musulamiorum, etc.; mais comme c'est là le nom donné à la dernière catégorie des communautés indépendantes, on évitait souvent de le mettre dans les dédicaces (cf. Corp. insc. lat., VIII, p. 1100), et on le remplaçait par celui de civitas, qui s'appliquait, comme le mot oppidum étranger à la langue technique et employé par Pline, à toutes les agglomérations qui n'étaient ni italiques ni grecques. Le changement de l'expression civitas Gurzensis (Corp. insc. lat., VIII, 69) en senatus populusque stipendiariorum pago Gurzenses, c'est-à-dire les anciens et le peuple des tribus qui paient l'impôt dans le village de Gurza nous montre bien quelle était la nature de la gens. 2. Lorsque le terme de princeps (Corp. insc. lat., VIII, p. 1101) n'est pas seulement une appellation, mais un titre précis, on le rencontre surtout dans les communautés qui ne sont ni des municipalités ni des parties de municipalités, et souvent aussi dans les gentes. On peut identifier les onze notables (cf. Eph. epigr., V, 302, 521, 523) avec les seniores, que l'on trouve çà et là. Nous sommes renseignés sur la valeur de ces deux fonctions par une inscription (Corp. insc. lat., VIII, 7041: Florus Labaconis f. princeps et undecimprimus gentis Saboidum). On a découvert récemment les ruines d'une agglomération berbère à Bou-Djelida, un peu à l'Ouest de la grande voie qui mène de Carthage à Theveste, dans une vallée du Djebel-Rihan, c'est-à-dire dans une région entièrement civilisée : cette agglomération est appelée, sur un monument du temps d'Antonin (Eph. epigr., VII, 86), gens Bacchuiana, et est administrée par onze anciens; les noms d'hommes (Candidus Balsomonis fil) sont moitié indigènes, moitié latins. Il faut remarquer que les gens de Calama comptaient les années par les noms des deux suffètes et du princeps (Corp. insc. lat., VIII, 5306, cf. 5369); il semble que cette communauté, libyenne sans doute, ait été d'abord gouvernée par un chef unique, qu'elle conserva même après avoir reçu des suffètes. Il est facile de comprendre pourquoi les monuments que nous possédons ne nous donnent guère de renseignements sur les tribus et leur organisation; les gens de cette espèce écrivaient peu sur la pierre. Les inscriptions libyques même appartiennent au moins pour la plupart à des villes habitées presque entièrement ou même tout à fait par des Berbères. Sur les inscriptions bilingues trouvées à Tenelium (Corp. insc. lat., VIII, p. 514), village situé en Numidie à l'Ouest de Bône dans la plaine de la Cheffia, et d'où l'on a tiré jusqu'à présent le plus grand nombre des inscriptions berbères, on trouve, dans la partie latine, des noms libyens. |
||||
30 av. J.C.-476 |
AgricultureRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugustePour l'agriculture la partie orientale de l'Afrique rivalise avec l'Egypte. Le sol est accidenté; les rochers et les steppes, qui constituent presque toute la partie occidentale, sont aussi très étendus à l'Est; aussi trouve-t-on dans cette région mainte contrée montagneuse d'un accès difficile, où la civilisation ne pénétra que tardivement et même ne pénétra pas du tout: la domination romaine n'a presque pas laissé de traces dans les rochers escarpés de la côte. C'est en généralisant faussement ce qui est vrai de certains points du rivage et des oasis, que l'on a désigné comme un pays très fertile la Byzacène, située au Sud-Est de la province consulaire; à l'Ouest de Sufetula (Sbeitia) la région est desséchée et rocheuse; au cinquième siècle après J.-C., la proportion entre la terre cultivable et le reste du sol était, en Byzacène, moitié moindre que dans les autres provinces africaines. Mais la partie Nord et Nord-Ouest de la province proconsulaire, surtout la vallée du plus grand fleuve de l'Afrique septentrionale, du Bagradas, (Medjerda), et aussi des territoires considérables en Numidie, produisaient des récoltes en céréales presque aussi abondantes que dans la vallée du Nil. Dans les districts privilégiés, les villages, si l'on en juge d'après leurs ruines, étaient si habités et si rapprochés les uns des autres, que la population n'était guère moins dense dans ce pays que dans la vallée du Nil; suivant toutes les apparences l'agriculture y était partout en honneur. Les armées puissantes, avec lesquelles les républicains soutinrent en Afrique la lutte contre César, après la défaite de Pharsale, étaient composées de ces paysans d'Afrique, si bien que les champs restèrent incultes pendant la durée de la guerre. Depuis que l'Italie consommait plus de blé qu'elle n'en produisait, c'était à l'Afrique qu'elle s'adressait en même temps qu'aux îles italiennes; l'une n'était guère plus éloignée d'elle que les autres. Lorsque ce pays fut devenu sujet des Romains, le blé africain fut transporté en Italie comme impôt et non plus seulement comme denrée commerciale. Déjà au temps de Cicéron la capitale de l'empire vivait en grande partie de ce blé; la Numidie une fois devenue une province romaine, sous la dictature de César, la quantité de blé importée en Italie comme impôt fut augmentée annuellement de douze cent mille boisseaux romains (525 000 hectolitres). Puis quand, sous Auguste, on organisa les transports de blé égyptien, on prit l'habitude de demander à l'Afrique septentrionale le tiers du blé consommé à Rome, à l'Egypte un autre tiers, à la Sicile dévastée, à la Sardaigne et à la Bétique le reste, moins ce que l'Italie produisait elle-même. Les mesures prises pendant les guerres entre Vitellius et Vespasien, entre Sévère et Pescennius Niger, nous montrent dans quelle mesure l'Italie impériale avait recours à l'Afrique pour sa subsistance: Vespasien ne songea à conquérir l'Italie qu'une fois maître de l'Egypte et de l'Afrique. Sévère envoya une forte armée en Afrique pour empêcher Pescennius de l'occuper. La production de l'huile et du vin avait déjà joué un rôle important dans l'agriculture des anciens Carthaginois; Leptis la petite (près de Sousse) pouvait payer à César un impôt annuel de trois mille livres d'huile (environ 10000 hectolitres) pour les bains romains; et alors, comme aujourd'hui, Sousse exportait annuellement 40000 hectolitres d'huile. Pourtant l'historien de la guerre de Jugurtha dit que l'Afrique était riche en blé, pauvre en huile et en vin; sous ce rapport, au temps de Vespasien, le rendement de cette province n'était encore que peu important. Mais lorsque l'empire eut assuré une paix durable, plus nécessaire encore aux arbres fruitiers qu'aux céréales, la culture de l'olivier prit une grande extension; au quatrième siècle aucune province n'exportait autant d'huile que l'Afrique, et celle que l'on employait dans les bains de Rome provenait en grande partie de ce pays. Sans doute elle était inférieure en qualité à celle de l'Italie et de l'Espagne, non parce que ce climat y est moins favorable, mais parce qu'on la fabriquait avec moins de soin et de précautions. La culture de la vigne en Afrique n'a jamais donné lieu à un grand commerce d'exportation. Au contraire l'élève des chevaux et du bétail était très prospère en Numidie et en Mauretanie. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Industrie et commerceRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'industrie et le commerce n'eurent jamais dans les provinces africaines la même importance qu'en Orient et en Egypte. Les Phéniciens avaient apporté de leur pays et établi dans cette région la fabrication de la pourpre, l'île de Girba (Djerba) était devenue la Tyr d'Afrique, et ne le cédait qu'à celle d'Asie, même pour la qualité. Cette industrie prospéra pendant tout l'empire. Parmi les quelques faits importants qui se rattachent au règne de Juba II, il faut citer l'établissement de pêcheries de pourpre sur la côte de l'Océan Atlantique et dans les îles voisines. Les indigènes de la Maurétanie fabriquaient des étoffes de laine de qualité inférieure et quelques articles de cuir, non seulement pour leur consommation, mais encore pour l'exportation1. Le commerce des esclaves était très considérable. Les produits de l'intérieur du pays passaient naturellement par l'Afrique septentrionale avant d'être livrés à l'exportation, mais non pas dans la mesure où le fait se produisait en Egypte. Les armes de la Mauretanie représentent un éléphant; cet animal, que l'on ne voit plus depuis longtemps dans le pays, y était encore chassé sous les empereurs; mais il est probable que le commerce n'en profitait pas beaucoup. (Prospérité du pays) La prospérité, qui régna surtout dans la partie cultivée de l'Afrique, est clairement prouvée par les ruines de ses nombreuses cités; malgré le peu d'étendue qu'elles occupaient, elles possédaient toutes des bains, des théâtres, des arcs de triomphe, des mausolées, en un mot des constructions luxueuses de toutes sortes, d'un art assez ordinaire, mais souvent d'une assez grande splendeur. La force économique du pays résidait non pas dans la haute noblesse, comme dans les Gaules, mais dans la classe moyenne des agriculteurs2. 1. Pline (Hist. nat., VI, 31, 201) nous dit que la pourpre de Gétulie remonte à Juba : paucas (Mauretaniae insulas) constat esse ex adverso Autololum a Juba repertas, in quibus Gaetulicam purpuram tinguere instituerat: ces insulae purpurariae (ibid., 203) ne peuvent être que Madère. En réalité c'est Horace qui fait le premier mention de cette pourpre (Ep., II, 2, 181). Nous manquons de preuves pour affirmer que cette fabrication se continua, et comme la domination romaine n'a pas été établie sur ces îles, cela est peu probable, quoique le sagum purpureum cité dans le tarif de Zaraï (Corp. insc. lat., VIII, 4508) puisse être rapproché de la fabrication de la pourpre de Mauretanie. 2. Le tarif de Zaraï établi à la frontière douanière entre la Numidie et la Maurétanie (Corp. insc. lat., VIII, 4508), qui date de l'an 202, nous donne un tableau détaillé de l'exportation mauretanienne. On y trouve du vin, des figues, des dattes, des éponges; mais le commerce porte principalement sur les esclaves, le bétail de toute sorte, les étoffes de laine (vestis afra) et les objets en cuir. La géographie du globe du temps de Constance porte aussi (c. 20) que la Mauretanie vestem et mancipia negotialur. 3. D'après une inscription funéraire trouvée à Mactaris, dans la Byzacène (Eph. epigr., V, 279), un homme libre de ce pays, après avoir travaillé à la moisson dans différentes parties de l'Afrique, d'abord comme simple moissonneur pendant douze ans, puis pendant onze ans comme ouvrier chef, acheta avec l'argent qu'il avait amassé une maison de ville et une maison de campagne, puis devint membre du conseil municipal et maire de sa ville. Son épitaphe assez poétique prouve sinon qu'il avait de la culture, du moins qu'il prétendait en avoir. Une telle carrière n'était pas aussi rare qu'on pourrait le croire, à l'époque impériale, mais il est probable qu'on en trouvait en Afrique des exemples plus nombreux qu'ailleurs. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Moyens de communicationRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteA en juger par la connaissance que nous avons du réseau des voies romaines, l'activité du trafic correspondait sans doute, dans l'intérieur des régions civilisées, à la densité de la population. C'est pendant le premier siècle que l'on construisit les routes impériales, qui reliaient le quartier général de cette époque, Theveste, soit à la côte de la petite Syrte - ce qui concorde avec la pacification des districts compris entre l'Aurès et la mer, pacification dont nous avons déjà parlé, - soit aux grandes villes de la côte septentrionale Hippo regius (Bône) et Carthage. Au second siècle toutes les grandes cités et même quelques villages s'occupèrent d'établir, à l'intérieur de leur territoire, les communications nécessaires : il en était de même dans les autres parties de l'empire; mais nous le savons surtout de l'Afrique, parce qu'on saisissait, plus que partout ailleurs, cette occasion de rendre hommage à l'empereur régnant par une inscription. Nous n'avons aucune connaissance d'ensemble des routes des districts soumis aux Romains, mais non romanisés, et des chemins qui traversaient le désert et qui étaient d'une importance capitale pour le commerce. Il est vraisemblable que l'apparition du chameau à cette époque produisit un changement considérable dans les communications à travers le désert. A une époque plus reculée, cet animal ne se rencontre qu'en Asie jusqu'à l'Arabie inclusivement; l'Egypte et l'Afrique tout entière ne connaissent que le cheval. Pendant les trois premiers siècles de notre ère, un changement important eut lieu dans ces contrées : le cheval arabe et le chameau de Libye entrent, pour ainsi dire, dans l'histoire. Ce dernier est mentionné pour la première fois dans l'histoire de la guerre faite par le dictateur César en Afrique; parmi le butin on cite, à côté des officiers faits prisonniers, 22 chameaux qui appartenaient au roi Juba : nous devons en conclure que la possession d'un aussi grand nombre de ces animaux était alors en Afrique un fait extraordinaire. Au quatrième siècle les généraux romains, avant d'entreprendre une expédition dans le désert, réquisitionnent dans les villes de la Tripolitaine plusieurs milliers de chameaux pour le transport de l'eau et des vivres. D'après cela, nous pouvons nous rendre compte de la révolution qui s'était opérée dans les relations commerciales entre le Nord et le Sud de l'Afrique : il est difficile de dire si elle prit naissance en Egypte ou à Cyrène et en Tripolitaine; mais toute l'Afrique septentrionale en bénéficia largement. |
||||
30 av. J.C.-476 |
Caractère et civilisation des habitantsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes finances de l'empire retiraient un grand profit de l'Afrique septentrionale. La nation romaine a-t-elle gagné ou perdu à s'assimiler cette province ? On ne peut guère le dire. L'antipathie, que les Italiens éprouvaient depuis longtemps pour les Africains, ne diminua pas lorsque Carthage fut devenue une capitale romaine, et lorsque toute l'Afrique du Nord parla latin. Sévère Antonin réunissait en lui, disait-on, les vices de trois nations : on attribua sa cruauté farouche à son origine africaine. L'introduction de l'élément africain dans la littérature romaine de l'époque impériale, autant que nous pouvons l'apprécier, ne fit qu'accentuer les défauts de cette littérature. La vie nouvelle, que les Romains puisèrent dans les ruines des peuples soumis, manqua de plénitude, de fraîcheur et de grâce; les deux créations de César, la Gaule et l'Afrique du Nord - car la romanisation de l'Afrique n'est guère moins son oeuvre que celle de la Gaule sont restées inachevées. Pourtant la toge convient mieux au nouveau Romain du Rhône et de la Garonne qu'aux semi-Numides et semi-Gétules. Carthage n'était pas de beaucoup inférieure à Alexandrie pour la population et la richesse, elle était sans conteste la seconde ville de la partie latine de l'empire, la cité la plus vivante, peut-être aussi la plus corrompue de l'Occident après Rome, le centre le plus important de la civilisation et de la littérature latines. Saint Augustin nous montre, dans une peinture énergique, comment il arrivait souvent que des jeunes gens bien nés de la province se perdissent dans les plaisirs du cirque, et comment lui-même, étudiant de dix-sept ans, lorsqu'il vint de Madaure à Carthage, fut entraîné vers le théâtre par la tragédie et les pièces amoureuses qu'on y représentait. L'amour de l'étude et le talent n'étaient pas rares en Afrique; plus peut-être que partout ailleurs dans l'empire, on s'y occupait d'enseigner le latin et le grec, et d'assurer l'instruction générale, qui était le but de cet enseignement; les écoles y furent très nombreuses. Le philosophe Apulée sous Antonin, le célèbre auteur chrétien saint Augustin appartenaient à la bonne bourgeoisie. L'un était de Madaure, l'autre de Thagaste, petite localité voisine. Ils reçurent leur première éducation dans l'école de leur pays; puis Apulée étudia à Carthage, et compléta son instruction à Athènes et à Rome; saint Augustin alla d'abord de Thagaste à Madaure, ensuite de Madaure à Carthage; ils suivaient en ceci la méthode adoptée dans les meilleures familles pour l'éducation des jeunes gens. Juvénal conseille à un professeur de rhétorique, qui veut gagner de l'argent, d'aller en Gaule ou plutôt en Afrique la nourrice des avocats. Dans une propriété seigneuriale des environs de Cirta, on a mis récemment au jour une salle de bains d'un luxe princier, remontant aux dernières années de l'époque impériale. Les mosaïques qui en recouvrent le sol nous retracent la vie qu'on menait alors dans ce château : au premier plan, le palais, le vaste parc de chasse avec ses chiens et ses cerfs, les stalles avec leurs fiers coursiers : mais il y a un coin réservé à l'étude (filosofi locus), et l'on voit la maîtressse du palais assise sous les palmiers. La littérature africaine naquit fort tard; avant Hadrien et Antonin on ne trouve parmi les écrivains latins aucun nom africain qui ait eu quelque renommée; et plus tard les Africains, devenus célèbres, ne sont pour la plupart que des professeurs, qui ont écrit. Sous ces empereurs les maîtres et les savants les plus courus de la capitale sont originaires d'Afrique: ce sont le rhéteur Marcus Cornelius Fronton de Cirta, précepteur à la cour d'Antonin, et le philologue Gaius Sulpicius Appollinaris de Carthage. Ce qui domine dans cette littérature, c'est tantôt le purisme extravagant qui ramène la langue latine aux antiques tournures d'Ennius et de Caton, et qui fit la réputation de Fronton et d'Appollinaris, tantôt l'oubli complet de la correction rigoureuse particulière au latin; c'est encore une légèreté de mauvais goût, imitant de pauvres modèles grecs d'une façon plus pauvre encore, dont nous trouvons l'exemple le plus frappant dans le roman de l'Ane, écrit par le philosophe de Madaure et très goûté à cette époque. La langue fourmillait soit de réminiscences classiques, soit de mots et de tournures fantaisistes et de création récente. Dans l'empereur Sévère, Africain de bonne famille, savant et même écrivain, on reconnaissait toujours l'Africain à son accent; il en est de même du style de tous les Africains, même des plus lettrés et de ceux qui avaient reçu dès l'enfance une éducation romaine, du Carthaginois Tertullien par exemple; ses écrits se distinguent par un caractère exotique et disparate; il se sert de grands mots pour exprimer des bagatelles; son style est décousu, il joue avec les idées, et passe d'une pensée à l'autre. Il lui manque deux qualités, la grâce du Grec et la dignité du Romain. Ce qui est curieux, c'est qu'on ne rencontre, parmi les écrivains latins originaires de l'Afrique, aucun poète qui mérite d'être cité. La situation change à l'époque chrétienne. L'Afrique joue certainement le premier rôle dans le développement du christianisme : s'il est né en Syrie, c'est dans l'Afrique et par l'Afrique qu'il est devenu une religion universelle. Lorsque les livres saints eurent été traduits d'hébreu en grec, et même dans la langue populaire des principales communautés juives établies en dehors de la Judée, la religion juive se répandit partout; le christianisme se propagea de même de l'Orient vaincu dans l'Occident vainqueur, par la traduction de ses livres sacrés; d'autant plus que ces livres furent traduits non pas dans la langue savante de l'Occident, qui avait cessé de bonne heure d'être la langue usuelle, quoiqu'elle fût encore enseignée dans les écoles sous les empereurs, mais dans ce latin vulgaire, parlé par les grandes masses, et qui servit de transition entre le latin classique et la langue romane. Si, lorsque l'état religieux des Juifs disparut, le christianisme, se détachant de ses bases judaïques, devint une religion universelle, c'est parce qu'il adopta la langue parlée dans tout l'empire. Les hommes obscurs, qui, à partir du second siècle, traduisirent en latin les Saintes Ecritures, ont accompli à cette époque une oeuvre semblable à celle que poursuivent aujourd'hui, sur les traces de Luther, les missions bibliques, dans une scène agrandie par l'extension des peuples. Ces hommes étaient en partie Italiens mais surtout Africains1. Selon toute apparence, on connaissait beaucoup moins le grec en Afrique qu'à Rome; or cette connaissance est indispensable à des traducteurs. D'autre part, l'élément oriental si important au début du christianisme trouva dans l'Afrique un accueil beaucoup plus empressé que dans les autres pays de l'Orient, où le latin était parlé. En outre, dans la littérature de polémique à laquelle la nouvelle foi donna naissance, l'Afrique ne parle que la langue latine, tandis que l'Eglise romaine subit à cette époque l'influence grecque. Jusqu'à la fin de cette période, tous les écrivains chrétiens qui font usage du latin viennent d'Afrique : Tertullien et Cyprien étaient de Carthage, Arnobe de Sicca; Lactance, et probablement aussi son émule Minucius Félix, en dépit de leur latin classique, sont des Africains, aussi bien qu'Augustin qui vint plus tard et dont nous avons déjà parlé. C'est en Afrique que l'Eglise naissante trouva ses disciples les plus zélés, ses représentants les plus remarquables. Dans la lutte littéraire provoquée par la nouvelle religion, c'est l'Afrique qui fournit les champions les plus nombreux et les plus enthousiastes; leur originalité apparut puissante dans la lutte qu'ils soutinrent contre les dieux d'autrefois; ils employèrent tour à tour la discussion savante, l'ironie mordante sous forme d'apologues, la violence passionnée. Nulle part, dans toute l'antiquité, on ne trouve rien de comparable à cet esprit que nous font connaître les Confessions de saint Augustin, gagné d'abord à tous les enivrements de la vie, pour s'embraser ensuite de l'enthousiasme de la foi. 1. Il serait difficile de déterminer avec précision si les versions latines que nous possédons de la Bible proviennent de traductions primitivement différentes, ou bien si, comme le prétendait Lachmann, les diverses récensions sont sorties d'une seule et même traduction augmentée de commentaires. Ce travail soit de traduction, soit de correction a été fait par des Italiens autant que par des Africains : c'est ce que prouvent les fameuses paroles de saint Augustin (De doctr. Christ., II, 15, 22): in ipsis autem interpretationibus Itala ceteris praeferatur, nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae, paroles que des autorités compétentes ont contestées, mais à tort. La proposition de Bentley, approuvée récemment et reprise par Corsen (Jahrbuch fur protestant. Theol., VII, p. 507 et suiv.), qui veut transformer Itala en illa et nam en quae, est inadmissible, aussi bien philologiquement que sous le rapport des faits. Ce double changement n'a aucune apparence de probabilité; en outre la leçon nam est appuyée par le copiste Isidore (Etym., VI, 4, 2). Il n'est pas juste de prétendre, comme on l'a fait, que l'usage réclame le mot Italica (Italus est employé par Sidoine et par Jordanès, ainsi que dans les inscriptions de l'époque postérieure: Corp. insc. lat., X, p. 1146; ce mot alterne avec Italicus); et le fait de désigner une traduction comme étant généralement la plus exacte, n'est pas incompatible avec le conseil de collationner ensemble le plus grand nombre possible de versions différentes. En changeant le texte, on transforme une observation sensée en une remarque banale dépourvue de sens. Il est vrai que pendant les trois premiers siècles la communauté chrétienne de Rome usa de la langue grecque, et qu'il ne faut pas chercher parmi eux les Italiens traducteurs de la Bible en latin. Mais hors de Rome en Italie, surtout dans la haute Italie, on ne connaissait pas le grec beaucoup mieux qu'en Afrique: les noms d'affranchis le prouvent jusqu'à l'évidence. L'observation de saint Augustin concerne précisément la partie non romaine de l'Italie; il n'est peut-être pas inutile de rappeler que cet évèque fut converti au christianisme par saint Ambroise de Milan. Dans ce qui nous reste des traductions de la Bible antérieures à saint Jérôme, il serait difficile de retrouver les traces d'une récension italienne postérieure à saint Augustin, mais il ne serait pas beaucoup plus facile de prouver que des Africains seuls ont travaillé aux traductions latines de la Bible antérieures à saint Jérôme. Beaucoup d'entre elles, sinon la plupart, ont été faites en Afrique, selon toute vraisemblance. La mention d'un texte en latin d'Italie (Itala) nous fait croire que plusieurs autres venaient d'Afrique (Afrae): le latin vulgaire, dans lequel ces traductions sont toutes faites, correspond bien au latin vulgaire que l'on parlait alors en Afrique. Nous ne devons pas oublier, il est vrai, que nous connaissons le latin vulgaire surtout d'après des sources africaines, et qu'on n'a pas encore prouvé, si utile que cette démonstration puisse être, que cette langue était exclusivement parlée en Afrique. Il existait en même temps des expressions vulgaires usitées partout et des idiotismes africains (cf. Eph. epigr., IV, p. 520, sur les cognomina en -osus): les formes glorificare, justificare, sanctificare appartiennent à la seconde catégorie; mais il n'est pas certain qu'elles soient exclusivement employées en Afrique, car nous n'avons pas pour Capoue et Milan les documents que Tertullien nous fournit pour Carthage. |
||||