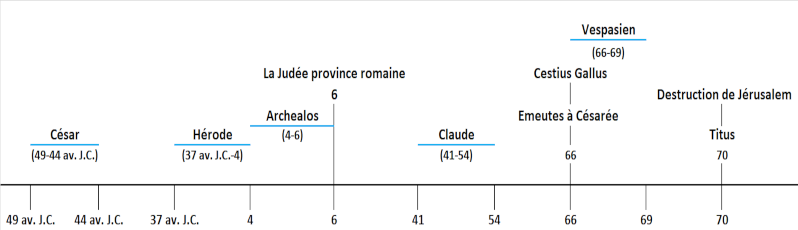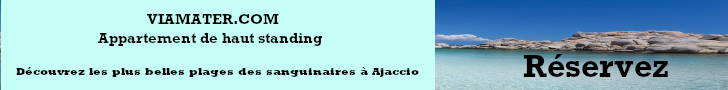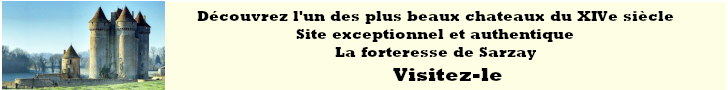|
|||||
La Judée
Sources historiques : Théodore Mommsen Vous êtes dans la catégorie : Empire Chapitre suivant : L'Egypte Chapitre précédent : La Syrie et les pays Nabatéens Dans ce chapitre : 42 rubriques; 28 234 mots; 147 533 caractères (espaces non compris); 175 522 caractères (espaces compris) Format 100% digital de cette rubrique (via l'espace membre) | |||||
305-27 av. J.C. |
La Judée et le gouvernement des prêtres sous les SéleucidesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Juifs du Jourdain, avec lesquels les Romains eurent à faire, n'étaient pas le peuple qui combattit Moab et Edom sous ses juges et sous ses rois, et qui écouta les discours d'Amos et d'Hosée. Le petit cénacle de pieux exilés, qui avaient été chassés de leur patrie par la domination étrangère, et que les vicissitudes de la domination étrangère avait ramenés en Palestine, commença, aussitôt après son retour, à écarter durement les descendants de leurs compatriotes, qui étaient restés dans leur pays, et à faire naître une haine implacable entre les Juifs et les Samaritains; cette société, modèle d'exclusivisme national et d'étroitesse sacerdotale, avait fondé, bien avant l'époque romaine, sous le gouvernement des Séleucides, ce que l'on a appelé la Théocratie mosaïque, collège religieux dirigé par un archiprêtre, s'appuyant sur la domination étrangère, et renonçant à toute puissance politique, pour conserver l'originalité du peuple et pour le dominer, sous la protection de l'étranger. Ce qui distingue le judaïsme des derniers temps, c'est précisément d'avoir dédaigné toute importance politique pour sauvegarder le caractère national dans les formes religieuses. Toute conception de la divinité est, dans sa physionomie propre, particulière à un peuple; mais aucun Dieu n'est resté le dieu spécial de ses adorateurs autant que Iahvé et cela sans distinction ni de temps ni de lieux. Ces exilés, revenus dans le pays sacré pour eux, qui croyaient vivre suivant les préceptes de Moïse et qui vivaient en réalité d'après les lois d'Ezras et de Néhémie, furent toujours les sujets des grands rois de l'Orient et plus tard des Séleucides, comme ils l'avaient été pendant la captivité de Babylone. Leur organisation n'avait pas plus d'éléments politiques que, de nos jours, les églises arménienne et grecque, qui vivent au milieu de l'empire turc, sous l'autorité de leurs patriarches. |
||||

|
|||||
140-27 av. J.C. |
Royauté des HasmonéensRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa révolution ne se fit pas longtemps attendre. Cette église sans organisation politique ne pouvait vivre que sous le patronage ou la surveillance d'une grande puissance temporelle. Lorsque l'empire des Séleucides tomba en décadence, un état juif fut reconstitué, à la suite d'une révolte contre la domination étrangère, qui tira précisément ses meilleures forces de la foi enthousiaste du peuple. L'archiprêtre de Salem dut quitter le temple pour livrer bataille. Non seulement les Hasmonéens rendirent presque ses anciennes limites au royaume de Saül et de David, mais encore ces grands-prêtres guerriers rétablirent en quelque façon l'antique royauté véritablement politique, à laquelle obéissait le clergé. Cependant ce gouvernement, à la fois fils et ennemi de l'autorité sacerdotale, déplaisait au parti religieux. Les Pharisiens et les Sadducéens se séparèrent, et leur lutte commença. Ce n'étaient pas des articles de foi ni des différences dans le rite qui les divisaient réellement; il y avait opposition entre le gouvernement sacerdotal, d'une part, uniquement préoccupé de l'organisation et des intérêts religieux et qui n'attachait aucune importance à la liberté et à l'autonomie du peuple, et, de l'autre, la royauté, qui voulait provoquer un développement politique, et qui s'efforçait, au milieu des luttes qui se livraient alors dans le royaume de Syrie, de rendre au peuple juif son ancienne situation par les combats et les traités. La foule soutenait les prêtres; les hommes intelligents et les classes supérieures favorisaient l'autre parti, dont le représentant le plus considérable fut le roi Iannaeos Alexandros; pendant tout son règne, celui-ci dut lutter à la fois contre les princes syriens et contre les Pharisiens ses compatriotes. Quoique cette politique ne fût à proprement parler qu'une expression différente de l'enthousiasme national, expression en réalité plus naturelle et plus puissante, les princes juifs, tout en pensant et en agissant librement, entrèrent en contact avec l'hellénisme; leurs ennemis du parti religieux en profitèrent pour les traiter d'étrangers et d'infidèles. |
||||
140-27 av. J.C. |
La dispersion des JuifsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais les habitants de la Palestine n'étaient qu'une partie, et la partie la moins importante des Juifs. Les Juifs de la Babylonie, de la Syrie, de l'Asie Mineure et de l'Egyte étaient de beaucoup supérieurs aux Juifs de Palestine, même lorsque ceux-ci eurent été régénérés par les Macchabées. L'oeuvre de ces princes est beaucoup moins considérable que la dispersion des Juifs, dans l'histoire de l'époque impériale. Cette dispersion est un événement d'un caractère tout à fait particulier. L'expansion des Juifs hors de la Palestine n'a été déterminée que dans une très faible mesure par le mouvement d'émigration qui emmena les Phéniciens et les Grecs. Primitivement le peuple israélite était un peuple d'agriculteurs, qui habitaient loin de la côte, et qui se sont répandus à l'étranger malgré eux et relativement tard, sous l'influence d'Alexandre ou de ses lieutenants1. Lorsque les Grecs, pendant plusieurs générations, fondèrent ces innombrables cités dont l'établissement est un fait inouï dans le passé, et qui ne devait plus jamais se renouveler depuis, les Juifs contribuèrent à cette oeuvre pour une part importante, si étrange qu'il fût de recourir à eux pour helléniser l'Orient. Ils s'établirent surtout en Egypte. Alexandrie du Nil, la plus importante de toutes les villes fondées par Alexandre, était une cité juive autant que grecque, dès le règne du premier Ptolémée, qui, après s'être emparé de la Palestine, avait transporté dans sa capitale un grand nombre d'Israélites; cette colonie juive était au moins égale en nombre, en richesse, en intelligence, à la population de Jérusalem; elle était aussi bien organisée. Sous les premiers empereurs, on comptait un million de Juifs pour huit millions d'Egyptiens. Nous avons déjà dit que les Juifs, établis dans la capitale de la Syrie, pour rivaliser avec ceux d'Egypte, s'étaient organisés comme eux et avaient fait les mêmes progrès. Ce qui nous prouve quelle extension et quelle importance les colonies juives avaient prises dans l'Asie Mineure, c'est la tentative que firent sous Auguste les villes grecques de l'Ionie; elles voulurent, ce semble, après une entente préalable, obliger les Juifs établis dans leurs murs à renier leur foi ou à supporter tout le poids des charges publiques. Il y avait certainement des colonies juives indépendantes dans toutes les villes grecques nouvellement fondées2 et même dans les anciennes cités helléniques, dans la Hellade proprement dite, par exemple à Corinthe. Leur organisation se perfectionna de plus en plus, mais fut soumise à certaines conditions : les Juifs conservaient leur nationalité, en acceptant les conséquences très graves de cette situation, conséquences qu'ils en tiraient eux-mêmes; on leur imposa seulement l'usage de la langue grecque. Au milieu des progrès ou plutôt de l'invasion de l'hellénisme en Orient, les Juifs des villes grecques restèrent des Orientaux qui parlaient grec. 1. Il est fort douteux qu'Alexandre lui-même ait donné aux Juifs d'Alexandrie la situation légale qu'ils occupaient dans cette ville, comme le prétend Josèphe (Contra Ap., II, 4); nous savons en effet qu'ils ne furent importés en masse dans l'Egypte que par le premier Ptolémée (Josèphe, Ant. Jud., XII, 1; Appien, Syr., 50). Les établissements juifs se ressemblent tous dans les différents états des Diadoques; s'ils n'ont pas été organisés par Alexandre, il faut en conclure que les différents princes qui lui succédèrent rivalisaient et s'imitaient les uns les autres dans la fondation des villes. Ce qui a contribué certainement à la dispersion des Juifs, c'est que la Palestine était tantôt égyptienne et tantôt syrienne. 2. C'est à la colonie juive de Smyrne que fait allusion une inscription découverte récemment dans cette ville (Reinach, Revue des études juives, 1883, p. 161). Il est rare que de simples collèges soient placés sur la même ligne qu'une ville ou qu'une municipalité, quand il s'agit, comme ici, d'édicter des peines. |
||||
140-27 av. J.C. |
La langue grecqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe n'est pas seulement parce qu'elle était la langue naturelle des affaires, que la langue grecque domina dans les colonies juives des villes macédoniennes, c'est aussi parce qu'elle leur fut rendue obligatoire : ce fait était la conséquence nécessaire de la situation générale. Plus tard Trajan a suivi la même méthode pour romaniser la Dacie avec des colons venus de l'Asie Mineure. Sans cette contrainte imposée aux Juifs, les fondateurs de villes n'auraient pas pu créer des cités extérieurement uniformes, et les éléments venus de la Judée n'auraient pas pu servir à helléniser le pays. Les Saintes Ecritures des Hébreux avaient déjà été traduites en grec sous le règne des premiers Ptolémées; ce travail fut entrepris aussi peu sur l'ordre du gouvernement que la traduction de la Bible de Luther, mais c'était bien l'intention des rois d'Egypte d'helléniser par la littérature les Juifs de leur pays; et cette oeuvre s'accomplit avec une rapidité remarquable. Au début de l'empire romain, et probablement depuis longtemps, la connaissance de l'hébreu était à peu près aussi rare parmi les Juifs d'Alexandrie que, de nos jours, celle du texte original des livres saints parmi les chrétiens, et l'on employait comme arguments les fautes de traduction des Alexandrins, qu'on nomme les Septante. A cette époque la langue nationale des Juifs disparaît partout du commerce ordinaire; elle ne se conserva que dans les rites ecclésiastiques, comme aujourd'hui la langue latine ne subsiste que dans l'église catholique. En Judée même, elle fut remplacée par l'araméen, langue voisine, il est vrai, de l'hébreu et qui devint l'idiome populaire de la Syrie. Les colonies juives fondées hors de la Palestine, et dont nous nous occupons, abandonnèrent complètement les langues sémitiques; et la réaction, qui a rétabli méthodiquement chez tous les Juifs la connaissance et l'usage de ces langues, est de beaucoup postérieure. Pendant les premiers temps de l'empire, les nombreuses oeuvres littéraires composées par des Juifs sont toutes grecques. Si la langue seule constituait la nationalité, nous n'aurions presque rien à dire des Juifs à cette époque. |
||||
509-27 av. J.C. |
Persistance de la nationalitéRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais, si dès le début on obligea les Juifs à parler grec, malgré leur répugnance, on reconnut du moins leur nationalité particulière, et on leur en fit subir toutes les conséquences. Partout dans les villes de l'empire d'Alexandre la population se composait de Macédoniens, c'est-à-dire de Grecs réellement originaires de Macédoine, ou assimilés aux vrais Macédoniens. Il y avait de plus, sans compter les étrangers, les indigènes, comme les Egyptiens à Alexandrie, les Libyens à Cyrène, et surtout les colons venus de l'Orient, qui n'avaient pas d'autre patrie que la nouvelle cité, mais qui n'étaient pas considérés comme des Grecs. Les Juifs appartiennent à cette seconde catégorie; mais à eux et à eux seuls, il était permis de former pour ainsi dire un Etat dans l'Etat; et, tandis que les autres habitants non citoyens étaient soumis aux autorités municipales, les Juifs s'administraient eux-mêmes dans une certaine mesure1, Les Juifs, dit Strabon, ont à Alexandrie un chef de peuple spécial, qui commande au peuple, qui juge les procès, qui décide dans les traités et qui signe des ordres, comme s'il était à la tête d'une cité indépendante. S'il en était ainsi, c'est parce que les Juifs avaient prétendu que leur nationalité, ou ce qui revient au même, leur religion, réclamait une juridiction spéciale. Les grands gouvernements politiques tinrent compte dans une large mesure du caractère national-religieux des Juifs, et l'aidèrent à se développer, en lui accordant tous les privilèges possibles. La cohabitation était sinon habituelle, au moins très fréquente: à Alexandrie, par exemple, deux des cinq quartiers de la ville étaient occupés surtout par des Juifs. Il ne semble pas que ce soit là une application du système de ghetto, mais bien plutôt une coutume qui datait du premier établissement, et qui avait été maintenue des deux côtés; on évitait par là tous les conflits qui pouvaient naître entre voisins. 1. Si l'on continua dans la suite à considérer les Juifs d'Alexandrie comme les égaux des Macédoniens qui habitaient la même ville (Josèphe, Contra Ap., II, 4; De bell. Jud., 18, 7), c'est que l'on dénatura la situation véritable. Ils étaient domiciliés à côté de la tribu des Macédoniens, sans doute la plus considérable et qui pour cette raison avait emprunté son nom à Dionysos (Theophilus, ad Aulolycum, II, 7); comme le quartier des Juifs formait une partie de cette tribu, Josèphe en fait à sa manière les égaux des Macédoniens. La situation légale de la population des villes grecques de cette catégorie nous est décrite très clairement par Strabon (dans Josèphe, Ant. Jud., XIV, 7, 2). Il divise les habitants de Cyrène en quatre catégories : citoyens, paysans (yawpyo!), étrangers et juifs. Si l'on fait abstraction des météques, dont la patrie légale est ailleurs, il reste, comme Cyrénéens légitimes, les citoyens qui jouissent de tous les privilèges, par conséquent les Hellènes et les assimilés, et les deux catégories d'habitants qui n'exerçaient pas activement leurs droits de citoyens, les Juifs qui forment une société à part, et les sujets, les Libyens, qui sont privés de l'autonomie. En altérant un peu les faits, il était facile d'attribuer les mêmes droits aux deux catégories privilégiées. |
||||
509-27 av. J.C. |
Importance de la dispersionRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAinsi les Juifs réussirent à jouer un rôle prépondérant dans l'oeuvre entreprise par les Macédoniens, dans l'hellénisation de l'Orient; leur souplesse et leur docilité d'une part, leur ténacité indomptable de l'autre doivent avoir décidé les hommes d'Etat très pratiques qui donnèrent cet exemple, à prendre une pareille résolution. L'extension et l'importance extraordinaires que prit l'émigration juive, sortie d'une contrée aussi étroite, n'en restent pas moins à la fois une réalité et une énigme. Il ne faut pas oublier en outre que les Juifs originaires de la Palestine n'ont formé que le noyau des Juifs répandus à l'étranger. Le judaïsme des premiers temps n'est rien moins qu'exclusif; au contraire, grâce au zèle des missionnaires, il s'est propagé tout autant que plus tard le christianisme et l'islam. L'évangile parle des rabbins, qui traversent terre et mer pour faire un prosélyte; l'admission de demi-fidèles, auxquels l'on accordait une certaine communion religieuse, sans leur imposer la circoncision, est une preuve du zèle avec lequel les Juifs convertissaient, en même temps qu'un des moyens les plus efficaces qu'ils employaient à cette époque. Des raisons très diverses favorisèrent cette propagande. Les privilèges civiques, que les Lagides et les Séleucides accordèrent aux Juifs, doivent avoir engagé un grand nombre d'Orientaux non juifs et de semi-Hellènes des villes nouvelles à entrer dans la catégorie des non-citoyens privilégiés. Beaucoup de personnes, appartenant surtout aux classes instruites, se détournaient avec indignation ou moquerie, sous l'influence de leurs sentiments religieux et moraux, de ce que les Grecs et encore plus de ce que les Egyptiens appelaient leur religion; elles cherchèrent un asile dans la doctrine juive plus simple et plus pure, ennemie du polythéisme et du culte des images, et qui se trouvait d'accord avec les idées religieuses que l'abaissement de la philosophie avait introduites dans les sociétés instruites et à moitié instruites. Nous avons un curieux poème moral grec, qui date probablement des dernières années de la République romaine; il a été composé d'après les livres de Moïse, car il proclame la doctrine monothéiste et la valeur universelle de la loi morale; mais il évite d'attaquer les non-juifs et de faire une opposition directe à la religion dominante: c'est un livre évidemment destiné à répandre davantage ce judaïsme dénationalisé. C'étaient surtout les femmes qui acceptaient avec enthousiasme la religion juive. Lorsque les autorités de Damas eurent décidé, en l'an 66, de faire mettre à mort les prisonniers juifs, il fut entendu que cette résolution serait tenue secrète, pour que la population féminine, dévouée aux Juifs, ne pût pas empêcher l'exécution de l'arrêt. Même en Occident, où les gens instruits étaient hostiles au judaïsme, de grandes dames firent de bonne heure exception; l'épouse de Néron, Poppaea Sabina, issue d'une noble famille, n'était pas moins connue dans Rome pour son dévouement aux Juifs. De véritables conversions n'étaient pas rares; la maison royale d'Adiabène, par exemple, le roi Izatès, sa mère Hélène, son frère et son successeur, embrassèrent formellement la foi juive à l'époque de Tibère et de Claude. Nous avons dit, en parlant des Juifs d'Antioche, qu'ils étaient presque tous des convertis; le fait est vrai de toutes les colonies juives. |
||||
509-27 av. J.C. |
Caractère hellénique de l'émigration juiveRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Juifs, tout en conservant leur individualité nationale, ne furent pas transplantés sur le sol hellénique et contraints de parler une langue étrangère, sans que le judaïsme ne fût envahi par des idées contraires à son essence même et qui, dans une certaine mesure, altérèrent son caractère primitif. Si nous voulons savoir jusqu'à quel point la vie littéraire des Grecs inonda les sociétés juives établies au milieu des Hellènes, nous n'avons qu'à examiner la littérature du siècle qui précéda et du siècle qui suivit la naissance du Christ. Elle est toute pénétrée d'éléments juifs; ce sont les écrivains les plus saillants, les penseurs les plus féconds qui cherchent, soit comme Hellènes à pénétrer le judaïsme, soit comme Juifs à saisir l'esprit hellénique. Nicolas de Damas, un vrai païen, un adepte distingué de la philosophie d'Aristote, ne se contenta pas de venir, comme littérateur et comme ambassadeur du roi Hérode, plaider devant Agrippa et devant Auguste la cause de son maître juif et du peuple de Palestine; dans son ouvrage historique, il tenta un effort sérieux et très important pour l'époque, dans le but de faire entrer l'Orient dans le cercle des études de l'Occident, tandis que les pages, que nous avons conservées, où il raconte les jeunes années de l'empereur Auguste qu'il avait connu personnellement, montrent de quel amour et de quel respect le souverain de Rome était entouré dans le monde grec. Le Traité du Sublime, écrit dans les premiers temps de l'empire par un auteur inconnu, l'un des ouvrages d'esthétique les plus subtils que l'antiquité nous ait transmis, est l'oeuvre sinon d'un Juif, du moins d'un homme qui honorait également Homère et Moïse1. Un autre écrit, également anonyme, sur l'univers, où l'on tentait, non sans succès, de fondre en une seule doctrine l'enseignement d'Aristote et les théories du Portique, a peut-être été aussi composé par un Juif; à coup sûr il est dédié au Juif le plus considérable et le plus haut placé de l'époque de Néron, au chef d'état-major général de Corbulon et de Titus, à Tiberius Alexandros. Là où l'union des deux mondes intellectuels apparaît le plus clairement, c'est dans la philosophie judaïcoalexandrine, l'expression la plus subtile et la plus vivante d'un mouvement religieux, qui non seulement englobait, mais encore ruinait le judaïsme. L'esprit hellénique, dans son développement, combattait les religions nationales de tout genre; il niait toutes leurs conceptions ou leur en substituait de nouvelles; il chassait les anciens dieux de la conscience humaine, et ne mettait à leur place que des astres ou des idées abstraites. La religion des Juifs ne fut pas à l'abri de ses attaques. Il se forma un nouveau judaïsme d'origine hellénique, qui traita Jéhovah à peu près aussi durement, mais pourtant un peu moins que les Grecs et les Romains instruits ne traitaient Zeus et Jupiter. La méthode universelle de ce que l'on a appelé l'interprétation allégorique, dont les philosophes stoïciens, entre autres, s'étaient servis pour mettre poliment à la porte toutes les religions païennes, pouvait être aussi bien et aussi mal appliquée à la Genèse qu'aux Dieux de l'Iliade. Si Moïse avait voulu personnifier dans Abraham l'intelligence, dans Sarah la vertu, dans Noé la justice, si les quatre fleuves du Paradis étaient les quatre vertus cardinales, le Grec le plus instruit pouvait croire à la Thora. Mais ce pseudo-judaïsme n'en était pas moins très puissant; la supériorité intellectuelle des Juifs d'Egypte s'affirme de plus en plus; c'est à Alexandrie que ce nouvel esprit a trouvé surtout des représentants. 1. Pseudo-Longin, Ilepi Ufous, 9 : Chez Homère la guerre des Dieux est beaucoup moins importante que la description des Dieux dans leur perfection, dans leur vraie grandeur et dans leur pureté : tel est le portrait de Poseidon (Iliade, XIII, 18 et suiv.). Ainsi le législateur des Juifs, qui n'était pas un homme ordinaire ayant fort bien conçu la grandeur et la puissance de Dieu, l'a exprimée dans toute sa dignité au commencement de ses lois par ces paroles : (Genèse, I, 3) : Dieu dit: quoi ? Que la lumière soit, et la lumière fut; que la terre soit, et la terre fut. |
||||
509-27 av. J.C. |
Union de tous les JuifsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMalgré les dissensions intérieures qui divisaient les Juifs de Palestine et qui ne se terminaient que trop souvent par la guerre civile, malgré la dispersion d'une grande partie de la nation juive dans tous les pays étrangers, malgré son mélange avec des masses étrangères, et surtout malgré l'introduction de l'hellénisme, élément destructeur qui pénétra jusque dans la moelle du judaïsme, tous les Juifs restaient néanmoins unis par un lien religieux. Le Salem sacré resta l'étendard, le temple de Sion le palladium de tout Juif, qu'il obéit aux Romains ou aux Parthes, qu'il parlât araméen ou grec, qu'il adorât l'ancien Iahvé ou le nouveau, qui n'était rien du tout. Le protecteur des Juifs avait accordé à leur chef spirituel une certaine puissance temporelle, peu considérable, il est vrai, mais elle n'avait pas plus d'importance pour le judaïsme qu'à une autre époque l'étendue des Etats de l'Eglise pour le catholicisme. Chaque année tous les membres d'une société juive devaient envoyer à Jérusalem une double drachme pour l'entretien du temple: cet impôt était perçu régulièrement comme les contributions d'Etat. Tous étaient obligés, au moins une fois dans leur vie, de sacrifier personnellement à Jéhovah dans la seule ville du monde qui lui fût agréable. Les connaissances théologiques restèrent communes; les rabbins de Babylone et d'Alexandrie ne les ont pas moins cultivées que ceux de Jérusalem. Malgré la dispersion et les discordes, le sentiment extraordinairement tenace de l'unité nationale se conserva tel qu'il était né dans ce cénacle d'exilés rentrés à Jérusalem, et tel qu'il avait passé dans toutes les colonies juives du monde hellénique. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le judaïsme subsista jusque dans les sociétés qui avaient abandonné la religion juive. Philon, le plus connu de tous ceux qui représentent dans la littérature cet état d'esprit, le seul même dont nous puissions saisir clairement les idées, était l'un des Juifs les plus distingués et les plus riches du temps de Tibère; il traite la religion de son pays à peu près comme Cicéron traitait la religion romaine; mais, loin de vouloir la détruire, il songe au contraire à la réformer. Pour lui comme pour tous les autres Juifs, Moïse est la source de toute vérité, ses préceptes écrits sont des lois formelles; il le respecte et il croit en lui. Ce judaïsme raffiné n'est cependant pas complètement identique à ce que l'on a appelé la croyance en Dieu des stoïciens. Pour Philon, Dieu n'est plus corporel, mais il est toujours personnel; le Juif repousse absolument la subjectivité des dieux, ce qui est le principe de la philosophie hellénique; mais il croit que l'homme est un pécheur soumis à un Etre parfait, qui lui est extérieur et supérieur. Aussi le nouveau judaïsme s'adapte-t-il aux rites de la religion nationale beaucoup plus facilement que le nouveau paganisme. La lutte de l'ancienne et de la nouvelle foi fut, dans la société juive, d'une nature tout autre que dans le monde païen; l'enjeu était beaucoup plus considérable. Le paganisme réformé ne combattait que l'antique religion; la réforme du judaïsme aurait eu pour dernière conséquence de détruire la nationalité juive, qui se serait noyée dans les flots de l'hellénisme, du jour où sa croyance aurait disparu; et les Juifs de cette époque n'osèrent pas aller jusque-là. Voilà pourquoi la forme, sinon le fond des anciennes croyances, fut conservée sur le sol grec et en langue grecque, avec une opiniâtreté inouïe : elle fut défendue par ceux-là mêmes qui, en principe, avaient capitulé devant l'hellénisme. Philon, comme nous le raconterons avec plus de détails, lutta et souffrit pour la cause juive. Aussi l'esprit hellénique n'a-t-il jamais exercé une influence toute-puissante dans le monde juif; jamais il n'a pu lutter contre le judaïsme national; à peine a-t-il adouci son fanatisme, prévenu ses fautes et ses crimes. Dans toutes les circonstances importantes, surtout en face de l'oppression et de la persécution, toutes les différences intestines du judaïsme disparaissent. Si la caste des rabbins était sans importance, la société religieuse, qu'elle dominait, était une puissance considérable, parfois redoutable. |
||||
Devenez membre de Roma LatinaInscrivez-vous gratuitement et bénéficiez du synopsis, le résumé du portail, très pratique et utile; l'accès au forum qui vous permettra d'échanger avec des passionnés comme vous de l'histoire latine, des cours de latin et enfin à la boutique du portail ! 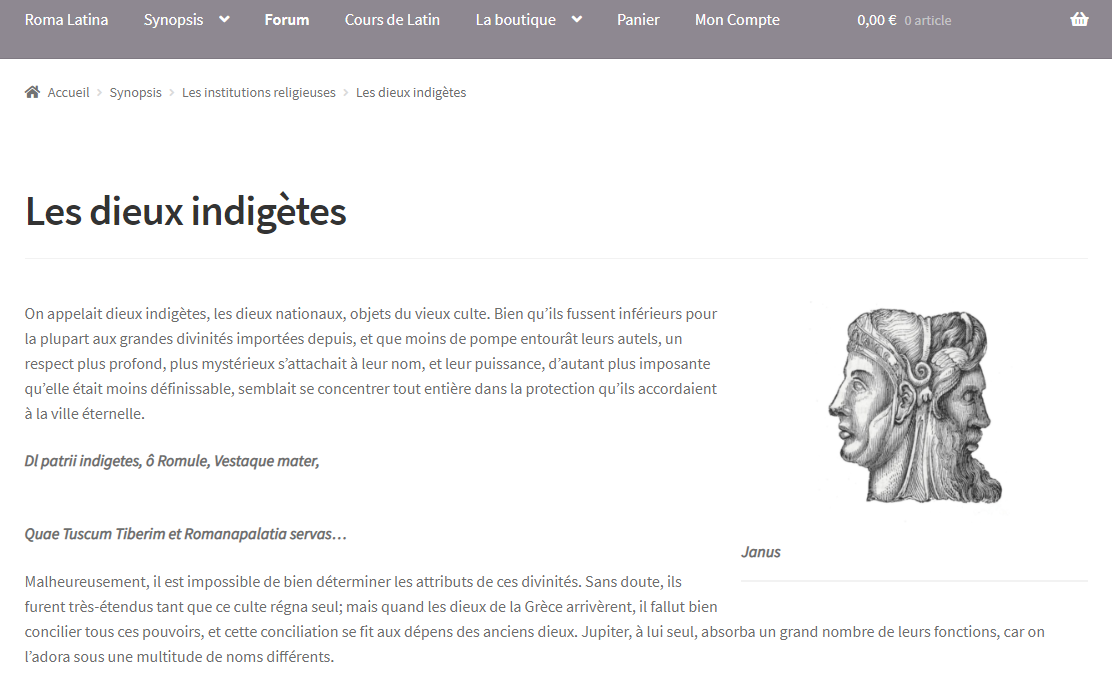 |
|||||
509-27 av. J.C. |
Le gouvernement romain et les Juifs en Occident et en OrientRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteTelle était la situation en présence de laquelle se trouvèrent les Romains, lorsqu'ils établirent leur domination sur l'Orient. La conquête ne force pas moins la main au peuple conquérant qu'au peuple conquis. Ni les Arsacides ni les Césars ne pouvaient faire que l'oeuvre des siècles et les fondations de villes macédoniennes n'eussent pas été accomplies; ni Séleucie de l'Euphrate, ni Antioche, ni Alexandrie, ne pouvaient être acceptées par les gouvernements postérieurs sous bénéfice d'inventaire. Sans doute le fondateur de l'empire s'est inspiré, dans ses rapports avec l'émigration juive d'Orient, comme dans beaucoup d'autres circonstances, de la politique des premiers Lagides: il a été plutôt favorable qu'hostile au judaïsme oriental et n'a pas détruit sa situation particulière; cette conduite a été imitée par tous ses successeurs. Nous avons déjà signalé la tentative que firent sous Auguste les cités de l'Asie Mineure, pour soumettre les Juifs comme les autres citoyens au service militaire, et pour leur interdire de célébrer désormais la fête du sabbat. Mais Agrippa donna tort aux villes; il rétablit le statu quo en faveur des Juifs, ou plutôt il déclara que les Juifs seraient désormais légalement exemptés du service militaire et pourraient célébrer leur sabbat, privilèges qui ne leur avaient été accordés jusqu'alors que par quelques gouverneurs ou quelques cités des provinces grecques. Auguste ordonna même aux gouverneurs de l'Asie de ne pas appliquer aux Juifs les lois impériales très sévères qu'il avait promulguées contre les sociétés et réunions. Mais le gouvernement romain n'ignorait pas que la situation privilégiée des Juifs de l'Orient était incompatible avec l'obligation, imposée à tous les autres habitants de l'empire, de se soumettre aux charges établies par l'Etat; que la position spéciale faite à l'élément juif, sous la garantie de Rome, provoquait dans les villes la haine de peuples et souvent des luttes intestines; que l'autorité religieuse des prêtres de Jérusalem sur tous les Juifs de l'empire avait une portée dangereuse; que tout cela causait à l'Etat un préjudice véritable et le menaçait dans son principe. Ce qui prouve le plus clairement combien l'empire était intérieurement divisé en deux parties distinctes, c'est que les empereurs ont traité différemment les Juifs de l'Occident latin et ceux de l'Orient grec. En Occident, les colonies juives n'obtinrent jamais l'autonomie. On y tolérait l'exercice de la religion juive, autant ou peut-être même moins que celui des religions de Syrie et d'Egypte. Auguste se montra bienveillant pour les Juifs établis dans un faubourg de Rome, au-delà du Tibre, et n'oublia pas, dans ses générosités, ceux qui s'étaient privés pour célébrer le sabbat; mais il évita d'entrer personnellement en contact avec la religion juive aussi bien qu'avec la religion égyptienne; lui-même, en Egypte, n'avait pas voulu rencontrer le boeuf sacré; et il approuva entièrement son fils Gaius, qui, pendant son voyage en Orient, n'était pas entré dans Jérusalem. Sous Tibère, en l'an 19, l'exercice du culte juif fut interdit à Rome et dans toute l'Italie, comme celui de la religion égyptienne; ceux qui ne consentirent pas à renier publiquement leur foi et à jeter dans le feu les vases sacrés, furent chassés de l'Italie, à moins qu'on ne les jugeât propres au service militaire; ils furent alors incorporés dans les compagnies de discipline, mais leurs scrupules religieux en amenèrent un grand nombre devant les conseils de guerre. Si, comme nous le verrons plus loin, le même empereur se montra très soucieux d'éviter en Orient tout conflit avec le Rabbi, cela prouve clairement que Tibère, le plus habile de tous les souverains que l'empire ait eus, reconnaissait à la fois qu'il était dangereux de favoriser l'immigration juive, et qu'il était injuste autant qu'impossible de vouloir détruire le judaïsme là où il existait1. Sous les empereurs postérieurs, comme nous pourrons le constater plus tard, on garda essentiellement une attitude hostile aux Juifs d'Occident, mais on imita plutôt l'exemple d'Auguste que celui de Tibère. On n'empêcha pas les Juifs de percevoir l'impôt du temple sous forme de contribution volontaire et de l'envoyer à Jérusalem. Il ne leur fut pas défendu de porter un différend commercial plutôt devant un arbitre juif que devant un tribunal romain. Il n'est plus question désormais en Occident d'une incorporation violente, comme celle de Tibère. Mais on ne reconnut jamais publiquement aux Juifs dans la Rome païenne, ni surtout dans l'Occident latin, le droit d'avoir une situation particulière et d'être jugés par des tribunaux spéciaux. En réalité, exception faite de la capitale du monde romain, où naturellement l'Orient était représenté et où existait une colonie juive dès l'époque de Cicéron, les sociétés de Juifs n'ont pris dans l'Occident, sous les premiers empereurs, ni une grande extension, ni une importance considérable2. Ce fut seulement en Orient que le gouvernement suivit l'exemple des puissances qui l'avaient précédé; ou plutôt il s'efforça de ne rien changer à la situation acquise et de prévenir les dangers qui en résultaient; de même que les livres sacrés des Juifs n'ont été connus du monde latin que par l'intermédiaire des Chrétiens et dans un texte latin, de même les mouvements importants du monde juif n'ont pas dépassé, pendant la période impériale, les limites de l'Orient grec. Dans cette région on n'essaya pas de tarir peu à peu la source de la haine contre les Juifs, en effaçant graduellement les différences légales qui les séparaient des autres races; mais en même temps, si l'on fait abstraction du caprice et des crimes de certains empereurs, le gouvernement ne prêta jamais assistance à ceux qui haïssaient et qui traquaient les Juifs. En réalité, la défaite du judaïsme ne provient pas de mauvais traitements subis par les émigrés juifs en Orient. Les rapports qui devaient fatalement s'établir entre le gouvernement impérial et le judaïsme ont non seulement causé la destruction de l'Etat de Jérusalem, mais encore et surtout affaibli et modifié la situation des Juifs dans l'empire. Nous allons maintenant raconter quelle fut l'histoire de la Palestine sous la domination romaine. 1. Le juif Philon attribue à Séjan la persécution des Juifs d'Italie (Legat. ad Gaium, 24; in Flacc., 1), et à l'empereur lui-même la tolérance accordée aux Juifs d'Orient. Mais Josèphe est plus dans le vrai lorsqu'il donne pour origine aux événements d'Italie un scandale causé à Rome même par trois dévots juifs extravagants et par une grande dame affiliée au judaïsme. Philon lui-même nous apprend, qu'après la chute de Séjan, Tibère ordonna seulement aux gouverneurs d'adoucir un peu leur conduite envers les Juifs. La politique de l'empereur et celle de ses ministres était sur ce point essentiellement la même. 2. Agrippa II, qui fait le dénombrement des établissements juifs à l'étranger (dans Philon, Legat. ad Gaium, 36), ne nomme aucun pays situé à l'Ouest de la Grèce; et parmi les étrangers fixés à Jérusalem, dont fait mention l'histoire des Apôtres, les Romains seuls sont originaires de l'Occident (II, 5 et suiv.). |
||||
509-27 av. J.C. |
La Judée sous la RépubliqueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes généraux de la République, Pompée et ses successeurs immédiats, avaient modifié la situation de la Syrie méridionale; ils avaient détruit les grands états, qui commençaient à s'y former, et divisé tout le pays en territoires de villes et en petites royautés. Les Juifs avaient été sérieusement atteints par cette réforme; non seulement ils avaient dû restituer leurs conquêtes, en particulier toute la côte, mais encore Gabinius avait partagé l'ancien territoire de leur empire en cinq districts indépendants s'administrant eux-mêmes, et le grand-prêtre Hyrkanos avait perdu sa puissance temporelle. Ainsi, d'une part, on avait rétabli le patronage de l'étranger; d'autre part, on avait reconstitué la théocratie pure. Mais la révolution ne se fit pas attendre. |
||||
|
|
|||||
49-44 av. J.C. |
Ordonnances de CésarRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste
musée Arles antique La reconnaissance personnelle de César favorisa puissamment la restauration formelle de l'état juif. Cet empire obtint tous les privilèges qui pouvaient être accordés à un état client: il ne dut payer aucun tribut aux Romains1, il ne reçut aucune garnison et ne fut pas soumis à la conscription militaire2; en revanche le gouvernement indigène fut chargé de défendre la frontière et de pourvoir à tous les frais qu'entraînait cette oeuvre. Les Juifs recouvrèrent la ville de Joppé et, par elle, la communication avec la mer; on leur garantit l'indépendance politique et la liberté religieuse; on leur permit enfin, ce qui leur avait été interdit jusqu'alors, de relever les remparts de Jérusalem, détruits par Pompée (707 de Rome = 47 avant J.-C.). Ce fut donc presque un étranger - car les Iduméens étaient placés par les Juifs proprement dit revenus de Babylone à peu près sur le même rang que les Samaritains - qui gouverna l'état juif, au nom du prince des Hasmonéens, sous la protection et selon la volonté de Rome. Les Juifs du parti national n'étaient rien moins que favorables au nouveau gouvernement. Les anciennes familles, prépondérantes dans le conseil de Jérusalem, tenaient au fond pour Aristoboulos, et, après sa mort, pour son fils Antigonos. Les fanatiques luttaient dans les montagnes de la Galilée autant contre les Romains que contre leur propre roi; lorsque le fils d'Antipatros, Hérode, eut fait prisonnier et condamné à mort le chef de cette bande sauvage, Ezékias, le conseil des prêtres de Jérusalem força le faible Hyrkanos à bannir Hérode, sous prétexte qu'il avait violé certaines prescriptions religieuses. Hérode entra dans l'armée romaine et rendit de grands services au gouverneur césarien de la Syrie dans sa lutte contre la révolte des derniers Pompéiens. Mais lorsqu'après le meurtre de César les républicains reprirent l'avantage en Orient, Antipatros fut encore le premier non seulement à prendre le parti du plus fort, mais même à obliger ses nouveaux maîtres en leur envoyant rapidement le produit des impôts qu'ils avaient établis. Aussi le chef des républicains, en quittant la Syrie, confirma-t-il Antipatros dans sa haute situation; de plus il confia à son fils Hérode un commandement en Syrie. 1. Dans le décret de César cité par Josèphe (Ant. Jud., XIV, 10, 5, 6), la seule lecture possible est celle que fournit Epiphanius; d'après ce document l'impôt, établi par Pompée (ibid., XIV, 4, 4) qui pesait sur ce pays, fut aboli, à partir de la deuxième année du contrat de ferrage alors en cours; il était en outre décidé que la ville de Joppé, cédée par les Romains aux Juifs, continuerait à payer aux Romains, à Sidon, à le quart des fruits de la terre, mais qu'en compensation Hyrkanos recevrait chaque année dans la même ville de Sidon 20 675 mesures de blé; de plus les habitants de Joppé devaient lui payer encore la dime de leurs produits. D'ailleurs le reste du récit prouve qu'à partir de cette époque l'état juif fut exempt de tout tribut; si Hérode paye des popol à la reine Cléopâtre, pour les districts qu'elle lui a accordés et affermés (Josèphe, Ant. Jud., XV, 4, 2, 4, cf. 5, 3), c'est là une exception qui ne fait que confirmer la règle. Appien (Bell. civ., V, 75), nommant les rois tributaires d'Antoine, cite Hérode pour l'Idumée et pour Samarie; mais c'est avec raison que le nom de la Judée manque à cette liste; et il se peut qu'Auguste ait exempté plus tard Hérode du tribut qu'il payait pour ces pays voisins. Le renseignement très détaillé et tout à fait digne de foi que nous avons sur la taxe imposée par Quirinius nous indique avec la plus grande clarté, que Rome n'avait jusqu'alors perçu dans la Palestine aucun impôt. 2. Dans le même décret, il est dit: ? (leçon de Wilamowitz au lieu de ?). Ce texte concorde, dans l'essentiel, avec la formule de la charte de liberté de Termessos, qui est un peu plus ancienne (Corp. insc. lat., I, 204) : Nei quis magistratu prove magistratu legatus nesive quis alius meilites in oppidum Thermesum agrumve hiemandi causa introducito nisei senatus nominalim utei Thermesum in hibernacula meililes deducantur decreverit. D'après cet article les troupes peuvent traverser le territoire de Termessos. Dans le privilège de la Judée il semble qu'on ne peut ni faire passer les troupes à travers le pays ni même y lever des soldats. | ||||
37 av. J.C.-4 |
HérodeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLorsque Antipatros mourut, empoisonné, dit-on, par un de ses officiers, Antigonos, qui s'était réfugié chez son beau-frère, Ptolémée, prince de Chalcis, crut le moment venu de détrôner son faible parent. Mais les fils d'Antipatros, Phasaël et Hérode, mirent son armée en déroute et Hyrcanos consentit à donner aux deux vainqueurs la même situation qu'à leur père. Il fit entrer, pour ainsi dire, Hérode dans la famille royale, en lui accordant la main de sa petite-fille Mariamme. Sur ces entrefaites les chefs du parti républicain succombèrent à Philippes. L'opposition à Jérusalem espérait bien obtenir des vainqueurs le renversement des Antipatrides désertés; mais Antoine, auquel incomba le soin de régler le différend, refusa de recevoir les ambassades du parti national, d'abord à Ephèse, puis à Antioche, enfin à Tyr; il fit même mettre à mort les derniers députés qu'on lui envoya, et confirma formellement Phasaël et Hérode comme Quatre princes1 des Juifs (713 de Rome = 41 après J.-C.). 1. Ce titre qui nous apprend d'abord l'existence d'un collège de quatre princes, semblable à celui qui existait depuis longtemps chez les Galates, est employé généralement pour désigner une autorité partagée, quelquefois même une autorité unique, mais il est toujours inférieur au titre de roi. Il n'est pas, en ce sens, particulier à la Galatie; il apparaît en Syrie, peut-être depuis Pompée, certainement depuis Auguste. C'est là seulement qu'on trouve, à côté les uns des autres, un Ethnarque et deux Tétrarques, comme ceux qui furent établis en Judée dès l'année 713, si nous en croyons Josèphe (Ant. Jud., XIV, 13, 1; Bell. Jud., I, 12, 15) : la situation de Phéroras, tétrarque de Péraea, soumis à l'autorité de son frère Hérode, est presque analogue (Josèphe, ibid., 24, 5). |
||||
|
|
|||||
37 av. J.C.-4 |
Les Parthes en JudéeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteBientôt l'état juif fut encore entraîné dans le remous de la politique générale. L'année suivante (714= 40) l'invasion des Parthes mit fin à la domination des Antipatrides. Le prétendant Antigonos se joignit aux envahisseurs, et s'empara de Jérusalem ainsi que de presque tout le pays. Hyrkanos fut fait prisonnier par les Parthes; Phasaël, le fils aîné d'Antipatros, également pris, se tua dans sa prison. Réduit à la dernière extrémité, Hérode enferma ses troupes dans une forteresse construite sur les rochers, à la frontière de la Palestine; lui-même s'enfuit pour aller chercher du secours, d'abord en Egypte, où il ne trouva plus Antoine, puis à Rome, où les deux maîtres du monde romain signaient alors une nouvelle alliance (714 = 40). On le reçut avec bienveillance, et on l'autorisa à reconquérir pour lui-même l'empire de Judée, ce que commandait d'ailleurs l'intérêt des Romains; il retourna en Syrie, reconnu par Rome comme maître du pays et revêtu de la dignité royale. Mais il était obligé, tout comme un prétendant, de conquérir son royaume non pas tant sur les Parthes que sur les patriotes. Ce fut surtout avec des Samaritains, des Iduméens et des soldats payés qu'il livra toutes ses batailles; il réussit enfin, sous la protection d'une légion romaine, à s'emparer de la capitale qui avait fait une longue résistance. Les bourreaux romains le délivrèrent de son ancien compétiteur Antigonos, les siens décimèrent les meilleures familles qui composaient le conseil de Jérusalem. |
||||
44-31 av. J.C. |
Hérode sous Antoine et CléopâtreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais les jours difficiles ne se terminèrent pas après son avènement. La malheureuse expédition d'Antoine contre les Parthes n'eut pas de suites pour Hérode, parce que les vainqueurs n'osèrent pas envahir la Syrie; mais il eut beaucoup à souffrir des prétentions toujours croissantes de la reine d'Egypte, qui régnait alors sur l'Orient bien plus qu'Antoine. La politique de cette femme, qui voulait d'abord étendre la puissance de sa famille et surtout augmenter ses revenus, ne fut pas toujours approuvée par Antoine; mais Cléopâtre sut enlever au roi de Judée une partie de ses plus belles possessions sur la côte syrienne et dans la région intermédiaire entre l'Egypte et la Syrie; elle lui ravit même les riches plantations de baumiers et les bosquets de palmiers de Jéricho, et lui imposa de lourdes charges financières. Pour conserver le reste de son royaume, Hérode dut prendre à ferme les nouvelles conquêtes de Cléopâtre en Syrie, ou se porter garant pour d'autres fermiers moins solvables. Au milieu de toutes ces tribulations, et dans la crainte d'exigences encore plus dures et auxquelles il ne pouvait pas plus se soustraire, Hérode attendait avec impatience que la guerre éclatât entre Antoine et Auguste. Ce fut un bonheur pour lui que Cléopâtre, dans son égoïsme coupable, le dispensât de prendre une part active à la guerre, parce qu'il avait besoin de ses troupes, pour recouvrer en Syrie les revenus de la reine; grâce à cette circonstance, il lui fut plus facile de se soumettre au vainqueur. Il eut plus de chance encore, lorsqu'il changea de parti; il put s'emparer d'une troupe de gladiateurs dévoués à Antoine, qui se rendaient d'Asie Mineure en Egypte à travers la Syrie, pour secourir leur maître. |
||||
27 av. J.C.-4 |
Hérode sous AugusteRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAvant de se rendre à Rhodes près d'Auguste, pour y obtenir son pardon, il fit mettre à mort, pour parer à tout événement, le dernier rejeton mâle de la famille des Macchabées, le vieil Hyrkanos, âgé de quatre-vingts ans, auquel la famille d'Antipatros devait sa haute situation : c'était prendre plus de précautions qu'il n'était nécessaire. Auguste fit ce que la politique lui ordonnait de faire, d'autant plus que l'appui d'Hérode lui était très important pour l'expédition d'Egypte qu'il projetait; il confirma dans sa royauté ce prince qui aimait à être dominé; il étendit même sa puissance en lui rendant tout ce que Cléopâtre lui avait enlevé, et en y ajoutant d'autres présents. Désormais toute la côte, depuis Gaza jusqu'à la Tour de Straton, la future Caesarea, le pays de Samarie qui s'intercale entre la Judée et la Galilée, et un certain nombre de villes situées à l'Est du Jourdain obéirent à Hérode. L'affermissement de la monarchie romaine épargnait aux Juifs de plus longues crises extérieures. |
||||
37-4 av. J.C. |
Gouvernement d'HérodeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste
Au point de vue romain l'attitude de la nouvelle dynastie ne peut paraître vraiment correct qu'à un observateur superficiel. Elle prend parti d'abord pour Pompée, puis pour César, puis pour Cassius et Brutus; elle se déclare ensuite pour les triumvirs, pour Antoine, enfin pour Auguste: sa fidélité est aussi changeante que sa parole. Pourtant cette conduite ne manque ni de logique ni de suite. Les états vassaux, surtout ceux de l'Orient grec, n'avaient en réalité aucun intérêt engagé dans les luttes qui divisaient la puissance souveraine; il leur importait peu que ce fût la République ou la Monarchie, Auguste ou Antoine qui triomphât. A cette époque plus que jamais, on vit s'étaler cette corruption des moeurs, qui accompagne toute révolution dans le gouvernement; on vit s'afficher un mélange dégradant de fidélité intérieure et d'obéissance extérieure; mais le roi Hérode sut accomplir tous les devoirs que l'état romain imposait à ses sujets, avec une exactitude dont n'auraient pas été capables des natures plus nobles et des âmes plus élevées. En face des Parthes il est resté toujours fidèle, même dans des situations très périlleuses, au maître qu'il avait choisi. Au point de vue de la politique intérieure du royaume juif, le gouvernement d'Hérode se caractérise par l'abaissement de la théocratie; c'est la continuation, c'est même une accentuation du gouvernement des Macchabées. Sous lui fut accomplie la séparation du pouvoir politique et du pouvoir ecclésiastique; il augmenta le contraste entre le roi tout-puissant, mais d'origine étrangère, et le grand-prêtre souvent impuissant, exposé à des changements arbitraires. A vrai dire la dignité royale convenait mieux au grand-prêtre juif qu'à un étranger, auquel était interdite la carrière sacerdotale; et, si les Hasmonéens représentaient la cause de l'indépendance du judaïsme, l'Iduméen plaçait sous la suzeraineté d'un patron la puissance royale qu'il exerçait sur les Juifs. Ce conflit éternel, qui se rouvrit alors avec un caractère profondément passionné, dura pendant toute la vie de cet homme qui a causé beaucoup de maux, mais qui n'en a peut-être pas moins souffert. En tous cas, son énergie, sa fermeté, sa souplesse en présence de ce qui était inévitable, son habileté militaire et politique, assurent une place au roi des Juifs dans le tableau général de cette époque curieuse. Il n'appartient pas à qui fait l'histoire de Rome, de raconter en détail, à l'aide des nombreux documents que nous avons conservés, les quarante années du règne d'Hérode il mourut en l'année 750 de Rome 4 après J.-C. Dans aucun temps aucune famille royale ne fut ensanglantée par des querelles furieuses entre parents et enfants, entre époux et frères, autant que la dynastie juive. L'empereur Auguste et les gouverneurs de Syrie se détournaient avec horreur, lorsqu'on les priait de favoriser l'oeuvre des assassins; et, ce qu'il y a de plus effrayant dans ce terrible tableau, c'est que les exécutions, presque toujours ordonnées sur des soupçons très vagues, étaient complètement inutiles, et que toujours le prince criminel se repentait de sa cruauté. Vainement le roi soutint, avec toute la force et toute l'intelligence qu'il put, les intérêts de son royaume, vainement il employa en faveur des Juifs, non seulement dans la Palestine, mais dans tout l'empire, ses trésors et son influence considérable - si Agrippa prit une décision favorable à leurs intérêts, lorsqu'il organisa le gouvernement impérial en Asie Mineure, c'est surtout à Hérode qu'ils le doivent -; il trouva bien de l'affection et de la fidélité dans l'Idumée et à Samarie, mais non pas chez le peuple d'Israël, qui le considéra toujours comme l'étranger bien plutôt que comme le prince coupable de tant de crimes. Hérode voyait dans son épouse de sang hasmonéen, la belle Mariamme, et dans les enfants qu'il avait eus d'elle des Juifs plus que des parents; il les craignait sans cesse, et ce fut là la cause principale des guerres intestines qui déchirèrent la famille royale; aussi ce prince a-t-il dit lui-même qu'il se sentait attiré par les Grecs autant que repoussé par les Juifs. Un fait caractéristique est qu'il fit élever à Rome les fils auxquels il réservait sa succession. Grâce à ses richesses inépuisables, il put combler de dons et orner de temples les villes grecques de l'étranger; il fit aussi de grandes constructions en Judée, mais non dans un esprit juif. Lorsqu'il bâtit un cirque et un théâtre à Jérusalem, lorsqu'il éleva dans les villes juives des temples consacrés au culte de l'empereur, les pieux Israélites l'accusèrent de provoquer au blasphème. S'il transforma le temple de Jérusalem en un magnifique édifice, ce fut presque contre la volonté des dévots; ils en admiraient tellement la construction, qu'ils reprochèrent à Hérode d'avoir ajouté au monument un aigle d'or bien plus vivement que d'avoir fait massacrer tant de personnes; il s'ensuivit une révolte populaire, dont l'aigle fut victime, mais qui coûta aussi la vie aux Juifs pieux qui l'arrachèrent. Hérode connaissait trop bien le pays pour le pousser à bout; s'il avait été possible de l'helléniser, ce n'est pas la volonté qui aurait fait défaut au prince. Le roi iduméen ne fut pas moins actif que les meilleurs hasmonéens. Le grand port qu'il construisit près de la Tour de Straton, ou près de Caesarea, comme s'appela désormais la ville rebâtie complètement par Hérode, donna, pour la première fois, à cette côte peu favorisée par la nature, ce dont elle avait besoin; pendant toute la durée de l'empire la nouvelle cité resta l'entrepôt le plus important de la Syrie médionale. Hérode a fait d'ailleurs tout ce qu'un gouvernement peut faire; il a favorisé le développement des ressources naturelles du pays; il est intervenu personnellement, quand son royaume a souffert de la famine ou d'autres fléaux; il a surtout donné à la région la sécurité intérieure et extérieure. On cessa d'être indulgent envers les bandes pillardes; contre les tribus nomades du désert on défendit sérieusement et sans répit la frontière, oeuvre très difficile dans toute cette contrée. Cette attitude d'Hérode décida le gouvernement romain à placer sous son autorité de nouveaux territoires, l'Iturée, la Trachonitide, l'Auranitide, la Batanée. Dès lors sa domination s'étendit, comme nous l'avons déjà indiqué, au-delà du Jourdain, jusqu'aux environs de Damas et à la chaîne de l'Hermon; lorsque son royaume se fut ainsi arrondi, il n'y eut plus, autant que nous pouvons le savoir, dans toutes les régions que nous avons nommées, ni une ville libre ni une seule autorité indépendante d'Hérode. La défense même des frontières incomba plutôt au roi des Arabes qu'à celui des Juifs; mais tant qu'elle fut confiée à Hérode, une ligne de forteresses puissantes assura aux habitants de la Palestine une tranquillité qu'ils n'avaient jamais connue jusqu'alors. On comprend qu'Agrippa, après avoir visité les constructions maritimes et militaires de ce roi, l'ait regardé et l'ait traité comme un collaborateur dans la grande oeuvre de la réorganisation de l'empire. |
||||
4 av. J.C. |
La fin d'Hérode et le partage de son royaumeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais son royaume ne dura pas longtemps. Hérode lui-même, dans son testament, le partagea entre trois de ses fils; Auguste en confirma les dispositions essentielles; il plaça seulement sous l'autorité directe du gouverneur de Syrie le port important de Gaza et les villes grecques situées au-delà du Jourdain. Les districts septentrionaux du royaume furent séparés des provinces principales; les dernières conquêtes d'Hérode, le pays situé au Sud de Damas, la Batanée et les territoires qui s'y rattachent furent donnés à Philippe; la Galilée et la Pérée, c'est-à-dire les régions transjordaniques, à l'exception des villes grecques, furent la part d'Hérode Antipas; ces deux princes eurent le titre de tétrarques; leurs petits royaumes, d'abord séparés, furent réunis à Agrippa II, arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, et le restèrent, sauf de courtes interruptions, jusqu'à l'époque de Trajan. Nous avons déjà raconté leur histoire, lorsque nous avons parlé de la Syrie orientale et de l'Arabie. Nous pouvons ajouter ici que les descendants d'Hérode gouvernèrent sinon avec autant d'énergie que le fondateur de la dynastie, du moins dans le même esprit et dans le même sens que lui. Ils donnèrent aux villes qu'ils réorganisèrent, Caesarea, l'antique Panéas, au Nord du royaume, et Tibérias dans la Galilée, une constitution complètement hellenique, comme aurait fait Hérode. Il faut citer, comme trait caractéristique, les imprécations que les rabbins juifs prononcèrent contre la ville impure de Tibériade parce qu'on avait trouvé un tombeau sur son emplacement. |
||||
4 av. J.C.-6 ap. J.C. |
La Judée sous ArchealosRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe centre du pays, la Judée avec Samarie au Nord et l'Idumée au Sud, revint, suivant la volonté d'Hérode, à son fils Archélaos. Mais ce successeur ne répondait pas aux voeux de la nation. Les orthodoxes, c'est-à-dire les Pharisiens, dominaient presque exclusivement la masse; si jusqu'alors la crainte du Seigneur avait été en quelque sorte effacée par la crainte d'un roi énergique et sans égard pour les prêtres, la grande majorité des Juifs n'en désirait pas moins rétablir, sous la suzeraineté de Rome, le pur gouvernement religieux des prêtres, tel qu'il avait été organisé jadis par les Perses. Immédiatement après la mort du vieux roi le peuple s'était soulevé à Jérusalem; il réclamait la révocation du grand-prêtre nommé par Hérode et le bannissement des infidèles, au moment où la fête de la Pâque allait être célébrée dans la ville Sainte; Archélaos dut commencer son règne en faisant tailler en pièces les masses révoltées; il y eut une foule de morts et la fête ne fut pas célébrée. Le gouverneur romain de la Syrie Varus, celui dont l'impéritie devait peu de temps après coûter la Germanie à Rome -, qui avait été chargé de maintenir l'ordre en Palestine pendant l'interrègne, avait permis aux émeutiers de Jérusalem d'envoyer à Rome, où précisément on s'occupait de la royauté de Judée, une ambassade de cinquante personnes, chargée de demander l'abolition du gouvernement royal; et lorsque Auguste l'eut reçue, huit mille Juifs de Rome escortèrent les députés jusqu'au temple d'Apollon. A Jérusalem, cependant, les Juifs fanatisés continuaient à agir par eux-mêmes; la garnison romaine, qui campait dans le Temple, fut attaquée à main armée; des bandes de voleurs dévots se répandirent dans le pays; Varus dut faire sortir sa légion et rétablir l'ordre l'épée à la main. Ces événements, qui étaient un avertissement pour l'empereur, justifiaient tristement le gouvernement brutal, mais respecté, du roi Hérode. Auguste, malgré la faiblesse dont il fit preuve surtout dans ses dernières années, renvoya ces représentants des masses fanatiques et rejeta leur demande; mais, se conformant pour les points essentiels au testament d'Hérode, il donna l'autorité dans Jérusalem à Archélaos, qu'il priva du titre royal - il ne pouvait alors l'accorder à ce jeune homme inexpérimenté; en outre il lui enleva les provinces septentrionales de son royaume, et diminua sa puissance militaire, en lui enlevant la mission de défendre les frontières. Sur l'ordre d'Auguste, les impôts si élevés sous Hérode furent diminués; mais cette réforme ne pouvait guère améliorer la situation des Quatre-Princes. Archélaos n'aurait pas été personnellement incapable et indigne de la couronne, qu'il lui eût été néanmoins impossible de gouverner; peu d'années après (6 ap. J.-C.) Auguste se vit obligé de le détrôner. |
||||
6 |
La Judée réduite en province romaineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe fut alors qu'il exauça complètement les voeux des rebelles: la royauté juive fut abolie; d'une part, la Palestine fut directement soumise à l'administration romaine; d'autre part, l'ombre de gouvernement intérieur qu'on laissa subsister dans le pays fut donnée au sénat de Jérusalem. Les causes de cet événement sont peut-être les promesses faites par Auguste à Hérode au sujet de sa succession, et la tendance de plus en plus accentuée, mais en général très justifiée, du gouvernement impérial, à détruire les grands états vassaux qui s'agitaient avec trop d'indépendance. Ce qui était arrivé peu de temps auparavant, ou ce qui survint quelques années plus tard en Galatie, en Cappadoce, en Maurétanie, nous explique pourquoi, en Palestine, l'empire d'Hérode n'a guère duré plus longtemps que lui. Mais si Rome établit sa domination immédiate sur ce pays, ce fut pour revenir, en ce qui concernait l'administration, aux idées d'Hérode; la situation était tellement particulière et les circonstances étaient si difficiles, que le contact immédiat des administrateurs romains et des Juifs administrés, réclamé avec tant d'insistance et finalement obtenu par le parti sacerdotal lui-même, ne fit le bonheur ni des uns ni des autres. |
||||
27 av. J.C.-38 |
Organisation provincialeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa Judée devint donc, en l'an 6 après J.-C., une province romaine de seconde classe1; et, si l'on excepte l'éphémère responsable remplacé par un fonctionnaire impérial révocable de rang équestre. Le siège de l'administration romaine fut, immédiatement sans doute, la ville de Caesarea, constituée par Hérode au bord de la mer, sur le modèle des villes helléniques. Naturellement le pays perdit le privilège de n'avoir pas de garnison romaine; mais, comme il arrivait toujours dans les provinces de seconde classe, les troupes romaines se composaient seulement de quelques détachements peu nombreux de cavaliers et de fantassins, de catégorie inférieure; plus tard on établit en Judée une aile et cinq cohortes, environ 3 000 hommes. Ces soldats furent peut-être recrutés par les premiers empereurs, pour une forte partie dans le pays lui-même, et aussi parmi les gens de Samarie et les Grecs de Syrie2. Il n'y avait pas de légionnaires dans la province; et même dans les pays voisins de la Judée, campait tout au plus une des quatre légions de Syrie. A Jérusalem on envoya un commandant romain permanent, qui s'établit dans le palais du roi avec une garnison, également permanente, très faible; c'était seulement à l'époque de la Pâque, où tous les gens du pays et d'innombrables étrangers accouraient au Temple, que l'on faisait camper un détachement plus considérable de soldats romains dans un portique voisin du temple. Lorsque la province fut organisée, ce fut Rome qui se chargea de lever les impôts, puisque le gouvernement impérial payait tous les frais que nécessitait la défense du pays. Celui-ci, en donnant le pouvoir à Archélaos, lui avait enjoint de diminuer les impôts; il est peu vraisemblable qu'il ait eu l'intention de les augmenter aussitôt après l'annexion du pays; mais, en Judée, comme dans toute région nouvellement conquise, on se prépara à réviser l'ancien cadastre3. (Les autorités indigènes) Dans cette province comme dans toutes les autres, le conseil municipal fut, autant que possible, la base de l'administration locale. Samarie ou S�baste, tel est désormais son nom, la nouvelle ville de Caesarea, et les autres cités qui existaient déjà dans l'ancien empire d'Archélaos, se gouvernèrent elles-mêmes sous le contrôle des autorités romaines. 1. Josèphe raconte que la Judée fut rattachée à la province de Syrie et placée sous l'autorité de son gouverneur (Ant. Jud., XVII, fine : restauration du royaume de Jérusalem sous Claude (41 à 44), elle resta dès lors une province romaine. L'ancien prince indigène, nommé à vie et dont la dignité était héréditaire, à la condition cependant d'être confirmée par le gouvernement romain, fut ? XVIII, 1, 1: ?evv; cf. 4, 6); ce renseignement parait inexact; il est beau????? ; coup plus probable que la Judée forma désormais une province procuratorienne spéciale. Josèphe n'a pas su distinguer avec netteté les attributions légales et l'intervention réelle du gouverneur de Syrie. Ce fonctionnaire organisa la nouvelle province et y établit la première taxe; mais ce fait ne tranche pas la question de savoir quelle constitution fut donnée à la Judée. Si les Juifs font appel au gouverneur de Syrie des jugements de leur procurateur, et si le gouverneur décide contre le procurateur, c'est que le procurateur dépend du légat; mais, pour que L. Vitellius agit ainsi (Josèphe, XVIII, 4, 2), il devait être investi d'une autorité extraordinaire sur cette province (Tacite, Ann., VI, 32; Staatsrecht, II, 822); dans un autre cas, les expressions de Tacite (XII, 54): Quia Clodius jus statuendi etiam de procuratoribus dederat, nous prouvent que le gouverneur de Syrie n'aurait pas pu rendre un tel jugement en vertu de sa compétence ordinaire. Aussi bien le jus gladii de ces procurateurs (Josèphe, De bell. Jud., II, 8, 1, XVIII, 11: ?), et toutes leurs attributions montrent, que ce ne sont pas des fonctionnaires placés sous l'autorité d'un légat impérial et chargés seulement des affaires financières, mais qu'ils ont la plus haute autorité en matière judiciaire et militaire comme les procurateurs de Norique et de Rétie. Les légats de Syrie n'avaient donc pas plus d'influence en Judée que le légat de Pannonie dans le Norique et celui de Haute-Germanie en Rétie. D'ailleurs cette situation concorde avec l'état général de l'empire; les grands royaumes, après leur annexion, ne furent jamais rattachés aux grands gouvernements voisins, parce qu'on ne voulait pas à cette époque créer de puissances trop considérables; ils furent transformés en gouvernements indépendants, confiés à l'origine pour la plupart à des citoyens de rang équestre. 2. D'après Josèphe (Ant. Jud., XX, 8, 7, plutôt que De bell. Jud., II, 13, 7) la plus grande partie des troupes romaines de Palestine se composait de soldats originaires de Césarée et de Sébastè. L'ala Sebastenorum combattit dans la guerre de Judée sous Vespasien (Josèphe, De bell. Jud., II, 12, 5). Cf. Eph. epig., V, p. 194. Il n'y a pas d'alae ni de cohortes Judaeorum. 3. D'après Josèphe, les revenus d'Hérode (XVII, 11, 4) montaient environ à 1200 talents, dont cent à peu près pour la Batanée et les pays voisins, 200 pour la Galilée et la Pérée, le reste pour la part d'Archélaos; il faut entendre ici l'ancien talent hébraïque et non pas, comme l'admet Hultsch (Metrol., 2 edit., p. 605), le talent de deniers, puisque les revenus du même pays sous Claude, toujours d'après Josèphe (XIX, 8, 2), sont évalués à douze millions de deniers. La principale part de ces revenus était formée par l'impôt foncier, dont nous ne connaissons pas le chiffre; à l'époque syrienne il rapportait, au moins de temps en temps, le tiers des céréales, et la moitié du vin et de l'huile (Macchab., I, 10, 30); au temps de César, Joppé fournissait un quart de sa récolte, plus la dîme du temple. Il faut ajouter un certain nombre d'autres impôts et taxes indirectes, impôts sur les enchères, gabelle, droits de passage, et péages, etc.; ce sont les impôts dont il est question dans l'Evangile. |
||||
27 av. J.C.-38 |
Synhédrion de JérusalemRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'administration de la capitale et du territoire considérable qui en dépendait fut organisée de la même manière. Déjà avant l'époque romaine, un conseil des Anciens avait été constitué à Jérusalem, sous les Séleucides, comme nous l'avons vu : c'était le Synhédrion ou, suivant la transcription juive, le Sanhédrin. La présidence en était dévolue au grand-prêtre, choisi pour un temps fixe par le chef du pays, lorsqu'il n'était pas lui-même grand-prêtre. Ce collège était composé des anciens grands-prêtres et des juges les plus estimés. Cette assemblée, où dominait l'élément aristocratique, était à la fois la plus haute représentation religieuse du judaïsme tout entier, et, dans la mesure où ces deux ordres d'idées peuvent être réunis, la représentation laïque surtout de la ville de Jérusalem. Ce sont les rabbins des temps postérieurs qui ont désigné, par une pieuse fiction, le Synhédrion comme une institution spirituelle fondée par Moïse. Il répondait essentiellement au conseil de la constitution municipale des Grecs; mais, par sa composition et sa compétence, il avait un caractère plus religieux que les assemblées communales des Hellènes. A ce Synhédrion et à son grand-prêtre, nommé par le procurateur agissant comme organe du souverain impérial, le gouvernement romain laissa ou plutôt transporta les attributions que possédaient, dans les cités helléniques sujettes, les autorités locales et les conseils municipaux. Avec une indifférence trop imprévoyante, il donna libre cours au Messianisme transcendental des Pharisiens; dans toutes les affaires religieuses, morales ou juridiques, qui ne touchaient pas immédiatement aux intérêts de Rome, on laissa, pour ainsi dire, les mains libres au consistoire du pays, qui n'avait rien de transcendental, et qui fonctionna jusqu'à la venue du Messie. Cette organisation fut surtout importante au point de vue judiciaire. A la vérité, toutes les fois qu'un citoyen romain était en cause, le jugement des affaires civiles et des affaires criminelles était déféré aux tribunaux romains, même avant l'annexion du pays. Mais, après l'annexion, les autorités locales continuèrent à juger les Juifs au civil. Il est probable qu'en général elles rendirent la justice criminelle concurremment avec le procurateur romain; seulement elles ne pouvaient faire exécuter leurs arrêts de mort qu'après confirmation du fonctionnaire impérial. |
||||
27 av. J.C.-38 |
Le gouvernement provincial des romainsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCette organisation était essentiellement une conséquence inévitable de l'abolition de la royauté juive; les Juifs, en réclamant l'une, réclamaient l'autre par le fait. Assurément c'était l'intention du gouvernement d'éviter autant que possible la dureté et la sévérité dans l'administration. Publius Sulpicius Quirinius, le gouverneur de Syrie qui fut chargé de constituer la nouvelle province, était un fonctionnaire de grand mérite, qui connaissait à fond la situation de l'Orient; en outre, tous les renseignements nous confirment que l'on n'ignorait pas les difficultés de l'entreprise et qu'on voulait en tenir compte. Comme auparavant, sous les rois de Judée, la petite monnaie fut frappée dans le pays, elle porta désormais le nom de l'empereur romain; mais pour respecter le sentiment des Juifs qui avaient horreur des images, on ne grava jamais sur les pièces l'effigie du souverain. L'entrée de l'intérieur du Temple resta interdite, sous peine de mort, à tout homme qui n'était pas juif1. Auguste n'a jamais favorisé personnellement les cultes orientaux; mais il ne dédaigna pas d'en faire dans leur patrie, en Palestine comme en Egypte, les alliés du gouvernement impérial; des présents magnifiques envoyés par Auguste, par Livie, et par d'autres membres de la famille impériale ornaient le sanctuaire des Juifs, et l'empereur faisait chaque jour sacrifier en son nom au Dieu suprême un taureau et deux agneaux. Les soldats romains reçurent l'ordre de laisser à Césarée, lorsqu'ils tiendraient garnison à Jérusalem, les enseignes qui portaient des images d'empereur. Sous Tibère, un gouverneur ayant transgressé cet ordre, l'autorité romaine fit droit aux supplications des Juifs pieux et rétablit l'ancien ordre de choses. Lors d'une expédition contre les Arabes, les troupes romaines devaient traverser Jérusalem; les prêtres protestèrent, à cause des images représentées sur les enseignes, et l'armée prit une autre route. Le gouverneur dont nous venons de parler ayant consacré à l'empereur dans la forteresse royale de Jérusalem des boucliers sans représentations figurées, les dévots crièrent au scandale; Tibère ordonna d'enlever ces boucliers et de les suspendre à Césarée, dans le temple d'Auguste. L'habit de cérémonie du grand-prêtre, qui se trouvait dans la forteresse sous la garde des Romains et qui par suite devait être lavé de cette souillure pendant sept jours, avant d'être revêtu, fut remis aux croyants sur leur réclamation, et l'on enjoignit au commandant de la forteresse de ne plus s'en occuper. D'ailleurs on ne pouvait pas demander à la foule de supporter patiemment les conséquences de l'annexion, sous prétexte qu'elle l'avait elle-même provoquée. Il ne faut pas non plus affirmer que les habitants du pays ne furent pas opprimés par les Romains, et qu'ils n'avaient aucune raison de se plaindre; l'organisation des provinces romaines a toujours entraîné des difficultés et des troubles. En outre, les injustices et les violences, commises par chaque gouverneur, ne furent pas moins nombreuses en Judée qu'ailleurs. Dès le commencement du règne de Tibère les Juifs protestaient comme les Syriens, contre le poids des impôts, et ce fut surtout à la longue administration de Ponce-Pilate qu'un juge équitable reprocha tous les crimes dont les fonctionnaires se rendaient ordinairement coupables. Mais, suivant le même auteur, Tibère pendant les vingt-trois ans de son règne laissa subsister les antiques coutumes consacrées par la religion; il n'en détruisit ni viola aucune. Il faut d'autant plus le reconnaître qu'en Occident cet empereur sévit plus durement qu'aucun autre contre les Juifs; s'il fit preuve d'indulgence et de modération à l'égard des Juifs de Judée, ce n'est pas parce qu'il favorisait personnellement le judaïsme. 1. A la barrière de marbre, qui fermait le sanctuaire, étaient attachés des avis rédigés en langue grecque et latine (Josèphe, De bell. Jud., V, 5, 2; VI, 2, 4; Ant. Jud., XV, 11, 5). Une de ces plaques que l'on a récemment découverte (Revue archéologique, XXIII (1872), p. 220) et qui se voit aujourd'hui dans le Musée public de Constantinople, porte cette inscription : ?. L'iota se trouve au datif; l'écriture est bonne, et paraît dater des premiers temps de l'empire. Il est difficile que ces plaques soient l'oeuvre des rois juifs; ils n'auraient pas ajouté un texte latin, et ils n'avaient pas de raison pour garder l'anonyme d'une façon si étrange en menaçant les coupables de la peine de mort. Tout s'explique, si les plaques ont été posées par le gouvernement romain; d'ailleurs; Titus, d'après Josèphe (Bell. Jud., VI, 2, 4), dit en s'adressant aux Juifs:?. Si la plaque dont nous avons parlé plus haut porte réellement des traces de coups de hache, ces coups ont été donnés par les soldats de Titus. |
||||
38 |
L'opposition juiveRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNéanmoins le gouvernement romain se heurta, même en temps de paix, à une opposition de principe et à la résistance puissante des dévots. On refusa de payer les impôts, non seulement parce qu'ils étaient lourds, mais parce qu'ils étaient impies. "Est-il permis", demande le Rabbin dans l'Evangile, de payer le cens à César ? La réponse ironique qui lui est faite ne parut pas suffisante à tout le monde; il y avait des saints, en petit nombre il est vrai, qui se seraient crus souillés, s'ils avaient touché une monnaie portant l'effigie de l'empereur. C'était un fait nouveau de voir ainsi croître l'opposition religieuse. Les rois Séleucus et Antiochus, sans être circoncis, s'étaient fait payer leurs impôts en pièces d'argent frappées à leur effigie. Telle était la théorie du parti national : l'application en fut faite non pas par le grand conseil de Jérusalem, où les nobles les plus traitables de la Palestine avaient acquis, sous l'influence du gouvernement impérial, une place prépondérante, mais par Judas le Galiléen, de Gamala près du lac de Génézareth, qui, comme Gamaliel le rappelait plus tard au grand conseil, se souleva au moment du recensement et entraîna tout le peuple à sa suite. Ce Judas exprima la pensée commune, en proclamant que la déclaration nécessitée par le recensement était une servitude, et que les Juifs devaient avoir honte de reconnaître au-dessus d'eux un autre maître que le seigneur Zebaoth; Dieu n'aiderait, ajoutait-il, que ceux qui pourraient s'aider eux-mêmes. Peu de gens répondirent à cet appel et prirent les armes; Judas périt sur l'échafaud quelques mois plus tard; mais mort, et mort pour la foi, il était plus redoutable aux vainqueurs impies que vivant. Cet homme et ses partisans formèrent aux yeux des Juifs postérieurs la quatrième secte, à côté des Sadducéens, des Pharisiens, et des Esséens; ils furent alors appelés les Zélotes; plus tard ils se nommèrent eux-mêmes les Sicaires, les Hommes au poignard. Leur doctrine est des plus simples : Dieu seul est maître; la mort est sans importance; la liberté est tout. Cette doctrine survécut: les fils et les petits-fils de Judas furent les promoteurs de toutes les insurrections. |
||||
38 |
Persécution des Juifs à JérusalemRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAgrippa partit en l'an 38 pour son nouvel empire; il se dirigea vers la ville d'Alexandrie où quelques mois auparavant, poursuivi pour dettes, il avait cherché à emprunter de l'argent aux banquiers juifs. Lorsqu'il se montra publiquement dans cette ville, revêtu de ses habits royaux, entouré de ses gardes magnifiquement costumés, la population non juive et peu favorable aux Juifs de cette cité à l'humeur moqueuse et avide de scandale le tourna en ridicule. Les choses n'en restèrent pas là. Les Juifs furent cruellement persécutés. Leurs maisons éloignées les unes des autres furent pillées et brûlées; leurs vaisseaux à l'ancre dans le port furent mis à sac; tous les Juifs que l'on rencontra dans les quartiers non juifs furent maltraités et frappés. Mais la violence était impuissante contre les quartiers purement juifs. Les chefs des assaillants réussirent à transformer en temples consacrés au nouvel empereur les synagogues qui n'étaient pas encore détruites, et auxquelles on s'attaquait surtout; ils élevèrent dans tous ces édifices des statues de Gaïus; dans la synagogue principale ils placèrent la statue sur-un quadrige. L'empereur Gaïus voulait se faire passer, aussi sérieusement que son cerveau troublé le comportait, pour un dieu réel et vivant; tout le monde le savait, les Juifs et le gouverneur de la province. Celui-ci, Avillius Flaccus, homme habile et qui avait été sous Tibère un excellent administrateur, avait maintenant les mains liées par la défaveur dans laquelle il se trouvait auprès du nouveau souverain; il craignait à chaque instant d'être rappelé et mis en accusation; aussi ne laissa-t-il pas échapper l'occasion de rentrer en grâce1. Non seulement il ordonna par un édit de n'opposer aucun obstacle à l'érection des statues dans les synagogues, mais encore il prit part à la persécution contre les Juifs; il interdit le sabbat; il déclara dans ses ordonnances que ces étrangers, tolérés seulement dans la ville, avaient osé s'emparer de la meilleure partie d'Alexandrie; ils se virent resserrés dans un des cinq quartiers et toutes les autres maisons juives furent livrées à la population, tandis que les propriétaires expulsés se trouvaient sans asile, et couraient en masse le long du rivage. Aucune protestation ne fut même écoutée: trente-huit membres du conseil des Anciens, qui dirigeait alors la colonie juive au lieu de l'Ethnarque2, furent fouettés, devant tout le peuple, dans le cirque. Quatre cents maisons furent détruites; le commerce cessa; les fabriques chômèrent. Il n'y avait plus de recours qu'auprès de l'empereur. Devant lui se présentèrent les deux députations alexandrines, celle des Juifs conduite par ce Philon, que nous avons déjà nommé, un érudit qui représentait les nouvelles tendances du judaïsme, plus doux que vaillant, mais qui néanmoins dans cette circonstance défendit consciencieusement ses coreligionnaires; celle des ennemis des Juifs, conduite par Apion, lui aussi savant et écrivain Alexandrin le grelot universel, comme l'avait surnommé l'empereur Tibère, habitué aux grands mots et plus encore aux grands mensonges, d'une érudition sans bornes3, d'une grande audace, ayant une entière confiance en lui-même, et connaissant sinon les hommes, du moins leur futilité; professeur de rhétorique et de science politique, très célèbre, toujours prêt à la lutte, mordant, effronté et suivant sans réserve le parti du plus fort. Le résultat de la démarche était connu d'avance. L'empereur reçut les deux ambassades en visitant les plantations de ses jardins; mais, au lieu d'écouter les suppliants, il leur posa des questions ironiques, que les ennemis des Juifs, au mépris de toute étiquette, accueillirent avec de grands éclats de rire. Comme l'empereur était de bonne humeur, il se contenta de regretter que ces hommes, d'ailleurs si bons, fussent assez mal organisés pour ne pas reconnaître sa déité innée, ce en quoi il parlait assurément avec un grand sérieux. Apion eut donc raison et les synagogues furent transformées en temples de Gaïus, partout où l'envie en prit aux ennemis des Juifs. 1. La haine toute particulière de Gaïus contre les Juifs (Philon, Leg., 20) ne fut pas la cause, mais la conséquence de la persécution d'Alexandrie. Il s'ensuit qu'il ne dut pas y avoir une entente préalable entre les chefs des persécuteurs et le gouverneur (Philon, in Flacc., 4), comme les Juifs le pensaient; le gouverneur ne pouvait pas savoir qu'il plairait au nouvel empereur en abandonnant les Juifs. Mais plusieurs questions se posent alors: Pourquoi les promoteurs de la persécution contre les Juifs choisirent-ils précisément cette époque? Pourquoi surtout le gouverneur, dont Philon parle expressément comme d'un fonctionnaire excellent, ferma-t-il d'abord les yeux, puis s'associa-t-il aux bourreaux, au moins dans la dernière partie de leur oeuvre ? Il est probable que les choses se passèrent comme nous les avons exposées : depuis longtemps la haine et la jalousie couvaient contre les Juifs dans Alexandrie (Josèphe, Bell. Jud., II, 18, 9; Philon, Leg., 18); la chute du gouvernement sévère de Tibère et la disgrâce manifeste, dans laquelle le préfet de l'Egypte se trouvait auprès de Gaïus, laissaient toute liberté aux émeutiers. L'arrivée d'Agrippa fournit l'occasion; l'habile transformation des synagogues en temples de Gaïus désigna les Juifs comme des ennemis de l'empereur; et, quand l'affaire fut ainsi engagée, Flaccus profita sans doute de cette persécution pour se réhabiliter aux yeux de son souverain. 2. Lorsque Strabon se trouvait en Egypte, au commencement du règne d'Auguste, les Juifs d'Alexandrie étaient soumis à un ethnarque (Geograph., XVII, 1, 13, p. 798, cf. Josèphe, Ant. Jud., XIV, 7, 1); quand plus tard, sous Auguste, l'ethnarque ou le génarque, comme il s'appelait encore, mourut, il fut remplacé par un conseil des Anciens (Philon, Leg., 10); cependant Auguste n'interdit pas aux Juifs de se donner un ethnarque, comme nous l'apprend Claude (Josèphe, XIX, 5, 2), ce qui doit signifier que pour cette fois seulement on renonça à choisir un chef unique, mais que l'ethnarque ne fut pas supprimé pour toujours. Sous Gaïus, les Juifs seuls pouvaient avoir des anciens; on les retrouve aussi sous Vespasien (Josèphe, Bell. Jud., VII, 10, 1). Josèphe nous parle d'un archonte des Juifs à Antioche (ibid., VII, 3, 3). 3. Apion discourait et écrivait sur toute chose, sur les métaux et sur l'alphabet romain, sur la magie et sur les hétaïres, sur l'histoire de l'Egypte primitive et sur les recettes culinaires d'Apicius; mais surtout il dut sa célébrité à ses leçons sur Homère, qui lui valurent le droit de cité honoraire dans un grand nombre de villes grecques. Il avait découvert qu'Homère avait mis au début de son Iliade le mot impropre prives, parce que les deux premières lettres de ce mot, employées comme chiffres, représentent le nombre total des livres de ses deux épopées; il donnait le nom de l'hôte d'Ithaque, qui lui avait enseigné le jeu de trictrac des prétendants; il avait même évoqué l'ombre d'Homère pour lui demander quelle était sa patrie; Homère lui était apparu et avait, paraît-il, répondu à sa question, mais en lui faisant promettre de ne révéler sa réponse à personne. |
||||
38-40 |
La statue de l'empereur dans le temple de JérusalemRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais on ne s'en tint pas à ces consécrations opérées par la jeunesse des rues d'Alexandrie. En l'an 39, le gouverneur de Syrie, Publius Petronius, reçut de Gaïus l'ordre d'entrer avec ses légions à Jérusalem et d'élever dans le temple la statue de l'empereur. Le gouverneur, un honorable fonctionnaire de l'école de Tibère, fut effrayé par cette injonction; de tous les coins du pays, les Juifs, hommes et femmes, vieillards et enfants, accoururent auprès de lui, d'abord à Ptolémaïs, en Syrie, puis à Tibériade, Galilée; ils le supplièrent d'intervenir, pour que la profanation n'eût pas lieu; partout, les champs furent abandonnés, et les masses désespérées déclarèrent qu'elles aimaient mieux mourir par l'épée ou par la famine, que voir de leurs yeux une telle monstruosité. En fait, le gouverneur osa différer l'exécution de l'ordre et présenter quelques objections à l'empereur, tout en sachant qu'il jouait sa tête. En même temps le roi Agrippa se rendit personnellement à Rome pour obtenir de son ami la révocation de l'édit. L'empereur renonça à son caprice, après une scène d'ivresse, dit-on, mise habilement à profit par le prince juif. Mais il limita la concession qu'il faisait au seul temple de Jérusalem, et envoya au gouverneur l'ordre de se donner la mort, pour le punir de sa désobéissance; heureusement cet ordre arrivé en retard ne fut pas exécuté. Gaïus était décidé à briser la résistance des Juifs, il n'en commanda pas moins aux légions de se retirer, ce qui prouve que cette fois il avait pesé d'avance toutes les conséquences de ses ordres. Après ces événements, tout l'amour de l'empereur se tourna vers les Egyptiens, qui croyaient de bonne volonté à sa nature divine; il réserva sa haine pour les Juifs opiniâtres et sots; avec un souverain aussi hypocrite que lui, habitué à donner, puis à retirer une grâce, la catastrophe ne devait paraître qu'ajournée. Il était sur le point de partir pour Alexandrie, afin d'y respirer lui-même l'encens qu'on brûlait sur ses autels; on travaillait en secret, dit-on, à la statue qu'il voulait se faire élever dans le temple de Jérusalem, lorsque, au mois de janvier 41, le poignard de Chaerea débarrassa de ce monstre, entre autres choses, le temple de Jéhovah. |
||||
40 |
Dispositions des JuifsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCette courte période de malheurs n'entraîna pas, après elle, de conséquences extérieures; avec le dieu tombèrent les autels. Néanmoins, cette persécution ne fut complètement oubliée ni d'un parti ni de l'autre. L'histoire que nous racontons ici est l'histoire de la haine croissante entre Juifs et non-Juifs; la persécution des Juifs, qui dura trois ans, sous Gaïus, en est un chapitre et y marque un progrès. L'aversion envers les Juifs et leurs persécutions est aussi vieille que leur dispersion à travers le monde; ces sociétés d'Orientaux privilégiées et autonomes, qui vivaient au milieu des Hellènes, devaient exciter la jalousie et la haine aussi nécessairement qu'un marais produit de mauvaises émanations. Mais, on ne trouverait ni dans l'ancienne histoire grecque, ni dans l'histoire romaine primitive, une persécution des Juifs comme celle qui eut lieu à Alexandrie en l'an 38, dont le prétexte fut que les Juifs n'étaient pas assez hellénisés, et qui fut dirigée à la fois par l'autorité supérieure et par la basse population. L'on avait désormais franchi l'espace assez large qui sépare la mauvaise volonté d'un individu des mauvaises actions d'une foule; on savait ce que les ennemis des Juifs avaient à désirer et à faire; on savait aussi ce dont ils étaient capables suivant les circonstances. La situation ne paraissait pas moins nette aux yeux des Juifs; cela n'est pas douteux, quoique nous ne puissions pas l'établir avec des documents certains1. Mais, la profanation du Saint des Saints par la statue du dieu Gaïus restait beaucoup plus dans la mémoire des Juifs que la persécution d'Alexandrie. Le temple avait été déjà souillé une fois; à cette époque, la témérité du roi de Syrie, Antiochus Epiphane, avait provoqué le soulèvement des Macchabées qui, victorieux, avaient rendu à leur patrie son indépendance politique. Cet Epiphane, l'Anti-Messie, qui amène le Messie, comme l'avait appelé le prophète Daniel, était depuis lors pour tous les Juifs le type du monstre; ce n'était pas un fait sans importance que la même idée pût s'attacher avec autant de raison à un empereur romain ou plutôt à l'image du souverain de Rome. Depuis cet édit fatal, on ne cessa de penser qu'un autre empereur pouvait donner le même ordre; il en avait le droit; d'après la constitution romaine, cela dépendait uniquement du caprice momentané de l'empereur régnant. Cette haine des Juifs pour le culte de l'empereur et pour l'empire lui-même se manifeste avec des couleurs très vives dans l'Apocalypse de saint Jean; c'est essentiellement pour cette raison que Rome y est désignée comme la prostituée de Babylone et l'ennemi commun de toute l'humanité2. Le parallèle que l'on établissait entre les événements qui avaient suivi les deux profanations n'était pas moins important. Mattathias de Modaïn n'avait pas été plus grand que Judas le Galiléen; la révolte des patriotes contre le roi de Syrie avait fait naître aussi peu d'espérance que l'insurrection contre le monstre établi au-delà des mers. L'application des parallèles historiques à la réalité pratique est une arme dangereuse, quand elle est maniée par l'opposition, et l'oeuvre d'un gouvernement resté longtemps sage ne chancelle que trop vite. 1.- Les écrits de Philon, où nous trouvons toute cette catastrophe racontée avec une actualité incomparable, ne nous indiquent rien de pareil; mais, outre que cet écrivain riche et âgé était plutôt un homme bon qu'un véritable ennemi, on comprend qu'un Juif n'ait pas exposé publiquement ces conséquences nécessaires des événements. Il ne faut pas juger la pensée et les sentiments des Juifs, d'après ce qu'ils trouvaient bon de dire, surtout dans les ouvrages qu'ils écrivaient en grec. Si le livre de la sagesse et le troisième livre des Macchabées sont vraiment dirigés contre la persécution des Juifs d'Alexandrie (Hausrath, Neutestam. Zeitgesch., II, p. 259 et suiv.), ce qui d'ailleurs n'est rien moins que certain, ils sont encore plus pacifiques, si cela est possible, que les écrits de Philon. 2. Telle doit être l'interprétation exacte des idées juives, qui transforment ordinairement les faits positifs en conceptions abstraites. Dans les récits sur l'Antimessie et l'Antichrist on ne trouve aucun détail historique qui se rapporte à l'empereur Gaïus; il est impossible d'attribuer à ce souverain le nom d'Armillus, que le Targoum donne à l'Antichrist, sous prétexte que Gaïus portait quelquefois des bracelets de femmes (armillae) (Sueton., Gaius, 52); cette hypothèse ne peut pas être considérée comme sérieuse. Dans l'Apocalypse de saint Jean, qui est la manifestation classique du sentiment national des Juifs et de leur haine contre les Romains, le portrait de l'Antimessie s'applique bien mieux à Néron, qui pourtant n'a pas fait placer sa statue dans le Saint des Saints. A l'époque où cet ouvrage fut composé, le christianisme était encore essentiellement, comme on le sait, une secte juive; les élus, désignés par l'ange, sont tous juifs, à raison de douze mille par chacune des douze tribus; ils ont le pas sur la grande foule des autres Justes, c'est-à-dire des alliés des Juifs (c. 7; cf. c. 12, 1). Il a été certainement écrit après la mort de Néron, et lorsqu'on s'attendait à voir revenir cet empereur de l'Orient. Il est vrai qu'un faux Néron parut immédiatement après la mort du vrai Néron et qu'il fut exécuté au commencement de l'année suivante (Tacite, Hist., II, 8, 9), mais ce n'est pas à lui que songe saint Jean; les renseignements précis que nous avons sur cet usurpateur ne mentionnent pas les Parthes à propos de cette révolte, comme le fait saint Jean; pour lui un espace de temps considérable doit s'écouler entre la mort de Néron et son retour; ce dernier événement est encore dans l'avenir. Son Néron est celui qui, sous Vespasien, trouva des partisans dans la vallée de l'Euphrate, que le roi Artaban reconnut sous Titus et se préparait à rétablir sur le trône de Rome par les armes, et qu'enfin les Parthes livrèrent à Domitien en l'an 88 après de longues négociations (voir plus haut, t. X). L'Apocalypse signale avec une précision absolue tous ces événements. D'autre part si, dans un ouvrage de cette nature, l'auteur nous raconte (c. 11, 1, 2) que le parvis seul du temple de Jérusalem et non pas le sanctuaire lui-même, est dans la puissance des païens, il ne faut pas en tirer des conclusions précises sur l'état du siège à cette époque. Dans le détail tout est fantaisie; cet épisode, en particulier, ou bien était destiné à consoler les Juifs, ou bien faisait allusion à l'ordre que reçurent les soldats romains campés dans Jérusalem, après sa destruction, de ne pas pénétrer dans l'antique Saint des Saints. L'idée fondamentale de l'Apocalypse est incontestablement la destruction de la Jérusalem terrestre et l'espérance, qui naissait alors pour la première fois, de sa résurrection idéale dans l'avenir; on ne peut pas substituer à la démolition complète de la ville la seule crainte de sa conquête. Si l'auteur dit, en parlant des sept têtes du dragon: ? (c. 17, 10), c'est que les cinq sont Auguste, Tibère, Gaïus, Claude et Néron; le sixième est Vespasien, et le septième est indéterminé; Le monstre qui était, qui n'est pas, et qui sera le huitième, mais qui fait partie des sept, est naturellement Néron. Le septième personnage, qui reste indéterminé, est une création inhabile, comme tant d'autres détails de cette fantasmagorie grandiose, mais pleine de contradictions et qui souvent s'embrouille elle-même; mais, s'il a été introduit dans l'ouvrage, ce n'est pas pour compléter le nombre sept, que l'on pouvait parfaire en ajoutant César à la liste des empereurs; c'est parce que l'auteur éprouvait un certain embarras à déclarer que le règne du dernier empereur, qui était alors sur le trône, serait très court et que Néron revenu d'Orient serait son successeur. Mais il est impossible, comme le fait Renan après beaucoup d'autres, de mettre César en ligne de compte, de voir dans le sixième empereur qui est Néron, désigné ensuite comme celui qui a été et n'est pas, et dans le septième qui n'est pas encore venu et qui ne règnera pas longtemps, le vieux Galba qui, d'après Renan, était alors sur le trône. Il est évident que Galba ne fait pas partie d'une telle série, pas plus qu'Othon ni Vitellius. Mais il est plus important de combattre l'interprétation ordinaire, d'après laquelle toute la polémique serait dirigée contre la persécution dont les chrétiens furent victimes sous Néron, et contre le siège ou la destruction de Jérusalem; en réalité l'auteur attaque le gouvernement des provinces romaines et surtout le culte de l'empereur. Si des sept empereurs Néron seul est nommé, avec son numéro d'ordre, ce n'est pas parce qu'il était le plus mauvais des sept, mais parce qu'il y avait du danger à nommer dans un ouvrage fait pour être publié l'empereur régnant, en annonçant la fin prochaine de son règne, et aussi parce que même un prophète doit avoir quelque égard pour celui qui est. Le nom de Néron était abandonné au public; la légende de sa guérison et de sa résurrection était dans toutes les bouches; c'est pour cette raison qu'il est dans l'Apocalypse le représentant de l'empire romain et qu'on en a fait l'Antichrist. Ce que l'on reproche au monstre de la mer et au monstre de la terre, qui en est l'image et l'instrument, ce n'est pas d'avoir conquis Jérusalem (c. 11, 2)- pour l'auteur, la prise de cette ville n'est pas un crime des Romains, mais un épisode du jugement dernier; il se peut que dans cette conception on ait pris en considération l'empereur régnant, c'est que les païens adorent comme un dieu le monstre de la mer (c. 13, 8), et le monstre de la terre, qui s'appelle aussi le Pseudoprophète, réclame et impose cette adoration (c. 13, 12: ?), ce qu'on lui reproche surtout, c'est d'exiger qu'on lui dresse une statue (c. 13, 14 : ?. Cf. 14, 9; 16, 2; 19, 20). Ces allégories désignent clairement d'une part le gouvernement impérial dont le centre est situé au-delà des mers, d'autre part le gouvernement provincial du continent asiatique, non pas le gouvernement de telle ou telle province ou de telle ou telle personne, mais en général l'administration qui représentait l'empereur, telle que la connaissaient les habitans des provinces d'Asie et de Syrie. Pour faire le commerce, il faut employer le zapayua du monstre de la mer (c. 13, 16, 17); au fond de cette allégorie se trouve la haine des effigies et des légendes des monnaies impériales, présentée sous un aspect fantastique; de même Satan fait parler la statue de l'empereur. Les gouverneurs sont représentés plus loin comme les dix cornes, qui s'ajoutent à l'image du monstre; ils sont appelés très justement les dix rois, qui n'ont pas la dignité royale, mais qui sont aussi puissants que des rois; il ne faut pas tenir grand compte du chiffre, qui est emprunté à la vision de Daniel. Lorsqu'il parle de tribunaux criminels, qui condamnent les Justes, saint Jean fait allusion aux sentences prononcées habituellement contre ceux qui refusaient d'adorer l'image de l'empereur, comme nous l'apprennent les lettres de Pline (c. 13, 15 : ?. Cf. 6, 9; 20, 4). Quand l'auteur fait remarquer que ces condamnations étaient souvent exécutées à Rome (c. 17, 6; 18, 24), il fait allusion aux combats de gladiateurs ou de bêtes fauves, que l'on ne pouvait organiser dans la ville même où le jugement avait été rendu; c'est à Rome qu'on les donnait de préférence en spectacle (Modestinus, Dig., XLVIII, 19, 31). Les massacres, ordonnés par Néron, sous prétexte que les Juifs avaient incendié Rome, n'ont aucun rapport avec les procès religieux; c'est seulement par anticipation que l'on peut rapprocher exclusivement ou en grande doute il ne recommença pas à expulser les Juifs, parce qu'on avait dû se convaincre de l'inutilité d'une pareille mesure; mais on leur interdit de se réunir pour célébrer les cérémonies de leur culte, ce qui revenait à peu près au même et ce qui était presque aussi difficile à faire exécuter. A côté de cet édit d'intolérance, d'autres mesures témoignèrent de dispositions entièrement contraires : une ordonnance, applicable dans tout l'empire, exemptait les Juifs de toutes les partie de ces événements tous les martyres, que les chrétiens subirent à Rome et que raconte saint Jean. On se fait d'habitude une idée fausse de ce que l'on appelle les persécutions chrétiennes, parce que l'on ne connaît pas exactement les théories et les pratiques judiciaires en usage dans l'empire romain; en réalité on poursuivait les chrétiens comme on poursuivait des voleurs, d'une façon permanente; on les traitait seulement tantôt avec plus de douceur ou d'indulgence, tantôt avec plus de sévérité, généralement sur des ordres venus d'en haut. Les mots de guerre contre les saints sont une interpolation postérieure due à ceux auxquels les paroles de saint Jean ne paraissaient pas suffisantes (c. 13, 7). L'Apocalypse est un monument remarquable de la haine nationale et religieuse des Juifs contre le gouvernement de l'Occident; mais on déforme et on aplatit les faits, si l'on veut illustrer avec de pareilles couleurs, comme le fait surtout Renan, le roman prophétique relatif à Néron. La haine des Juifs n'attendit pas, pour éclater, la conquête de Jérusalem; elle ne distingua pas naturellement les bons empereurs des mauvais; son Antimessie s'appelle Néron, mais il pourrait se nommer Vespasien ou Marc-Aurèle. |
||||
41-54 |
Claude et les JuifsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe gouvernement de Claude suivit dans les deux sens l'exemple de Tibère. Sans doute il ne recommença pas à expulser les Juifs, parce qu'on avait dû se convaincre de l'inutilité d'une pareille mesure; mais on leur interdit de se réunir pour célébrer les cérémonies de leur culte1, ce qui revenait à peu près au même et ce qui était presque aussi difficile à faire exécuter. A côté de cet édit d'intolérance, d'autres mesures témoignèrent de dispositions entièrement contraires : une ordonnance, applicable dans tout l'empire, exemptait les Juifs de toutes les charges publiques incompatibles avec leurs convictions religieuses; en ce qui concernait surtout le service militaire, on ne fit que supprimer une obligation qu'on n'avait pas encore pu leur imposer réellement. A la fin de l'ordonnance, on recommandait aux Juifs d'agir de leur côté avec la plus grande modération, et de ne pas insulter les fidèles des autres religions; cela nous prouve que les Juifs s'étaient parfois écartés du droit chemin. En Egypte et en Palestine la situation religieuse fut rétablie telle qu'elle était avant Gaïus, au moins dans ses lignes générales; mais à Alexandrie les Juifs recouvrèrent difficilement tout ce qu'ils avaient possédé2. Néanmoins l'ensemble de ces mesures apaisa toutes les révoltes qui avaient éclaté ou qui allaient éclater dans l'une et l'autre province. En Palestine Claude alla même plus loin que Tibère; il rendit l'ancien royaume d'Hérode à un prince indigène, à cet Agrippa dont nous avons déjà parlé, qui s'était aussi lié d'amitié avec lui et qui lui avait rendu service au milieu des crises de son avènement. Claude avait certainement l'intention de reprendre le système appliqué au temps d'Hérode, et d'écarter les dangers que présentait le contact immédiat des Romains et des Juifs. Mais Agrippa, prince léger, aussi gêné dans ses finances comme roi que comme particulier, d'ailleurs débonnaire et disposé plutôt à bien traiter ses sujets qu'à obéir au suzerain éloigné, suscita plusieurs fois des difficultés au gouvernement, par exemple lorsqu'il releva les remparts de Jérusalem, qu'on lui avait interdit de reconstruire; les villes de Caesarea et de Sébasté, dévouées aux Romains, les troupes organisées à la romaine lui étaient antipathiques. Lorsqu'il mourut prématurément et subitement en l'an 44, il parut dangereux de confier à son fils unique, âgé de dix-sept ans, ce royaume important au point de vue politique et militaire; d'autre part les puissants du cabinet impérial ne renonçaient pas volontiers aux gouvernements lucratifs. Là comme ailleurs, Claude avait vu juste; mais il n'eut pas l'énergie de mettre ses projets à exécution en négligeant les considérations accessoires. Un prince juif pouvait gouverner la Judée avec une armée juive, au nom des Romains; si les fonctionnaires et les soldats romains choquaient sans cesse les Juifs, c'était plutôt par ignorance de leurs idées que par acharnement contre eux; quoi qu'ils fissent, les croyants se figuraient toujours qu'on les persécutait; l'acte le plus indifférent devenait un crime contre leur religion. On avait raison de demander aux deux partis de s'entendre et de se supporter mutuellement; mais il était impossible d'obtenir un pareil résultat. Un conflit entre un roi juif et ses sujets n'avait guère d'importance pour le reste de l'empire; au contraire, tout conflit entre les Romains et les Juifs de Jérusalem creusait l'abîme ouvert entre les peuples de l'Occident et les Hébreux qui vivaient au milieu d'eux. Le véritable danger ne résidait pas dans les événements de Palestine, mais dans l'incompatibilité des peuples de nationalité différente que le sort avait réunis au sein de l'empire. 1. Suétone (Claud., 25) désigne un certain Chrestus comme le promoteur des troubles permanents qui éclataient à Rome, et qui provoquèrent d'abord cette mesure d'après lui les Juifs furent expulsés; Dion (60, 6) nous dit le contraire -. On a supposé, sans raison suffisante, que Suétone faisait allusion au mouvement que l'arrivée du Christ fit naître parmi les Juifs et leurs alliés. L'histoire des Apôtres (18, 2) ne parle que de l'expulsion des Juifs. Mais il n'est pas douteux que les chrétiens, dans la situation qu'ils occupaient alors au milieu du judaïsme, n'aient été victimes du même édit. 2. Tout au moins les Juifs ne paraissent avoir occupé plus tard, à Alexandrie, que le quatrième des cinq quartiers de la ville (Josèphe, Bell. Jud., II, 18, 8). D'ailleurs, si on leur avait rendu avec tant d'éclat leurs quatre cents maisons détruites, les écrivains juifs Josèphe et Philon en auraient parlé; ils accentuent toujours les faveurs accordées aux Juifs par les empereurs. |
||||
44-66 |
Les préludes de l'insurrectionRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAinsi le navire était irrésistiblement entraîné dans le tourbillon. La catastrophe avait été préparée par tout le monde, par le gouvernement et les fonctionnaires romains, les autorités et le peuple de Judée. Et pourtant Rome avait sans cesse manifesté la volonté de faire droit autant que possible aux prétentions des Juifs, justes ou injustes. Lorsqu'en l'an 44 un procurateur romain fut rétabli dans Jérusalem, on lui enleva la nomination du grand-prêtre et l'administration du trésor du temple, deux prérogatives attachées jadis à la royauté et par conséquent aussi à la procurature; elles furent données à un frère du roi défunt Agrippa, le roi Hérode de Chalcis, et après sa mort, en l'an 48, à son successeur Agrippa le Jeune, dont nous avons déjà parlé. Sur la plainte des Juifs, le gouverneur romain fit mettre à mort un soldat romain qui avait déchiré un exemplaire du Pentateuque (Thora), pendant le pillage autorisé d'un village juif. La justice impériale n'hésita même pas, suivant les circonstances, à frapper des fonctionnaires plus élevés dans la hiérarchie. Deux procurateurs, qui administraient des territoires voisins, prirent parti, l'un contre l'autre, dans la querelle entre les Samaritains et les Galiléens, et firent combattre leurs soldats à ce sujet; le gouverneur impérial de Syrie, Ummidius Quadratus, reçut des pouvoirs extraordinaires et fut envoyé en Palestine, pour juger et pour punir les deux adversaires; en effet, l'un des coupables fut banni, et l'on décapita dans Jérusalem même un tribun militaire romain du nom de Celer. Mais à côté de ces exemples de sévérité on peut citer d'autres actes, qui témoignent d'une faiblesse coupable. Dans ce même procès, le second procurateur, Antonius Felix, qui n'était pas moins criminel que le premier, put se soustraire au châtiment, parce qu'il était le frère du puissant affranchi Pallas et le beau-frère du roi Agrippa. Ce qu'il faut reprocher au gouvernement impérial plus encore que les abus de pouvoir de ses représentants, c'est de n'avoir pas augmenté la puissance des fonctionnaires et la force des troupes dans une telle province, et d'avoir continué à recruter la garnison presque exclusivement parmi les indigènes. C'était une lourde sottise et une économie mal placée que d'appliquer l'ancien système d'administration dans cette province peu considérable; si l'on avait créé, au moment opportun, une puissance écrasante, si l'on avait fait preuve d'une sévérité impitoyable, si l'on avait envoyé dans le pays un gouverneur de rang élevé et une légion, on aurait épargné à la Palestine et à l'empire de grands sacrifices d'argent, de sang et d'honneur. Mais les Juifs ne furent pas moins coupables que le gouvernement impérial. La puissance des grands-prêtres, - et les Romains n'étaient que trop portés à les laisser agir librement dans toutes les affaires intérieures de la Judée - ne fut jamais, d'après les historiens juifs eux-mêmes, aussi brutale ni aussi dépourvue de valeur que pendant la période qui s'écoula depuis la mort d'Agrippa jusqu'à l'explosion de la guerre. Le plus connu et le plus influent de ces souverains religieux est Ananias, fils de Nebedaeus, le mur cr�pi, comme saint Paul l'appela, lorsque ce juge spirituel le fit frapper sur la bouche par ses sergents, parce qu'il osait se défendre devant le tribunal. On lui reprocha d'avoir corrompu le gouverneur, et d'avoir interprété l'Ecriture de manière à priver le bas clergé de la dîme des fruits de la terre. Il fut traduit devant la juridiction romaine comme un des promoteurs principaux de la guerre entre les Samaritains et les Galiléens. Les fanatiques intransigeants avaient une grande influence dans la haute société; mais ces machinateurs d'émeutes populaires et ces organisateurs d'inquisition ne possédaient pas l'autorité morale et religieuse, dont les modérés s'étaient servis en de meilleurs temps pour conduire la foule; ils ne comprenaient pas pourquoi les autorités romaines s'abstenaient de toute intervention dans les affaires intérieures, et ils abusaient de cette indulgence; aussi ne pouvaient-ils pas rendre plus pacifiques les rapports entre la domination étrangère et le peuple juif. Ce fut sous leur gouvernement que les fonctionnaires romains furent l'objet des provocations les plus grossières et les plus déraisonnables, et qu'éclatèrent des émeutes d'une bouffonnerie effrayante. Telle fut cette pétition violente, qui réclama et qui obtint la mort d'un soldat romain, parce qu'il avait déchiré un texte de loi. Une autre fois le peuple se souleva, et sa révolte couta la vie à beaucoup d'hommes, parce qu'un soldat romain avait eu l'inconvenance de mettre à nu dans le temple une partie de son corps. Le meilleur des rois n'aurait pu guérir complètement ce peuple d'une pareille démence; mais même le plus petit prince aurait eu, pour tenir tête à cette foule fanatique, plus de force que ces prêtres. La véritable conséquence de tous ces événements fut l'accroissement incessant du parti des nouveaux Macchabées. D'habitude on place le début de la guerre en l'an 66; on pourrait le placer avec autant et peut-être plus de raison en l'an 44. Depuis la mort d'Agrippa la paix n'avait pas régné un seul moment en Judée; non seulement la guerre civile avait éclaté entre les Juifs, mais encore les troupes romaines avaient dû lutter sans cesse contre les bandes des partisans retranchés dans les montagnes, contre les zélés, comme les appelaient les Juifs, tandis que les Romains leur donnaient le nom de brigands. Les deux surnoms étaient également justes : tout ce qu'il y avait de corrompu et de corrupteur dans la société venait s'associer aux fanatiques. Après leur victoire, un des premiers actes de ces zélotes fut de brûler les lettres de créance conservées dans le temple. Tous les procurateurs habiles, à commencer par Cuspius Fadus, purgèrent le pays de ce fléau, et toujours on vit renaître l'hydre plus puissante qu'auparavant. Le successeur de Fadus, Tiberius Julius Alexander, issu lui-même d'une famille juive et neveu de Philon, ce savant d'Alexandrie que nous avons déjà nommé, fit mettre en croix deux fils de Judas le Galiléen, Jacob et Simon; leur sang fut le germe d'un nouveau Mattathias. Les patriotes prêchaient tout haut la guerre dans les rues des villes; un grand nombre d'enthousiastes les suivaient dans le désert. Ces bandes incendiaient les maisons de leurs compatriotes pacifiques et intelligents, de tous ceux qui ne voulaient pas être leurs complices. Lorsque les soldats faisaient prisonniers quelques-uns de ces brigands, des personnages considérables étaient enlevés et emmenés comme otages dans les montagnes et l'autorité se résigna très souvent à relâcher les uns, pour délivrer les autres. Ce fut à la même époque que les hommes au poignard commencèrent dans la capitale leur oeuvre sinistre; ils assassinaient quelquefois pour de l'argent - leur première victime fut, dit-on, le prêtre Jonathan, leur premier commettant le procurateur Félix -; mais c'était autant que possible à titre de patriotes qu'ils tuaient les soldats romains ou les Juifs partisans de Rome. Dans de pareilles circonstances, les miracles et les prodiges devaient bientôt faire leur apparition, ainsi que les gens, dupeurs ou dupés, qui s'en servaient pour fanatiser les masses. Sous Cuspius Fadus le sorcier Theudas conduisit ses fidèles au bord du Jourdain, en leur assurant que les eaux allaient s'entr'ouvrir devant eux, puis engloutir les cavaliers romains qui les poursuivaient, comme au temps du roi Pharaon. Sous Félix, un autre fabricant de miracles, qu'on nommait l'Egyptien à cause de sa patrie, affirma que les murs de Jérusalem, comme ceux de Jéricho au son des trompettes de Josué, allaient bientôt s'écrouler, et il entraîna 4 000 sicaires jusqu'à la montagne des Oliviers. Ce qui était le plus dangereux encore, c'était la sottise de la foule. La grande masse des populations juives se composait de petits agriculteurs, qui cultivaient leurs champs et produisaient leur huile à la sueur de leur front; c'étaient des paysans bien plus que des citadins, des hommes d'une instruction médiocre et d'une foi enthousiaste, étroitement unis aux bandes qui occupaient la montagne, remplis d'une crainte respectueuse pour Jéhovah et pour ses prêtres de Jérusalem, ennemis irréconciliables des étrangers impurs. La guerre de Judée n'était donc pas une lutte entre deux puissances pour l'hégémonie; ce n'était même pas une révolte d'opprimés qui combattent leurs oppresseurs pour reconquérir la liberté; ce ne furent pas des hommes d'Etat téméraires1, mais des paysans fanatiques qui prirent les armes, qui se battirent et qui versèrent leur sang. Cette guerre est une nouvelle étape dans l'histoire de la haine nationale; les deux partis sentaient qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble; ils étaient d'accord pour comprendre que l'un ou l'autre devait être exterminé. 1. L'orgueil fait tourner la tête au politique Josèphe, quand il nous raconte, dans la préface de son histoire de la guerre, que les Juifs de la Palestine comptaient d'une part sur le recrutement de soldats juifs dans la vallée de l'Euphrate, d'autre part sur les troubles de la Gaule, sur l'attitude menaçante des Germains, et sur les crises de l'année des quatre empereurs. La guerre de Judée était depuis longtemps commencée, lorsque Vindex se souleva contre Néron, et lorsque les Druides jouèrent dans la réalité le rôle qui est attribué en Orient aux rabbins; et si nombreux que fussent les Juifs dans la vallée de l'Euphrate, il leur était presque aussi impossible qu'aux Juifs d'Egypte et d'Asie Mineure d'entreprendre une expédition contre les Romains de l'Orient. Il est vrai que plusieurs chefs de bandes vinrent de cette contrée, par exemple quelques princes de la maison royale d'Adiabène, pleine d'enthousiasme pour la religion juive (Josèphe, Bell. Jud., II, 19, 2; VI, 6, 4). Les insurgés envoyèrent des ambassades dans ce pays pour demander des secours (ibid., VI, 6, 2); mais ils en obtinrent difficilement même une certaine quantité d'or. Ce détail caractérise l'historien plus encore que la guerre elle-même. On comprend que le chef des Juifs révoltés, devenu plus tard le courtisan des Flaviens, se soit volontiers comparé aux princes parthes internés à Rome; mais ce qu'on lui pardonne moins, c'est d'avoir écrit sa dernière oeuvre historique dans le même esprit que la première, d'avoir jugé ces événements comme des épisodes de l'histoire des empereurs romains et de Rome, ou même de l'histoire des relations entre Rome et les Parthes; c'est d'y avoir introduit sottement ce qu'il appelle la grande politique, et d'avoir rendu plus obscure la redoutable nécessité de ce drame tragique. |
||||
66 |
Emeutes à CésaréeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe mouvement, qui devait transformer ces émeutes en une véritable guerre, partit de Césarée. Cette ville d'origine grecque, qu'Hérode avait constituée sur le modèle des colonies fondées par Alexandre, était devenue le premier port de la Palestine; sa population se composait de Grecs et de Juifs, qui jouissaient des mêmes droits civiques sans distinction de nationalité ni de religion; les Juifs étaient plus nombreux et plus riches. Mais ces Hellènes, pour imiter leurs compatriotes d'Alexandrie et sans doute sous l'influence immédiate des événements de l'année 38, recoururent à l'autorité suprême pour faire enlever à leurs concitoyens juifs le droit de cité. Le ministre de Néron1, Burrus (mort en 62), leur donna raison. Il était singulièrement injuste d'accorder à des Hellenes seuls le privilège du droit de cité dans une ville fondée sur le sol juif et par un gouvernement juif; mais il ne faut pas oublier quels étaient précisément à cette date les rapports entre les Juifs et les Romains; l'attitude des sujets engageait les vainqueurs à transformer en une cité purement hellénique la capitale romaine et le quartier général romain de la province. Cette décision provoqua, comme bien l'on pense, de violentes émeutes dans les rues de Césarée; le dédain des Hellènes semble avoir égalé l'arrogance des Juifs, surtout pendant le combat qui se livra autour de la synagogue. Les autorités romaines intervinrent et prirent naturellement parti contre les Juifs. Ceux-ci quittèrent la ville; mais ils furent contraints par le gouverneur d'y rentrer, puis massacrés jusqu'au dernier dans une émeute (6 août 66). Le gouvernement n'avait ni commandé ni désiré une telle exécution; désormais des forces étaient déchaînées, auxquelles il ne pouvait plus lui-même résister. 1. Josèphe (Ant. Jud., XX, 8, 9) fait de lui le secrétaire de Néron pour la correspondance grecque, et pourtant, lorsqu'il puise à des sources romaines (ibid., 2), il le désigne avec raison comme préfet; mais c'est du même personnage qu'il s'agit. Il est nommé par Josèphe, comme par Tacite (Ann., XIII, 2) rector imperatoriae juventae. |
||||
66 |
Explosion de la révolte à JérusalemRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteSi, à Césarée, les ennemis des Juifs avaient été les agresseurs, à Jérusalem, ce furent les Juifs qui attaquèrent. Ceux de leurs compatriotes qui ont raconté ces événements assurent que le procurateur qui gouvernait alors la Palestine, Gessius Florus, pour ne pas être accusé d'avoir mal administré sa province, avait voulu provoquer une révolte par l'excès de la persécution; il n'est pas douteux qu'à cette époque les fonctionnaires romains aient été beaucoup trop incapables et trop cruels. Mais si tel était réellement le projet de Florus, ce projet ne réussit pas. Car, d'après les mêmes historiens, les Juifs sensés et propriétaires surent apaiser les masses avec l'aide du roi Agrippa II, auquel on avait confié l'administration du temple et qui se trouvait alors à Jérusalem - il avait, dans l'intervalle, abandonné la royauté de Chalcis pour celle de la Batanée; - les attroupements et l'intervention des troupes armées n'eurent pas cette fois plus d'importance qu'elles n'en avaient en Palestine depuis quelques années. Mais ce qui était plus dangereux que les troubles de la rue et les bandes de patriotes retirées dans les montagnes, c'étaient les progrès de la théologie juive. Le judaïsme des temps primitifs avait libéralement ouvert sa religion aux étrangers; sans doute, l'intérieur du temple n'était accessible qu'aux fidèles proprement dits; mais on admettait tout le monde dans les portiques extérieurs sous le nom de prosélytes du portail; les non-Juifs eux-mêmes pouvaient de leur côté adresser leurs prières et sacrifier au seigneur Jéhovah. C'est ainsi que, par suite d'une fondation d'Auguste, dont nous avons déjà parlé, on offrait chaque jour une victime dans le temple de Jérusalem, au nom de l'empereur romain. Ces sacrifices de non-Juifs furent interdits par le nouveau gouverneur du temple, Eleazar, fils du grand-prêtre Ananias, que nous avons nommé plus haut; c'était un jeune homme de naissance illustre, à l'âme passionnée, personnellement honnête et irréprochable, le contraste vivant de son père, mais plus redoutable par ses vertus qu'Ananias ne l'avait été par ses vices. En vain, on lui représenta que cette interdiction était à la fois injurieuse pour les Romains, dangereuse pour le pays et contraire à l'usage; il ne voulut pas renoncer à sa piété exagérée et interdit le service divin au maître de son peuple. Depuis longtemps, les Juifs croyants étaient divisés en deux grands partis : le parti de ceux qui mettaient leur confiance dans le seigneur Zebaoth seul, et qui supportaient la domination romaine, jusqu'à ce qu'il plût à Dieu de réaliser sur terre le royaume du ciel, et le parti des hommes plus pratiques, qui étaient décidés à fonder eux-mêmes cet empire céleste et qui se croyaient soutenus dans leur oeuvre pieuse par le Dieu des armées; en deux mots, le parti des Pharisiens et celui des Zélotes. Ces derniers croissaient sans cesse en nombre et en influence. L'on avait découvert une antique prophétie d'après laquelle un homme devait sortir à cette époque de la Judée et conquérir le monde; on y croyait d'autant plus qu'elle était absurde, et cet oracle ne contribua pas peu à fanatiser davantage encore les masses. Le parti modéré reconnut le danger et se décida à écraser les fanatiques les armes à la main. Il demanda des troupes aux Romains de Césarée et au roi Agrippa. Les Romains ne lui envoyèrent aucun secours; Agrippa leur fournit un certain nombre de cavaliers. Mais les patriotes et les sicaires envahirent Jérusalem, conduits par le Manahem, l'un des fils de ce Judas de Galilée que nous avons souvent nommé. Les insurgés furent les plus forts et s'emparèrent bientôt de toute la ville. La poignée de soldats romains, qui occupait la forteresse voisine du temple, fut elle-même écrasée et massacrée. Le palais du roi, situé non loin de là, et les tours puissantes qui en dépendaient, où s'étaient réfugiés le parti des modérés, un certain nombre de Romains commandés par le tribun Metilius et les soldats d'Agrippa, ne firent pas plus longue résistance. On laissa sortir librement les derniers qui avaient demandé à capituler, mais on repoussa la même proposition faite par les Romains; lorsqu'ils se rendirent enfin sous la condition d'avoir la vie sauve, ils furent d'abord désarmés, puis mis à mort, excepté leur officier, qui promit de se faire circoncire et qui fut épargné comme Juif. Les chefs du parti modéré, parmi eux le frère et le père d'Eléazar, furent victimes de la rage populaire, qui sévissait plus cruellement contre les alliés des Romains que contre les Romains eux-mêmes. Eleazar fut effrayé de sa victoire; après le triomphe, une collision sanglante éclata entre lui et Manahem, l'autre chef des fanatiques, peut-être parce que la capitulation avait été violée. Manahem, fait prisonnier, fut exécuté. Mais la ville sainte était libre et le détachement romain, campé à Jérusalem, anéanti: les nouveaux Macchabées avaient vaincu comme leurs ancêtres. |
||||
66 |
Extension de la guerre des JuifsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAinsi, presque à la même date, le 6 août 66, les non-Juifs avaient massacré les Juifs à Césarée; les Juifs avaient massacré les non-Juifs à Jérusalem. Ces deux événements engagèrent les Juifs à persévérer dans cette oeuvre patriotique et agréable à Dieu. Dans les villes grecques voisines, les Hellènes se débarrassèrent comme à Césarée des colonies juives. Ainsi, à Damas, tous les Juifs furent d'abord enfermés dans le gymnase, puis mis à mort, lorsqu'on apprit un échec des armes romaines. Les mêmes mesures ou des mesures semblables furent prises à Ascalon, à Skytopolis, à Hippos, à Gadara, partout où les Hellènes étaient les plus forts. Dans le royaume d'Agrippa qu'habitaient surtout des Syriens, l'énergique intervention du prince sauva la vie aux Juifs de Caesarea Paneas et d'autres villes. En Syrie, Ptolémaïs, Tyr, suivirent l'exemple de Césarée, et plus ou moins les autres cités grecques; firent seules exception, avec Sidon, les deux villes considérables et civilisées d'Antioche et d'Apamée. C'est grâce à leur attitude que la persécution ne pénétra pas dans l'Asie Mineure. En Egypte, non seulement il y eut une émeute populaire, qui fit beaucoup de victimes, mais encore les légions d'Alexandrie elles-mêmes durent tailler en pièces les Juifs. Dans la défaite inévitable des Juifs, l'insurrection, victorieuse à Jérusalem, gagna bientôt toute la Judée; elle s'organisa partout en écrasant les minorités, mais en faisant preuve d'activité et d'énergie. |
||||
66 |
Expédition inutile de Cestius GallusRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl était nécessaire d'intervenir le plus tôt possible et de circonscrire rapidement le foyer de l'incendie; à la première nouvelle de la révolte, le gouverneur romain de la Syrie, Gaïus Cestius Gallus marcha contre les insurgés avec ses forces. Il commandait environ à 20000 hommes de troupes romaines et à 13000 soldats envoyés par les princes vassaux, sans compter les nombreuses milices syriennes. Après s'être emparé de Joppé, dont toute la municipalité fut mise à mort, il arriva au mois de septembre devant Jérusalem; il entra même dans la ville. Mais il ne put pas briser les murs formidables du palais et du temple; il ne sut pas davantage mettre à profit l'occasion qui lui fut souvent offerte d'entrer en possession de la cité avec l'aide du parti modéré. La conquête de Jérusalem était-elle une tâche impossible ou simplement trop difficile pour lui ? Nous ne le savons. Quoi qu'il en soit, il leva bientôt le siège et dut sacrifier, pour assurer sa retraite précipitée, ses bagages et son arrière-garde. Les Juifs exaspérés gardèrent donc ou conquirent alors la Judée entière avec l'Idumée et la Galilée; le pays de Samarie fut bientôt contraint de se joindre aux rebelles. Les villes grecques de la côte Anthédon et Gaza furent détruites; Césarée et les autres cités helléniques furent conservées à grand peine. Si l'insurrection ne s'étendit pas en dehors de la Palestine, ce n'est pas parce que le gouvernement agit avec fermeté, mais parce que les Syro-Hellènes détestaient les Juifs. |
||||
66-69 |
Campagne de VespasienRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe gouvernement prit les choses au sérieux, comme elles le méritaient. Au lieu d'un procurateur on envoya en Palestine un légat impérial, Titus Flavius Vespasianus, homme prudent et soldat éprouvé. On lui confia, pour faire cette guerre, deux légions d'Occident qui avaient pris part aux luttes contre les Parthes et qui se trouvaient encore en Asie; en outre on lui donna celle des légions de Syrie qui avait le moins souffert pendant la malheureuse expédition de Cestius. L'armée de Syrie, commandée par le nouveau gouverneur Gaïus Licinius Mucianus, Gallus venait de mourir à bien à propos, fut complétée avec une autre légion et se trouva dans le même état qu'auparavant1. A cette armée de légionnaires et à ses auxiliaires vinrent s'ajouter d'abord l'ancienne garnison de la Palestine, puis les troupes des quatre rois vassaux de Commagène, d'Hémèse, de Judée et des Nabatéens, en tout près de 50000 hommes, dont 15000 soldats royaux2. Au printemps de l'année 67 cette armée fut réunie à Ptolémaïs et entra en Palestine. Depuis que les insurgés avaient été énergiquement repoussés par la faible garnison romaine d'Ascalon, ils n'avaient plus osé s'attaquer aux villes qui tenaient pour les Romains; les rebelles commençaient à désespérer, et ce qui le prouve, c'est qu'ils renonçaient déjà à toute offensive. Lorsque les Romains entrèrent en campagne, ils ne se présentèrent jamais devant eux en bataille rangée; ils n'essayèrent même pas une seule fois de porter secours aux différentes places assiégées. En homme prudent, le général romain ne divisa pas son armée; il tint toujours réunies au moins les trois légions. La résistance fut cependant opiniâtre, parce que dans la plupart des villages, les fanatiques, quoique en nombre très restreint, terrorisaient les pouvoirs locaux; l'expédition romaine ne fut ni brillante, ni rapide. Vespasien consacra toute sa première campagne (67) à s'emparer des forteresses construites dans le petit pays de la Galilée, et à conquérir la côte jusqu'à Ascalon; les trois légions furent arrêtées pendant quarante-cinq jours devant la seule petite ville de Jotapata. Une légion prit ses quartiers d'hier (67-68) à Skytopolis, sur la frontière méridionale de la Galilée, les deux autres à Césarée. Cependant à Jérusalem les diverses factions en venaient aux mains et se combattaient avec acharnement; les bons patriotes, qui étaient aussi partisans d'une organisation municipale, et les patriotes encore meilleurs, qui voulaient inaugurer et mettre à profit un régime de terreur, soit par enthousiasme fanatique, soit par amour du crime, se battaient dans les rues de la ville; ils n'étaient d'accord que pour considérer toute tentative de réconciliation avec les Romains, comme un crime digne de mort. Le général romain invité plusieurs fois à profiter de ces discordes, aima mieux procéder lentement. Pendant la seconde année de la guerre, il fit occuper d'abord le territoire situé au-delà du Jourdain, et surtout les villes importantes de Gadara et de Gérasa; il s'établit lui-même près d'Emmaüs et de Jéricho; de là il envoya des troupes au Sud occuper l'Idumée, au Nord Samarie, de telle sorte que, pendant l'été de l'année 68, Jérusalem était cernée de toutes parts. Le siège allait commencer, lorsqu'on reçut la nouvelle de la mort de Néron. (Interruption de la guerre) En théorie, la mission confiée au légat prenait fin; en fait, Vespasien suspendit les opérations jusqu'à nouvel ordre, ce qui n'était pas moins prudent au point de vue politique qu'au point de vue militaire. La bonne saison était écoulée avant que Galba eût envoyé de nouvelles instructions. Au printemps de l'année 69, Galba était renversé, et la lutte était engagée entre l'empereur des prétoriens de Rome et l'empereur de l'armée du Rhin. Ce fut seulement après la victoire de Vitellius, au mois de juin 69, que Vespasien reprit les opérations et s'empara d'Hébron; mais bientôt toutes les armées de l'Orient refusèrent de prêter serment au nouvel empereur, et proclamèrent à sa place le légat de Judée. Pour faire face aux Juifs on conserva les positions d'Emmaüs et de Jéricho; mais, comme les légions de Germanie avaient découvert la frontière du Rhin, pour porter leur général à l'empire, de même le noyau de l'armée de Palestine partit, soit avec le légat de Syrie Mucianus, pour l'Italie, soit avec le nouvel empereur et son fils Titus d'abord pour la Syrie, puis pour l'Egypte; et ce fut seulement à la fin de l'année 69, lorsque la guerre de succession fut terminée et lorsque la domination de Vespasien fut reconnue dans tout l'empire, que l'empereur chargea son fils d'en finir avec les Juifs. 1. Nous ne connaissons pas très clairement la situation militaire de la Syrie en l'année 63, à la fin de la guerre contre les Parthes. A cette époque, il y avait en Orient sept légions, les quatre anciennes légions de Syrie, la IIe Gallica, la VIe Ferrata, la Xe Fretensis, la XIIe Fulminata, et trois légions venues d'Occident, la IVe Scythica de Mésie (t. IX, p. 271, note 1), la Ve Macedonica probablement de la même province (elle fut remplacée en Mésie par une légion de la Haute-Germanie), la XVe Apollinaris de Pannonie. La Syrie étant alors la seule province d'Asie qui fût occupée par des légions, et pendant la paix le gouverneur de Syrie n'ayant certainement jamais eu plus de quatre légions, il est certain que l'armée de Syrie a été ramenée à cette époque à l'effectif normal, ou qu'elle a dû l'être. Les quatre légions, qui restèrent alors en Syrie, furent, suivant l'hypothèse la plus simple, les quatre anciennes légions de Syrie; car en l'an 70 la IIIe partait de Syrie pour se rendre en Mésie (Sueton., Vesp., 6; Tacite, Hist., II, 74), et Josèphe, (Bell. Jud., II, 18, 9, cf. 19, 7; VII, 1, 3), nous apprend que les Vie, Xe, XIIIe faisaient partie de l'armée de Cestius. Lorsque la guerre de Judée éclata, sept légions furent de nouveau désignées pour combattre en Asie; quatre furent attribuées à la Syrie (Tacite, Hist., I, 10), trois à la Palestine; les trois légions supplémentaires étaient précisément celles qui avaient servi dans la guerre contre les Parthes, la IVe, la Ve et la VIe, et qui n'étaient peut-être pas encore rentrées dans leurs anciens cantonnements. Il est probable que la IVe fut alors définitivement envoyée en Syrie, où elle est restée depuis; en revanche Vespasien prit à l'armée de Syrie la Xe, sans doute parce que c'était elle qui avait été le moins éprouvée pendant la campagne de Cestius. Il reçut en outre la Ve et la XVe. D'après Josèphe (Bell. Jud., III, 1, 3, cf. IV, 2) la Ve et la Xe légion vinrent d'Alexandrie; mais il n'est pas probable que ces deux troupes aient été amenées de l'Egypte : non seulement la Xe était une légion syrienne, mais encore et surtout Josèphe n'a pas pu dire qu'au début de la guerre de Judée un corps de troupes s'était rendu d'Alexandrie sur le Nil à Ptolémaïs, par la voie de terre, car il aurait eu à traverser un pays révolté. Ce qui est beaucoup plus vraisemblable c'est que Titus alla par mer de l'Achase jusqu'au golfe d'Issus, et qu'il débarqua à Alexandrie, la moderne Alexandrette, d'où il conduisit les deux légions à Ptoléma&iiuml;s. La XVe doit avoir reçu l'ordre de marcher, en quelque endroit de l'Asie Mineure, puisque Vespasien se rendit par terre en Syrie, pour en prendre le commandement (Josèphe, Bell. Jud., III, 1, 3). A ces trois légions avec lesquelles Vespasien commença la guerre, vint s'adjoindre, sous Titus, une autre des légions de Syrie, la XIIe. Des quatre légions qui prirent Jérusalem, les deux anciennes légions de Syrie restèrent en Orient, la Xe en Judée, la XIIe en Cappadoce, tandis que la Ve retournait en Mésie et la XVe en Pannonie (Josèphe, Bell. Jud., VII, 1, 3, cf. 5, 3). 2. Ces trois légions comprenaient en outre 5 ailes, 18 cohortes, et l'armée de Palestine qui se composait d'une aile et de 5 cohortes. Par conséquent ces troupes auxiliaires comptaient 3000 cavaliers auxiliaires, et puisque parmi les 23 cohortes il y en avait 10 qui étaient fortes de 1000 hommes, et 13 de 720 ou plutôt de 480 seulement; 16240 fantassins auxiliaires. Il faut ajouter 1000 cavaliers fournis par les quatre rois, 5000 archers d'Arabie, et 2000 donnés par les trois autres rois. La somme s'élève donc, si l'on évalue la légion à 6000 hommes, à 52240 hommes, environ 60000 hommes, comme dit Josèphe (Bell. Jud., III, 4, 2). Mais, comme les détachements sont comptés suivant leur plus fort effectif normal, l'effectif réel ne doit pas avoir dépassé en tout 50000 hommes. On peut se fier à ces chiffres fournis par Josèphe comme aux indications analogues qu'il nous donne pour l'armée de Cestius (Bell. Jud., II, 18, 9); au contraire celles de ses estimations qui sont fondées sur le recensement sont continuellement erronées; il nous dit par exemple que le plus petit village de la Galilée compte 15000 habitants (Bell. Jud., III, 3, 2), chiffre aussi inutile à l'histoire que les comptes de Falstaff. On ne trouve que rarement des nombres en rapport avec la réalité, comme ceux qu'il donne à propos du siège de Jotapata. |
||||
70 |
Titus à JérusalemRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes insurgés avaient donc été maîtres absolus dans Jérusalem depuis l'été de l'an 66 jusqu'au printemps de l'année 70. Tous les malheurs qu'ont causés à la nation juive, dans ces quatre années terribles, l'union du fanatisme religieux et de l'enthousiasme national, le noble désir de ne pas survivre à la chute de la patrie, et la conscience des crimes commis avec la crainte d'une punition impitoyable, la succession sauvage de toutes les passions les plus hautes et les plus basses, tous ces malheurs sont d'autant plus épouvantables, que les étrangers n'ont été que des spectateurs. Les fanatiques, soutenus par les sauvages et farouches habitants des villages de l'Idumée, triomphèrent bientôt (fin de 68) des patriotes modérés et massacrèrent leurs chefs. Désormais le parti violent l'emportait; tout ordre politique, religieux ou moral fut détruit. On rendit la liberté aux esclaves; le grand-prêtre fut choisi par le sort; les rites furent foulés aux pieds et méprisés par ces fanatiques, dont le temple était la forteresse; les prisonniers furent égorgés dans les prisons, et sous peine de mort il fut interdit d'ensevelir leurs cadavres. Les différents chefs combattaient les uns contre les autres avec leurs troupes particulières: Jean de Giskala avait amené ses bandes de Galilée; Simon, fils de Giorax, de Gérasa, commandait une armée de patriotes qu'il avait formée dans le Sud et des Iduméens révoltés contre Jean; Eleazar, fils de Simon, avait déjà lutté contre Cestius Gallus. Le premier campait dans le portique du temple, le second dans la ville, le troisième dans le sanctuaire même: chaque jour des combats se livraient entre les Juifs dans les rues de Jérusalem. L'accord n'existait que contre l'ennemi commun. Lorsque l'assaut commença, la petite troupe d'Eléazar se plaça sous les ordres de Jean, et quoique Jean et Simon n'eussent pas cessé de faire les maîtres, l'un dans le temple et l'autre dans la ville, ces deux hommes qui se détestaient combattirent l'un auprès de l'autre contre les Romains. La tâche n'était pas facile pour les assiégeants. Sans doute l'armée romaine, qui pour remplacer le détachement envoyé en Italie avait reçu des renforts considérables d'Egypte et de Syrie, était assez nombreuse pour faire le blocus de la ville; en vain les Juifs avaient eu beaucoup de temps pour se préparer au siège, les vivres étaient insuffisants, d'autant plus qu'on en détruisait sans cesse dans les émeutes, et qu'un grand nombre d'étrangers avaient été enfermés dans la cité, parce que le siège avait commencé au moment de la fête de Pâques. Mais, si la masse de la population tomba bientôt dans un grand dénûment, les troupes assiégées prenaient tout ce dont elles avaient besoin là où elles le trouvaient et, bien nourries, allaient au combat sans s'occuper de la foule affamée ou même mourante de faim. Le jeune général ne pouvait se résigner à bloquer simplement la ville; un siège ainsi terminé avec quatre légions ne lui donnait personnellement aucune gloire et ne pouvait illustrer la nouvelle dynastie. La ville, protégée de tous les côtés par des rochers inaccessibles, n'était attaquable que par le Nord; encore n'était-ce pas un petit travail que de forcer la triple circonvallation que les richesses amassées dans le temple avaient permis de construire sans tenir compte de la dépense, et, lorsqu'on aurait pénétré dans l'intérieur de la ville, d'enlever la forteresse, le temple et les trois tours puissantes d'Hérode à une garnison nombreuse, fanatique et désespérée. Jean et Simon ne se contentèrent pas de repousser les assauts; ils attaquèrent avec succès les troupes romaines qui travaillaient aux fortifications; ils détruisirent ou brûlèrent les machines de siège. |
||||
70 |
Destruction de JérusalemRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste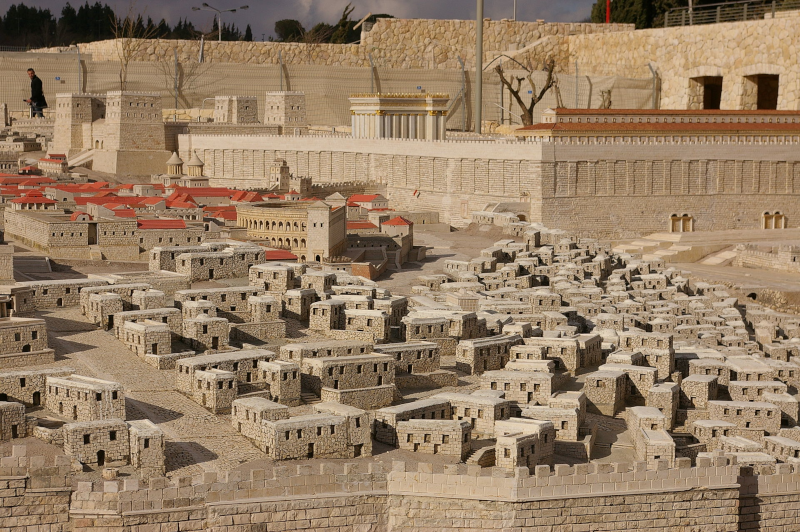
Mais le nombre et la science militaire donnèrent la victoire aux Romains. Les remparts furent emportés; la forteresse Antonia fut prise; enfin, après une longue résistance, les portiques du temple furent réduits en cendres, et le 10 Ab (août), le temple lui-même fut brûlé avec les trésors qu'on y avait entassés depuis six siècles. On lutta dans les rues pendant un mois; le 8 Eloul (septembre) les dernières résistances furent brisées et le Salem sacré fut détruit. Ce travail sanglant avait duré cinq mois. L'épée, les flèches et plus encore la famine avaient fait d'innombrables victimes; les Juifs égorgeaient, au moindre soupçon de trahison; ils forçaient leurs femmes et leurs enfants à mourir de faim dans la ville; les Romains n'eurent pas plus de pitié; ils passèrent au fil de l'épée ou crucifièrent tous les prisonniers. Les combattants qui survivaient à la lutte, et surtout les deux chefs des assiégés furent tirés des égouts, où ils s'étaient cachés. Sur les bords de la mer Morte, là où jadis le roi David et les Macchabées avaient trouvé un refuge au moment de leurs plus durs revers, les débris des insurgés résistèrent encore pendant plusieurs années dans les forteresses de Machaerus et de Massada, construites au milieu des rochers; puis Eléazar, petit-fils de Judas le Galiléen, et les siens, les derniers des Juifs libres, se donnèrent la mort après avoir tué leurs femmes et leurs enfants. L'oeuvre était achevée. L'empereur Vespasien, vaillant général, ne dédaigna pas de monter en triomphe au Capitole pour célébrer cette victoire qu'il lui était impossible de ne pas remporter sur un petit peuple depuis longtemps sujet de l'empire, et le chandelier à sept branches, qui fut enlevé du sanctuaire et transporté à Rome, fut représenté sur l'arc de triomphe que le sénat de l'empire fit élever en l'honneur de Titus sur la place publique de la ville victorieuse, où on peut le voir encore aujourd'hui1. Il n'y a pas là de quoi nous donner une haute idée du sens militaire des Romains de ce temps. Sans doute la profonde aversion que les Occidentaux ressentaient pour le peuple juif ajouta, pour ainsi dire, ce qui manquait à la gloire militaire; et, si le nom des Juifs était trop détesté pour que les empereurs s'en fissent un surnom honorifique comme ils le faisaient pour celui des Germains ou des Parthes, ils ne jugeaient pas indigne d'eux de fournir par leur triomphe au peuple de la capitale l'occasion de manifester la joie cruelle de la victoire. 1. Cet arc de triomphe fut dédié par le sénat de l'empire à Titus après sa mort. Un autre arc fut construit en son honneur au milieu du cirque par le même sénat pendant le règne si court de cet empereur (C. I. L., VI, 944); on y trouve indiquée en termes très nets la raison d'être des monuments : c'est parce qu'il a vaincu le peuple juif sur l'ordre, avec les instructions, et sous la direction de son père, et parce qu'il a détruit la ville de Jérusalem qui avait été vainement assiégée avant lui par d'autres généraux, par d'autres rois ou par d'autres peuples, ou même qui n'avait jamais été attaquée. La science historique dont témoigne cette inscription étrange, qui ignore non seulement Nabuchodonosor et Antiochus Epiphane, mais encore Pompée lui-même, peut-être mise sur le même rang que la gloire exagérée que Titus acquit pour ce fait d'armes des plus ordinaires. |
||||
70 |
Destruction de la puissance centrale des JuifsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa transformation politique suivit de près l'oeuvre militaire. Il était désormais impossible de reconnaître le judaïsme comme une société nationale et religieuse particulière; les premiers états hellénistiques l'avaient fait, et les Romains, en adoptant cette politique, avaient montré plus que de la tolérance pour une civilisation et une croyance étrangères. L'insurrection juive avait trop clairement montré tous les dangers que présentait cette association nationale et religieuse, très resserrée en elle-même, mais couvrant tout l'Orient et même étendant ses rameaux jusqu'en Occident. Le culte central fut une fois pour toutes aboli. Cette décision fut certainement prise sans hésitation par le gouvernement. Elle n'a rien de commun avec la question, restée jusqu'à nos jours sans réponse définitive, de savoir si la destruction du temple fut préméditée ou accidentelle; d'une part il suffisait de fermer le temple pour supprimer le culte, et le magnifique édifice pouvait être épargné; mais d'autre part, si le temple avait été détruit par hasard, le culte aurait pu être encore exercé dans un nouveau monument. Il n'en reste pas moins toujours très vraisemblable que les hasards de la guerre ne furent pas seuls coupables, et que les flammes du temple faisaient partie en quelque sorte du programme de la politique nouvelle que le gouvernement romain voulait suivre dans ses rapports avec le judaïsme1. Ce qui, plus encore que les événements de Jérusalem, caractérise cette politique, c'est que Vespasien fit fermer à la même époque le sanctuaire commun de tous les Juifs Egyptiens, le temple d'Onias construit près de Memphis dans le district d'Hèliopolis, qui existait depuis plusieurs siècles à côté du temple de Jérusalem, comme la traduction des Septante d'Alexandrie à côté de l'ancien Testament; on le dépouilla de ses ex-voto et l'on interdit aux fidèles d'y adorer leur dieu. On alla plus loin encore : la nouvelle organisation fit disparaître les grands-prêtres et le Synhédrion de Jérusalem; le judaïsme de l'empire perdit ainsi son chef extérieur et l'autorité suprême qui jouissait jusqu'alors d'une compétence générale dans toutes les questions religieuses. On avait jusque là toléré que tout Juif, sans distinction de lieu, payât chaque année l'impôt du temple; cette contribution ne fut pas abolie, mais transportée, par une amère parodie, à Jupiter Capitolin, et à son représentant sur terre, l'empereur de Rome. Le judaïsme était constitué de telle façon que la ville de Jérusalem ne pouvait pas survivre au culte central. Non seulement la ville fut détruite et brûlée; mais même, comme jadis Carthage et Corinthe, elle ne se releva pas de ses ruines; son territoire, propriété publique ou privée, devint un domaine impérial2. Tous les habitants de cette cité populeuse qui avaient échappé à la famine ou au massacre furent vendus à l'encan sur le marché d'esclaves. Ce fut au milieu des débris de la ville démolie que campa la légion, qui devait occuper dès lors la Judée avec ses auxiliaires de Thrace et d'Espagne. Les anciennes troupes provinciales recrutées dans la Palestine même furent transportées dans d'autres pays. Un certain nombre de vétérans romains furent établis à Emmaüs, dans le voisinage immédiat de Jérusalem; mais cette petite colonie ne reçut pas le droit de cité. L'antique Sichem, le centre religieux des Juifs de Samarie, qui était une ville grecque peut-être depuis Alexandre le Grand, fut réorganisée; elle fut constituée sur le modèle des cités helléniques et porta désormais le nom de Flavia Neapolis. La capitale du pays, Césarée, qui avait gardé jusqu'alors sa constitution grecque, fut transformée en une ville romaine, et fut appelée la première colonie flavienne; le latin y devint la langue des affaires. Ces institutions complétaient l'oeuvre entreprise en Judée, où l'on avait introduit l'organisation municipale de l'Occident. La Judée proprement dite, quoique dépeuplée et ruinée, n'en resta pas moins un pays juif; ce qui prouve combien le gouvernement fit fausse route à propos de cette province, c'est la force extraordinaire des troupes permanentes qu'on y maintint, et qui ne pouvaient être destinées qu'à écraser les habitants, puisque la Judée n'était pas située sur la frontière de l'empire. 1. Josèphe nous raconte que Titus résolut avec son conseil de guerre de ne pas détruire le temple; mais ce récit nous paraît suspect à cause des intentions manifestes de l'auteur; et, puisque Bernays a complètement démontré que Sulpice Sévère avait eu recours à Tacite pour composer sa chronique, on peut se demander si le récit complètement opposé de cet historien (Chron., II, 30, 6), d'après lequel le conseil de guerre aurait au contraire décidé de détruire le temple, n'a pas été emprunté à Tacite, et s'il ne faut pas lui donner la préférence, quoiqu'il porte des traces de retouche chrétienne. Ce qui confirme cette hypothèse, c'est que le poète Valerius Flaccus, dédiant ses Argonautiques à Vespasien, chante le vainqueur de Solyma, qui lance des brandons. 2. Josèphe (Bell. Jud., VII, 6, 6) nous dit que l'empereur prit ce pays pour lui; ce texte n'est pas d'accord avec l'ordre donné par l'empereur (loc. cit.), qui contient une erreur ou une faute d'écriture. Ce qui confirme l'hypothèse de l'expropriation, c'est que plusieurs propriétaires juifs obtinrent par faveur des terres dans d'autres pays (Josèphe, Vit., 16). D'ailleurs le territoire fut sans doute abandonné comme dotation à la légion qui tenait garnison dans le pays (Eph. epigr., II, n. 696; Tacite, Ann., XIII, 54). |
||||
70-100 |
La fin de la dynastie d'HérodeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa dynastie d'Hérode ne survécut pas longtemps à la ruine de Jérusalem. Le roi Agrippa II, maître de Caesarea Paneas et de Tibériade, s'était fidèlement rangé sous les ordres des Romains dans la guerre contre ses compatriotes; à la fin de cette lutte il pouvait montrer des cicatrices honorables, au moins sous le rapport militaire; en outre, sa seur Bérénice, une Cléopâtre aux petits pieds, avait su ravir avec les restes de sa prétendue beauté le coeur du conquérant de Jérusalem. Aussi Agrippa II resta-t-il personnellement en possession de sa royauté; mais après sa mort, trente ans plus tard environ, ce dernier souvenir de l'état juif disparut dans la province romaine de Syrie. (Situation postérieure des Juifs) On n'empêcha les Juifs ni en Palestine ni dans les autres provinces d'observer leurs coutumes religieuses. On ne s'opposa même pas, du moins en Palestine, à leur enseignement théologique; on toléra les réunions de professeurs et de savants que cet enseignement rendait nécessaire; et, lorsque ces assemblées de rabbins tentèrent de se substituer en quelque façon à l'ancien Synhédrion de Jérusalem, lorsqu'elles voulurent fixer leur doctrine et leurs lois suivant les principes du Talmud, on les laissa faire. Plusieurs rebelles de Judée, réfugiés en Egypte et à Cyrène, y suscitaient des troubles; les colonies juives, établies en dehors de la Palestine, n'en conservèrent pas moins, autant que nous pouvons le savoir, la même situation qu'auparavant. Au moment de la destruction de Jérusalem, les Juifs faillirent être persécutés à Antioche, parce qu'un de leurs coréligionnaires révoltés les avait excités publiquement à incendier la ville; mais le représentant du gouverneur de Syrie intervint énergiquement, et ne permit pas qu'on obligeât les Juifs, comme on voulait le faire, à sacrifier aux Dieux du pays, et qu'on leur interdit de célébrer le sabbat. Titus lui-même, lorsqu'il vint à Antioche, refusa formellement d'expulser les Juifs de cette ville et même d'abolir leurs privilèges, comme le réclamaient les chefs des persécuteurs. On redoutait de déclarer la guerre à la religion juive, en tant que religion; on ne voulait pas pousser à bout les Juifs dispersés dans tout l'empire; il suffisait d'avoir rayé le judaïsme du nombre des états, en détruisant sa représentation politique. |
||||
70 |
Les suites de la catastropheRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa politique suivie depuis Alexandre à l'égard des Juifs fut modifiée; on enleva à cette société religieuse sa direction monarchique et sa cohésion extérieure; ses chefs furent dépouillés de leur puissance, qui s'étendait non seulement sur la patrie des Juifs, mais encore sur les sociétés juives établies à l'extérieur et à l'intérieur de l'empire romain, et qui portait préjudice, surtout en Orient, au gouvernement impérial. Les Lagides, les Séleucides, les empereurs romains de la dynastie Julio-Claudienne avaient toléré cette organisation; mais, lorsque la Judée fut directement soumise à l'autorité des Occidentaux, la lutte devint plus vive entre la puissance des empereurs et celle des grands-prêtres; la catastrophe et ses conséquences étaient devenues inévitables. On peut blâmer au point de vue politique la cruauté dont on fit preuve dans cette guerre, cruauté que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes les guerres analogues de l'histoire romaine; mais le gouvernement romain eut raison, la lutte finie, de briser l'unité religieuse et politique de cette nation. En extirpant du sol juif les institutions qui avaient provoqué et qui devaient nécessairement provoquer la formation d'un parti comme celui des Zélotes, on fit une oeuvre juste et indispensable, quoique certains individus en aient profondément et injustement souffert. Vespasien, qui prit cette décision, était un souverain intelligent et modéré. Il ne s'agissait pas ici d'une religion, mais d'une puissance; l'Etat religieux de la Palestine, considéré comme le chef des Juifs dispersés, était incompatible avec l'autorité absolue du grand empire temporel. Le gouvernement ne s'est pas écarté dans cette occasion de la tolérance dont il usait en règle générale; ce n'est pas au judaïsme qu'il avait fait la guerre, mais au grand-prêtre et au Synhédrion. D'ailleurs les Romains n'ont pas complètement manqué le but qu'ils s'étaient proposé en détruisant le temple. Parmi les Juifs, et plus encore parmi les alliés des Juifs, surtout en dehors de la Palestine, il y avait beaucoup de gens qui tenaient à la loi morale et au monothéisme israélites plutôt qu'à la forme exclusivement nationale de leur religion; la secte considérable des Chrétiens s'était détachée tout entière du judaïsme, et combattait même publiquement le rite juif. Pour elle la chute de Jérusalem n'était nullement la fin du monde; dans cette société nombreuse et influente, le gouvernement obtenait en quelque manière le résultat qu'il avait poursuivi en détruisant le sanctuaire central de la religion juive. La chute du temple de Jérusalem a précipité la séparation de la foi chrétienne commune à tous les peuples et de la croyance juive étroitement nationale; elle a déterminé la victoire des sectateurs de saint Paul sur ceux de saint Pierre. Mais, pour les Juifs de la Palestine, qui parlaient à la vérité non pas l'hébreu, mais l'araméen, et pour un certain nombre de Juifs dispersés, qui étaient restés fidèles à Jérusalem, la destruction du temple agrandit encore l'abîme creusé entre le judaïsme et le reste du monde. Le gouvernement impérial, qui voulait faire disparaître cette cohésion religieuse et nationale, ne fit que donner une force nouvelle à ce cercle étroit, lorsqu'il voulut le briser violemment, et le poussa à une dernière lutte désespérée. |
||||
99-117 |
La révolte des Juifs sous TrajanRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCinquante années ne s'étaient pas écoulées depuis la chute de Jérusalem, lorsqu'en l'an 1161, les Juifs, qui habitaient les rivages de la Méditerranée orientale, se révoltèrent contre le gouvernement impérial. Cette guerre, quoique entreprise par des Juifs émigrés, eut un caractère purement national; dans ses principaux foyers, à Cyrène, à Chypre, en Egypte, elle tendait à l'expulsion des Romains et des Hellènes, et, semblet-il, à la fondation d'un état purement juif. La révolte gagna l'Asie; elle embrassa la Mésopotamie et même la Palestine. Dans les villes où les rebelles furent vainqueurs, ils luttèrent avec autant d'acharnement que les Sicaires à Jérusalem; ils massacraient tous leurs ennemis - l'historien Appien, Alexandrin de naissance, nous raconte que, fuyant devant eux pour sauver sa vie, il eut grand'peine à atteindre Péluse, - souvent ils faisaient périr leurs prisonniers au milieu des tortures les plus cruelles, ou bien ils les forçaient, comme Titus avait forcé les Juifs prisonniers de Jérusalem, à figurer dans les combats du cirque pour amuser les yeux du vainqueur. A Cyrène, 220 000 hommes, à Chypre, 240 000 doivent avoir été égorgés par eux. En revanche, les Hellenes assiégés dans Alexandrie, qui ne semble pas elle-même être tombée entre les mains des Juifs, tuèrent tous ceux qui se trouvaient dans la ville. On ne connait pas clairement la cause immédiate de la révolte. Le sang des zelotes qui s'étaient réfugiés à Alexandrie et à Cyrène, et qui périrent dans ces deux villes sous la hache des bourreaux romains, pour être restés fidèles à leur religion, n'a sans doute pas coulé en vain. L'insurrection commença pendant la guerre contre les Parthes, et fut favorisée par elle; car il est probable que les troupes d'Egypte furent appelées sur le théâtre de la guerre. Suivant toute apparence, ce fut une explosion de la colère religieuse des Juifs, qui couvait en secret, comme la flamme d'un volcan, depuis la destruction du temple et dont l'éruption subite fut terrible. L'Orient a toujours subi de pareilles commotions; il en subit encore. S'il est vrai que les rebelles aient proclamé roi un Juif, il n'en est pas moins certain que cette révolte, comme celle de la Palestine, eut son foyer dans la grande masse des petites gens. Ce qui lui donna une grande importance politique, c'est qu'elle eut lieu presque au moment où les peuples, soumis peu de temps auparavant par Trajan, tentèrent, comme nous l'avons raconté plus haut, de recouvrer leur indépendance, tandis que l'empereur s'attardait dans l'extrême Orient aux embouchures de l'Euphrate; si Trajan vit fondre tous ses succès entre ses mains à la fin de sa carrière, l'insurrection juive y contribua pour sa part, surtout en Palestine et en Mésopotamie. Pour triompher de la révolte, les troupes durent marcher de tous côtés : Trajan envoya contre le Roi des Juifs de Cyrène, Andréas ou Lukuas, et contre les insurgés d'Egypte, Quintus Marcius Turbo avec une armée et une flotte, contre les rebelles de la Mésopotamie, Lusius Quietus, comme nous l'avons dit plus haut : c'étaient les deux officiers les plus éprouvés de son armée. Nulle part les révoltés ne purent opposer de résistance sérieuse aux troupes régulières, quoique la lutte se soit continuée en Afrique et en Palestine jusqu'au commencement du règne d'Hadrien; les Juifs émigrés furent châtiés aussi durement que l'avaient été les Juifs de Palestine. Appien nous dit que Trajan extermina les Juifs d'Alexandrie; c'est là une expression de la réalité juste quoique peut-être exagérée. Nous savons par des témoignages certains que l'accès de Chypre fut désormais interdit à tous les Juifs et que les Israélites naufragés étaient eux-mêmes condamnés à mort. Si nous avions sur cette catastrophe des renseignements aussi abondants que sur celle de Jérusalem, la seconde défaite du judaïsme nous apparaîtrait comme la suite et le complément de la première, et pourrait nous l'expliquer dans une certaine mesure. Cette insurrection nous montre quels liens rattachaient les colonies juives à la mère patrie, et de quelle façon le judaïsme s'était développé comme un état dans l'Etat. 1. Eusèbe (Hist. eccles., IV, 2) place le début de la guerre la 18e année, par conséquent d'après sa manière de compter (dans la Chronique) l'avant dernière année du règne de Trajan. Dion (LXVIII, 32) est d'accord avec lui. |
||||
132-135 |
Soulèvement des Juifs sous HadrienRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteBrisée pour la seconde fois, la résistance de l'élément juif à la puissance impériale n'était pas encore anéantie. On ne peut pas dire que le gouvernement ait de nouveau provoqué le judaïsme; certaines mesures administratives, que l'empereur avait l'habitude de prendre et que tous les sujets accueillaient sans murmure, atteignirent les Hébreux dans le pays même où la foi nationale avait la plus grande force de résistance, et provoquèrent, probablement au grand étonnement du gouvernement lui-même, une insurrection qui devint bientôt une guerre. Lorsque d'Hadrien, pendant son voyage à travers l'empire, vint en Palestine, il résolut (an 130) de reconstruire la ville sacrée des Juifs pour la transformer en colonie romaine; il ne faisait pas aux indigènes l'honneur de les craindre; il ne songeait même pas à poursuivre une propagande religieuse et politique; il appliquait simplement à ce camp de légion le système qui venait d'être ou qui allait être employé sur le Rhin, sur le Danube et en Afrique; il le rattachait à une cité peuplée d'abord de vétérans, qu'il appela AElia Capitolina pour rappeler à la fois le nom de son fondateur et le nom du Dieu qui recevait alors, au lieu de Jéhovah, l'impôt des Juifs. Il en fut de même, lorsque l'empereur interdit la circoncision; il n'avait probablement pas l'intention, comme nous le remarquerons plus loin, de déclarer dans cette circonstance la guerre au judaïsme. Les Juifs, on le comprend, ne se demandèrent pas quels étaient les motifs de cette fondation et de cette défense; ils virent dans ces deux mesures une attaque à leur religion et à leur nationalité; ils répondirent à cette prétendue provocation par une révolte, dont les Romains ne s'occupèrent pas tout d'abord, mais qui n'eut pas son égale pour l'intensité et la durée dans l'histoire de l'empire. Tous les Juifs de la Palestine et de l'étranger prirent part au mouvement et soutinrent plus ou moins les insurgés du Jourdain1, qui s'emparèrent de Jérusalem2; le gouverneur de Syrie et l'empereur Hadrien lui-même parurent sur le théâtre de la guerre. A la tête des rebelles se trouvaient deux hommes assez remarquables, le prêtre Eléazar3: et le chef de bandits Simon, surnomné Bar-Kokheba, c'est-à-dire le fils des Etoiles, parce qu'il amenait le secours du ciel, et considéré peut-être comme le Messie. Les monnaies d'argent et de cuivre, frappées pendant plusieurs années et qui portent les noms de ces deux chefs, témoignent de la puissance financière et de l'organisation des insurgés. Après avoir réuni une armée suffisante, l'habile capitaine Sextus Julius Severus triompha de la révolte, mais lentement et peu à peu; comme autrefois, pendant la campagne de Vespasien, aucune bataille rangée ne fut livrée; il fallut emporter les places l'une après l'autre, en perdant beaucoup de temps et de soldats; enfin au bout de trois ans, la dernière citadelle des insurgés, la forteresse de Bether, non loin de Jérusalem, fut enlevée par les Romains. Les sources sérieuses parlent de 50 forteresses prises, de 985 villages occupés, de 580 000 prisonniers; ces chiffres ne sont pas dignes de foi. La guerre fut conduite avec une cruauté impitoyable, et la population mâle fut partout massacrée. (La Judée aprè Hadrien) Après cette insurrection le nom même du peuple vaincu disparut; la province ne s'appela plus, comme auparavant, la Judée; on lui rendit l'ancien nom qu'elle portait sous Hérodote, de Syrie des Philistins ou Syrie-Palestine. Le pays resta désolé; la ville construite par Hadrien subsista, mais sans prospérer. Il fut interdit aux Juifs sous peine de mort d'entrer seulement dans Jérusalem; la garnison en fut doublée; deux légions occupèrent désormais la région située entre l'Egypte et la Syrie, qui ne comprenait au-delà du Jourdain qu'une bande très étroite le long de la mer Morte, et qui ne touchait nulle part à la frontière de l'empire. Malgré toutes ces mesures énergiques, le pays continua d'être troublé; depuis longtemps le brigandage était une forme du patriotisme; Antonin fit marcher des troupes contre les Juifs, et, même sous Sévère, il est question d'une guerre contre les Juifs et les Samaritains. Mais la révolte qui avait éclaté sous Hadrien fut la dernière des grandes insurrections de Judée. 1. Si d'après le contemporain Appien (Syr., 50), Hadrien détruisit une seconde fois la ville, cela prouve à la fois que l'établissement de la colonie avait été au moins presque achevé auparavant, et qu'elle fut alors prise par les insurgés. Cela nous explique les grandes pertes que subirent les Romains (Fronton. De bello Parth. p. 218; ed. Naber: Hadriano imperium obtinente quantum militum a Judaeis caesum; cf. Dion, LXIX, 14); nous savons en outre que le gouverneur de Syrie, Publius Marcellus quitta sa province pour porter secours en Palestine (Corp. insc. graec., 4033, 4034) à son collègue Tineius Rufus (Eusèbe, Hist. eccles., IV, 6; Borghesi, Euv., III, p. 164). 2. Il est aujourd'hui prouvé (von Sallet, Zeitschrift fur Numism., V, p. 110) que les monnaies qui portent ce nom datent de l'insurrection qui éclata sous Hadrien; c'est donc le rabbin Eléazar de Modaïn dont parlent les historiens juifs (Ewald, Gesch. Israël., VII (2e edit.), p. 418; Schurer, Lehr buch, p. 357). Il est tout au moins très vraisemblable que le Simon, nommé sur ces monnaies tantôt avec Eléazar, tantôt seul, est le Bar-Kokheba de Justin le Martyr et d'Eusèbe. 3. Dion (LXIX, 12) dit que la guerre dura longtemps; Eusèbe, dans sa Chronique, en place le début pendant la 16me, la fin pendant la 18e ou la 19e année du règne d'Hadrien; les monnaies des insurgés sont datées de la première ou de la seconde année de la libération d'Israël. Nous n'avons pas de dates certaines; on ne peut pas se servir, pour les déterminer, de la tradition rabbinique (Schurer, Handbuch, p. 361). |
||||
Deuxième et troisième siècle |
La situation des Juifs aux deuxième et troisième siècleRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl faut reconnaître que ces explosions répétées de la haine qui fermentait dans le coeur des Juifs contre tous leurs concitoyens non juifs ne modifièrent pas la politique générale du gouvernement. Non seulement les empereurs qui succédèrent à Vespasien restèrent, comme lui, tolérants au point de vue politique et religieux, mais encore les lois d'exception accordées aux Juifs continuèrent d'être principalement destinées à les exempter de tous les devoirs civiques incompatibles avec leur morale et leur foi; aussi furent-elles considérées comme des privilèges1. L'interdiction, prononcée sous Claude contre le culte juif au moins en Italie, est la dernière mesure de ce genre que nous connaissions; depuis lors les Juifs eurent le droit de séjourner et de pratiquer librement leur religion dans tout l'empire. Il n'aurait pas été étonnant qu'à la suite de toutes ces insurrections les Juifs établis en Afrique et en Syrie fussent chassés de ces contrées; mais les restrictions de cette nature, furent toutes locales, autant que nous pouvons le savoir, comme ce qui se passa à Chypre. Le monde grec resta toujours le quartier général des Juifs; dans la capitale de l'empire, où l'on parlait pour ainsi dire les deux langues latine et grecque, la société juive très nombreuse, et qui possédait toute une série de synagogues, formait une portion de la colonie grecque. A Rome les épitaphes des Juifs sont exclusivement grecques; dans la secte des Chrétiens de Rome, issue de cette société juive, les actes de baptême furent pendant très longtemps rédigés en grec, et durant les trois premiers siècles les auteurs chrétiens employèrent exclusivement la langue grecque. Mais il ne semble pas qu'on ait traité sévèrement les Juifs établis dans les provinces latines; c'est grâce à l'hellénisme et avec lui que l'élément juif a pénétré en Orient; et si des colonies juives s'y étaient établies, elles restèrent toujours inférieures en nombre et en importance aux sociétés juives de l'Orient, même à l'époque où ces dernières avaient le plus souffert des coups dirigés contre le judaïsme. (Associations corporatives) Si le gouvernement toléra le culte des Juifs, il ne leur donna du moins aucun privilège politique. On ne leur défendit pas d'établir des synagogues et des lieux de prière, soumis à l'autorité d'un chef, ni de fonder un collège des anciens (zoxovtes), présidé par le Premier des Anciens. Aucun droit réel ne dut être attaché à ces différents titres; mais, comme il était impossible de séparer l'organisation religieuse des Juifs de leur organisation judiciaire, les chefs de ces associations exercèrent partout en réalité une certaine juridiction, comme les évêques au moyen âge. Les colonies juives établies dans les différentes cités ne furent pas reconnues comme des corporations d'une manière générale, par exemple, à coup sûr, la société juive de Rome; cependant, grâce aux privilèges locaux qu'ils obtinrent, les Juifs purent former dans quelques villes des associations corporatives, dirigées par des ethnarques, ou, comme ils se nomment alors presque partout, par des patriarches. Nous trouvons même en Palestine, au commencement du troisième siècle, un chef de tout le judaïsme, qui règne pour ainsi dire comme un souverain sur ses coréligionnaires en vertu du droit sacerdotal héréditaire, qui a sur eux le droit de vie et de mort et qui est au moins toléré par le gouvernement2. Sans aucun doute ce patriarche était pour les Juifs l'ancien grand-prêtre; sous les yeux et sous le poids de la domination étrangère, l'opiniâtre peuple de Dieu s'était de nouveau reconstitué et avait détruit l'oeuvre de Vespasien. (Charges publiques) En ce qui concerne la soumission des Juifs aux charges publiques, on avait reconnu depuis longtemps que le service militaire était incompatible avec leurs convictions religieuses; on les en avait exemptés, et on ne les dépouilla pas de ce privilège. La capitation extraordinaire qu'ils payaient, l'ancien impôt du temple, pouvait être considérée comme une compensation de cette faveur, bien qu'elle n'eût pas été établie dans ce sens. Quant aux autres charges, comme les tutelles et les fonctions municipales, les Juifs furent en général regardés, au moins depuis le règne de Sévère, comme capables et comme obligés de les supporter, mais on en dispensa ceux d'entre eux qui renonçaient à leur superstition3; il en résulte que l'exclusion des Juifs des charges municipales devint de plus en plus un privilège, au lieu d'être une aveur. Plus tard il en fut sans doute de même pour les fonctions publiques. (Interdiction de la circoncision) La seule attaque sérieuse dirigée par le gouvernement impérial contre les coutumes juives atteignit la cérémonie de la circoncision. Mais il est très probable qu'on ne se plaça pas dans cette circonstance au point de vue religieux et politique; cette mesure fut prise lorsque l'on interdit la castration et en grande partie parce que l'on ignorait les usages juifs. La mutilation avait pris de telles proportions que Domitien dut la mettre au nombre des crimes punis par la loi; Hadrien alla plus loin encore et défendit la castration sous peine de mort. Il semble qu'à ce moment la circoncision ait été mise sur le même rang que la castration4, ce qui devait être et ce qui fut en effet considéré par les Juifs comme une attaque contre leur propre existence, quoique peut-être l'on n'ait pas eu l'intention de les provoquer. Peu de temps après, et probablement à la suite de la révolte qui avait éclaté sous Hadrien, Antonin autorisa la circoncision pour les enfants de naissance juive, mais la circoncision de tout esclave non juif et de tout prosélyte continua d'entraîner pour ceux qui avaient pris part à la cérémonie le même châtiment que la castration. Cette mesure avait une grande importance politique, puisque le prosélytisme juif était formellement considéré comme un crime puni par la loi; si l'interdiction n'avait pas eu ce sens au début, elle l'acquit dans la suite5. Elle contribua pour sa part à aigrir davantage encore les Juifs contre tous les non-Juifs. 1. Biographie d'Alexandre, c. 22 : Judaeis privilegia reservavit, Christianos esse passus est. Cette phrase nous indique clairement que les Juifs étaient mieux traités que les Chrétiens; ceux-là formaient une nation; il n'en était pas de même de ceux-ci. 2. Pour prouver que, même dans l'esclavage, les Juifs jouissent d'une certaine indépendance, Origène écrit à Africanus (c. 14), vers l'an 226 : A cette époque, où les Romains sont les maîtres et où les Juifs leur payent l'impôt de deux drachmes, l'ethnarque exerce sur ses coréligionnaires une grande autorité, avec permission de l'empereur. Des jugements sont rendus en secret d'après la loi juive, et même des condamnations à mort ont été plusieurs fois prononcées. Je le sais par expérience, car j'ai longtemps vécu dans la patrie de ce peuple. Le patriarche de Judée est déjà cité dans la lettre apocryphe attribuée à Hadrien que contient la biographie du tyran Saturninus (c. 8); il apparaît pour la première fois dans les actes officiels en l'an 392 (Cod. Theod., XVI, 8). On rencontre déjà dans les ordonnances de Constantin (ibid., XVI, 8, 1, 2) les patriarches mentionnés comme chefs de diverses associations juives; cette situation correspond beaucoup mieux à leur nom. 3. Les juristes du troisième siècle établissent cette règle en rappelant un édit de Sévère (Dig., XXVII, 1, 15, 6; L, 2, 3, 3). D'après le décret de l'an 321 (Cod. Theod., XVI, 8, 3) cela apparait comme un droit, et non comme un devoir des Juifs, de telle sorte qu'il dépendait d'eux d'accepter ou de refuser la charge. 4. Ce qui confirme cette hypothèse, c'est que d'une part le décret d'Hadrien (Dig., XLVIII, 8, 4, 2), et d'autre part Paul (Sent., V, 22, 3, 4) et Modestin (Dig., XLVIII, 8, 11) traitent de la même façon la castration et la circoncision. De même, lorsque Sévère Judaeos fieri sub gravi poena vetuit (Vita, 17), il ne fit sans doute que confirmer l'interdiction d'Hadrien. 5. Le renseignement curieux fourni par Origène dans son ouvrage contre Celse (II, 13, écrit vers 250), nous apprend que la circoncision des non-Juifs était légalement puni de mort; mais on ne voit pas clairement comment cette loi pouvait être appliquée aux Samaritains ou aux Sicaires. |
||||
Troisième siècle-476 |
Changements survenus dans la situation des Juifs sous l'empireRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteSi nous jetons un regard sur l'histoire du judaïsme pendant la période qui s'écoule depuis Auguste jusqu'à Dioclétien, nous constatons qu'il fut profondément modifié dans son essence et dans sa situation. Il nous apparaît, au début de l'empire, comme une puissance nationale et religieuse, étroitement rattachée au petit pays où elle est née, combattant les armes à la main contre le gouvernement impérial lui-même en Judée et faisant preuve d'une grande force de propagande sur le terrain religieux. On comprend que Rome n'ait pas voulu se montrer plus favorable au culte de Iahvé et à la religion de Moïse qu'à celle de Mithra et à la foi de Zoroastre. Elle lutta contre ce judaïsme exclusif et ramassé sur lui-même. Vespasien et Hadrien écrasèrent les Juifs de la Palestine, Trajan frappa les colonies juives établies en dehors de ce pays. La destruction immédiate de cette société vivace, la disparition de la gloire et de la puissance des Juifs ne furent pas les seuls résultats de cette politique. En réalité c'est la victoire de l'Occident sur l'Orient qui a donné naissance au christianisme et au judaïsme des temps modernes. Le grand mouvement de propagande, qui porta de l'Est à l'Ouest la conception religieuse plus profonde des chrétiens, brisa, comme nous l'avons déjà dit, les limites étroites de la nationalité juive; si la foi nouvelle ne renia pas Moïse et les prophètes, elle s'affranchit du moins nécessairement de l'autorité déjà ruinée des Pharisiens. Depuis le moment où la Jérusalem terrestre fut détruite, l'idéal des chrétiens devint universel. Mais si les défaites du judaïsme provoquèrent l'apparition de cette jeune religion plus large et plus profonde, qui changea de nom en même temps que de caractère, elles n'affermirent pas moins l'antique croyance; si les Juifs ne purent plus s'assembler à Jérusalem, ils furent unis dans leur haine contre ceux qui avaient démoli la ville sainte et surtout contre le mouvement religieux plus libéral et plus élevé qui avait fait sortir le christianisme du judaïsme. La puissance temporelle des Juifs était brisée; les dernières années de l'empire n'assistèrent plus à des révoltes comme celles qui avaient éclaté au milieu de cette période; les empereurs romains avaient détruit cet Etat dans l'Etat; le véritable danger consistait maintenant dans l'extension de la propagande chrétienne. Les sectateurs de l'ancienne foi, qui refusaient d'accepter la religion nouvelle, ne jouaient plus aucun rôle dans le développement général du monde romain. Mais, si les légions avaient détruit Jérusalem, elles n'avaient pas pu anéantir le judaïsme lui-même; ce qui dans un sens avait servi de remède faisait, dans un autre sens, l'effet d'un poison. Le judaïsme non seulement subsista, mais se modifia. Un abîme profond sépare le judaïsme des premiers temps, qui veut répandre ses croyances, qui admet les païens dans le parvis du temple, et dont les prêtres offrent chaque jour un sacrifice au nom de l'empereur Auguste, du rabbinisme rigide, qui ne connait rien et ne veut rien connaître du monde en dehors du sein d'Abraham et de la loi de Moïse. Les Juifs avaient toujours été et toujours voulu être des étrangers; mais le sentiment de cette situation s'accrut à cette époque d'une façon effrayante en eux-mêmes et chez leurs ennemis; il en résulta que les deux partis se détestèrent davantage et se firent l'un à l'autre plus de mal qu'auparavant. Les juifs se détournaient de la littérature hellénique, comme si elle devait les souiller; ils protestaient même contre l'usage de la traduction grecque de la Bible; l'exclusivisme toujours croissant de leur religion se tournait non seulement contre les Grecs et les Romains, mais encore contre les semi-Juifs de Samarie et contre les hérétiques chrétiens; ils poussaient jusqu'à une absurdité extravagante l'observation littérale des saintes écritures; surtout ils avaient forgé une morale plus sainte encore, s'il était possible, dans les chaînes de laquelle toute vie et toute pensée s'immobilisaient. Il y a un abîme entre les principes du Talmud, qui appartiennent à cette époque, et cet ouvrage d'un esprit élevé, où le Poseidon d'Homère, qui ébranle la terre et les flots, et le Jéhovah créateur du soleil brillant sont audacieusement placés à côté l'un de l'autre, le même qui existe entre le judaïsme du premier siècle et celui du troisième. Il était nécessaire désormais que les Juifs et les non Juifs vécussent dans la même société; mais il n'était pas moins impossible que leurs rapports fussent réglés par les mêmes lois qu'autrefois; l'opposition religieuse, juridique et morale s'accentuait toujours; l'orgueil et la haine réciproques ne pouvaient que bouleverser les deux partis. Non seulement à cette époque on ne se hâta pas d'établir l'égalité entre les adversaires, mais même, plus la nécessité de cette mesure s'imposait, plus on différait de la prendre. |
||||