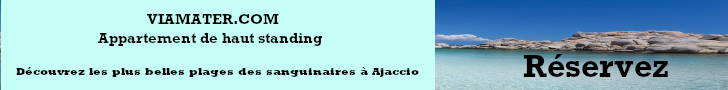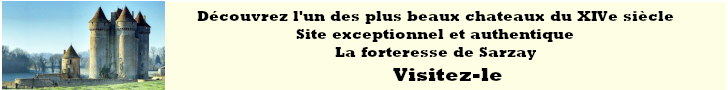|
|||||
La Syrie et les pays NabatéensSources historiques : Théodore Mommsen Vous êtes dans la catégorie : Empire Chapitre suivant : La Judée Chapitre précédent : Frontière de l'Euphrate-Les Parthes Dans ce chapitre : 23 rubriques; 16 682 mots; 87 137 caractères (espaces non compris); 103 669 caractères (espaces compris) Format 100% digital de cette rubrique (via l'espace membre) | |||||
64 av. J.C. |
La conquête de la SyrieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteC'est peu à peu que les Romains se sont décidés à s'emparer du rivage oriental de la mer Méditerranée, après avoir conquis les côtes occidentales. On ne pouvait pourtant leur opposer qu'une résistance relativement faible; mais ils craignaient, avec raison, que cette conquête ne fit perdre à Rome sa nationalité; ils se contentèrent le plus longtemps qu'ils purent d'exercer dans ce pays une influence politique prépondérante; l'annexion proprement dite, tout au moins de la Syrie et de l'Egypte, n'eut lieu que lorsque l'état romain était déjà presque une monarchie. Dès lors l'empire était géographiquement fermé; la mer Méditerranée, la base propre de la puissance romaine, devenait de toutes parts un lac romain, la navigation et le commerce y étaient politiquement réunis, pour le bien de tous les peuples qui habitaient les rivages de cette mer. Mais si cette conquête fondait l'unité géographique, elle détruisait l'unité nationale. L'annexion de la Grèce et de la Macédoine n'aurait jamais provoqué la division en deux de l'état romain, pas plus que les villes grecques de Naples et de Marseille n'ont hellénisé la Campanie ou la Provence. Mais si les régions grecques de l'Europe et de l'Afrique n'avaient aucune importance en face du territoire latin qu'elles entouraient, les parties du troisième continent et la vallée du Nil, justement rattachée à l'Asie, qui entrèrent dans le cercle de la civilisation latine, appartenaient exclusivement aux Grecs; l'hellénisme, qui avait atteint son apogée sous Alexandre, s'était surtout propagé à Antioche et à Alexandrie, centres de la vie et de la civilisation helléniques et cités rivales de Rome. Dans le chapitre précédent nous avons raconté la lutte que l'Orient et l'Occident se livrèrent pendant toute la durée de l'empire dans l'Arménie, dans la Mésopotamie et autour de ces deux province; il nous faut maintenant écrire l'histoire de la Syrie à la même époque, c'est-à-dire la région qui est séparée de l'Asie Mineure par les masses montagneuses de la Pisidie, de l'Isaurie et de la Cilicie occidentale, de l'Arménie et de la Mésopotamie par la continuation de cette chaîne et par l'Euphrate, de l'empire parthe et de l'Egypte par le désert d'Arabie. |
||||

|
|||||
27 av. J.C.-476 |
Administration de la provinceRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteDepuis le partage des provinces entre l'empereur et le sénat, la Syrie ne cessa d'être une province impériale; elle fut en Orient, ce que la Gaule était en Occident, le centre de l'administration impériale, civile et militaire. Ce gouvernement fut, dès son origine, le plus considérable de tous, et son importance s'accrut de plus en plus. Celui qui le possédait avait quatre légions sous son autorité, comme les gouverneurs des deux Germanies; mais, tandis que l'administration des provinces intérieures de la Gaule avait été enlevée aux chefs de l'armée du Rhin, dont la puissance était en quelque sorte restreinte par ce voisinage, le gouverneur de Syrie avait gardé le pouvoir tout entier dans cette vaste région, et, seul pendant longtemps, il eut en Asie un commandement de première classe. Vespasien, il est vrai, lui donna pour collègues les gouverneurs de Palestine et de Cappadoce, auxquels il avait confié des légions; mais d'autre part l'annexion du royaume de Commagène et des principautés du Liban étendit le territoire du gouvernement de Syrie. Ce fut pendant le cours du deuxième siècle que son autorité fut diminuée pour la première fois, lorsqu' Hadrien enleva au gouverneur de Syrie une de ses quatre légions, pour la donner au gouverneur de la Palestine. En réalité c'est l'empereur Sévère qui a fait descendre ce fonctionnaire du sommet de la hiérarchie militaire. Après avoir soumis, malgré la résistance de la capitale, Antioche, cette province qui avait voulu proclamer empereur Niger, comme autrefois Vespasien, il la divisa en deux régions : au gouvernement de la province septentrionale, appelée Colé-Syrie, il donna deux légions; au gouverneur de la province méridionale, ou Syrophénicie, une seule. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Les troupes de SyrieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais ce qui permet encore de comparer la Syrie et la Gaule, c'est que cette province impériale se divisait plus nettement que les autres en districts pacifiés et en pays frontières, qu'il fallait sans cesse défendre. Si la côte étendue de la Syrie et les régions occidentales n'étaient pas exposées aux attaques de l'ennemi, si la garde de la frontière du désert contre les Bédouins vagabonds était confiée aux princes d'Arabie et de Judée, plus tard aux troupes de la province d'Arabie et aux Palmyréniens plutôt qu'aux légions de Syrie, il fallait, surtout avant que la Mésopotamie devînt une province romaine, se défendre sur l'Euphrate contre les Parthes comme sur le Rhin contre les Germains. Mais bien que les légions de Syrie fussent employées à couvrir la frontière, on ne pouvait pourtant pas se passer d'elles dans la Syrie occidentale1. Les troupes du Rhin maintenaient certainement l'ordre en Gaule; néanmoins les Romains pouvaient dire avec un orgueil légitime qu'une garnison de 1200 légionnaires suffisait pour garder la grande capitale et les trois provinces de la Gaule. Il ne suffisait cependant pas, pour la population de la Syrie et surtout pour la capitale de l'Asie romaine, de placer des légions sur l'Euphrate. Non seulement sur la lisière du désert, mais au fond des montagnes habitaient, dans le voisinage des riches plaines et des grandes villes, des bandes audacieuses, moins nombreuses assurément qu'aujourd'hui, mais cependant également permanentes; ces brigands, souvent déguisés en marchands ou en soldats, ravageaient les fermes isolées et les villages. Les garnisons n'étaient pas moins nécessaires dans les villes elles-mêmes, dans Antioche principalement, qu'à Alexandrie. C'est là sans aucun doute la raison pour laquelle on n'essaya jamais de diviser la Syrie en territoire civil et en territoire militaire, comme Auguste l'avait fait en Gaule; voilà pourquoi de grandes colonies militaires indépendantes, telles que Mayence sur le Rhin, Léon en Espagne, Chester en Angleterre, manquent totalement dans l'Orient romain. C'est pour le même motif assurément que l'armée de Syrie fut si inférieure comme discipline et comme esprit aux garnisons des provinces occidentales, et que les règles sévères, observées dans les camps des légions de l'Ouest, complètement fermés à l'élément civil, n'ont jamais pu prendre racine au milieu des troupes de l'Orient cantonnées dans des villes. Lorsqu'une troupe permanente, outre sa fonction propre, est obligée de faire la police, elle se démoralise toujours; trop souvent, quand elle doit maintenir l'ordre dans les villes turbulentes, elle perd elle-même sa discipline. Cette affirmation trouve un triste commentaire dans les guerres de Syrie que nous avons racontées plus haut; dans aucune circonstance l'armée ne fut prête au combat; il fallut toujours faire venir des troupes de l'Occident, pour donner à la lutte une issue favorable. 1. Nous ne pouvons pas déterminer avec précision où se trouvaient les camps permanents des légions de Syrie; pourtant ce que nous allons dire est certain. Sous Néron la Xe légion était campée à Raphaneae, au Sud-Ouest d'Hamath (Josèphe, Bel. Jud., VII, 1, 3) et la Vie tenait garnison dans la même ville ou à peu de distance sous Tibère (Tacite, Ann., II, 79); la XIIe était probablement cantonnée sous Néron à Antioche ou non loin de là (Josèphe, ibid., II, 18, 9). Une légion au moins surveillait l'Euphrate; Josèphe (ibid., VII, 1, 3) nous l'affirme pour l'époque qui précéda l'annexion de la Commagène; plus tard, une des légions avait son quartier général à Samosate (Ptolémée, V, 15, 11; Inscription du temps de Sévère, Corp. insc. lat., VI, 1409; Itin. Antonini, p. 186). L'Etat-major de presque toutes les légions de Syrie résidait probablement dans les districts de l'Ouest. De là provient sans doute le reproche continuel que l'on faisait aux légions syriennes d'être corrompues par le séjour des villes. Nous ne savons pas si, dans la meilleure époque, il y avait de véritables quartiers généraux au bord du désert. Dans les postes de cette région se trouvaient des détachements de légions; ainsi le district turbulent entre Damas et Bostra était puissamment occupé par des légionnaires que fournissaient d'une part le gouverneur de Syrie, d'autre part le gouverneur de l'Arabie, lorsque cette province eut été organisée par Trajan. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Hellénisation de la SyrieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa Syrie au sens propre du mot, et les pays voisins, la plaine de la Cilicie et la Phénicie, n'ont pas eu une histoire particulière sous les empereurs romains. Les habitants de ces contrées appartiennent à la même lignée que les populations de la Judée et de l'Arabie; les ancêtres des Syriens et des Phéniciens ont jadis vécu dans les mêmes lieux et parlé la même langue que les aïeux des Juifs et des Arabes. Mais tandis que ces derniers ont conservé leurs coutumes et leur idiome, les Syriens et les Phéniciens se sont hellénisés, avant même d'être soumis à la domination romaine. Cette transformation du pays a été provoquée presque partout par la création de cités helléniques; il est vrai qu'elle était favorisée par le développement particulier de cette région, surtout par la présence de grandes villes commerciales fondées depuis longtemps sur la côte phénicienne. Le régime politique d'Alexandre et de ses successeurs, comme celui de la république romaine, avait pour base non la tribu, mais la cité; ce n'est pas la royauté, héréditaire de l'ancienne Macédoine, c'est la constitution des cités grecques qu'Alexandre a introduite en Orient; les cités, non les tribus, tels étaient les éléments avec lesquels le roi de Macédoine et les Romains comptaient former leur empire. La conception de la bourgeoisie autonome se prête à plusieurs formes: l'autonomie d'Athènes et de Thèbes n'est pas la même que l'autonomie des villes macédoniennes et syriennes; de même, dans l'empire romain, l'autonomie de la ville libre de Capoue est différente de l'autonomie des colonies latines de la République ou des municipalités de l'empire; mais partout l'idée fondamentale est la souveraineté des citoyens s'administrant eux-mêmes dans l'intérieur des murs de leur ville. Après la chute de l'Empire perse, la Syrie devint, en même temps que la contrée voisine, la Mésopotamie, comme le trait d'union militaire entre l'Occident et l'Orient; elle fut couverte, plus que tout autre pays, de colonies macédoniennes. Les noms de lieu macédoniens, très fréquents en Syrie, et très rares dans toutes les autres parties de l'empire d'Alexandre, prouvent que le noyau des Grecs, qui avaient conquis l'Orient, s'était établi en Syrie, et que cette région devait être pour l'état hellénique la Nouvelle-Macédoine; - et cependant, tant qu'il y eut un gouvernement central pour l'empire d'Alexandre, ce gouvernement demeura dans l'ancienne. Les troubles qui éclatèrent sous les derniers Séleucides permirent ensuite à ces villes de Syrie d'acquérir une plus grande indépendance. Telle était la situation de la contrée quand les Romains y arrivèrent. Lorsque Pompée eut introduit une nouvelle organisation dans ce pays, il n'y eut vraisemblablement plus, sous la dépendance immédiate de la République, que des territoires organisés en cités; il est vrai que, au début de la domination romaine, des principautés dépendantes comprenaient une grande partie de la province méridionale, mais celles-ci étaient presque toutes montagneuses, peu peuplées, et d'une importance secondaire. Somme toute, les Romains n'eurent pas beaucoup à faire pour perfectionner le développement municipal en Syrie; beaucoup moins certes qu'en Asie Mineure. Aucune ville ne fut à proprement parler fondée en Syrie par les empereurs. Les colonies peu nombreuses qui y furent établies, par exemple sous Auguste Béryte et probablement aussi Hélioupolis, étaient destinées, comme les villes créées par les Macédoniens, à recevoir des vétérans. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Persistance de la langue et des coutumes locales sous l'hellénismeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteC'est en examinant les noms de lieu que nous nous ferons une idée nette de la situation qu'occupaient les Grecs et l'ancienne population indigène, les uns en face des autres. Les noms de pays et de villes sont presque tous grecs; la plupart, comme on l'a remarqué, sont originaires de la Macédoine, comme Pieria, Anthémusias, Arethusa, Béroea, Chalkis, Edessa, Europos, Kyrrhos, Larisa, Pella; d'autres rappellent les noms d'Alexandre ou des membres de la famille des Séleucides, comme Alexandreia, Antiocheia, Séleukis ou Séleukeia, Apameia, Laodikeia, Epiphaneia. Les anciens noms indigènes se conservent à côté des noms grecs : Béroea, l'ancienne Chaleb, en araméen, s'appelle aussi Chalybon; Edessa ou Hierapolis, auparavant Mabog, Bambyké; Epiphaneia, auparavant Hamat, Amathé. Mais le plus souvent ces noms disparaissent devant les dénominations étrangères; il y a peu de pays ou de grandes villes qui ne portent pas un nom grec, comme Kommagénè, Samosata, Hémésa, Damaskos. Les Macédoniens fondèrent peu dans la Cilicie orientale; mais la capitale, Tarse, fut de bonne heure complètement hellénisée; bien longtemps avant l'époque romaine, elle était déjà l'un des centres de la civilisation grecque. Il en fut autrement en Phénicie; les grandes villes commerciales célèbres depuis une haute antiquité, Arados, Byblos, Bérytos, Sidon, Tyros, ont gardé leurs anciens noms; mais, là comme ailleurs, le Grec finit par l'emporter, ainsi que le prouve la forme hellénique donnée à ces mêmes noms; de plus, et ceci est encore plus probant, la nouvelle Arados ne nous est connue que sous son grec d'Antarados, comme la ville fondée sur cette côte par les Tyriens, les Sidoniens, et les gens d'Arados réunis, sous celui de Tripolis, et les deux dénominations qu'elles portent aujourd'hui, Tartos et Tarabolos, sont deux noms d'origine grecque. Déjà sous les Séleucides, les monnaies de la Syrie proprement dite portent exclusivement des légendes grecques; celles des villes phéniciennes en ont la plupart du temps; dès le commencement de l'empire le grec triomphe partout1. - Palmyre seule, comme nous l'avons vu fait exception, dans son oasis, qui non seulement était séparée de la Syrie par de vastes déserts, mais même qui avait conservé une certaine indépendance politique. Cependant les idiomes indigènes servaient toujours aux relations quotidiennes. Dans les montagnes du Liban et de l'anti-Liban, où de petites maisons princières d'origine syrienne régnèrent jusqu'à la fin du premier siècle après J.-C. à Hémèse (Homs), à Chalkis, à Abila (toutes deux entre Béryte et Damas), il est probable que la langue du pays a été parlée pendant l'époque impériale, de même que, dans les montagnes peu accessibles des Druses, l'idiome araméen n'a été remplacé par l'arabe que dans les temps tout à fait modernes. Mais il y a deux mille ans, c'était en fait la langue populaire de toute la Syrie2. Lorsqu'une ville portait deux noms, le nom syrien était plus employé dans la vie ordinaire, le nom grec dans la littérature. Ce qui le prouve, c'est que de nos jours, Béroea-Chalybon s'appelle Haleb (Alep); Epiphaneia-Amathè, Hama; Hiérapolis - Bambyké-Mabog, Membodj; Tyr a gardé son nom phénicien de Sour; la ville syrienne que les documents et les historiens n'appellent qu'Hèlioupolis, porte encore aujourd'hui son vieux nom indigène de Baalbek : en général les noms de lieu modernes proviennent, non pas des noms grecs, mais des noms araméens. La persistance de la nationalité syrienne apparaît aussi dans la religion. Les Syriens de Béroea consacrent, avec une dédicace en grec, leurs offrandes à Zeus Malbachos, les habitants d'Apamée à Zeus Bélos; ceux de Béryte, étant citoyens romains, à Jupiter Balmarchodes; toutes ces divinités n'ont aucun rapport avec Zeus ou avec Jupiter. Zeus Bélos n'est autre que le dieu invoqué en langue syrienne par les Palmyréniens sous le vocable de Malach-Belos (t. X, p. 274, n. 1). Le culte des dieux indigènes a été et est resté très vivace en Syrie. Nous en avons un témoignage très clair dans le fait suivant : la princesse d'Hémèse, qui entra par un mariage dans la famille de Sévère, et dont le petit-fils revêtit la pourpre impériale au commencement du IIe siècle, vit avec mécontentement que son enfant était nommé grand pontife du peuple romain; elle l'exhorta à prendre devant tous les Romains le titre du dieu soleil de Syrie, Elagabale. Les Romains pouvaient triompher des Syriens, mais leurs dieux nationaux, à Rome, devaient céder la place aux dieux de Syrie. De même, les nombreux noms propres syriens qui sont parvenus jusqu'à nous sont très rarement grecs et les doubles noms sont assez fréquents. Le Messie s'appelle aussi Christos; l'apôtre Thomas, Didymos; la femme de Joppé ressuscitée par Pierre, la chèvre, Tabitha ou Dorkas. Mais pour la littérature, peut-être aussi pour le commerce et pour les relations des gens instruits, l'idiome syrien était aussi peu employé que la langue celtique en Occident; dans ce domaine régnait exclusivement le grec, abstraction faite du latin obligatoire dans l'armée, même en Orient. Un littérateur de la seconde moitié du IIe siècle, qui fut appelé à la cour d'Arménie par le roi Sohaemos, dont nous avons déjà parlé, a écrit un roman où la scène se passe à Babylone, et qui reproduit en quelque sorte la vie de l'auteur; il nous aide à comprendre l'état de la Syrie. L'écrivain dit qu'il est Syrien, mais qu'il ne descend pas de Grecs immigrés; par sa mère et par son père, il est d'origine indigène, Syrien de langue et de moeurs; il connaît aussi l'idiome babylonien et la magie perse. Néanmoins cet homme même, qui renie, en un certain sens, l'hellénisme, ajoute qu'il est devenu Grec par l'éducation et qu'il est maintenant un des professeurs les plus considérés de la Syrie et l'un des meilleurs romanciers de la basse littérature grecque3. Si plus tard la langue syrienne est redevenue une langue littéraire et l'instrument d'une littérature spéciale, ce n'est pas parce que le sentiment national s'était réveillé; cette résurrection était une conséquence nécessaire de la propagande chrétienne; cette littérature syrienne, qui commença par traduire les livres fondamentaux de la religion chrétienne, ne s'étendit guère au-delà des limites où était renfermée l'éducation toute spéciale du clergé chrétien; elle n'emprunta à la civilisation grecque générale que ce qui parut aux théologiens de cette époque favorable à l'oeuvre qu'ils accomplissaient, ou du moins compatible avec elle4. Transporter dans les cloîtres des Maronites la bibliothèque des monastères grecs, tel fut le but que visa et qu'atteignit cette littérature. Il est difficile d'en faire remonter la naissance plus loin que le IIe siècle de notre ère; son centre fut non pas en Syrie, mais en Mésopotamie, notamment à Edesse5, où se sont vraisemblablement développés dans la langue du pays, d'une tout autre façon que dans l'ancien territoire romain, les débuts d'une littérature antérieure au christianisme. 1. Une monnaie de Byblos, du temps d'Auguste, porte une inscription grecque et phénicienne (Imhoof-Blumer, Monnaies grecques, 1883, p. 443). 2. Jean Chrysostome d'Antioche (4 407) cite plusieurs fois (De sanctis martyr., dans ses (Euvres, ed. de Paris, 1718, vol. II, p. 651; Homil., 19; ibid., p. 188) ?, la ? du kaos, en opposition avec la langue des gens instruits. 3. L'extrait du roman de Jamblique, donné par Photius (ch. 11), qui présente faussement cet auteur comme un Babylonien, est corrigé et complété par le scholiaste. Le secrétaire particulier du Grand-Roi, qui, fait prisonnier par Trajan et amené en Syrie, y fut le maître de Jamblique, et lui enseigna la sagesse barbare, est naturellement un des personnages du roman, qui se passe à Babylone et dont Jamblique prétend avoir reçu l'idée de son maître. Mais ce qui caractérise cette époque, c'est l'écrivain courtisan et le précepteur des princes d'Arménie (Sohaemos l'appela à Valarchapat en tant que bon rhéteur) : cet homme, grâce à sa connaissance de la magie, non seulement comprenait le vol des oiseaux et savait conjurer les esprits, mais encore il prédit à Vérus sa victoire sur Vologasos, et il raconta aux Grecs, en langue grecque, des histoires qui pourraient trouver place dans les Mille el une Nuits. 4. La littérature syrienne se compose presque exclusivement de traduction d'auvres grecques. Parmi les écrits profanes, il faut citer au premier rang des traités d'Aristote et de Plutarque, des livres pratiques de droit ou d'agronomie, des ouvrages d'enseignement populaire, comme le roman d'Alexandre, les fables d'Esope, les sentences de Ménandre. 5. La traduction syrienne du Nouveau Testament, le plus ancien texte en langue syrienne que nous connaissions, fut probablement écrite à Edesse; les otpatluta! de l'histoire des apôtres s'appellent dans cette version: les Romains. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Civilisation hellénico-syrienneRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste
Parmi les diverses formes bâtardes qu'a revêtues l'hellénisme dans sa propagande à la fois civilisatrice et démoralisatrice, la civilisation hellénico-syrienne est celle où les deux éléments se balançaient le mieux, mais peut-être aussi celle qui a exercé l'influence la plus puissante sur le développement général de l'empire. Sans doute, l'organisation municipale des villes grecques fut introduite en Syrie; les habitants acceptèrent la langue et les moeurs helléniques, mais ils se considérèrent toujours comme des Orientaux, ou plutôt comme les représentants d'une double civilisation. Nulle part peut-être cette idée n'est exprimée plus nettement dans le gigantesque monument funéraire que le roi Antiochus de Commagène, au début de l'empire, se fit construire non loin de l'Euphrate, sur une cime isolée. Il déclare dans sa longue épitaphe qu'il est Perse; il ordonne au prêtre de son sanctuaire de revêtir, pour lui apporter des offrandes, des habits perses, comme l'exige l'origine de sa famille; mais il place au début de sa généalogie les Hellènes aussi bien que les Perses; il appelle sur ses successeurs les bénédictions de tous les dieux de la Perside comme de la Makélite, c'est-à-dire de la Perse et de la Macédoine. Car il est le fils d'un prince indigène issu des Achéménides et d'une princesse grecque de la famille de Séleucus; aussi son tombeau est-il orné sur toute la longueur d'une double rangée de figures qui représentent, les unes, ses ancêtres paternels jusqu'à Darius Ier, les autres, ses ancêtres maternels, jusqu'au lieutenant d'Alexandre. Les dieux qu'il invoque sont à la fois perses et grecs, Zeus-Orosmadès, Apollon-Mitkra-Hélios-Hermès, Artagnès-Héraclès-Arès; ce dernier porte, par exemple, la massue du héros grec et la tiare persane. Ce prince perse, qui se nomme en même temps ami des Hellènes et, comme un loyal sujet de l'empereur, ami de Rome, est, autant que ce Sohaemos, prince achéménide, placé par Marc-Aurèle et Lucius Verus sur le trône d'Arménie, un pur représentant de cette aristocratie de la Syrie impériale, noblesse indigène qui réunit en elle le passé perse et le présent hellénico-romain. C'est par elle que le culte perse de Mithra s'introduisit en Occident. Mais les populations que gouvernait cette noblesse perse ou prétendue perse et qui étaient soumises en même temps à l'autorité des Macédoniens et plus tard des Italiens, étaient, en Syrie, en Mésopotamie et en Babylonie, d'origine araméenne; on peut les comparer aux Roumains modernes, dominés par des Saxons et des Magyars. Ces peuples étaient assurément l'élément le plus corrompu et le plus corrupteur de tous ceux qui formaient l'agglomération hellénico-romaine. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Christianisme et néoplatonismeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCette union de l'Orient et de l'hellénisme ne s'accomplit nulle part aussi parfaitement qu'en Syrie, mais la forme sous laquelle nous la connaissons est telle, que tout ce qu'il y avait de bien et de noble a disparu dans le mélange. Pourtant, ce n'est pas le cas partout; les formes postérieures de la religion et de la philosophie, le christianisme et le néoplatonisme sont nés du même accouplement; grâce au premier, l'Orient conquiert l'Occident; le second n'est que la philosophie occidentale pénétrée par les idées et par l'esprit de l'Orient : c'est une création d'abord de l'égyptien Plotin (204-270), puis de son disciple le plus brillant, Malchos ou Porphyre de Tyr (233-300 environ), qui s'est répandue surtout dans les villes de la Syrie. Ce n'est pas ici le lieu de tracer ces deux grands tableaux qui appartiennent à l'histoire universelle; mais, en appréciant la situation de la Syrie, il nous était impossible de les passer sous silence. |
||||
27 av. J.C.-476 |
AntiocheRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa civilisation syrienne s'est, pour ainsi dire, exprimée tout entière dans Antioche, capitale du pays et de tout l'Orient romain avant la fondation de Constantinople, ville qui n'était alors inférieure en population qu'à Rome, à Alexandrie et à Séleucie de Babylonie. Il est nécessaire de nous y arrêter un moment. Cette cité, une des plus modernes de la Syrie, qui n'a plus aujourd'hui qu'une importance minime, ne doit pas sa grandeur à sa situation naturelle, c'est une création de la politique monarchique. Les conquérants macédoniens se sont inspirés, en la fondant, de leurs intérêts militaires; ils l'ont choisie comme position centrale pour un empire, qui embrassait l'Asie Mineure, la vallée de l'Euphrate, l'Egypte, et qui ne voulait pas s'éloigner de la mer Méditerranée1. Les Séleucides et les Lagides poursuivaient une même entreprise par des voies différentes; c'est ce que prouvent à la fois la ressemblance et l'opposition d'Antioche et d'Alexandrie; celle-ci était destinée à soutenir la puissance navale et à favoriser la politique maritime des rois d'Egypte; l'autre devait être le centre de la monarchie continentale créée en Orient par les maîtres de l'Asie. A plusieurs reprises, les derniers Séleucides ont agrandi Antioche; aussi la ville se composait-elle, comme si elle avait été romaine, de quatre quartiers indépendants et séparés par des murs, qui étaient eux-mêmes tous enfermés dans un rempart commun. Les émigrés, venus de pays lointains, n'y manquaient pas. Lorsque la Grèce proprement dite tomba sous la domination des Romains, Antiochus le Grand, après avoir essayé, mais vainement, de les en chasser, offrit du moins un refuge dans sa capitale aux Eubéens et aux Etoliens qui abandonnèrent leur patrie. A Antioche comme dans la capitale de l'Egypte, les Juifs formaient une société en quelque sorte indépendante et occupaient une situation privilégiée; et le fait d'avoir été des centres pour les Juifs dispersés n'a pas été sans influence sur le développement des deux villes. Après avoir formé la résidence et le siège du gouvernement suprême d'un grand empire, Antioche resta, à l'époque romaine, la capitale des provinces conquises par Rome en Asie. C'est là que séjournaient les empereurs lorsqu'ils venaient en Orient, et que se tenait habituellement le gouverneur de Syrie; les monnaies impériales y étaient frappées pour tout l'Orient, et le gouvernement romain y faisait fabriquer ses armes, comme à Damas et à Edesse. Mais Antioche avait perdu aux yeux des Romains son importance militaire; depuis que sa situation était changée, c'était pour elle un grand désavantage d'être mal reliée à la mer, non pas parce que son port, la ville de Séleucie fondée à la même époque, était trop éloigné, mais parce qu'il n'était pas disposé pour le grand commerce. Depuis les Flaviens jusqu'à Constance, les empereurs romains ont dépensé des sommes énormes pour ouvrir des canaux dans les masses de rochers voisines de ce port, pour y établir les docks nécessaires et pour bâtir des môles suffisants; mais l'art des ingénieurs, qui avait réussi dans les plus grandes entreprises aux bouches du Nil, lutta vainement en Syrie contre les difficultés insurmontables du terrain. Tout naturellement, la plus grande ville de la Syrie a joué, dans l'industrie et le commerce de cette province, un rôle important dont nous reparlerons plus loin; néanmoins elle était plutôt habitée par des consommateurs que par des producteurs. Dans toute l'antiquité il n'y eut aucune ville où jouir de la vie fût autant le souci principal, et où l'on songeât moins à en remplir les devoirs qu'à Antioche près de Daphné : c'est ainsi que l'on désignait cette ville, comme si nous disions aujourd'hui, Vienne, près du Prater. Daphné2 est en effet le jardin de plaisance situé à un mille allemand [7 kilom. et demi] de la ville, ayant deux milles de tour [15 kilom.], célèbre par ses lauriers, qui lui ont donné son nom, par ses vieux cyprès, que les empereurs chrétiens eux-mêmes ordonnaient d'épargner, par ses eaux courantes et jaillissantes, par son magnifique temple d'Apollon, par ses fêtes splendides du 10 août qui attiraient tant de monde. Tous les environs de cette ville, située entre deux collines boisées, dans la vallée de l'Oronte aux eaux abondantes, à trois milles allemands [21 kilom. et demi] en amont de son embouchure, sont encore aujourd'hui, quoique abandonnés, un jardin fleuri et l'une des plaines les plus délicieuses de la terre. Dans aucune cité de l'empire romain, les monuments publics n'étaient aussi magnifiques ni aussi grandioses. La voie principale, qui traversait la ville en ligne droite, et qui longeait le fleuve sur une étendue de 36 stades, presque un mille allemand [7 kilom. et demi], était ornée de chaque côté d'un portique couvert; au milieu courait un large chemin pour les voitures. Plusieurs villes de l'antiquité ont imité cette disposition, mais aucune d'elles, pas même la Rome impériale, n'a pu égaler Antioche. L'eau coulait dans toutes les grandes maisons3; à travers toute la ville, les portiques offraient, en toute saison, un abri contre la pluie et les rayons du soleil; enfin le soir les rues étaient éclairées, ce qui ne nous a été dit d'aucune autre ville de l'antiquité4. 1. C'est ce que Diodore (XX, 47) dit de la ville qui précéda Antioche, d'Antigoneia, située sur le même fleuve, à une lieue en amont. Antioche a été pour la Syrie ancienne, à peu près ce qu'est Alep pour la Syrie moderne, le point de jonction des routes intérieures, mais Antioche, comme le prouve la fondation du port de Séleucie à la même époque, devait être mise en communication directe avec la mer Méditerranée; aussi fut-elle construite plus à l'Ouest. 2. L'espace compris entre Antioche et Daphné était couvert de villas et de vignobles (Libanius, Pro rhetor., II, p. 213, ed. Reiske); il y avait aussi dans cette région un faubourg nommé Hérakleia ou également Daphné (O. Muller, Antiq. Antioch., p. 44; cf. Vila Veri, 7); - lorsque Tacite (Ann., II, 83) appelle ce faubourg Epidaphne, il commet une de ses plus étranges bévues. Pline (Hist. nat., V, 21, 79) dit avec justesse : Antiochia Epidaphnes cognominata 3. Libanius d'Antioche, dans le panégyrique de sa patrie, qu'il écrivit sous Constance (1, p. 354 R), après avoir décrit les sources de Daphné, et les aqueducs qui aboutissaient à Antioche, ajoute : Ce qui frappe tout le monde à Antioche, c'est sa richesse en eau; si l'on peut rivaliser avec nous sur d'autres points, personne ne nous égale, lorsqu'on parle de l'eau, de son abondance et de sa qualité. Dans les bains publics chaque courant est aussi fort qu'un fleuve; il en est de même dans la plupart des bains particuliers, et dans les autres le courant n'est guère moins puissant. Celui qui a le moyen de construire un nouveau bain peut le faire sans se préoccuper de l'eau; il n'a pas à craindre qu'elle lui manque, s'il en a besoin. Aussi chaque quartier de la ville (il y en avait dix-huit) met-il un soin tout particulier à orner son établissement de bains; ces bains de quartiers sont plus beaux que les bains communs à tous, parce qu'ils sont plus petits et parce que les sociétés de quartiers veulent toujours se surpasser les unes les autres. On mesure l'abondance des eaux courantes au nombre des (belles) maisons d'habitation; plus il y a de ces maisons, plus il y a d'eau courante: il y a même souvent plusieurs fontaines pour une seule maison, la plupart des ateliers jouissent d'avantages semblables. Voilà pourquoi nous ne nous battons pas autour des fontaines publiques, pour savoir qui puisera le premier, comme il arrive malheureusement trop fréquemment dans des villes considérables, où les fontaines sont entourées d'une foule bruyante et où l'on entend le fracas des cruches brisées. Chez nous les fontaines publiques sont un pur ornement, puisque chacun a de l'eau dans sa maison. Cette eau est si claire, que le vase paraît vide; et si agréable, qu'elle excite à boire. 4. La lumière du soleil, dit le même orateur (p. 363), est remplacée par d'autres lumières, par des flambeaux, qui laissent loin derrière eux les illuminations des fêtes égyptiennes; chez nous la nuit ne se distingue du jour que par la différence de l'éclairage. Les travailleurs n'y font pas attention et continuent à forger; on chante et l'on danse comme l'on veut; chez nous Hephaistos et Aphrodite se séparent la nuit. D'après Ammien (XIV, 1, 9) le prince Gallus, pendant ses courses à travers la ville, fut fort contrarié par les lanternes d'Antioche. |
||||
Devenez membre de Roma LatinaInscrivez-vous gratuitement et bénéficiez du synopsis, le résumé du portail, très pratique et utile; l'accès au forum qui vous permettra d'échanger avec des passionnés comme vous de l'histoire latine, des cours de latin et enfin à la boutique du portail ! 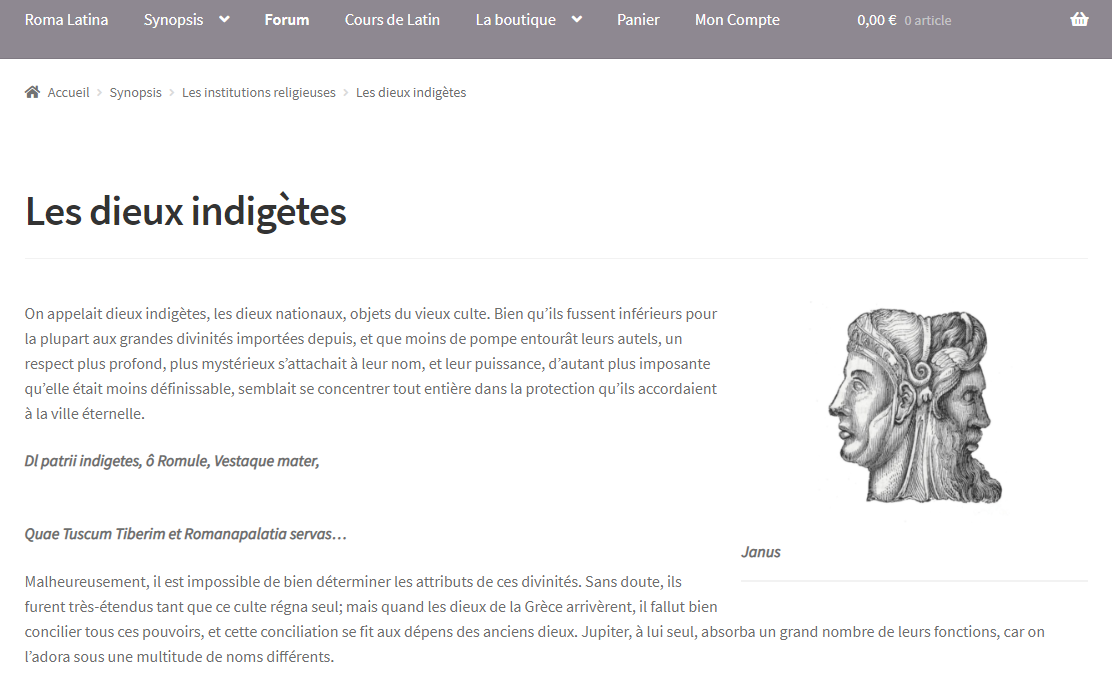 |
|||||
27 av. J.C.-476 |
Vie intellectuelleRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais cette existence luxueuse ne convenait pas aux Muses; la science et l'art lui-même étaient trop sérieux pour être cultivés en Syrie, surtout à Antioche. Autant le développement de l'Egypte et celui de la Syrie offrent une analogie frappante, autant est grande l'opposition des deux pays sous le rapport de la littérature. Seuls les Lagides ont recueilli cette partie de l'héritage d'Alexandre le Grand. Tandis qu'ils favorisaient la littérature hellémique et qu'ils poursuivaient les recherches scientifiques d'après la méthode et l'esprit d'Aristote, les meilleurs Séleucides étaient forcés par leur situation politique de fermer l'Orient aux Grecs. Seleucus I envoya Mégasthène dans l'Inde auprès du roi Tchandragoupta, et, à la même époque, fit explorer la mer Caspienne par l'amiral Patroclès, événements qui sont restés célèbres; mais les Séleucides ne se sont jamais intéressés directement aux choses littéraires et l'histoire de la littérature grecque ne leur doit rien. Tout ce que l'on peut dire en ce sens, c'est qu'Antiochus, surnommé le Grand, choisit pour bibliothécaire le poète Euphorion. Peut-être l'histoire de la littérature latine a-t-elle le droit de réclamer la gloire d'une véritable activité scientifique pour Béryte, sorte d'île latine perdue au milieu de l'Océan de hellénisme oriental. Peut-être n'est-ce pas l'effet du hasard si Marcus Valerius Probus, qui dirigea la réaction contre les tendances modernes de littérateurs de l'époque Julio-Claudienne, et qui remit en faveur dans les écoles et dans le monde des écrivains la langue et les oeuvres des auteurs de l'âge républicain, était un enfant de Béryte, issu de la classe moyenne; formé par l'étude des anciens classiques dans les écoles arriérées de sa lointaine patrie, plutôt écrivain et critique que professeur, au sens propre du mot, il prépara avec une activité énergique le classicisme du Bas-Empire. Plus tard Béryte fut, pour tout l'Orient, le centre des études juridiques, nécessaires à tous ceux qui voulaient remplir des fonctions publiques, et garda ce privilège pendant tout l'empire. Dans la littérature grecque, il est vrai, la poésie épigrammatique et l'esprit de feuilleton fleurissent en Syrie; plusieurs petits poètes grecs très célèbres, comme Méléagros et Philodemos de Gadora, ou comme Antipatros de Sidon, sont des Syriens; personne n'a surpassé la grâce de leurs pensées ni la science raffinée de leur prosodie; le créateur du feuilleton est Ménippe de Gadara. Mais tout cela existait déjà, et depuis longtemps avant l'époque impériale. Aucune province n'a été aussi peu représentée que la Syrie dans la littérature grecque de ce temps: il est bien difficile que le hasard seul soit coupable, si peu d'importance d'ailleurs que l'on doive attacher à la patrie des écrivains, à un moment où l'hellénisme était universellement répandu. En revanche c'est en Syrie que la littérature de second ordre s'est surtout développée : là sont nés ces récits, vides et écrits sans art, ces histoires d'amour, de voleurs, de pirates, de proxénètes, de devins, songes et ces voyages fabuleux. Parmi les collègues de ce Jamblique que nous avons déjà nommé, auteur du roman de Babylone, la plupart sont du même pays que lui; ce fut sans aucun doute en Syrie que se fit le contact entre cette littérature grecque et la littérature orientale qui lui ressemble. Certes les Grecs n'ont pas eu besoin d'emprunter à l'Orient l'art du mensonge; mais les oeuvres de cette basse époque, produits de l'imagination sans qualités de forme, paraissent plutôt sortir de la corne d'abondance de Scheherazade que du sein des Grâces. Peut-être n'est-ce pas par hasard que la satire de ce temps, qui considérait Homère comme le père des voyages fabuleux, en fait un Babylonien et lui donne le nom indigène de Tigranès. Si l'on fait abstraction de ces ouvrages amusants, dont rougissaient ceux-là mêmes qui perdaient leur temps à les écrire ou à les lire, le seul nom important que l'on puisse citer à propos de cette région, est celui du contemporain de Jamblique, de Lucien de Commagène. Encore cet écrivain s'est-il toujours inspiré des essais et feuilletons de Ménippe; c'est un franc représentant de l'esprit syrien, dont le persiflage est piquant et drôle, mais qui ne s'élève pas au-delà, qui est incapable de dire en riant une vérité sérieuse, et qui ignore l'art du comique. Ce peuple ne s'occupait que du présent. Aucune province grecque n'a laissé moins d'inscriptions funéraires que la Syrie; la grande ville d'Antioche, la troisième cité de l'empire, est plus pauvre en monuments de cette nature, que maint petit village d'Afrique ou d'Arabie, sans compter le pays des hiéroglyphes et des obélisques. A l'exception du rhéteur Libanius, contemporain de Julien, plus connu qu'il ne le mérite, cette ville n'a fourni à la littérature aucun nom d'écrivain remarquable. Ce n'est pas à tort que le Messie du paganisme, Appollonius de Tyane, ou l'apôtre qui parlait en son nom, appelait les habitants d'Antioche un peuple ignorant et à moitié barbare; il pensait qu' Apollon ferait bien de les métamorphoser eux et leur Daphne: A Antioche, disait-il, les cyprès savent bien murmurer, mais les hommes ne savent pas parler. Sous le rapport de l'art, Antioche n'est remarquable que par son théâtre et ses jeux. Les représentations, qui charmaient le public de cette ville, étaient, suivant la mode du temps, beaucoup moins des représentations dramatiques que des concerts bruyants, des ballets, des chasses d'animaux et des combats de gladiateurs. Les applaudissements ou les sifflets de ce public décidaient de la renommée d'un danseur dans tout l'empire. Les jockeys, les autres héros de cirque et de théâtre venaient surtout de Syrie1. Les danseurs de ballets et les musiciens, les jongleurs et les bouffons, ramenés à Rome par Lucius Verus dont la campagne d'Orient se termina à Antioche - ont fait époque dans l'histoire de la scène italienne. Ce qui caractérise le mieux ce public d'Antioche, ce qui nous montre avec quelle passion il se livrait à de tels plaisirs, c'est la tradition que nous avons conservée sur la catastrophe la plus terrible, dont Antioche fut frappée pendant cette période, sur la prise de cette ville par les Perses, en l'an 260: lorsque les ennemis arrivèrent, les habitants de la ville étaient au théâtre, et les flèches tombaient jusque dans les rangs des spectateurs, du haut de la montagne à laquelle il était appuyé. A Gaza, la ville la plus méridionale de la Syrie, où le paganisme conserva longtemps une puissante citadelle dans le temple célèbre de Marnas, deux chevaux luttèrent à la fin du IVe siècle dans les courses publiques; l'un appartenait à un chrétien ardent, l'autre à un païen non moins ardent; lorsque dans cette course le Christ eut vaincu Marnas, dit saint Jérôme, de nombreux païens se firent baptiser. 1. La curieuse description de l'empire du temps de Constance (Muller, Geogr. min., II, p. 513 et suiv.), le seul ouvrage de ce genre où l'on accorde une certaine place à la situation commerciale des pays, nous donne à ce point de vue les renseignements suivants sur la Syrie. Antioche possède en abondance tout ce qu'on peut désirer; mais surtout elle a ses courses de chevaux. Laodicée, Béryte, Tyr, Césarée (de Palestine) en ont aussi. Laodicée exporte des jockeys, Tyr et Béryte des acteurs, Césarée des danseurs (pantomimi), Hèliopolis du Liban des joueurs de flûte (choraulae), Gaza des musiciens (auditores, mauvaise traduction du mot axpoduata), Ascalon des lutteurs (athlelae), Castabala (en Cilicie) des pugiles. |
||||
27 av. J.C.-476 |
ImmoralitéRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl est certain que toutes les grandes villes de l'empire romain rivalisaient pour le relâchement des moeurs; mais c'est probablement Antioche qui mérite le prix en cette matière. L'honnête Romain, dont nous parle le sévère - moraliste du temps de Trajan, tourne le dos à sa patrie, parce qu'elle est devenue une ville grecque; mais il ajoute que les Achéens sont la moindre partie de l'ordure qui souille Rome; il y a longtemps, dit-il, que l'Oronte de Syrie s'est déversé dans le Tibre, et a vomi sur Rome sa langue, sa civilisation, ses musiciens, ses harpistes, ses joueuses de triangles, et ses troupeaux de filles de joie. Les Romains du temps d'Auguste parlaient de la joueuse de flûte syrienne, l'Ambubaia1, comme nous parlons aujourd'hui de la cocotte de Paris. Dans les villes de Syrie, disait déjà, pendant les dernières années de la république romaine, Posidonius, écrivain remarquable né dans la cité syrienne d'Apamée, les habitants ont perdu l'habitude des travaux pénibles; on ne songe plus qu'à banqueter et à boire; les réunions et les petits cercles n'ont pas d'autre objet; à la table royale on met une couronne sur la tête de chaque convive, et on l'arrose des parfums de Babylone; on joue de la flûte et on pince de la harpe à travers les rues; les gymnases sont transformés en bains chauds - il faut voir là une allusion à l'organisation de ce qu'on a appelé les thermes, dont l'usage, né probablement en Syrie, devint plus tard général; c'était essentiellement un mélange des gymnases et des bains chauds. Pendant quatre siècles Antioche resta la même. Si une querelle éclata entre ses habitants et l'empereur Julien, ce n'est pas tant à cause de la barbe de l'empereur, que parce qu'il imposa un tarif aux hôteliers, dans cette ville de cabarets où l'on ne songeait, suivant ses propres expressions, qu'à danser et à boire. Ce dérèglement et cette sensualité ont pénétré, aussi et surtout, la religion syrienne. Le temple du dieu syrien était souvent une succursale de la maison de tolérance2. 1. Du mot syrien abbubo, flûte. 2. Le petit écrit de Lucien sur la déesse syrienne adorée par tous les Orientaux à Hièrapolis nous donne une idée de ces récits grossiers et licencieux, propres à la religion de ce pays. Dans cet ouvrage - qui a servi de modèle au Kombabus de Wieland l'auteur se moque des gens qui se mutilent eux-mêmes, tout en célébrant cette opération comme un acte de haute moralité et de croyance religieuse. |
||||
|
|
|||||
27 av. J.C.-476 |
L'esprit satirique d'AntiocheRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl serait injuste de reprocher au gouvernement romain la corruption de la Syrie; elle existait déjà sous les Diadoques, et les Romains n'ont fait qu'en hériter. Mais l'élément hellénico-syrien a joué un rôle important dans l'histoire de cette époque, et quoique son influence indirecte soit de beaucoup la plus considérable, il a néanmoins tenu plusieurs fois une grande place dans la politique générale. A cette époque et en tout temps, on parle beaucoup moins de factions politiques proprement dites à propos d'Antioche, qu'à propos des autres grandes villes de l'empire; mais quand il s'agissait de railler et de raisonner, la capitale de la Syrie était supérieure à tout le monde, même à Alexandrie qui lui disputait encore cette gloire. Les habitants d'Antioche n'ont jamais fait de révolution; ils ont volontairement et sérieusement soutenu tous les prétendants, que l'armée de Syrie proclamait empereurs; ils ont pris parti pour Vespasien contre Vitellius, pour Cassius contre Marc-Aurèle, pour Niger contre Sévère; mais ils étaient toujours prêts, quand ils croyaient pouvoir revenir sur leur décision, à reconnaître de plein gré le gouvernement vainqueur. Le seul talent qu'on ne leur conteste pas était d'être des moqueurs incomparables. Ils maniaient la satire non seulement contre les acteurs de leur théâtre, mais encore et tout autant contre les empereurs qui venaient résider dans la capitale de l'Orient. Les railleries étaient les mêmes contre l'acteur et contre le souverain : les Syriens s'attaquaient à l'apparence personnelle et aux particularités individuelles, comme si le chef de l'empire n'était venu parmi eux, que pour jouer un rôle qui les amusait. Aussi, entre le public d'Antioche et les empereurs, surtout ceux qui avaient longtemps résidé dans cette ville, Hadrien, Vérus, Marc-Aurèle, Sévère, Julien, il y avait, pour ainsi dire, une guerre de sarcasmes permanente; nous possédons encore aujourd'hui un des actes de cette comédie, la réplique de l'empereur Julien aux habitants d'Antioche, qui s'étaient moqués de sa barbe. Mais si ce littérateur impérial répondait aux paroles satiriques par des écrits satiriques, d'autres empereurs ont fait payer plus cher à Antioche ses méchancetés et tous ses défauts : Hadrien lui retira le droit de battre monnaie; Marc-Aurèle lui enleva celui de se réunir et ferma pour quelque temps son théâtre; Sévère priva cette cité de son titre de capitale, et le transporta à la ville voisine de Laodicée, rivale perpétuelle d'Antioche. Ces deux mesures furent, il est vrai, bientôt après rapportées, mais la division de la province, dont Hadrien avait déjà menacé les Syriens, fut accomplie sous Sévère, comme nous l'avons déjà dit; et une des raisons principales en fut certainement que le gouvernement voulait humilier cette grande ville insoumise. Ce fut aussi la raillerie qui causa sa perte définitive. Lorsqu'en l'an 540 le roi des Perses Chosroès Nouchirvan parut sous les murs d'Antioche, on lui lança, du haut des remparts, non seulement des flèches, mais des surnoms grossiers, comme les habitants avaient l'habitude d'en donner; le roi, furieux, ne se contenta pas de prendre la ville d'assaut; il en transporta la population dans la cité de Nouvelle-Antioche qu'il avait fondée dans la province de Suse. | ||||
27 av. J.C.-476 |
Culture du solRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe côté le plus brillant de l'histoire de Syrie est le côté économique. Pour l'industrie et le commerce, la Syrie occupait, avec l'Egypte, la première place parmi les provinces de l'empire romain; elle était même, sous certains rapports, supérieure à l'Egypte. Grâce à une paix durable et à une administration prévoyante qui s'occupait avant tout d'assurer les approvisionnements d'eau, la culture du sol atteignit une prospérité, qui fait honte à la civilisation moderne. Plusieurs régions de la Syrie sont encore aujourd'hui d'une fertilité luxuriante. Les pachas n'ont pu ruiner ni la vallée inférieure de l'Oronte, ni le riche jardin qui entoure Tripoli, couvert de palmiers, de bois d'orangers, de bouquets de grenadiers et de jasmins, ni la plaine fertile qui s'étend le long de la côte au Nord et au Sud de Gaza. L'oeuvre de ces destructeurs est pourtant considérable. Apamée, dans la vallée moyenne de l'Oronte, n'est plus qu'un amas de rochers sauvages sans cultures et sans arbres, où les maigres troupeaux épars dans de rares pâturages sont décimés par les brigands de la montagne; elle est couverte çà et là de ruines; et cependant les documents nous affirment que sous le gouverneur de Syrie Quirinius, celui dont parle l'Evangile, cette ville avec son territoire comptait 117 000 habitants de condition libre. Il est certain que toute la vallée de l'Oronte, ce fleuve puissant qui, à Hémèse, est déjà large de 30 à 40 mètres et profond de 1 mètre 1/2 à 3, fut couverte de grandes cultures. Mais, en outre, des bras vigoureux travaillaient et labouraient une partie considérable des régions voisines, que le désert a conquises aujourd'hui, et où les voyageurs modernes ne croient pas que l'homme puisse vivre et prospérer. A l'Est d'Hémèse, dans un pays où il n'y a plus maintenant ni une feuille verte, ni une goutte d'eau, on a retrouvé en grand nombre les lourdes meules de basalte, employées dans les pressoirs à huile. Tandis que de nos jours les oliviers ne croissent plus, et encore en petit nombre, que dans les hautes vallées du Liban, jadis ces arbres couvraient toute la vallée de l'Oronte. Le voyageur qui va maintenant d'Hémèse à Palmyre emporte son eau sur le dos des chameaux : et pourtant la route est bordée de villas et de hameaux en ruines1. Aucune armée moderne ne pourrait entreprendre la même expédition qu' Aurélien. Une grande partie de ce que l'on appelle aujourd'hui le désert n'est qu'une région désertée par les travailleurs qui la fécondaient à une meilleure époque. Dans toute la Syrie, dit une géographie du milieu du IVe siècle, les céréales, le vin et l'huile sont en abondance. Mais cette province n'exportait pas, dans l'antiquité, ses produits agricoles, comme l'Egypte et l'Afrique; néanmoins d'excellents vins en étaient expédiés, par exemple, ceux de Damas en Perse, ceux de Laodicée, d'Ascalon et de Gaza en Egypte, et de là dans l'Ethiopie et dans l'Inde; mais les Romains aussi savaient apprécier les crus de Byblos, de Tyr, de Gaza. 1. L'ingénieur autrichien Joseph Tschernik (livraison supplémentaire 44 aux Geographischen Mittheilungen, de Petermann, 1875, p. 3, 9) a trouvé des meules de basalte pour pressoirs d'huile non seulement sur le plateau désert de Kala'at-elHossn, entre Hémèse et la mer, mais encore, au nombre de vingt et plus, à l'Est d'Hémèse près de El-Ferklous, où le basalte n'existe pas à l'état naturel; il a découvert, en outre, dans la même région des terrasses murées et des monceaux de ruines; puis des terrassements sur tout l'espace de seize lieues qui sépare Hémèse de Palmyre. Sachau (Reise in Syrien und Mesopotanien, 1883, p. 23-55) a rencontré des restes d'aqueducs, en différents endroits de la route qui mène de Damas à Palmyre. Les citernes d'Arados, creusées dans le roc, dont Strabon parle déjà (XVI, 2, 13, p. 753), sont encore aujourd'hui utilisées (Renan, Phénicie, p. 40). |
||||
|
|
|||||
27 av. J.C.-476 |
IndustrieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes fabriques syriennes ont eu une influence beaucoup plus considérable sur la situation générale de la province. Un grand nombre d'industries, importantes pour l'exportation, étaient originaires de ce pays, surtout celles de la toile, de la pourpre, de la soie et du verre. Le tissage du lin, qui se pratiquait depuis une haute antiquité dans la Babylonie, s'est de bonheur répandu en Syrie : Skytopolis (en Palestine), Laodicée, Byblos, Tyr, Béryte envoient leurs toiles dans le monde entier, dit la géographie que nous avons déjà citée; dans le tarif du maximum de Dioclétien les produits des trois premières villes sont cités parmi les toiles les plus fines, à côté de celles de Tarse et d'Egypte; ils sont même estimés supérieurs. L'on sait que la pourpre de Tyr est restée la meilleure de toutes, malgré les nombreuses fabriques qui lui faisaient concurrence; auprès de Tyr il y avait en Syrie, sur la côte au Nord et au Sud de cette ville, beaucoup de teintureries de pourpre aussi célèbres, à Sarepta, à Dora, à Césarée; il y en avait jusque dans l'intérieur du pays, à Néopolis de Palestine et à Lydda. La soie brute venait alors de Chine, et arrivait en Syrie surtout par la mer Caspienne; elle était travaillée principalement dans les fabriques de Béryte et de Tyr; cette dernière cité fournissait la soie pourpre la plus employée et la plus estimée. Les verreries de Sidon conservèrent sous l'empire leur ancienne renommée; plus d'un vase de verre de nos musées porte l'estampille d'un fabricant de Sidon. |
||||
27 av. J.C.-476 |
CommerceRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteA ces produits, qui appartenaient par leur nature au commerce universel, venait s'ajouter la masse des marchandises qui de l'Orient se dirigeaient vers l'Occident par les routes de l'Euphrate. Sans doute les produits de l'Arabie et de l'Inde ne prenaient pas alors cette voie, et passaient plutôt par l'Egypte; mais le commerce de la Mésopotamie resta nécessairement entre les mains des Syriens, et de plus les entrepôts situés aux bouches de l'Euphrate étaient en communication régulière avec Palmyre par des caravanes; ils se servaient donc des ports de Syrie. Ce qui prouve combien ces relations avec les pays voisins de l'Orient étaient importantes, c'est surtout que le monnayage d'argent était le même dans l'Orient romain et dans la Babylonie parthique; dans les provinces de Syrie et de Cappadoce le gouvernement romain frappait des monnaies d'argent, différentes des monnaies impériales, au coin et sur le modèle des pièces de l'empire voisin. L'industrie syrienne, principalement la fabrication de la laine et de la soie, était excitée par l'abondance des mêmes produits importés de Babylonie; de même, pendant l'époque impériale, c'est en grande partie par la Syrie que sont arrivés dans l'Italie et dans tout l'Occident, les peausseries, les fourrures, les onguents, les épices et les esclaves de l'Orient. Mais ce qui est resté toujours le caractère particulier de cette région où naquit le commerce, c'est que les Sidoniens et leurs compatriotes, différents en cela des Egyptiens, non seulement vendaient leurs marchandises aux étrangers, mais encore les leur portaient eux-mêmes; les capitaines de vaisseau formaient en Syrie une classe puissante et honorée1; l'on trouve sous l'empire des négociants et des comptoirs syriens dans presque tous les pays, comme aux temps reculés dont parle Homère. Les Tyriens avaient des comptoirs de ce genre dans les deux grands ports commerciaux de l'Italie, Ostie et Pouzzoles; ils les désignaient eux-mêmes dans leurs documents comme les plus considérables et les plus importants des établissements de ce genre; d'autre part, la géographie que nous avons déjà citée plusieurs fois nomme Tyr la première place commerciale de l'Orient2 et Strabon, parlant de Tyr et d'Arados, signale comme une curiosité leurs maisons, extraordinairement hautes, composées de plusieurs étages. Béryte, Damas et quelques autres villes de Syrie et de Phénicie ont eu de semblables établissements commerciaux dans les ports de l'Italie3. En effet, nous trouvons, surtout à la fin de l'empire, des négociants syriens, presque tous d'Apamée, établis non seulement dans l'Italie tout entière, mais encore dans les grands entrepôts d'Occident, à Salonae en Dalmatie, à Apulum en Dacie, à Malaea en Espagne, principalement en Gaule et en Germanie, par exemple à Bordeaux, à Lyon, à Paris, à Orléans, à Trèves; comme les Juifs, ces chrétiens de Syrie apportaient leurs costumes avec eux, et se servaient dans leurs réunions de leur dialecte grec4. C'est seulement après s'être rendu compte de cette situation que l'on peut comprendre entièrement l'histoire d'Antioche et des autres villes syriennes, que nous avons racontée plus haut. L'aristocratie s'y composait des riches fabricants et des négociants; la masse du peuple, des ouvriers et des matelots5; et, comme, plus tard, toutes les richesses acquises en Orient affluaient à Gênes et à Venise, de même, à cette époque, tous les gains produits par le commerce avec l'Occident s'entassaient dans Tyr et dans Apamée. Les régions commerciales, ouvertes à ces grands négociants, étaient très vastes; les droits d'exportation et d'importation qu'ils devaient payer étaient en général très modérés; aussi le commerce syrien, qui embrassait une grande partie des articles les plus lucratifs et les plus transportables, concentrait-il des capitaux énormes. Il ne se bornait pas d'ailleurs à exporter les produits de la Syrie6. Les traces de l'antique prospérité se retrouvent non pas dans les ruines éparses des grandes villes détruites, mais dans la contrée plutôt abandonnée que dévastée, qui s'étend sur la rive droite de l'Oronte depuis Apamée jusqu'à l'endroit où il change de direction pour aller à la mer. Sur cet espace long d'à peu près 20 à 25 milles allemands (150 à 180 kilomètres) existent encore aujourd'hui les restes d'environ cent localités; toutes les rues y sont reconnaissables; les édifices sont construits en pierres de taille, sauf les toits; les maisons d'habitation sont entourées de colonnades, ornées de galeries et de balcons, les fenêtres et les portes sont richement et élégamment décorées d'arabesques de pierres : il y a des jardins, des bains, des salles de banquet en sous-sol, des stalles, des pressoirs pour la fabrication du vin et de l'huile creusés dans le roc7; de grandes chambres sépulcrales, également creusées dans le roc, sont remplies de sarcophages, et l'on y pénètre par des couloirs ornés de colonnes. Nulle part on ne découvre des traces de la vie publique; ce sont les maisons de campagne des négociants et des industriels d'Apamée et d'Antioche qui attestent la solidité de leurs fortunes et leur science des plaisirs. Ces villes, qui se ressemblent toutes, datent des derniers temps de l'empire; les plus anciennes remontent au commencement du quatrième siècle; les plus modernes ont été construites au milieu du sixième. On rencontre partout des symboles chrétiens et des sentences bibliques, on trouve même de magnifiques églises et des emplacements de chapelles. Ce développement de la civilisation n'a pas commencé sous Constantin; il s'est seulement à cette époque perfectionné et affermi; d'autres villas et d'autres jardins moins durables ont assurément précédé ces constructions en pierre. La résurrection du gouvernement impérial après les troubles sanglants du troisième siècle apparait dans l'essor que prit alors le monde commercial de la Syrie; mais le tableau qui nous en est resté doit être appliqué dans une certaine mesure aux premiers siècles de l'empire. 1. A Arados, ville très populeuse du temps de Strabon (XVI, 2, 13, p. 753), apparaît sous Auguste un tipoooulos Tuv vauapensavtwy (Corp. insc. graec., 4736 h. ou mieux Renan, Mission de Phénicie, p. 3). 2. Totius orbis descriptio, c. 24: Nulla forte civitas Orientis est ejus spissior in negotio. Des documents caractéristiques (Corp. insc. graec., 5853; Corp. insc. lat., X, 1601) nous donnent une image vivante de ces comptoirs. Ils avaient avant tout une destination religieuse, c.-à-d. qu'ils servaient à la propagation du culte des divinités syriennes dans les pays étrangers. Dans le comptoir important d'Ostie un impôt était levé à cet effet par les navigateurs et les commerçants syriens; sur le produit de cette contribution, une subvention annuelle de 1000 sesterces était donné à l'établissement moins considérable de Pouzzoles, pour payer la location du local; les autres dépenses étaient à la charge des Tyriens de Pouzzoles, aidés sans doute par des dons volontaires. 3. C'est ce que prouve pour Beryte une inscription de Pouzzoles (Corp. insc. lat., X, 1634); l'inscription consacrée dans la même ville à Jupiter Maximus Damascenus (ibid., X, 1576) semble entraîner la même conséquence pour Damas. D'ailleurs nous comprenons aussi par là pourquoi Pouzzoles s'appelait si justement Petite-Délos. A Délos on trouve, dans les dernières années de sa prospérité, c'est-à-dire pendant le siècle qui précéda la guerre de Mithridate, les comptoirs et les dieux syriens établis de même, mais en bien plus grand nombre; nous y rencontrons l'association des Héraclistes de Tyr (Corp. insc. graec., 2271), celle des Poseidoniastes de Béryte (Bull. de Corr. hell., VII, p. 468), celle des adorateurs d'Adad et d'Atargatis d'Hierapolis (ibid., VI, p. 495 et sq.), sans compter de nombreuses inscriptions de négociants syriens. Cf. Homolle, ibid., VIII, p. 110 sq. 4. Lorsque Salvien (vers 450) reproche aux chrétiens gaulois de n'être pas meilleurs que les païens, il fait allusion (De gub. Dei, IV, 14, 69) à ces misérables negotiatorum et Syricorum omnium turbae, quae majorem ferme civitatum universarum partem occupaverunt. Grégoire de Tours raconte que le roi Gontran venant à Orléans fut reçu par la population tout entière, et acclamé en hébreu et en syriaque autant qu'en latin (VIII, 1: hinc lingua Syrorum, hinc Latinorum, hinc... Judaeorum in diversis laudibus varie concrepabat); d'après le même auteur, lorsque le siège épiscopal de Paris devint vacant, un marchand syrien sut l'acquérir; puis il donna à ses compatriotes toutes les places qui en dépendaient (X, 26 : omnem scholam decessoris sui abjiciens Syros de genere suo ecclesiasticae domui ministros esse statuit). Sidoine (vers 450) décrit en ces termes la population perverse de Ravenne (Ep., I, 8): fenerantur clerici, Syri psallunt, negotiatores militant, monachi negotiantur. Usque hodie, dit S. Jérôme (in Ezech., 27, vol. V, p. 513, ed. Vallarsi) permanet in Syris ingenitus negotiationis ardor, qui per totum mundum lucri cupiditate discurrunt et tantum mercandi habent vesaniam, ut occupato nunc orbe Romano (ceci fut écrit vers la fin du IVe siècle) inter gladios et miserorum neces quaerant divilias et paupertatem periculis fugiant. Friedlander (Sittengeschichte, II, 5e édition, p. 67) donne d'autres documents. On peut y ajouter sans crainte les nombreuses inscriptions de l'Occident, qui concernent des Syriens, quand même leur qualité de négociants n'est pas expressément indiquée. Nous en trouvons une preuve dans le cimetière de la petite ville de Concordia, dans l'Italie septentrionale; ce cimetière date du cinquième siècle; les étrangers qui y sont enterrés sont tous des Syriens, en grande partie originaires d'Apamée (Corp. insc. lat., V, p. 1060); de même toutes les inscriptions grecques trouvées à Trèves sont relatives à des Syriens (Corp. insc. graec., 9891, 9892, 9893). Ces inscriptions non seulement sont datées à la manière syrienne, mais encore elles présentent des particularités propres au dialecte grec de la Syrie (Hermès, XIX, p. 423). Cette dissémination des chrétiens de Syrie, qui n'est pas sans relation avec l'opposition existant entre le clergé d'Orient et celui d'Occident, ne doit pas être confondue avec la dispersion des Juifs; c'est ce que prouve le témoignage de Grégoire de Tours. 5. Il en est encore de même à peu près. Le nombre des ouvriers en soierie d'Homs est d'environ 3000 (Tschernik, loc. cit.). 6. Une des plus anciennes épitaphes de ce genre (elle est postérieure à Sévère et antérieure à Dioclétien) est l'inscription latino-grecque trouvée près de Lyon (Wilmanns, 2498; cf. Lebas-Waddington, 2329), concernant un certain @aiuos � 'Ioulavos 2xcoou (en latin Thaemus Julianus Sati fil.), originaire d'Atheila (de vico Athelani), non loin de Kanatha en Syrie (en langue moderne: d'Atil près de Kanavat dans le Haouran), et décurion à Kanatha, établi à Lyon, où il est commerçant en gros pour les produits d'Aquitaine (- negotiatori Lugduni et prov. Aquitanicae). On voit par là que les négociants syriens ne faisaient pas seulement le commerce des marchandises syriennes, mais qu'ils consacraient aux grandes affaires commerciales leurs capitaux et leur expérience pratique. 7. Une épigramme latine sur un pressoir (Corp. insc. lat., III, 188) est caractéristique dans le pays des raisins d'Apamée (Vita Elagabali, 21). |
||||
27 av. J.C.-476 |
Les juifsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'histoire des Juifs dans l'empire romain est tout à fait spéciale; elle est, pourrait-on dire, indépendante de la province qui porta leur nom sous les premiers empereurs, et pour laquelle on remit en usage plus tard l'ancienne dénomination des Philistins ou Palestiniens; aussi, comme nous l'avons déjà dit, nous a-t-il paru préférable de la traiter dans un chapitre particulier. Lorsque nous avons parlé de la Syrie, nous avons surtout signalé la part importante que les villes de la côte et même, dans une certaine mesure, de l'intérieur ont prise à l'industrie et au commerce de cette province. Les Juifs s'étaient déjà dispersés en grand nombre avant la destruction du temple, si bien que Jérusalem, lorsqu'elle était encore debout, était plutôt un symbole qu'une patrie, à peu près comme la ville de Rome pour ceux que l'on appelait, dans les derniers temps de l'empire, citoyens romains. Les colonies juives d'Antioche et d'Alexandrie, les autres sociétés du même genre, dont les droits et l'importance étaient beaucoup moindres, ont naturellement joué leur rôle dans la vie commerciale des villes où elles habitaient. Si nous devons les examiner à titre de Juifs, c'est uniquement parce que les sentiments de haine et de mépris réciproques, qui se sont produits ou plutôt qui se sont accrus entre Juifs et non-Juifs depuis la destruction du temple, et dans les nombreuses guerres nationales religieuses qui ont suivi, ont exercé leur influence jusque sur les relations commerciales. Puisque les commerçants syriens qui séjournaient à l'étranger se réunissaient surtout pour honorer leurs divinités nationales, il est impossible que les Juifs syriens de Pouzzoles aient fait partie de la société des marchands syriens de cette ville; et, tandis que le culte des dieux syriens prenait en dehors de la Syrie une extension toujours plus grande, les Syriens sectateurs de Moïse se séparaient de plus en plus des Italiens, ce qui était à l'avantage des autres Syriens. Du moment que les Juifs, qui avaient trouvé loin de la Palestine une seconde patrie, s'unissaient non pas à ceux de leurs compatriotes qui habitaient les mêmes villes, mais à ceux qui professaient leur religion, et cela était inévitable, ils renonçaient par là au crédit et à l'indulgence dont ils avaient joui à Alexandrie, à Antioche et ailleurs. Mais les Juifs de Palestine qui habitaient l'Occident ne provenaient pas pour la plupart de l'émigration commerciale; c'étaient des prisonniers de guerre ou des fils de prisonniers, des gens, par conséquent, qui n'avaient plus de patrie. Cette situation de parias faite aux fils d'Abraham, surtout à Rome, cet état de Juifs mendiants qui avaient pour tous meubles une botte de paille et un panier de petites marchandises et ne regardaient aucun profit comme maigre ou ordinaire, se rattachent au marché d'esclaves. On comprend alors pourquoi dans l'Occident les Juifs de l'époque impériale n'ont joué qu'un rôle secondaire auprès des Syriens. La communauté de religion entre les émigrés juifs commerçants et les émigrés juifs prolétaires pesait également sur tous les Juifs, sans compter que leur situation était forcément très humble. | ||||
106 |
La province d'ArabieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl nous reste encore à parler d'un pays dont il n'est pas souvent question et qui pourtant mérite qu'on l'étudie, de la province romaine d'Arabie. Elle a été mal nommée; l'empereur qui l'a organisée, Trajan, était un homme à grandes actions, mais à plus grands mots encore. La péninsule arabique, qui sépare le bassin de l'Euphrate de la vallée du Nil, pays sans pluies et sans fleuves, entouré de toutes parts par une côte rocheuse et privée de ports, est aussi peu favorable à l'agriculture qu'au commerce; pendant l'antiquité, elle est presque tout entière le patrimoine incontesté des nomades qui habitaient le désert. Les Romains qui, surtout en Asie et en Egypte, ont eu, plus qu'aucune des puissances qui se succédèrent dans ces régions, l'intelligence de borner leurs conquêtes, n'ont jamais même essayé de soumettre la péninsule arabique. Les rares expéditions qu'ils entreprirent dans le Sud-Est de cette presqu'île, dans la partie la plus fertile et la plus importante sous le rapport commercial, à cause de ses relations avec l'Inde, seront racontées lorsque nous décrirons la situation économique de l'Egypte. L'Arabie romaine ne comprend, comme état client et surtout comme province, qu'une faible partie du Nord de la péninsule; mais elle embrasse le pays situé à l'Est et au Sud de la Palestine jusqu'au grand désert, au-delà de Bostra. Nous nous occuperons en même temps de la région qui s'étend de Bostra à Damas, et qui était rattachée à la Syrie. Elle porte aujourd'hui le nom de la chaîne de montagnes voisine, l'Haourân; jadis elle s'appelait la Trachonitide et la Batanée. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Conditions de l'agriculture dans la Syrie orientaleRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCes territoires étendus ne peuvent être conquis à la civilisation que sous certaines conditions. La steppe proprement dite (Hamâd), qui se développe à l'Est du pays, dont nous nous occupons, jusqu'à l'Euphrate, n'a jamais été possédée par les Romains, et est impropre à toute culture; seules les tribus errantes du désert, comme aujourd'hui les Anézè, par exemple, la traversent, pour mener leurs chevaux et leurs chameaux paître pendant l'hiver sur les bords de l'Euphrate, pendant l'été dans les montagnes situées au Sud de Bostra, et souvent plusieurs fois dans l'année, pour changer de pâturages. Déjà la civilisation est plus développée à l'Ouest de la steppe, chez les tribus de bergers sédentaires qui élèvent le mouton en grande quantité. Mais cette région est très favorable aussi à l'agriculture. A l'état naturel, la terre rouge de l'Haourân, qui est de la lave décomposée, produit beaucoup de seigle, d'orge et d'avoine sauvages; c'est elle qui donne le plus beau froment. Certaines vallées profondes entourées de déserts de pierres, comme le champ ensemencé, la Rahba de la Trachonitide, sont les parties les plus fertiles de toute la Syrie : sans qu'on laboure, à plus forte raison sans qu'on fume la terre, le blé rapporte quatre-vingts fois, l'avoine cent fois sa valeur; il n'est pas rare de voir vingt-six épis sortir d'un seul grain de blé. Pourtant personne ne s'établit à demeure dans ce pays, car pendant les mois d'été, les grandes chaleurs et le manque d'eau et de pâturages forcent les habitants à se réfugier dans les montagnes de l'Haourân. La contrée a cependant plus d'un endroit où l'on peut se fixer. Le jardin, arrosé par les bras nombreux du fleuve Baradâ, qui entoure Damas, et les régions fertiles, encore aujourd'hui bien peuplées, qui s'étendent à l'Est, au Nord et au Sud de la ville, ont été dans l'antiquité, comme de nos jours, la perle de la Syrie. La plaine de Bostra, surtout à l'Ouest où elle porte le nom de Noukra, est aujourd'hui le grenier d'abondance de la Syrie, quoique le manque de pluies fasse perdre en moyenne une moisson sur quatre, et que des bandes de sauterelles, venues du désert voisin, soient une plaie inguérissable. Là où les eaux de la montagne arrivent jusqu'à la plaine, la vie et la prospérité se répandent avec la fraîcheur : La fécondité de ce pays, dit un connaisseur, est inépuisable; encore actuellement, dans des régions où les nomades n'ont épargné ni un arbre ni un buisson, le pays ressemble, aussi loin que l'oeil peut atteindre, à un jardin. De même, sur les plateaux volcaniques des montagnes, les courants de lave ont laissé de vastes espaces propres à la culture (nommés Kâ' dans le Haourân). Cette fertilité naturelle a régulièrement livré le pays aux bergers et aux bandits. L'instabilité forcée d'une grande partie de la population provoque des querelles incessantes à propos des pâturages; les régions, où l'on peut s'établir, sont continuellement exposées à des surprises; dans cette contrée, plus que partout ailleurs, il aurait fallu fonder une puissance politique, réellement capable de maintenir la paix et la sécurité; mais la population ne contient pas en elle-même les éléments d'une telle puissance. On pourrait à peine citer dans le monde entier un autre pays où, comme en Syrie, la civilisation ne s'est pas développée d'elle-même, mais a été importée de l'étranger par des conquérants tout-puissants. Si des postes militaires contenaient les tribus nomades du désert et les forçaient à vivre sur les territoires civilisés de la vie pacifique des bergers, si des colons étaient transportés dans les régions cultivables, et si l'eau des montagnes était amenée dans les plaines par le travail de l'homme, alors, mais seulement alors, la vie renaîtrait joyeuse et prospère. |
||||
27 av. J.C.-476 |
L'influence grecque dans la Syrie orientaleRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAvant les Romains, ce pays n'était pas aussi riche. Les habitants de tout le territoire qui s'étend jusqu'aux environs de Damas appartiennent au rameau arabe du grand tronc sémitique; tout au moins les noms de personnes sont généralement arabes. Dans la Syrie orientale, comme dans la Syrie septentrionale, la civilisation de l'Orient et celle de l'Occident s'étaient rencontrées; pourtant jusqu'à l'époque impériale elles n'avaient fait ni l'une ni l'autre de grands progrès. La langue et l'écriture dont les Nabatéens se servent sont celles de la Syrie et de la vallée de l'Euphrate; ces tribus indigènes ne peuvent les avoir reçues que de là. D'autre part les Grecs, établis en Syrie, s'étaient répandus, au moins en partie, dans ces régions. La grande ville commerçante, Damas, était devenue grecque comme le reste du pays. Les Séleucides avaient fondé des cités grecques au-delà du Jourdain, surtout dans la Décapole septentrionale; plus au Sud, l'antique Rabbath-Ammon était devenue, sous l'influence des Lagides, la ville de Philadelphie. Mais plus bas, et dans les régions orientales voisines du désert, les rois Nabatéens n'étaient guère soumis que de nom aux Syriens ou aux Egyptiens successeurs d'Alexandre; l'on n'a découvert nulle part ni monnaies ni inscriptions, ni monuments que l'on puisse rapporter à l'hellénisme qui précéda la période romaine. |
||||
37 av. J.C.-4 |
Les possessions d'Hérode au-delà du JourdainRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste(Organisation du pays par Pompée) Lorsque la Syrie tomba sous la puissance de Rome, Pompée s'efforça d'affermir dans les villes la constitution hellénique qu'il trouva établie; les cités de la Décapole comptaient leurs années à partir de l'an 690-691 de Rome = 64-63 av. J. C., date où la Palestine avait été rattachée à l'empire1. Mais on négligea dans cette région de gouverner et de civiliser les deux royaumes vassaux de Judée et d'Arabie. Nous parlerons dans un autre chapitre du roi des Juifs, Hérode, et de sa dynastie; ici nous devons signaler l'activité avec laquelle il étendit la civilisation vers l'Est. Son royaume, qui couvrait les deux rives du Jourdain dans tout son cours, atteignait vers le Nord au moins Chelbon, au Nord-Ouest de Damas, et, vers le Sud, la mer Morte; le pays situé plus à l'Est entre son royaume et le désert était soumis au roi des Arabes. Hérode et ses successeurs, qui continuèrent à gouverner cette contrée après l'annexion du royaume de Jérusalem, jusqu'à Trajan, et qui plus tard résidèrent à Caesarea Paneas, dans le Liban méridional, avaient fait les efforts les plus énergiques pour dompter les indigènes. Les plus anciens vestiges d'une certaine civilisation dans ce pays sont les villes souterraines, dont il est question dans le livre des Juges, grandes cavernes que des soupiraux rendaient habitables, avec des rues et des fontaines; elles étaient destinées à cacher des hommes et des troupeaux; il était difficile de les trouver, et lorsqu'on les avait trouvées, difficile d'y pénétrer. Leur existence seule nous apprend que les habitants pacifiques du pays étaient opprimés par les nomades, fils de la steppe. Cette région, dit Josèphe, lorsqu'il décrit l'état de l'Haourân sous Auguste, est habitée par des tribus sauvages qui n'ont ni villes ni champs fixes, mais qui se cachent avec leurs troupeaux dans des cavernes souterraines, dont l'entrée est étroite et dont les rues sont longues et tortueuses; de plus, comme ils ont en abondance de l'eau et des vivres, il est très difficile de les réduire. Quelques-unes de ces villes souterraines contenaient jusqu'à 400 individus. Un édit curieux du premier ou du second Agrippa, dont on a retrouvé quelques fragments à Kanatha (Kanavât), engage ces indigènes à cesser de vivre comme les animaux, et à se civiliser. Les Arabes nomades passaient leur temps soit à piller les agriculteurs voisins, soit à détrousser les caravanes qui traversaient le désert. Le pays devint encore moins sûr, lorsque Zénodoros prince d'Abila, qui régnait au Nord de Damas, dans l'Anti-Liban, et qu'Auguste avait chargé de surveiller le Trachon, aima mieux faire cause commune avec les bandits et participer en secret à leurs gains. Ce fut à la suite de cette trahison que l'empereur confia ce territoire à Hérode. Ce prince énergique n'eut aucun égard pour les brigands et réussit à les assujettir. Il semble avoir établi sur la frontière orientale de ses Etats une ligne de postes militaires fortifiés et commandés par des officiers royaux (ertzeye!). Il aurait obtenu des résultats encore meilleurs, si le pays des Nabatéens n'avait pas été l'asile de tous les pillards; ce fut une des causes pour lesquelles la mésintelligence régna entre Hérode et son collègue d'Arabie2. Les tendances hellénistiques furent aussi accentuées et eurent des conséquences moins fâcheuses dans cette région que dans son propre royaume. Toutes les monnaies d'Hérode et de ses descendants sont grecques; au-delà du Jourdain, le plus ancien monument avec inscription que nous connaissions, le temple de Baalsamin à Kanatha, porte une dédicace en langue araméenne; mais sur les bases honorifiques qui y furent placées, entre autres sur celle d'Hérode le Grand3, les inscriptions sont bilingues ou même seulement grecques; sous les successeurs de ce prince, le grec seul domine. 1. La Décapole, telle qu'elle fut réorganisée par Pompée, atteignait au moins Kanatha (Kerak) au Nord-Ouest de Bostra: nous le savons par les témoignages des écrivains, et par les monnaies datées de l'ère pompéienne (Waddington, à propos du no 2412). Il est probable que les monnaies qui portent le nom de las(8){v(6) Kavala et qui sont datées d'après la même ère, appartiennent à cette ville (Reichardt, Num. Zeitschrift, 1880, p. 53); il en résulte que ce devait être une des nombreuses cités que Gabinius releva (Josèphe, XIV, 5, 3). Il est vrai que Waddington (n. 2329) attribue toutes les monnaies de cette sorte qu'il connaît au second lieu du même nom, la moderne Kanavât, véritable capitale du Haouran, située au Nord de Bostra; mais il est peu probable que l'oeuvre de Pompée et de Gabinius se soit étendue aussi loin vers l'Est. Cette seconde ville est probablement plus moderne; elle a emprunté son nom à l'autre, qui était la place la plus orientale de la Décapole. 2. Les gens qui s'étaient enfuis de la Tétrarchie de Philippos, qui servaient dans l'armée du tétrarque de Galilée, Hérode Antipas, et qui passèrent à l'ennemi dans le combat contre l'Arabe Arétas (Josèphe, XVIII, 5, 1), sont sans doute des Arabes chassés de la Trachonitide. 3. Waddington 2366 = de Vogue, Inscr. du Haourun, 3. La plus ancienne épitaphe de ce pays, trouvée à Sououeda (Waddington 2320 = de Vogue, 1), est aussi bilingue; c'est la seule du Haouran, qui contienne l'iota ascrit. Les inscriptions sont placées de telle façon sur les deux monuments qu'il est impossible de déterminer quelle est la version qui précède l'autre. |
||||
IVe siècle av. J.C.-106 |
Le royaume de NabatRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe prince dont nous avons déjà parlé, le Roi de Nabat, comme il s'appelait lui-même, était voisin du roi des Juifs. La résidence de ce prince arabe était la ville de pierre, en araméen Séla, en grec Pétra, citadelle perchée sur les rochers à moitié chemin entre la mer Morte et la pointe Nord-Est du golfe Arabique, et qui depuis longtemps était une station intermédiaire pour les caravanes qui de l'Inde et de l'Arabie se dirigeaient vers la mer Méditerranée. Les rois des Nabatéens ne possédaient que la partie septentrionale de la péninsule arabique; leur puissance s'étendait sur la mer Rouge jusqu'au port de Leuke Kome situé en face de la ville égyptienne de Berenike, et, dans l'intérieur du pays, au moins jusqu'à la région de l'ancienne Thaema1. Au Nord de la péninsule leur territoire atteignait Damas, placée sous leur protection2; il se prolongeait même au-delà et entourait comme une ceinture toute la Palestine3. Les Romains, après avoir pris possession de la Judée, entrèrent en lutte avec ces princes, et Marius Scaurus conduisit une expédition contre Pétra. Il ne réussit pas alors à la soumettre; mais peu de temps après cette ville fut réduite4. Sous Auguste le roi Obodas était sujet de l'empire5, ainsi que le roi des Juifs Hérode; comme lui, il amena le ban et l'arrière-ban de ses troupes, aux Romains qui marchaient contre l'Arabie méridionale. Depuis lors la défense de la frontière impériale au Sud et à l'Est de la Syrie jusqu'à Damas doit avoir été confiée à ce prince arabe. Il était en guerre perpétuelle avec son voisin de Judée. Auguste, irrité de ce que le roi des Nabatéens, au lieu de poursuivre Hérode devant le tribunal de son suzerain, l'avait attaqué les armes à la main, et de ce que le fils d'Obodas, Harethath, en grec Arétas, après la mort de son père, était immédiatement monté sur le trône, sans attendre l'investiture de l'empereur, voulait le dépouiller de sa royauté et réunir son territoire à celui des Juifs; mais Hérode gouverna si mal pendant ses dernières années qu'Auguste abandonna son projet: Arétas fut confirmé (747 de Rome=7 av. J.-C.). Une quarantaine d'années plus tard, ce même Aretas prit encore une fois l'initiative de déclarer la guerre à son gendre, le prince de Galilée, Hérode Antipas, qui avait répudié sa fille pour épouser la belle Hérodiade. Il fut vainqueur; mais le suzerain irrité, Tibère, donna l'ordre au gouverneur de Syrie de marcher contre lui. Déjà les troupes étaient en mouvement, lorsque Tibère mourut (37). L'empereur suivant, Gaïus, auquel Antipas déplaisait, pardonna au prince arabe. Le successeur d'Arétas, le roi Malikou ou Malchos prit part, sous Néron et sous Vespasien, à la guerre de Judée comme vassal des Romains, et transmit son royaume à son fils Rabel, le contemporain de Trajan, et le dernier des souverains nabatéens. Lorsque l'état de Jérusalem eut été annexé à l'empire, et lorsque la puissance considérable d'Hérode eut été réduite au royaume peu dangereux de Caesarea Paneas, le royaume arabe devint le plus important de tous les états vassaux de la Syrie; au siège de Jérusalem, c'étaient les Nabatéens qui avaient amené le plus fort contingent à l'armée romaine. L'usage de la langue grecque n'a pas pénétré dans ce pays même sous la domination romaine; les monnaies frappées par les rois arabes ne portent que des inscriptions araméennes; les pièces de Damas font seules exception. Mais on assiste aux débuts d'une administration régulière et d'un gouvernement civilisé. Les princes indigènes n'ont même probablement commencé à battre monnaie que sous la suzeraineté romaine. Le commerce de l'Inde et de l'Arabie avec le bassin de la Méditerranée passait en grande partie par la route de caravanes, qui allait de Leuké Komé à Gaza par Pétra, et que les Romains surveillaient6. Dans le royaume des Nabatéens, comme à Palmyre, les fonctionnaires royaux portaient des noms grecs, par exemple les titres d'éparque et de stratège. Si l'on vante sous Tibère la bonne organisation introduite par les Romains en Syrie, et la sécurité assurée aux laboureurs par l'occupation militaire, il faut attribuer ce progrès aux réformes faites dans les états vassaux de Jérusalem ou plus tard de Caesarea Paneas et de Pétra. 1. A Medaïn Sâlih ou Hidjr, au Sud de Teimâ, l'ancienne Thaema, les voyageurs Doughty et Huber ont trouvé récemment une série d'inscriptions nabatéennes, presque toutes datées, de la période qui s'étend entre le règne d'Auguste et la mort de Vespasien. Il n'y a pas d'inscriptions latines; les rares inscriptions grecques sont d'une époque tout à fait moderne; selon toute apparence les Romains ont abandonné ce que les princes nabatéens possédaient dans l'Arabie centrale, lorsqu'ils ont transformé leur royaume en province romaine. 2. Sous les derniers Séleucides, vers l'époque de la dictature de Sylla, la ville de Damas se soumit volontairement au roi des Nabatéens, sans doute à cet Arétas, que Scaurus combattit (Josèphe, XIII, 15). Les monnaies qui portent la légende old anyos (Eckhel, III, p. 330; de Luynes, Rev. de numism., 1858, p. 311) ont peut-être été aussi frappées à Damas, lorsque cette ville était soumise aux Nabatéens; la date de l'une d'elles n'a pas été déterminée avec certitude, mais elle remonte probablement aux dernières années de la République romaine. Il est vraisemblable que Damas a fait partie du royaume des Nabatéens, tant que ce royaume a existé. De ce que les monnaies de cette ville portent les têtes des empereurs romains, il s'ensuit que Damas était sujette de Rome et par conséquent qu'elle s'administrait elle-même, mais non pas qu'elle était indépendante des princes vassaux de Rome. Les rapports de suzeraineté étaient alors si variés, que ces diverses conditions pouvaient bien s'accorder ensemble. Ce qui prouve que Damas était toujours soumise aux Nabatéens, c'est, d'une part, que l'ethnarque du roi Aretas voulait faire emprisonner à Damas l'apôtre Paul, comme celui-ci nous l'apprend dans sa 2e lettre aux Corinthiens (11, 32); et d'autre part que la domination des Nabatéens s'étendait encore sous Trajan au nord-est de Damas. - De ce fait qu'Arétas régnait à Damas, on a conclu faussement que la ville ne pouvait pas être romaine, et l'on a cherché par différents moyens à déterminer dans la vie de saint Paul une date précise pour l'événement que nous venons de signaler. On a songé aux complications qui avaient surgi entre Arétas et le gouvernement romain dans les dernières années du règne de Tibère; mais, comme cette querelle s'apaisa, il est probable que la situation territoriale d'Arétas ne subit alors aucune modification durable. Melchior de Vogue (Mélanges d'arch. orientale, app., p. 33) a fait remarquer qu'entre Tibère et Néron plus exactement entre les années 33 et 62 (De Saulcy, Numismatique de la Terre sainte, p. 36) - il n'y a pas de monnaies impériales de Damas, et que le gouvernement des Nabatéens s'y est établi à cette époque; il admet que l'empereur Gaïus s'est montré aussi bienveillant pour le roi arabe que pour les autres princes vassaux et qu'il lui a donné Damas. Mais des interruptions semblables dans la série des monnaies sont très fréquentes, et n'ont pas besoin d'être aussi profondément expliquées. Il faut renoncer à déterminer d'une façon précise dans la biographie de saint Paul l'année pendant laquelle le roi des Nabatéens était maître de Damas, et l'époque où le saint séjourna dans cette ville. S'il faut en croire le récit de cet événement dans l'histoire des apôtres (9) où, dans tous les cas, il n'est pas bien daté, Paul vint à Damas avant sa conversion, pour y continuer la persécution des Chrétiens, dans laquelle saint Etienne était mort; puis, lorsqu'il se fut converti à Damas et eut pris le parti des Chrétiens, les Juifs de ce pays voulurent l'assassiner, ce qui a fait supposer que le fonctionnaire d'Arétas, comme Pilate, avait favorisé la persécution hérétique. La lettre aux Galates nous indique d'une manière très positive que la conversion eut lieu à Damas et que de là Paul partit pour l'Arabie; en outre, qu'il revint à Jérusalem pour la première fois trois ans, pour la seconde fois dix-sept ans après sa conversion : c'est ainsi qu'il faut corriger les renseignements apocryphes donnés par l'histoire des apôtres sur les voyages de saint Paul à Jérusalem (Zeller, Apostelgesch., p. 216). Mais on ne peut déterminer d'une façon précise ni la date de la mort de saint Etienne, ni l'espace de temps qui s'écoule entre cette mort et la fuite de saint Paul converti quittant Damas, ni celui qui sépare son second voyage à Jérusalem de la composition de la lettre aux Galates, ni l'année où cette lettre fut écrite. 3. L'inscription nabatéenne, trouvée dernièrement à Dmér, au Nord-Est de Damas sur la route de Palmyre (Sachau, Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellschaft, XXXVIII, p. 535), datée du mois Ijjar de l'année 405 (ère romaine, c.-à-d. des Séleucides), et de la 24e année du règne du roi Rebel, le dernier prince nabatéen, par conséquent de mai 94 av. J.-C., a prouvé que ce district était resté soumis aux Nabatéens jusqu'à l'annexion de leur royaume à l'empire romain. D'ailleurs dans cette région les territoires soumis aux divers souverains semblent avoir pénétré géographiquement l'un dans l'autre : ainsi le tétrarque de Galilée et le roi des Nabatéens se disputaient le territoire de Gamala, près du lac de Génézareth (Josèphe, XVIII, 5, 1). 4. Peut-être par Gabinius (Appien, Syr., 51). 5. Strabon, XVI, 4, 21, p. 779. Les monnaies de ces rois ne portent cependant pas la tête de l'empereur. Mais ce qui prouve que dans le royaumne des Nabatéens les années de règne des empereurs romains pouvaient servir à dater, c'est l'inscription nabatéenne d'Hebrân (De Vogue, Syrie centrale, inscr. n. 1), datée de la 7e année du règne de Claude, par conséquent de l'année 17. Hebrân, située un peu au Nord de Bostra, semble avoir été rattachée plus tard à l'Arabie (LebasWaddington, 2287), et l'on ne trouve pas hurs du royaume nabatéen d'inscriptions officielles en langue indigène; les rares monuments de cette espèce, qui proviennent de la Trachonitide, sont de source privée. 6. Leuke-Kome, dans le pays des Nabatéens, dit Strabon sous Tibère (XVI, 4, 23, p. 780), est une grande place de commerce, point de départ et d'arrivée pour les caravanes (raunheu. To so!) qui vont à Petra ou qui en viennent, et dont les chefs emmènent avec eux tant de gens et tant de chameaux, qu'on dirait des camps militaires. De même le marchand d'Egypte, qui écrivait sous Vespasien, cite, dans sa description des côtes de la mer Rouge (c. 19), le port et la citadelle de Leuke-Kome (oppupuov), d'où part la route qui conduit à Petra et dans les Etats du roi des Nabatéens, Malichas. C'est un port de commerce où peuvent entrer les navires de grandeur moyenne qui apportent des marchandises d'Arabie. On y envoie un fonctionnaire pour percevoir un droit d'importation égal au quart de la valeur des marchandises, et un centurion avec sa troupe pour assurer la sécurité. Si un sujet de l'empire romain signale dans cette place la présence de fonctionnaires et de soldats, ils ne peuvent être que romains; d'ailleurs le centurion n'aurait pas de raison d'être dans l'armée du roi des Nabatéens, et la nature de l'impôt perçu est bien celle de l'impôt romain. Ce n'est pas le seul état vassal qui ait été englobé dans les limites douanières de l'empire; il en est de même par exemple dans la région des Alpes. Pline (Hist. nat., VI, 28, 144) cite la route de Pétra à Gaza. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Civilisation de la Syrie orientale sous la domination romaineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteJamais cette région n'avait été ainsi protégée. A proprement parler, elle ne perdit pas sa nationalité. Les noms arabes ont subsisté jusqu'aux temps modernes, quoique souvent, comme en Syrie, un nom héllénico-romain se soit ajouté au nom indigène; par exemple, nous savons qu'un cheikh s'appelait Adrianos ou Soaidos, fils de Malechos1. On ne toucha pas non plus à la religion nationale; la divinité suprême des Nabatéens, le dieu Dousaris, peut bien être comparé à Dionysos; mais il continua d'être adoré généralement sous son nom indigène, et les habitants de Bostra célébrèrent encore longtemps en son honneur les Dousaries?. De même, dans la province d'Arabie, on éleva toujours des temples et l'on offrit toujours des sacrifices à Aumou ou Hélios, à Vasaeathou, à Théandritos, à Ethaos. L'organisation par tribus ne fut pas détruite, les inscriptions signalent des séries de quazi, qui portent des noms indigènes, souvent aussi des Phylarques ou Ethnarques. Mais à côté des moeurs anciennes, la civilisation et l'hellénisme font des progrès. Si, avant Trajan, on ne peut citer aucun monument grec dans le pays qu'occupaient les Nabatéens, la langue indigène, au contraire, disparaît des inscriptions après cet empereur2; selon toute apparence, le gouvernement impérial a interdit, après l'annexion, l'usage de l'écriture araméenne; mais la langue araméenne resta certainement la langue nationale proprement dite, comme le prouvent les noms propres et le titre d'interprète pour les percepteurs d'impôts que l'on rencontre alors. 1. Epiphanius (Haeres., p. 483, ed. Dindorf) rapporte que le 25 décembre, le jour anniversaire de la naissance du Christ, était déjà célébré à Rome dans la fête des Saturnales, à Alexandrie dans la fête de la Kikellia (que cite également le décret de Canope), et dans d'autres cultes païens. C'est ce qui arrive à Alexandrie dans le sanctuaire appelé sanctuaire des Vierges (Koplov).....; et lorsqu'on demande aux habitants ce que signifie ce mystère, ils vous répondent en disant que, le même jour, la Vierge avait enfanté l'Eternel. Il en est de même à Pétra, capitale de l'Arabie; dans le temple de cette ville, les Arabes célèbrent dans leur langue la Vierge, qu'ils nomment Chaamou, c'est-à-dire la Jeune Fille, et son fils Dousarés, dont le nom signifie le fils unique du Seigneur. Le nom de Chaamou a peut-être quelques rapports avec l'Aumou ou Aumos des inscriptions grecques de ce pays, qui correspond à Zev; (Waddington, 2392-2395, 2441, 2455, 2456). 2. Il faut ici faire abstraction de la fameuse inscription greco-arabe trouvée à Harren, non loin de Zorava, qui (qu'on remarque bien la suite) date de l'an 568 ap. J.-C., et dont l'auteur est le phylarque Asaraélos, fils de Talémos (Waddington, 2464). |
||||
27 av. J.C.-476 |
Agriculture et commerceRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNous n'avons pas de témoignages écrits sur l'état de l'agriculture; mais sur toute la pente orientale et méridionale de l'Haourân, depuis le sommet de la montagne jusqu'au désert, les pierres, dont cette plaine volcanique était autrefois parsemée, sont rassemblées en monceaux ou réunies en longues rangées; de magnifiques champs ont ainsi été conquis. Il faut reconnaître là l'oeuvre du seul gouvernement qui ait admistré le pays, comme il pouvait et comme il devait être administré. Sur la Ledja, plateau de lave long de treize lieues et large de huit à neuf, qui est maintenant presque désert, les vignes et les figuiers croissaient jadis entre les courants de lave; à travers ce plateau court la voie romaine qui menait de Bostra à Damas; là et aux environs on trouve les ruines de douze grands villages et de trente-neuf hameaux. Le gouverneur, qui avait organisé la province d'Arabie, fit bâtir le grand aqueduc, qui amenait dans la plaine de Kanatha (Kerak) l'eau des montagnes de l'Haourân, et un aqueduc semblable pour alimenter Arrha (Rahâ); ces monuments du règne de Trajan doivent être cités à côté du port d'Ostie et du Forum romain. Le choix même de la capitale de cette nouvelle province témoigne de l'extension que prit le commerce. Bostra existait déjà sous le gouvernement des rois Nabatéens; on y a trouvé une inscription du roi Malichou; mais son importance militaire et commerciale ne commença qu'avec la domination immédiate des Romains. Parmi toutes les villes de la Syrie orientale, dit Wetzstein, c'est Bostra qui est la mieux située; Damas elle-même, qui doit sa prospérité à l'abondance de ses eaux, et à sa position que protège le Trachon oriental, ne sera préférée à Bostra que par un gouvernement faible; sous un maître puissant et sage, cette dernière ville atteindra au bout d'un demi-siècle une prospérité fabuleuse. C'est le grand marché du désert syrien, du plateau arabique, et de la Peraea; sa longue rangée de boutiques de pierre, qui subsistent encore au milieu des solitudes, atteste la réalité de sa grandeur passée et prouve qu'elle peut la retrouver dans l'avenir. Les restes de la voie romaine qui conduisait de Bostra, par Salchat et Ezrak, au golfe persique, nous apprennent que cette ville était, avec Pétra et Palmyre, une des stations intermédiaires entre l'Orient et la mer Méditerranée. Elle a probablement été dotée par Trajan de la constitution hellénique; tout au moins elle s'appelle depuis lors la nouvelle Bostra de Trajan; les monnaies grecques commencent avec Antonin. Plus tard, lorsqu' Alexandre Sévère lui eut concédé le droit de colonie, la légende des pièces devint latine. De même Pétra était organisée, dès le règne d'Hadrien, comme une municipalité grecque; postérieurement d'autres localités isolées ont obtenu le droit de cité; mais c'est l'organisation en villages indigènes qui a dominé jusqu'aux temps modernes sur cette terre arabe. |
||||
27 av. J.C.-476 |
Architecture de la Syrie orientaleRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNous en avons gardé une image plus complète que des autres manifestations du monde antique; les constructions de Pétra, taillées presque toutes dans le roc, et les monuments de l'Haouran bâtis complètement en pierre à défaut de bois, n'ont pour ainsi dire pas été endommagés par les Bédouins : ces édifices sont encore aujourd'hui conservés en grande partie et jettent une vive lumière sur l'art et sur la vie pratique de cette époque. Le temple de Baalsamin à Kanatha, dont nous avons parlé plus haut, élevé certainement sous Hérode, est, dans ses plus anciennes parties, complètement différent des monuments grecs; son architecture présente des analogies curieuses avec celle du temple d'Hérode à Jérusalem, quoique les représentations symboliques, bannies de ce sanctuaire, soient ici assez abondantes. On a fait la même remarque à propos des monuments trouvés à Pétra. Plus tard on alla même plus loin. Sous les rois juifs et nabatéens, la civilisation ne s'était dégagée que lentement des influences orientales, l'établissement d'une légion à Bostra. L'architecture, dit un excellent observateur français Melchior de Vogué, prit alors un développement, qui ne s'arrêta pas. Partout s'élevèrent des maisons, des palais, des bains, des temples, des théâtres, des aqueducs, des arcs de triomphe; dans l'espace de quelques années, des villes sortirent du sol, toutes ornées de ces colonnades symétriques, qui indiquent les cités neuves, et qui, pendant l'époque impériale, furent, pour cette partie de la Syrie, comme un uniforme inévitable. Sur la pente orientale et méridionale de l'Haourân, il y avait alors près de trois cents villes et villages aujourd'hui déserts; il en reste à peine cinq; quelques-unes de ces localités, Bousân, par exemple, contenaient jusqu'à huit cents maisons à un et deux étages, construites en basalte; leurs murs étaient formés de pierres de taille bien assemblées sans ciment; les portes étaient couvertes d'ornements et souvent aussi d'inscriptions; le toit plat se composait de dalles de pierre, soutenues par des cintres également en pierre; il était protégé contre la pluie par une assise de ciment. Les murs de la ville étaient généralement formés uniquement par les parties postérieures des maisons, reliées entre elles, que protégeaient de nombreuses tours. Lorsque dans les temps modernes on a tenté de coloniser à nouveau ce pays, on a bien trouvé les maisons habitables; ce qui manquait, c'étaient les travailleurs actifs, et la puissance capable de les protéger. Devant les portes sont des citernes presque toujours souterraines ou recouvertes d'un toit de pierre artificiel. Aujourd'hui que cette cité déserte est devenue un pâturage, plusieurs de ces puits ont été conservés par les Bédouins, qui, pendant l'été, y font boire leurs troupeaux. La construction et l'architecture ont bien gardé quelques traces de l'ancien art oriental, entre autres la forme habituelle des tombeaux en cubes surmontés d'une pyramide, peut-être aussi les tours à pigeons, souvent ajoutées aux monuments funéraires et très abondantes aujourd'hui même en Syrie; mais, en général, l'architecture syrienne est l'architecture grecque ordinaire de l'époque impériale. Seulement le défaut de bois a provoqué dans cette contrée un grand développement du cintre en pierre et de la coupole, qui donne à ces constructions un caractère original aussi bien sous le rapport technique que pour ce qui est de l'art même. Au lieu de reproduire, suivant les habitudes des autres pays, les formes traditionnelles, l'architecture syrienne se soumit avec indépendance aux nécessités et aux conditions locales; elle n'employa l'ornementation que discrètement; elle fut surtout saine et rationnelle, sans manquer pourtant d'élégance. Les tombeaux, creusés dans les murs de rochers qui s'élèvent à l'Est et à l'Ouest de Pétra et dans les vallées latérales, avec leurs portiques d'ordre dorien ou corinthien, souvent superposés en plusieurs rangées, avec leurs pyramides et leurs propylées qui rappellent les monuments égyptiens de Thèbes, ne sont pas artistiques pour l'ail, mais sont imposants par leur masse et leur richesse. Seul un peuple actif et très prospère pouvait consacrer autant de soin à ses morts. En voyant ces monuments de l'architecture syrienne, on ne s'étonne plus si les inscriptions signalent un théâtre dans le village de Sakkaea, un Odéon en forme de théâtre à Kanatha, et si un poète indigène de Namara, dans la Batanée, se vante lui-même d'être passé maître dans l'art sublime de la poésie élevée d'Ausonie. Ainsi, sur la frontière orientale de l'empire, la civilisation hellénique avait conquis un territoire, que l'on peut comparer à la vallée du Rhin romanisée; les cintres et les coupoles de la Syrie orientale peuvent rivaliser avec les châteaux et les monuments funéraires des nobles et des grands négociants de la Belgique. |
||||