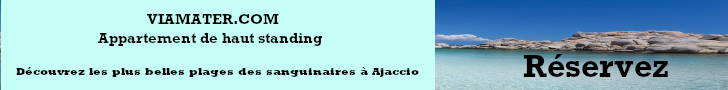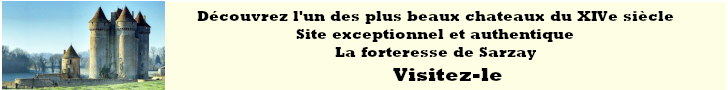|
|||||
Frontière de l'Euphrate-Les Parthes
Sources historiques : Théodore Mommsen Vous êtes dans la catégorie : Empire Chapitre suivant : La Syrie Chapitre précédent : L'Asie mineure Dans ce chapitre : 73 rubriques; 45 238 mots; 235 743 caractères (espaces non compris); 280 491 caractères (espaces compris) Format 100% digital de cette rubrique (via l'espace membre) | |||||
559 av. J.C.-146 ap. J.C. |
L'empire de l'IranRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe seul grand Etat qui fut limitrophe de l'empire romain était l'empire de l'Iran1, habité par le peuple qui était connu surtout, autrefois comme aujourd'hui, sous le nom de Perses, et qui avait été formé en une unité politique par l'ancienne dynastie des Achéménides dont le premier grand roi fut Cyrus, tandis que l'unité religieuse y était assurée par le culte d'Ahoura Mazda et de Mithra. Aucun des peuples civilisés de l'antiquité n'a résolu si tôt ni si complètement le problème de l'unification nationale. Au Sud, les tribus iraniennes atteignaient les côtes de l'Océan indien; au Nord, elles s'étendaient jusqu'à la mer Caspienne; vers le Nord-Est, les steppes de l'Asie centrale étaient sans cesse le champ de bataille entre les Perses sédentaires et les Touraniens nomades. A l'Est, de puissantes chaînes de montagnes séparaient les Iraniens des peuples de l'Inde. L'Asie occidentale avait été envahie de bonne heure par trois nations, qui s'y étaient rencontrées: les Hellènes, venus d'Europe et maîtres des côtes de l'Asie Mineure; les tribus araméennes, originaires d'Arabie et de Syrie, qui s'étaient avancées vers le Nord et le Nord-Est, et qui occupaient en grande partie la vallée de l'Euphrate; enfin, les peuples de l'Iran, qui non seulement atteignaient le Tigre, mais qui avaient même conquis l'Arménie et la Cappadoce, soumettant et anéantissant les populations primitives de ces vastes contrées, issues d'un autre peuple. La puissance iranienne, lors de son apogée, sous le règne des Achéménides, s'étendit dans tous les sens, surtout vers l'Ouest, bien au-delà de cet immense territoire. Si l'on fait abstraction de l'époque où les Touraniens furent vainqueurs de l'Iran et du temps pendant lequel les Turcs Sedjoucides et les Mongols commandèrent aux Perses, la domination étrangère ne fut réellement établie que deux fois sur le berceau des peuples iraniens par Alexandre le Grand et ses successeurs immédiats, puis par les Arabes Abbassides; les deux fois, elle fut d'une durée relativement courte. Les peuples de l'Est, dans un cas les Parthes, dans l'autre les habitants de l'ancienne Bactriane, non seulement secouèrent le joug des étrangers, mais encore les chassèrent des contrées de l'Ouest, occupées par des tribus de même lignée qu'eux. 1. Un médecin de Smyrne, Hermogène, fils de Charidème (Corp. insc. graec., 3311) écrivit non seulement soixante-dix sept volumes sur la médecine, mais encore, comme son épitaphe nous l'apprend, des ouvrages historiques sur Smyrne, sur la patrie d'Homère, sur la sagesse d'Homère, sur les fondations de villes en Asie, en Europe et dans les îles, des itinéraires d'Asie et d'Europe, un traité sur les ruses de guerre, enfin des tableaux chronologiques sur l'histoire de Rome et de Smyrne. Un médecin impérial Ménécrate (ibid., 6607), dont l'origine est inconnue, fonda, suivant ses admirateurs romains, dans ses ouvrages qui forment cent cinquante-six volumes, la nouve médecine à la fois logique et empirique. 2. Dans tout l'Orient romain, principalement dans les provinces frontières, on avait l'idée que l'empire romain et que l'empire parthe étaient deux grands états qui existaient à côté l'un de l'autre, et même qu'ils étaient les seuls dans le monde. Cette conception est exprimée en termes frappants dans l'Apocalypse de saint Jean; on y voit un cavalier monté sur un cheval blanc et armé d'un arc, auprès d'un cavalier monté sur un cheval rouge et armé d'une épée (6, 2 et 3); les Mégistanes y côtoient les Chiliarques (6, 15. Cf. 18, 23 et 19, 18). De même la catastrophe est représentée comme la défaite des Romains par les Parthes qui ramènent l'empereur Néron (c. 9, 14; 16, 12) et par Armagedon, c'est-à-dire par tous les Orientaux unis pour se jeter sur l'Occident. D'ailleurs l'écrivain qui nous fait connaître, au sein même de l'empire romain, ces espérances peu patriotiques, les constate beaucoup plutôt qu'il ne les exprime en son propre nom. |
||||

|
|||||
247 av. J.C.-224 ap. J.C. |
L'empire des ParthesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe royaume des Perses avait été régénéré par les Parthes, lorsque les Romains, après avoir conquis la Syrie, se trouvèrent, au dernier siècle de la République, en contact immédiat avec l'Iran. Nous avons déjà dû faire plusieurs allusions à cet Etat; il nous faut maintenant réunir le peu de renseignements que nous avons sur l'histoire particulière de cet empire, qui exerça tant de fois une action décisive sur les destinées de l'Etat voisin. La tradition ne donne aucune réponse à la plupart des questions que l'historien peut se poser ici. Les Occidentaux ne nous fournissent sur l'histoire intérieure des Parthes, leurs voisins et leurs ennemis, que des détails isolés, capables de nous induire en erreur. Les Orientaux n'ont guère compris quel intérêt ils avaient à fixer et à conserver la tradition historique; mais cette remarque s'applique doublement à l'époque des Arsacides, les Iraniens postérieurs ayant toujours considéré cette époque, ainsi que le temps de la domination des Séleucides, qui l'avait précédée, comme une usurpation injuste entre les deux périodes de l'ancien et du nouvel empire perse, entre les Achéménides et les Sassanides : ces cinq siècles ont été en quelque sorte rayés de l'histoire de l'Iran? et sont comme disparus. |
||||
vers 238 av. J.C. |
Les Parthes de ScythieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste
Les historiographes des Sassanides se sont placés bien plus au point de vue de la dynastie légitime issue de la noblesse persane qu'à celui de la nationalité iranienne. A vrai dire, les historiens des premiers temps de l'empire représentent la langue des Parthes, sortis de la région qui correspond à peu près au Khorassan actuel, comme un idiome intermédiaire entre les langues médique et scythique, c'est-à-dire comme un dialecte iranien impur. Les Parthes étaient donc regardés comme des étrangers venus du pays des Scythes et, en ce sens, leur nom est souvent appliqué à des peuplades diverses. Arsace, le fondateur de leur empire, est appelé par les uns Bactrien, par les autres Scythe du Palus-Moeotis. Si les rois parthes ne résidèrent pas à Séleucie, sur le Tigre, mais établirent leur camp d'hiver dans le voisinage immédiat de Ctésiphon, c'est qu'ils ne voulaient pas livrer aux troupes scythes cette riche ville commerçante. Les moeurs et l'organisation intérieure du peuple parthe s'écartent beaucoup des coutumes iraniennes et rappellent les habitudes des nomades: ils vivent, ils mangent même à cheval; chez eux, l'homme libre ne va jamais à pied. Sans aucun doute les Parthes, qui seuls de tous les peuples habitant ces régions ne sont pas nommés dans les livres sacrés des Perses, sont des intrus dans l'Iran proprement dit, où les Achéménides et les Mages se trouvaient chez eux. Le contraste qui existait entre les Iraniens et ce peuple victorieux sortie d'une contrée barbare et à demi étrangère, contraste qui ne disparut pas après les premières générations et dont les historiens romains aiment à nous parler, en s'inspirant des Perses, leurs voisins, a duré pendant tout l'empire des Arsacides; il a, pour ainsi dire, fermenté, jusqu'au moment où il a amené leur chute. Néanmoins, ce n'est pas encore une raison pour considérer le règne des Arsacides comme une époque de domination étrangère. Aucun privilège ne fut accordé aux Parthes de naissance ni à la région d'où ils étaient sortis. Il est vrai que la ville parthe d'Hékatompylos est appelée la résidence des Arsacides; mais le plus souvent ils passaient l'été à Ecbatane (Hamadan) ou encore à Rhagae, comme les Achéménides, et l'hiver, soit dans leur camp, près de Ctésiphon, comme nous l'avons déjà dit, soit à Babylone, sur la frontière occidentale de leur empire. Le tombeau de la famille royale resta dans la ville parthe de Nisée; mais plus tard les princes furent souvent ensevelis à Arbeles, en Assyrie. La région pauvre et lointaine, que les Parthes habitaient jadis, ne pouvait convenir aux Arsacides, surtout à ceux des derniers temps, pour y faire briller leur cour et pour entretenir des relations suivies avec les pays de l'Ouest. La Médie resta, comme sous les Achéménides, le centre de l'empire. Les Arsacides pouvaient bien être Scythes d'origine; mais on s'occupait plutôt de ce qu'ils voulaient être que de ce qu'ils étaient en réalité; eux-mêmes se considéraient et se donnaient comme les successeurs de Cyrus et de Darius. Jadis sept princes perses avaient chassé le faux Achéménide et rétabli la dynastie légitime en couronnant Darius; de même, disait-on, sept autres princes, après avoir détruit la domination étrangère des Macédoniens, avaient élevé sur le trône le roi Arsace. Pour compléter cette légende patriotique, on attribuait au premier Arsace une origine bactrienne et non scythe. Le costume et l'étiquette étaient à la cour des Arsacides les mêmes que sous les rois perses. Lorsque Mithridate Ier eut étendu son empire jusqu'au Tigre et jusqu'à l'Indus, ses successeurs changèrent leur simple titre de roi en celui de roi des rois, qu'avaient porté les Achéménides, et la calotte pointue des Scythes fut remplacée par la haute tiare ornée de perles; sur les monnaies, les rois parthes sont armés de l'arc comme Darius. L'aristocratie venue dans le pays en même temps que les Arsacides, et qui s'était déjà souvent alliée sans doute avec la noblesse indigène, adopta les moeurs, les habits, et en grande partie aussi les noms des Perses; dans l'armée parthe, qui lutta contre Crassus, les soldats, dit-on, portaient encore la chevelure inculte, à la mode des Scythes; mais le chef ressemblait à un Mède, avec ses cheveux séparés par le milieu et sa figure fardée. |
||||
171 av. J.C.-224 ap. J.C. |
La royautéRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'organisation politique, telle qu'elle avait été établie par Mithridate I, reproduisait, dans ses traits essentiels, celle des Achéménides. La famille du fondateur de la dynastie est entourée de tout l'éclat et revêtue du caractère sacré d'une royauté héréditaire de droit divin : son nom se transmet régulièrement à chacun de ses successeurs, et on lui rend des honneurs comme à une divinité; c'est pourquoi ses descendants s'appellent Fils de Dieu1, et même Frères du dieu Soleil et de la déesse Lune; comme aujourd'hui encore le chah de Perse. Enfin, verser le sang d'un membre de la famille royale, c'est commettre un sacrilège. Toute cette organisation se retrouve, à peine modifiée, à la cour des empereurs romains, qui l'ont peut-être empruntée en partie aux anciens souverains de la Perse. 1. Les vice-rois de la Perside sont toujours nommés Zag Alohin (du moins c'est à ces mots, vraisemblablement énoncés en perse dans la prononciation, que correspondent les caractères araméens), fils de Dieu (Mordtmann, Zeitschrift fur Numismatik, IV, p. 155 et sq.). A ce titre répond le nom de Ocot�tup que portent les grands-rois sur les monnaies grecques. On rencontre aussi le surnom de Dieu, comme au temps des Séleucides et des Sassanides. Nous ne savons pas encore pourquoi les Arsacides sont ornés d'un double diadème (Hérodien, VI, 2, 1). |
||||
171 av. J.C.-224 ap. J.C. |
MégistanesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteQuoique la dignité royale fût attachée à la naissance, il y avait cependant une sorte d'élection. Le nouveau roi, pour pouvoir monter sur le trône, devait appartenir à la fois au collège des Membres de la Maison royale et au Conseil des Prêtres; il est probable que ces deux collèges reconnaissaient par un acte quelconque le nouveau souverain. Parmi les Membres de la Maison royale, il faut comprendre non seulement les Arsacides eux-mêmes, mais les sept familles du temps des Achéménides, races princières qui, d'après l'ordre alors établi, étaient égales entre elles par la naissance et avaient libre entrée auprès du grand roi, et qui ont dû, sous les Arsacides, conserver les mêmes privilèges1. Ces familles possédaient en même temps certaines dignités de la cour à titre héréditaires1; par exemple, les Suren, - ce nom, comme celui d'Arsace, est à la fois un nom de personne et un titre, qui constituent la seconde famille après la maison royale, plaçaient chaque fois, comme maîtres de la couronne, la tiare sur la tête du nouvel Arsace. Mais, de même que les Arsacides étaient originaires de la Parthie, les Suren venaient de la Sakastane (Sedjistan); peut-être étaient-ils Saces, c'est-à-dire Scythes; de même aussi, les Karen sortaient de la Médie occidentale. Sous les Achéménides, au contraire, la haute aristocratie était purement de sang perse. 1. En Egypte, où le cérémonial de la cour, comme dans tous les états des Diadoques, rappelait l'étiquette établie par Alexandre, et par conséquent celle de l'empire perse, ce même titre semble avoir été personnel (Franz, Corp. insc. graec., III, p. 270). Il se peut qu'il en ait été de même à la cour des Arsacides. Chez les sujets grecs de l'empire parthe, le nom de psylotavas paraît désigner, dans le sens primitif et plus strict du mot, les membres des sept familles; il faut remarquer que les mots megistanes et satrapae sont souvent réunis (Sénèque, Ep. 21; Josèphe, XI, 3, 2; XX, 2, 3). Quand la cour des Perses était en deuil, le roi n'admettait pas les Mégistanes à sa table (Suétone, Gaius, 5); on peut en conclure qu'ils avaient le droit d'y paraître en temps ordinaire. En outre, le titre twv sportov oilwy se trouve chez les Arsaci des comme dans les cours d'Egypte et de Pont (Bull. de corr. hell., VII, p. 349). 2. Josèphe (Ant. Jud., XIV, 13, 7 = Bell. Jud., I, 13, 1) parle d'un échanson royal, qui était en même temps général en chef. De semblables dignitaires se rencontrent souvent dans les Etats des Diadoques. |
||||
247 av. J.C.-224 ap. J.C. |
Les SatrapesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'administration est entre les mains des vice-rois ou des satrapes; d'après les géographes romains du temps de Vespasien, l'empire parthe se compose de dix-huit royaumes. Quelques-unes de ces satrapies sont réservées aux princes du sang; ainsi, les deux provinces du Nord-Ouest, la Médie Atropatène (Aderbaidian) et l'Arménie, lorsqu'elle était au pouvoir des Parthes, semblent avoir été gouvernées habituellement par les plus proches parents du souverain régnant1. Immédiatement au-dessous des satrapes venaient le roi du pays d'Elymaïs ou de Suse, qui jouissait d'une puissance et d'une situation exceptionnelles, puis le roi de la Perside, berceau des Achéménides. La forme de gouvernement sinon exclusive, du moins dominante dans l'empire des Parthes, celle qui donnait un titre, était - conception différente de ce qu'on rencontre dans l'empire romain - la royauté vassale, les satrapies étant héréditaires, mais les satrapes devant obtenir la confirmation du Grand-Roi2. Suivant toute apparence, cette hiérarchie se continuait dans les fonctions inférieures : des princes, des chefs de tribus moins importants étaient subordonnés aux vice-rois, de la même façon que les vice-rois l'étaient au Grand-Roi3. Suivant toute apparence, cette hiérarchie se continuait dans les fonctions inférieures : des princes, des chefs de tribus moins importants étaient subordonnés aux vice-rois, de la même façon que les vice-rois l'étaient au Grand-Roi?. Ainsi, chez les Parthes, la puissance du souverain était limitée, en faveur de la haute aristocratie, qui possédait, par droit d'hérédité, l'administration des provinces. La masse de la population, ce qui convient bien à un tel état de choses, se composait d'esclaves ou d'hommes à moitié libres4: l'affranchissement n'était pas possible. Dans l'armée qui combattait contre Antoine, il ne devait y avoir que quatre cents hommes libres sur 50 000 soldats. Le plus puissant des vassaux d'Orodes, celui qui vainquit Crassus à la tête de l'armée parthe, entra en campagne avec un harem de 200 femmes et des bagages portés par 1 000 chameaux; lui-même fournissait 10 000 cavaliers, recrutés parmi ses clients et ses esclaves. Les Parthes n'ont jamais eu d'armée permanente; mais toujours, quand la guerre était déclarée, on appelait les princes vassaux, les feudataires placés sous leur dépendance et la grande masse des esclaves qui leur obéissaient. 1. Tacite, Ann., XV, 2, 31. D'après la préface d'Agathangélos (p. 109, ed. Langlois), sous les Arsacides, le prince le plus âgé et le plus vaillant était roi du pays tout entier: ses trois parents les plus proches étaient rois des Arméniens, des Indiens et des Massagètes; cette organisation est peut-être aussi la base de l'état parthe. Il est très vraisemblable que l'empire indo-parthe, lorsqu'il était uni au royaume central, était gouverné par un prince du sang. 2. C'est ce que pense Justin (XLI, 2, 2): proximus majestati regum praepositorum ordo est; ex hoc duces in bello, hoc in pace rectores habent. Le glossaire d'Hésychius nous a conservé le nom indigene: ?. Ammien (XXIII, 6, 14) appelle vitaxae (corriger vistaxae), id est magistri equitum et reges et satrapae, les commandants des regiones de Perse; mais il a maladroitement appliqué à toute l'Asie centrale ce qui est propre à la Perse (cf. Hermès, XVI, p. 613); d'ailleurs on peut tirer du nom de chef de la cavalerie la double conséquence que ces fonctionnaires, comme les gouverneurs romains, réunissaient en eux la suprématie militaire et l'autorité civile et que l'armée des Parthes se composait surtout de cavalerie. 3. C'est ce que nous apprend le titre de carparons tuv tpatuv donné à un certain Gotarzès dans l'inscription de Kermanchahan en Kurdistan (Corp. insc. graec., 4674). Il ne s'agit pas ici du roi des Arsacides qui porte ce nom, en tant que souverain; mais comme Olshausen le suppose (Monatsbericht der Berliner Akademie, 1878, p. 179), c'est peut-être la dignité qui lui fut conférée, lorsqu'il eut renoncé à l'autorité suprême (Tacite, Ann., XI, 9). 4. A une époque postérieure une troupe de cavaliers, dans l'armée des Parthes, est appelée troupe des hommes libres. (Josèphe, Ant. jud., XIV, 13, 5 = De Bell. jud., I, 13, 3.) |
||||
247 av. J.C.-224 |
Les villes grecques de l'empire partheRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'élément municipal ne manquait pas complètement dans l'organisation politique de l'empire parthe. Sans doute les plus considérables des agglomérations qui s'étaient formées spontanément en Orient n'étaient pas des villes; la résidence même des rois parthes, Ctésiphon, n'est qu'une bourgade auprès de la cité grecque voisine de Séleucie. Ces villages n'avaient pas de chef propre ni de conseil municipal; ils étaient administrés, comme les provinces, uniquement par des fonctionnaires royaux. Mais quelques-unes des institutions données au pays par les conquérants grecs avaient survécu sous la domination des Parthes. L'organisation municipale grecque s'était établie solidement, au temps d'Alexandre et de ses successeurs, dans la Mésopotamie et la Babylonie, provinces où vivait une population araméenne. La Mésopotamie était couverte de villes grecques; dans la Babylonie, Séleucie, sur le Tigre, qui avait succédé à l'antique Babylone, qui précéda Bagdad, et qui fut pendant longtemps la résidence des rois grecs de l'Asie, avait prospéré, grâce à sa situation, si favorable au commerce, et à ses fabriques; elle était devenue la première ville commerçante du monde non romain, avec plus d'un demi-million d'habitants. Son organisation de ville libre grecque, cause certaine de sa fortune, ne fut pas détruite par les rois parthes, qui ne firent en cela que suivre leurs intérêts. Séleucie non seulement conserva son conseil composé de 300 membres élus, mais encore elle garda, au milieu de l'Orient non grec, la langue et les moeurs grecques. Les Hellènes ne formaient, il est vrai, dans ces villes grecques, que l'élément dominant; à côté d'eux vivaient beaucoup de Syriens et un nombre presque aussi grand de Juifs s'ajoutait à ces deux premières nations. La population des villes grecques de l'empire parthe, comme celle d'Alexandrie, se composait donc de trois éléments divers juxtaposés. Comme à Alexandrie, des conflits éclataient souvent entre eux: par exemple, à l'époque de l'empereur Gaius, les trois nations en vinrent aux mains sous les yeux des rois parthes, et finalement les Juifs furent chassés de toutes les grandes villes. L'empire parthe forme un contraste absolu avec l'empire romain. Dans l'un la vice-royauté orientale n'existe qu'à l'état d'exception; dans l'autre la ville grecque est une rareté. Le caractère général d'aristocratie orientale, qui distingue l'état parthe, n'est pas effacé par les cités grecques commerçantes établies sur la frontière occidentale de ce royaume, pas plus que les royautés vassales de Cappadoce et d'Arménie n'influent sur la constitution en cités de l'empire romain. Sur le domaine des Césars l'organisation municipale gréco-romaine s'étend de plus en plus et devient le type de l'administration; lorsque les Parthes établissent leur domination en Orient, on cesse soudainement d'y fonder des villes, oeuvre caractéristique de la civilisation hellénico-romaine qui embrassait les cités commerçantes des Hellènes et les colonies militaires des Romains tout autant que les grandes créations d'Alexandre et de ses successeurs; d'autre part, les villes grecques, englobées dans l'empire parthe, tombent en décadence. Dans l'un et l'autre état, les exceptions deviennent de plus en plus rares. |
||||
247 av. J.C.-224 |
ReligionRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa religion de l'Iran, voisine du monothéisme, qui adorait �le plus grand des dieux, celui qui a créé le ciel, la terre, les hommes, et tout ce qu'il y a de bon pour eux�, religion sans images et surtout spiritualiste, sévère dans sa morale, âpre dans la recherche de la vérité, ayant une grande influence sur l'activité pratique et sur la vie quotidienne, frappé les esprits de ses initiés bien autrement et beaucoup plus vivement que les religions de l'Occident ne pouvaient le faire; ni Zeus ni Jupiter n'ont pu résister aux progrès de la civilisation; au contraire la foi des Perses est toujours restée jeune, ou se réfugia dans l'Inde en lui cédant la place. Nous n'avons pas à rechercher ici quel rapport avait l'ancien culte de Mazda, qui avait été pratiqué par les Achéménides, et dont l'origine remonte à l'époque préhistorique, avec la religion qui nous est présentée comme l'enseignement du sage Zarathoustra, par l'Avestâ, le livre sacré de la Perse, composé sans doute sous les derniers Achéménides; à l'époque où l'Occident entre en contact avec l'Orient, il n'y a d'intéressant que la dernière de ces deux croyances religieuses. Il est prouvé par les travaux les plus récents que l'Avestà aussi s'est formé, non pas dans l'Est de l'Iran, en Bactriane, mais plutôt dans la Médie. Le progrès religieux et le développement politique furent unis plus étroitement dans l'Iran que chez les Celtes mêmes. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, la royauté légitime était, dans cet empire, une institution religieuse; on croyait que le chef suprême du pays avait été revêtu de l'autorité royale par la plus puissante des divinités nationales; on le regardait lui-même presque comme un dieu. Sur les monnaies frappées dans la région est régulièrement représenté le grand autel du feu; au-dessus plane Ahoura Mazda, la divinité ailée; auprès se tient, dans une posture de suppliant, le roi, de taille plus petite; en face du roi, la bannière nationale. Suivant les mêmes principes, la puissance de la noblesse est liée dans l'état parthe à la situation privilégiée du clergé. Les prêtres de cette religion, les Mages, apparaissent déjà dans les documents qui remontent à l'époque des Achéménides, et dans les récits d'Hérodote; les Occidentaux les ont toujours considérés, avec raison sans doute, comme une institution nationale de la Perse. Le sacerdoce était héréditaire; en Médie au moins, et peut-être dans d'autres provinces, la caste des prêtres, comme les Lévites aux derniers temps d'Israël, formait une classe sociale importante. L'ancienne religion et le sacerdoce national subsistèrent sous la domination des Grecs. Lorsque Seleucus I voulut fonder la nouvelle capitale de son empire, cette ville de Séleucie dont nous avons déjà parlé, il fit déterminer par les Mages le jour et l'heure de la cérémonie; et ce ne fut qu'après que ces Perses eurent tiré, bien malgré eux, l'horoscope qu'on leur demandait, que Séleucus et son armée fixèrent, d'après leur réponse, le moment où l'on devait poser en grande pompe la première pierre de la nouvelle cité grecque. Les prêtres d'Ahoura Mazda étaient aussi appelés auprès du roi comme conseillers; c'étaient eux, et non les prêtres de l'Olympe hellénique que l'on consultait, lorsque les affaires publiques intéressaient la en fut de même à plus forte raison sous les Arsacides. Nous avons déjà dit que le collège des prêtres jouait, dans le choix du souverain, un rôle aussi important que le conseil des Nobles. Tiridate, roi d'Arménie, de la famille des Arsacides, vint à Rome, escorté par un grand nombre de Mages; c'est d'après leurs instructions qu'il voyageait et qu'il prenait ses repas, même en compagnie de l'empereur Néron, qui se fit exposer leurs doctrines par ces sages étrangers et leur demanda de conjurer les esprits devant lui. Il ne s'ensuit pas nécessairement que l'ordre des prêtres ait eu, en tant que caste sacerdotale, une influence décisive sur le gouvernement de l'Etat; mais, ce qui est certain, c'est que les Sassanides n'eurent pas à rétablir la religion de Mazda; malgré les changements de dynastie, malgré tous les progrès accomplis, les bases de la religion nationale ne se modifièrent pas dans l'Iran. |
||||
Devenez membre de Roma LatinaInscrivez-vous gratuitement et bénéficiez du synopsis, le résumé du portail, très pratique et utile; l'accès au forum qui vous permettra d'échanger avec des passionnés comme vous de l'histoire latine, des cours de latin et enfin à la boutique du portail ! 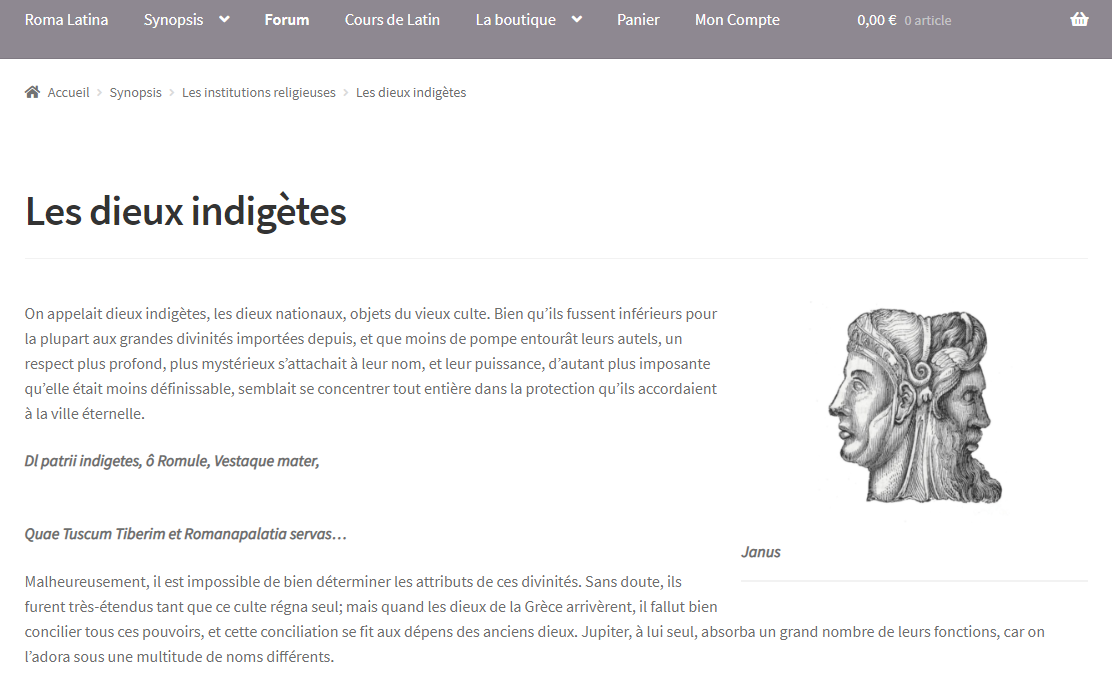 |
|||||
247 av. J.C.-224 |
La langueRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa langue nationale de l'empire parthe fut l'idiome indigène de l'Iran. Aucun document ne nous permet de croire qu'une langue étrangère soit devenue sous les Arsacides la langue officielle. Le dialecte iranien de la Babylonie et l'écriture particulière à cette province s'étaient développés, avant et pendant l'époque des Arsacides, sous l'influence de la langue et de l'écriture des peuples araméens, voisins du pays; ce sont eux sans doute que l'on a désignés, sous le nom de Pahlavi, c'est-à-dire Parthava, comme particuliers à l'empire parthe. Le grec même n'est pas devenu la langue officielle de cet Etat. Aucun de ses rois ne porte un nom grec, même comme surnom. Or, si les Arsacides avaient fait du grec leur idiome, les inscriptions grecques1 ne manqueraient pas dans leur empire. Sans doute, jusqu'à l'époque de Claude, on ne trouve sur les monnaies que des inscriptions grecques', et plus tard elles sont encore les plus nombreuses, mais ces monnaies ne présentent aucune trace de la religion nationale et paraissent avoir été frappées au même coin que les monnaies des provinces orientales de l'empire romain; la division et le comput des années se font encore suivant le système appliqué sous les Séleucides. Il faut en conclure que les Grands-Rois n'exerçaient pas eux-mêmes le droit de battre monnaie2; ces pièces, employées surtout dans les relations commerciales avec les voisins de l'occident, ont été frappées au nom des souverains du pays par les villes grecques. Le nom d'Ami des Grecs (pearv), que les Arsacides portent sur ces monnaies, est fort ancien3; il devient habituel à partir de Mithridate I, c'est-à-dire depuis le moment où l'Etat parthe s'est étendu jusqu'au Tigre. Cette épithète ne se comprend, que si les monnaies reflètent la pensée des villes grecques enclavées dans l'empire des Parthes. Peut-être la langue grecque a-t-elle joué, dans cet empire à côté de l'idiome perse, un rôle secondaire; semblable à celui qu'elle a joué dans l'empire romain, à côté du latin. Il est facile de suivre sur ces monnaies municipales la décadence progressive de l'hellénisme sous la domination des Parthes: la langue indigène apparait auprès de la langue grecque, et même se substitue à elle, et d'autre part le grec se corrompt de plus en plus4. 1. La plus ancienne monnaie connue, qui porte une inscription en pahlavi, date du règne de Claude, et a été frappée sous Volagasos I; elle est bilingue. En grec le roi porte son titre complet, mais il est simplement nommé Arsakes; en iranien il n'a que son nom personnel indigène en abré:gé : Vol. 2. D'habitude on n'admet ce fait que pour la d'argent, et l'on croit que la petite monnaie d'argent et la monnaie de cuivre étaient frappées par le roi. Cette théorie n'accorde au Grand-Roi qu'un rôle étrangement effacé dans le monnayage. Il est plus juste de penser que l'un des deux systèmes était appliqué pour l'exportation, et l'autre réservé aux relations intérieures; de cette façon l'on explique aussi les différences qui existent entre les deux espèces de monnaies. 3. Le premier roi auquel ce nom fut donné est Phraapatès, en 188 av. J.-C. (Percy Gardner, Parthian coinage, p. 27). 4. Par exemple, on lit sur les monnaies de Gotarzès, contemporain de Claude: ? Apia6�vou. Sur les pièces postérieures les inscriptions grecques sont souvent absolument inintelligibles. |
||||
247 av. J.C.-224 |
L'ArabieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes Parthes possédaient les deux côtes du golfe Persique, même celle d'Arabie; la navigation sur cette dernière leur appartenait donc complètement; quant au reste de la péninsule arabique, il n'était soumis ni aux Parthes ni aux Romains, maîtres de l'Egypte. |
||||
|
|
|||||
247 av. J.C.-224 |
Le pays de l'IndusRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl ne nous appartient pas de décrire les luttes que les peuples se sont livrées autour de la vallée de l'Indus et dans les pays qui la bornent à l'Ouest et à l'Est, si tant est que les lambeaux de tradition rendent possible un tel récit; mais nous devons raconter dans ses principaux traits cette série de guerres, qui se développent toujours parallèlement aux combats livrés dans la vallée de l'Euphrate; d'autant plus que la tradition ne nous permettant pas de suivre dans le détail les rapports de l'Iran avec l'Orient, lorsque cette contrée commença de jouer son rôle dans l'histoire de l'Occident, il semble nécessaire d'en indiquer au moins ici les grandes lignes. Peu de temps après la mort d'Alexandre le Grand, Séleucus, l'un de ses officiers et des héritiers de son empire, conclut avec le fondateur de l'empire indien, Tchandragoupta, en grec Sandrakottos, un traité qui fixa les limites entre l'Iran et l'Inde. D'après cette convention, Tchandragoupta régnait non seulement sur la vallée du Gange et sur l'Inde septentrionale tout entière, mais encore, dans la région de l'Indus, au moins sur une partie du cours supérieur du fleuve appelé aujourd'hui le Kaboul, sur l'Arachosie ou Afghanistan, peut-être aussi sur la Gedrosie désolée et aride, le Bélouchistan moderne : il possédait en outre le delta et les bouches de l'Indus. L'on a trouvé dans ce vaste territoire, et jusque dans les environs de Pichavar, les tables de pierre, sur lesquelles le petit-fils de Tchandragoupta, le fidèle adorateur de Bouddha, Asoka, fit graver le code de lois morales qu'il donna à son peuple1. L'Hindoukouch, le Parapanisos des Anciens, et les montagnes qui le prolongent vers l'Est et l'Ouest, séparaient donc l'Iran et l'Inde par leur chaîne puissante, que coupent seulement quelques cols peu nombreux. Mais ce traité ne dura pas longtemps. 1. Tandis que l'empire de Darius, d'après les inscriptions de ce prince, renferme la Gadara (la Gandhara des Indiens, la l'avoacitis des Grecs, près du fleuve Kaboul) et les Hidou (les habitants des bords de l'Indus), le premier de ces peuples est nommé, dans les inscriptions d'Asoka, parmi les sujets de ce roi, et un exemplaire de son grand édit a été trouvé à Kapourdi-Giri ou plutôt à Chahbaz-Garhi (district d'Youzoufzai), à six milles allemands (45 kilom.] au Nord-Ouest d'Attok, où le Kaboul se jette dans l'Indus. Dans cette province, située au Nord-Ouest de l'empire d'Asoka, le siège du gouvernement, d'après une inscription (Corp. insc. indic., I, p. 91), était Takkhasila, la Tecida des Grecs, environ à neuf milles allemands [67 kilom.] E.-S.-E. d'Attok; la capitale des provinces du Sud-Ouest était Oudjein (Osvn). La partie orientale de la vallée du Kaboul appartenait donc en tout cas à l'empire d'Asoka. Il n'est pas impossible que le col de Khaibar ait été la limite des deux états; mais alors il est probable que la vallée du Kaboul tout entière était rattachée à l'Inde, et que la frontière était formée, au Sud de ce fleuve, par la chaîne des monts Soliman, et plus au Sud-Ouest par le col de Bolan. Près de Vardak, non loin de Kaboul, dans la direction du Nord, on a trouvé une inscription du roi indo-scythe Houvichka (l'Ooerke des monnaies), qui régna fort tard et qui semble avoir résidé à Mathourâ, sur la Yamounâ (Communication d'Oldenberg). |
||||
247 av. J.C.-224 |
L'empire bactro-indienRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAu début du règne des Diadoques, l'empire de Bactres, détaché du royaume des Séleucides, avait rapidement prospéré; les souverains grecs de ce pays, franchissant les montagnes, avaient conquis une grande partie de la vallée de l'Indus et s'étaient peut-être solidement établis plus loin encore dans l'Inde antérieure, si bien que le centre de gravité de cet empire n'était plus à l'Ouest, dans l'Iran; il s'était transporté dans l'Inde, à l'Orient, et l'hellénisme avait été vaincu par l'élément indien. Les souverains de cet Etat s'appellent Indiens, et, plus tard même, leurs noms ne sont plus grecs; sur les monnaies, la langue et l'écriture nationales de l'Inde apparaissent à côté de la langue et de l'écriture grecques, comme le Pahlavi sur les pièces frappées par les Perso-Parthes. |
||||
|
|
|||||
247 av. J.C.-224 |
Les Indo-ScythesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteUne nation nouvelle entra bientôt dans la lice : les Scythes, ou, comme on les appelait dans l'Iran et dans l'Inde, les Saces, quittèrent les bords de l'Iaxarte, leur ancienne patrie, et passèrent les montagnes pour marcher vers le Sud. Ils conquirent au moins une grande partie de la Bactriane; pendant le dernier siècle de la république romaine, ils doivent s'être établis dans l'Afghanistan et le Bélouchistan modernes. Dans les premiers temps de l'empire, la côte asiatique voisine de Minnagara portait, sur les deux rives de l'Indus, le nom de Scythie; dans l'intérieur du pays, la contrée située à l'Ouest de Kandahar, la Drangiane, s'appela plus tard pays des Saces, Sakastanè, aujourd'hui le Sedjistan. Cette immigration des Scythes dans les provinces de l'empire bactro-indien a diminué l'étendue de cet Etat et lui a fait grand tort, de même que les premières invasions germaniques ont menacé l'existence de l'empire romain, mais sans le ruiner. Sous Vespasien, il existait encore très probablement un Etat bactrien indépendant1. 1. Le marchand égyptien, dont il fait mention dans la note 2 de la page suivante, parle (c. 47) du peuple guerrier des Bactriens, gouvernés par un roi qui leur est propre. La Bactriane était donc alors distincte de l'empire indien, sur lequel régnaient les princes parthes. De même Strabon (XI, 11, 1, p. 516) parle de l'empire bactro-indien comme d'un état disparu. |
||||
247 av. J.C.-224 |
Empire partho-indienRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteSous les dynasties julienne et claudienne, les Parthes semblent avoir été la puissance prépondérante aux bouches de l'Indus. Un historien digne de foi du siècle d'Auguste cite la Sakastane parmi les provinces parthes, et donne au roi des Saces-Scythes le titre de vice-roi des Arsacides; il désigne l'Arachosie comme la province la plus orientale de l'empire parthe, et lui donne pour capitale Alexandropolis, sans doute Kandahar. Peu de temps après, sous Vespasien, des princes parthes règnent à Minnagara. Pour l'empire situé sur les bords de l'Indus, c'était plutôt un changement de dynastie qu'une annexion proprement dite à l'Etat de Ctésiphon. Le roi parthe Gondopharos, qui, d'après la légende chrétienne, eut des rapports avec saint Thomas, l'apôtre des Parthes et des Indiens1, régnait sur le pays qui s'étend depuis Minnagara jusqu'à Pichavar et Kaboul; mais ces princes emploient, comme les souverains de l'empire indien, la langue de l'Inde à côté du grec, et se donnent le titre de Grands-Rois, comme les princes de Ctésiphon : ils semblent avoir été les rivaux des Arsacides, quoiqu'ils fussent de même famille qu'eux2. 1. C'est sans doute le Kaspar-Gothaspar d'après une tradition plus ancienne - qui figure parmi les trois rois mages venus de l'Orient (Gutschmid, Rhein. Mus., XIX, p. 162). 2. Le témoignage le plus précis que l'on ait de la domination des Parthes dans ces régions se trouve dans la description des côtes de la mer Rouge, faite au temps de Vespasien par un marchand d'Egypte (c. 38): Au-delà de l'embouchure de l'Indus, dans l'intérieur des terres, se trouve la capitale de la Scythie, Minnagara; mais cette ville est occupée par les Parthes qui se chassent continuellement les uns les autres. Ce même renseignement se retrouve au c. 41, en termes un peu confus. Il semble donc que Minnagara soit située dans l'Inde même, au-dessus de Barygaza; Ptolémée a été par là induit en erreur, mais l'auteur égyptien, qui ne connaît l'intérieur que par oui-dire, a voulu seulement faire savoir qu'une grande ville appelée Minnagara se trouvait dans le pays non loin de Barygaza, et que le coton venait en grande quantité de cette région. Le même négociant affirme que l'on trouve à Minnagara des traces nombreuses du passage d'Alexandre; cette assertion n'est peut-être vraie que des bords de l'Indus et non du Goudjerat. Ainsi la situation de Minnagara sur l'Indus inférieur, non loin d'Haiderabad, et l'existence d'un royaume parthe dans cette contrée sous Vespasien paraissent confirmées. On peut rapprocher de cette relation les monnaies du roi Gondopharos ou Hyndopherres qui, d'après les anciennes légendes chrétiennes, aurait été converti au christianisme par l'apôtre des Parthes et des Indiens, saint Thomas, et qui semble avoir été contemporain des premiers empereurs de Rome (Sallet, Num. Zeitschrift, VI, p. 355; Gutschmid, Rhein. Mus., XIX, p. 162); celles de son neveu Abdagasès (Sallet, loc. cit., p. 365), qui est peut-être le même que le roi parthe du même nom, cité par Tacite (Ann., VI, 26), mais qui en tout cas porte un nom parthe; enfin celles du roi Sanabaros, qui doit avoir régné peu de temps après Hyndopherrès, et qui peut avoir été son successeur. Beaucoup d'autres monnaies présentent aussi des noms parthes Arsakès, Pakoros, Vononès. Ce monnayage se rapproche incontestablement de celui des Arsacides (Sallet, loc. cit., p. 277): les pièces d'argent de Gondopharos et de Sanabaros - des autres rois nous n'avons que des pièces de cuivre ressemblent tout à fait aux drachmes des Arsacides. Suivant toute apparence, ces monnaies ont été frappées par les rois parthes de Minnagara; ce qui le confirme, c'est qu'elles portent des inscriptions indiennes à côté d'inscriptions grecques, comme celles des derniers Arsacides portent des légendes en pahlavi. Ce ne sont pas des monnaies de satrapes, mais, comme le négociant égyptien l'indique, de Grands-Rois rivaux du souverain de Ctésiphon. Hyndopherrès se donne, dans un grec tres corrompu, le nom de ? autozpatwo, et en très bon indien, de Maharadja Radjadi Radja. Si, comme il est probable, le Sanabaros des monnaies est le Mambaros ou l'Akabaros que le Périple (c. 41 et 52) appelle roi de la côte de Barygaza, il se trouve alors contemporain de Néron et de Vespasien; son royaume s'étendait au-delà des bouches de l'Indus jusqu'au Goudjerat. Une inscription trouvée près de Pichavar est attribuée au roi Gondopharos; si cela est vrai, le pouvoir de ce prince s'étendait jusque sur ce pays, probablement jusqu'au Kaboul. - En l'an 60, Corbulon fit passer par les côtes de la mer Rouge les ambassadeurs du peuple hyrcanien, qui avait abandonné les Parthes, afin de les soustraire aux coups de leurs ennemis; de là ils pouvaient regagner leur patrie, sans entrer sur le territoire parthe (Tacite, XV, 25); il résulte de ce fait que la vallée de l'Indus n'était pas alors soumise au prince de Ctésiphon. |
||||
247 av. J.C.-224 |
Royaume sace sur l'IndusRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugustePeu de temps après la chute de l'empire parthe, le royaume indien passa entre les mains de cette dynastie, que la tradition du pays appelle soit dynastie des Saces, soit dynastie du roi Kanerkou ou Kanichka; elle monta sur le trône en l'an 78 ap. J.-C., et elle y resta au moins jusqu'au IIIe siècle1. Les rois de cette dynastie appartiennent aux Scythes dont l'invasion a été signalée plus haut; leurs monnaies portent, au lieu de légendes indiennes, des légendes scythes2. Ainsi, dans les trois premiers siècles de notre ère, ce sont les Parthes et les Scythes qui ont été les maîtres de la vallée de l'Indus, après les Indiens et les Grecs. Mais, même sous les dynasties étrangères, les Indiens s'étaient donné une constitution politique nationale qu'ils surent garder, et les progrès de la puissance perso-parthe trouvaient à l'Est une barrière aussi solide que l'était à l'Ouest l'empire romain. 1. Il est fort probable, d'après les monnaies, que la puissance des Arsacides de Minnagara a disparu peu de temps après Néron. Mais on ne sait qui leur a succédé. Les rois bactro-indiens, qui portent un nom grec, sont la plupart, peut-être tous, antérieurs à Auguste; plusieurs princes de nom indigène, comme Manès et Azès, sont aussi plus anciens que cet empereur, si l'on se fie à la langue et à l'écriture (par exemple à la forme de l'w, 2). Au contraire les pièces des rois Kozulokadphisès et Ooemokadphisès et celles des rois saces, Kanerkou et ses successeurs, parmi lesquelles on rencontre constamment le statère d'or du poids de l'aureus romain, inconnu jusqu'à cette époque dans la monnaie indienne, ce qui est un indice caractéristique d'un monnayage unique, sont postérieurs, suivant toute apparence, à Gondopharos et à Sanabros. Elles prouvent que l'Etat de la vallée de l'Indus est devenu de plus en plus un royaume national en face des Grecs et des Iraniens. Le règne de ces deux Kadphisès doit donc se placer entre l'empire indo-parthe et la dynastie des rois saces, qui régna depuis l'an 78 ap. J.-C. (Oldenberg, dans la Zeitschr. fur Numismalik, VIII, p. 292). Les monnaies de ces rois saces, trouvées dans le trésor de Pichavar, portent, ce qui est fort curieux, des noms de divinités grecques corrompus, Hpaz:20, Laparo, à côté du dieu national Bovao. Les monnaies les plus récentes de cette dynastie montrent que l'on en revenait, pour le monnayage, au système des anciens Sassanides: elles doivent dater de la seconde moitié du troisième siècle (Sallet, Zeitschrift fur Numismatik, VI, p. 225). 2. Les rois indo-grecs, les princes indo-parthes, ainsi que les Kadphisès, emploient très souvent sur leurs monnaies la langue et l'écriture nationales de l'Inde, à côté de la langue et de l'écriture grecques; au contraire, les rois saces ne se sont jamais servis de l'idiome ni de l'alphabet indiens, mais ils font usage exclusivement des lettres grecques. Les légendes de leurs monnaies, qui ne sont pas grecques, sont certainement scythiques. Sur les pièces d'or de Kanerkou on trouve Bao!ae's?, ou encore?: les deux premiers mots doivent être la traduction scythique des termes indiens; les deux derniers sont le nom propre et le nom générique (Gouchana) du roi (Oldenberg, loc. cit., p. 294). Par conséquent les Saces furent dans l'Inde des maîtres étrangers dans un autre sens que les Parthes et que les Grecs de la Bactriane. Néanmoins les inscriptions qu'ils gravèrent dans l'Inde sont non pas scythiques, mais indiennes. |
||||
247 av. J.C.-224 |
Les Scythes d'AsieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteVers le Nord et le Nord-Est l'Iran confinait au pays de Touran. Le rivage occidental et méridional de la mer Caspienne et les hautes vallées de l'Oxus et de l'Iaxarte sont accessibles à la civilisation; mais la steppe qui entoure le lac d'Aral et l'immense plaine qui s'étend au-delà appartiennent de droit aux peuples errants. Parmi ces nomades il y avait sans doute quelques tribus apparentées aux Iraniens, mais elles ne participaient pas plus que les autres à la civilisation iranienne. Ce qui caractérise la situation que l'Iran a occupée dans l'histoire, c'est qu'il a été le rempart des peuples civilisés contre les hordes barbares Scythes, Saces, Huns, Mongols et Turcs, dont le seul rôle semble avoir été de détruire la civilisation. Bactres, le grand boulevard de l'Iran vis-à-vis le pays de Touran, gouvernée après Alexandre par des princes grecs, a été pendant une longue période une défense suffisante; mais nous avons déjà dit que, si cette ville ne fut pas détruite, elle ne put pas du moins s'opposer plus longtemps aux invasions des Scythes. Lorsque la puissance bactrienne fut tombée, cette tâche incomba aux Arsacides. Il est difficile de dire comment ils l'ont accomplie. Les Grands-Rois de Ctésiphon semblent, dans les premières années de l'empire romain, avoir repoussé les Scythes de l'Hindoukouch et les avoir refoulés dans les pays du Nord, ou bien les avoir soumis à leur autorité. Ils leur ont repris une partie de la Bactriane. Mais nous ne savons pas s'ils ont établi de ce côté des frontières durables ni quelles sont ces frontières. On parle souvent des guerres entre les Parthes et les Scythes. Ces derniers, qui habitaient les bords du lac d'Aral, ancêtres des modernes Turcomans, étaient d'habitude les agresseurs; tantôt ils traversaient la mer Caspienne pour envahir les vallées du Cyrus et de l'Araxe; tantôt ils sortaient de leurs steppes pour ravager les riches campagnes de l'Hyrcanie et l'oasis fertile de la Margiane (Merv). Les districts voisins de la frontière avaient consenti à racheter ces pillages arbitraires par des tributs qu'ils payaient régulièrement à des époques déterminées, comme aujourd'hui encore les Bédouins de Syrie lèvent sur les paysans de cette contrée l'impôt de la Koubba. Sous les premiers empereurs romains, au moins, le gouvernement des rois parthes ne pouvait donc pas, plus que la Porte ne le peut aujourd'hui, assurer à ses tranquilles sujets les fruits de leur travail ni établir sur la frontière une paix durable. Ces troubles étaient une plaie continuelle pour la puissance du royaume; ils ont eu souvent une grande importance dans les guerres de succession des Arsacides et dans leurs luttes avec Rome. |
||||
509 av. J.C.-224 |
La frontière romano-partheRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste
Nous avons raconté à sa place comment étaient nées les relations entre les Parthes et les Romains et comment avaient été fixées les frontières des deux grands empires. Tant que les Arméniens furent les rivaux des Parthes et que les rois du pays de l'Araxe prétendirent jouer dans l'Asie intérieure le rôle de Grands-Rois, les Parthes avaient entretenu des rapports en général pacifiques avec Rome, ennemie de ses adversaires. Mais, après la défaite de Mithridate et de Tigrane, les Romains, à cause surtout de l'organisation établie par Pompée, avaient pris une position difficilement compatible avec le maintien d'une paix sérieuse et durable entre les deux Etats. Au Sud la Syrie était toujours directement soumise à la domination romaine; les légions campaient au bord du grand désert qui sépare la côte de la vallée de l'Euphrate. Au Nord la Cappadoce et l'Arménie étaient des principautés dépendantes de Rome. Les peuplades qui habitaient au Nord de l'Arménie, Colchidiens, Ibériens, Albaniens, étaient nécessairement soustraites à l'influence parthe, et devenaient, aux yeux des Romains du moins, des peuples vassaux. La Petite-Médie ou Atropatène (Aderbaidian), qui bornait l'Arménie au Sud-Est et qui était séparée d'elle par l'Araxe, avait déjà affirmé sa nationalité vis-à-vis des Séleucides, en relevant son antique dynastie nationale qui remontait jusqu'au temps des Achéménides, et reconquis son indépendance. Sous les Arsacides, le roi de ce pays apparait, suivant les circonstances, tantôt comme un feudataire des Parthes, tantôt comme un prince indépendant, soutenu par les Romains. Ainsi l'influence romaine s'étendait jusqu'au Caucase et jusqu'à la côte occidentale de la mer Caspienne. Elle empiétait en réalité sur les limites fixées par l'état ethnographique du pays. L'hellénisme avait pris pied si solidement sur le rivage méridional de la mer Noire et dans l'intérieur de la contrée, en Cappadoce et en Commagène, qu'il arrêta sur ce point les progrès de la puissance romaine; mais l'Arménie est toujours restée, même sous la longue domination de Rome, un pays non grec, rattaché à l'Etat parthe par des liens indestructibles, par la communauté de langue et de religion, par les nombreux mariages qui unissaient les noblesses des deux contrées, par l'habillement et par l'armement1. Les Romains n'ont jamais levé de troupes ni perçu d'impôts en Arménie; tout au plus le pays devait-il suffire à l'équipement des soldats indigènes, et à leur entretien ou à celui des troupes romaines campées dans la région. Les négociants arméniens faisaient le commerce avec les Scythes au-delà du Caucase, avec l'Asie orientale et la Chine au-delà de la mer Caspienne, avec Babylone et l'Inde par le Tigre, avec la Cappadoce du côté de l'Ouest; rien n'aurait été donc plus utile que d'établir dans ce pays politiquement soumis les douanes et les impôts romains et pourtant l'on n'y est jamais parvenu. La situation politique de l'Arménie était en désaccord avec sa nationalité; c'est un point capital pour l'histoire des conflits qui éclatèrent pendant toute la durée de l'empire entre Rome et son voisin oriental. Les Romains reconnaissaient qu'en s'avançant au-delà de l'Euphrate, ils empiétaient sur le territoire ethnographique des peuples orientaux et qu'en réalité leur puisance n'y gagnait rien; pourtant ils empiétaient toujours. La raison, ou plutôt l'excuse de leur conduite, c'est que les Romains et l'antiquité tout entière, pourrait-on dire, ne comprenaient pas l'existence de deux Etats voisins aussi forts l'un que l'autre. L'empire romain ne connaissait comme frontière proprement dite que la mer ou les pays sans défense. Il enviait sa puissance au royaume des Parthes, plus faible que lui, mais pourtant assez considérable; il voulait la lui enlever, alors que les Parthes n'étaient pas disposés à l'abandonner; aussi les rapports entre Rome et l'Iran sous les empereurs n'ont-ils été qu'une suite de guerres sur la rive gauche de l'Euphrate, interrompues seulement par quelques suspensions d'armes. 1. Arrien, qui fut gouverneur de la Cappadoce, et qui à ce titre commanda aussi les Arméniens (Contra Alan., 29), nomme toujours ensemble les Parthes et les Arméniens (Tact., 4, 3; 44, 1, à propos de la cavalerie pesante, des , et à propos de la cavalerie légère, des ; 35, 7, à propos des hauts de chausses); et, lorsqu'il rappelle qu'Hadrien a enrôlé des cavaliers barbares dans l'armée romaine, il parle des gardes à cheval organisés sur le modèle des Parthes ou Arméniens. |
||||
54-49 av. J.C. |
Les Parthes pendant les guerres civilesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes traités signés avec les Parthes par Lucullus et Pompée reconnaissaient l'Euphrate comme frontière; ils laissaient donc la Mésopotamie aux rois de Ctésiphon. Les Romains n'en imposèrent pas moins leur protection aux princes d'Edesse; ils reculèrent vers le Sud les limites de l'Arménie, et prétendirent par là exercer une domination au moins indirecte sur une grande partie de la Mésopotamie septentrionale. Au bout de quelque temps les rois parthes commencèrent la lutte contre Rome en déclarant la guerre aux Arméniens. Pour répondre à cette attaque, Crassus entreprit son expédition; il fut écrasé près de Karrhae, et l'Arménie fut de nouveau soumise à l'autorité des Parthes, qui affirmèrent encore une fois leurs prétentions sur la partie occidentale de l'empire des Séleucides; ils ne réussirent pas, il est vrai, dans leur tentative. Pendant les douze années que dura la guerre civile, dont le résultat fut la chute de la République romaine et l'établissement définitif du principat, la lutte ne cessa pas entre les Romains et les Parthes, et de nombreux combats furent livrés. Avant la bataille de Pharsale, Pompée avait tenté de gagner à sa cause le roi Orodes; mais, comme celui-ci réclamait la cession de la Syrie, Pompée ne voulut pas abandonner une province qu'il avait lui-même donnée à Rome. Après sa défaite, il semblait prêt à subir cette humiliation, quand les péripéties de sa fuite le portèrent en Egypte où il trouva la mort, au lieu de le conduire en Syrie. On crut que les Parthes allaient encore envahir cette province, et les derniers chefs des républicains ne dédaignèrent pas l'assistance d'un ennemi national. Du vivant même de César, Caecilius Bassus, levant en Syrie l'étendard de la révolte, appela les Parthes à son aide. Ils répondirent à son appel; Pakoros, fils d'Orodes, battit le gouverneur envoyé par César, et délivra les troupes de Bassus assiégées dans Apamée (709). Pour se venger et aussi pour prendre la revanche de Karrhae, César voulait se rendre lui-même en Syrie et franchir l'Euphrate, au printemps de l'année suivante; mais la mort l'empêcha d'exécuter ses projets. Lorsque Cassius arma en Syrie, il s'allia avec le roi des Parthes; à la bataille décisive de Philippes, des cavaliers parthes combattirent pour la liberté de Rome. Les républicains furent vaincus, et le Grand-Roi ne fit aucun mouvement. Antoine avait formé le projet de mettre à exécution les plans du dictateur; mais il dut d'abord organiser les provinces d'Orient. |
||||
27 av. J.C.-14 |
Les Parthes en Syrie et en Asie MineureRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe conflit était néanmoins inévitable; cette fois l'agresseur fut le roi des Parthes. En 713 de Rome, tandis qu'Octave combattait en Italie les généraux et l'épouse d'Antoine, resté inactif aux pieds de la reine d'Egypte, Cléopâtre, Orodès céda aux sollicitations d'un Romain exilé, qui vivait près de lui, Quintus Labienus, fils de Titus Labienus, l'adversaire acharné du dictateur, et lui-même ancien officier, dans l'armée de Brutus; il l'envoya avec son fils Pakoros et une forte armée au-delà de la frontière. Le gouverneur de la Syrie, Decidius Saxa, fut surpris et succomba; les garnisons romaines, formées pour la plupart de soldats qui avaient servi dans l'armée des républicains, se rangèrent sous les ordres de leur ancien officier; Apamée, Antioche, et avec elles presque toutes les villes de la Syrie se soumirent, sauf Tyr, bâtie dans une île et dont on ne pouvait s'emparer qu'avec une flotte. Saxa, qui s'était enfui vers la Cilicie, se donna la mort pour ne pas être fait prisonnier. Après avoir conquis la Syrie, les deux généraux parthes se séparèrent; Pakoros marcha vers la Palestine, Labienus vers la province d'Asie. Là encore toutes les villes firent leur soumission, ou plutôt cédèrent à la force, excepté Stratonicée de Carie. Antoine, occupé des événements d'Italie, n'envoya aucun secours aux gouverneurs de ses provinces; pendant près de deux ans, depuis la fin de 713 jusqu'au printemps de 715, la Syrie et une grande partie de l'Asie Mineure furent occupées par les chefs parthes, et par l'imperator républicain Labienus, - le Parthique, comme il s'appelait lui-même avec une ironie impudente, Romain qui s'alliait aux Parthes pour vaincre ses compatriotes, au lieu de vaincre les Parthes dans les rangs de l'armée romaine. |
||||
39 av. J.C. |
Expulsion des Parthes par Ventidius BassusRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLorsque la guerre, qui menaçait d'éclater entre les deux maîtres du monde romain, eut été conjurée, Antoine envoya une nouvelle armée, sous le commandement de Publius Ventidius Bassus, auquel il donna l'autorité suprême dans les provinces d'Asie et de Syrie. Cet habile général atteignit en Asie Labienus, isolé avec ses troupes romaines, et l'en chassa rapidement. A la limite de l'Asie et de la Cilicie, dans les passes du Taurus, un détachement de Parthes voulut soutenir ses alliés en déroute; il fut battu lui aussi, avant que Labienus eût pu le rejoindre. Ce dernier fut pris et mis à mort, tandis qu'il fuyait vers la Cilicie. Ventidius franchit avec autant de succès les passes de l'Amanos, sur les frontières de la Cilicie et de la Syrie; c'est là que tomba Pharnapatès, le meilleur des généraux parthes (715). Les ennemis étaient donc chassés de la Syrie. L'année suivante, Pakoros franchit encore une fois l'Euphrate; mais ce fut pour être tué avec la plus grande partie de ses troupes dans une bataille décisive qui se livra près de Gindaros, au Nord-Est d'Antioche (9 juin 716). Cette victoire, qui effaçait en quelque sorte la défaite de Karrhae, eut des conséquences durables; de longtemps les Parthes ne conduisirent plus leurs armées sur la rive romaine de l'Euphrate. |
||||
44-30 av. J.C. |
Situation d'AntoineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteS'il était utile pour Rome d'étendre ses conquêtes à l'Est, et de reconstituer entièrement à son profit l'héritage d'Alexandre le Grand, jamais la situation ne fut plus favorable qu'en l'année 716. Les relations des deux maîtres du pouvoir étaient redevenues pacifiques; Octave lui-même désirait sans doute que son collègue et nouveau beau-frère fit en Orient une guerre sérieuse et prospère. La défaite de Gindaros avait provoqué chez les Parthes une crise dynastique violente. Le roi Orodes, profondément affecté par la mort du plus âgé et du plus vaillant de ses fils, avait abdiqué en faveur du cadet Phraatès. Celui-ci, pour affermir son trône, régnait par la terreur: il avait fait massacrer ses nombreux frères et son père lui-même, ainsi que beaucoup des nobles les plus considérables du royaume; d'autres s'étaient enfuis et avaient cherché un refuge auprès des Romains, comme Monaesès, personnage puissant et influent. Jamais Rome n'eut en Orient une armée aussi forte ni aussi aguerrie; Antoine pouvait conduire au-delà de l'Euphrate seize légions, c'est-à-dire environ soixante-dix mille hommes d'infanterie romaine, quarante mille auxiliaires, dix mille cavaliers espagnols et gaulois, et six mille cavaliers arméniens. La moitié au moins de ces soldats étaient des vétérans venus de l'Occident; tous étaient dévoués au chef qu'ils aimaient et qu'ils respectaient, au vainqueur de Philippes; ils étaient prêts à le suivre partout, et à couronner par de nouveaux succès obtenus sous son commandement les brillantes victoires qu'ils avaient remportées sur les Parthes, sinon avec lui, du moins pour lui. |
||||
36 av. J.C. |
Projets d'AntoineRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteEn réalité, le but d'Antoine était de reconstituer un grand empire asiatique, semblable à celui d'Alexandre. Avant d'entrer en campagne, Crassus avait proclamé qu'il étendrait la domination romaine jusqu'à la Bactriane et à l'Inde et Antoine donnait le nom d'Alexandre au premier fils qu'il avait de la reine d'Egypte. Il semblait décidé, d'une part, à diviser en principautés dépendantes tous les pays de l'Orient qui n'étaient pas soumis à de petits princes vassaux, sauf les provinces de Bithynie et d'Asie complètement hellénisées; d'autre part, à établir sa propre autorité sur toutes les contrées orientales qu'avaient possédées les Occidentaux, en les organisant comme des satrapies. Dans l'Est de l'Asie Mineure le plus beau morceau fut donné, ainsi que la suprématie militaire, au prince le plus belliqueux du pays, le Galate Amyntas. Les rois voisins furent: les princes de Paphlagonie, héritiers de Dejotarus, qui avaient subi le joug de la Galatie; Polémon, le nouveau roi de Pont, et le mari d'une petite-fille d'Antoine, Pythodoris; enfin les anciens rois de Cappadoce et de Commagène. Antoine réunit à l'Egypte une grande partie de la Cilicie et de la Syrie, ainsi que Chypre et Cyrène; il rendit à cet Etat les frontières qu'il avait eues sous les Ptolémée; après avoir fait de la reine Cléopâtre, qui avait été la maîtresse de César, une de ses femmes ou plutôt sa femme, il donna au bâtard de César, Césarion1, avec lequel il avait déjà partagé la royauté de l'Egypte2, l'expectative de l'ancien empire des Lagides; à son propre bâtard, Ptolémée Philadelphe, celle de la Syrie. Un autre fils, qu'Antoine avait eu de Cléopâtre et dont nous avons déjà parlé, Alexandre, reçut le gouvernement de l'Arménie, en attendant l'empire d'Orient qui lui était destiné. Antoine rêvait d'unir la domination de l'Occident à cette royauté organisée sur le modèle des états orientaux ?. Lui-même n'a pas porté le nom de roi; vis-à-vis de ses compatriotes et de ses soldats, il s'est donné seulement les mêmes titres qu'Octave; mais sur les monnaies officielles à légendes latines, Cléopâtre est appelée Reine des Rois et les fils qu'elle a eus d'Antoine Rois. La tête de son fils aîné se voit auprès de celle du père, comme si la filiation se comprenait d'elle-même; le mariage, l'ordre de succession des enfants légitimes et des enfants naturels furent traités par Antoine suivant l'usage des Grands-Rois de l'Orient, ou, comme il le disait lui-même, avec la désinvolture divine de son ancêtre Hercule3. Le jeune Alexandre reçut le nom d'Hélios, sa soeur jumelle Cléopâtre, celui de Séléné. Antoine imitait ainsi les souverains orientaux; et comme Artaxerxès qui avait donné à Thémistocle exilé plusieurs villes d'Asie, Antoine accorda trois villes de Syrie au Parthe Monaesés, qui s'était réfugié près de lui. Alexandre lui aussi était une sorte de mélange où s'étaient confondus le roi de Macédoine et le Roi des Rois de l'Orient; lui aussi, après avoir couché sous la tente à Gaugamele, avait trouvé comme récompense à Suse le lit d'une fiancée. Mais le Romain qui voulut en reproduire en lui la copie exacte n'arriva guère qu'à en être la caricature. 1. Le batard de Cesar, ? (telles sont les dénominations royales qu'il porte Corp. insc. graec., 4717), fut appelé à partager le trône d'Egypte dans la vingt-neuvième année égyptienne (août de l'an 711/2, suivant le comput des années en Egypte: Wescher, Bulleit. dell. Inst., 1866, p. 199; Krall, Wiener Studien, V, p. 313). Comme il prenait la place de Ptolémée le jeune, frère et mari de sa mère, il faut que Cléopâtre, au sujet de qui on n'a pas de détails précis, ait d'abord écarté celui-ci, ce qui permit de faire proclamer Césarion roi d'Egypte. De même Dion (XLVII, 31) place cet événement pendant l'été de l'année 712, avant la bataille de Philippes. Cet acte n'est donc pas l'oeuvre d'Antoine, mais l'oeuvre commune des deux maîtres du monde, accomplie à une époque où il leur était utile de flatter la reine d'Egypte, qui avait pris leur parti dès le début de la guerre civile. 2. C'est ce que pense Auguste, lorsqu'il dit qu'il a rattaché à l'empire les provinces de l'Orient presque toutes soumises à des rois (Mon. Ancyr., V, 41: Provincias omnis, quae trans Hadrianum mare vergunt ad Orientem, Cyrenasque, jam ex parte magna regibus eas possidentibus... reciperavi).
3. La décence qui caractérise Auguste, autant que l'impudeur caractérise son collègue, ne se démentit même pas dans cette circonstance: non seulement Césarion, que le dictateur lui-même avait reconnu, ne fut jamais officiellement considéré comme le fils de César, mais les enfants d'Antoine et de Cléopâtre, dont il était difficile de nier l'origine, furent considérés comme des membres de la famille impériale, sans cependant être formellement reconnus pour fils d'Antoine. Au contraire, le fils de la fille d'Antoine et de Cléopâtre, qui fut plus tard roi de Maurétanie, Ptolémée, est appelée petit-fils de Ptolémée dans une inscription athénienne (Corp. insc. att., 555); les mots ? ne peuvent pas être autrement interpretés. C'est à Rome que l'on imagina de remplacer l'aïeul réel par l'aïeul maternel. O. Hirschfeld propose de traduire exyovos par arrière-petit-fils; on remonterait ainsi jusqu'à l'arrière-grand-père maternel. Mais le résultat n'est nullement modifié, car si l'on ne s'arrête pas au grand-père, c'est que, en droit, la mère de Ptolémée n'a pas de père. Qu'on ait voulu, comme je le crois, désigner un Ptolémée réel et prolonger par une fiction la vie du dernier Lagide mort en 712, ou qu'on se soit contenté de supposer un père imaginaire, peu importe; ce qu'il y a de certain, c'est que l'on donna au fils de la fille d'Antoine le nom d'un grand-père fictif. Si les enfants des Lagides eurent toujours le pas sur les descendants de Massinissa, ce fut peut-être parce qu'on les rattachait à la famille impériale, qui ne reniait pas ses bâtards, et non parce que leurs ancêtres étaient des Hellènes. |
||||
36 av. J.C. |
Préparatifs de la guerre contre les ParthesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteIl est difficile de dire si Antoine conçut tous ses projets, dès qu'il fut devenu gouverneur de l'Orient. C'est peu à peu sans doute que mûrit en lui l'idée de créer un nouvel empire d'Orient et de l'unir à la domination de l'Occident; cette pensée ne fut complètement développée qu'en l'année 717, lorsqu'il revint d'Italie en Asie, et lorsqu'il contracta avec la dernière reine de la famille des Lagides des liens qu'il ne devait plus rompre. Cependant une pareille entreprise était au-dessus de ses forces. Il lui manquait quelques-unes de ces qualités militaires qui se révèlent en face de l'ennemi et surtout dans les circonstances difficiles : la volonté de l'homme d'Etat, la sûreté du coup d'oeil, et la persévérance à poursuivre le but politique. Si le dictateur César lui avait ordonné de soumettre l'Orient, il aurait accompli cette tâche; mais le bon général ne fait pas le roi. Lorsque les Parthes eurent été chassés de la Syrie, Antoine laissa s'écouler deux ans (de l'été 716 à l'été 718), sans avancer d'un pas vers le but qu'il s'était fixé. Il voyait à regret ses lieutenants remporter d'éclatants succès; aussi rappela-t-il le vainqueur de Labienus et de Pakoros, le brave Ventidius, après ses dernières victoires et se mit-il lui-même à la tête de ses troupes, poussé par l'ambition mesquine de prendre Samosate, la capitale de la Commagène, petit état vassal de la Syrie; il échoua dans son entreprise et quitta l'Orient de fort mauvaise humeur, pour aller régler en Italie avec son beau-frère l'organisation future du monde romain, ou pour jouir de la vie avec sa jeune épouse Octavie. Ses lieutenants n'étaient pas inactifs en Orient. Publius Canidius Crassus s'avançait de l'Arménie jusqu'au Caucase, pour réduire Pharnabaze, roi des Ibériens, et Zober, roi des Albaniens. Gaius Sossius prenait en Syrie Arados, la dernière ville qui fût encore occupée par les Parthes; en Judée il rétablissait Hérode sur le trône et faisait mettre à mort le prétendant que soutenaient les Parthes, l'Hasmonéen Antigone. Les conséquences de cette victoire furent considérables pour Rome : sa domination fut reconnue jusqu'à la mer Caspienne et jusqu'au désert de Syrie. Mais Antoine s'était réservé l'honneur de commencer la guerre contre les Parthes et il ne venait pas. |
||||
36-35 av. J.C. |
Guerre d'Antoine contre les ParthesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLorsqu'en l'année 718, il put enfin s'arracher des bras non d'Octavie mais de Cléopâtre, lorsqu'il se mit en marche avec ses troupes, la saison favorable était en grande partie passée. Mais ce retard est encore moins surprenant que la direction prise par Antoine. Dans toutes les guerres offensives que les Romains avaient déjà faites, dans toutes celles qu'ils firent plus tard aux Parthes, ils marchèrent sur Ctésiphon, la capitale de leurs ennemis; cette ville, située près de la frontière occidentale de l'empire parthe, était le but naturel et immédiat de toute armée qui descendait l'Euphrate ou le Tigre. Antoine, après avoir traversé la Mésopotamie septentrionale et suivi à peu près le même chemin qu'Alexandre pour gagner le Tigre, pouvait, en longeant le fleuve, se diriger aussi sur Ctésiphon et Séleucie. Au lieu de prendre ce chemin, il s'enfonça dans le Nord du côté de l'Arménie; là il réunit toutes ses forces, leur ajouta la cavalerie arménienne, et s'avança sur le plateau de la Médie Atropatène (Aderbaidian). Le roi d'Arménie, son allié, accueillit avec faveur ce plan de campagne, car, de tout temps, les princes arméniens avaient convoité cette province voisine, et le roi Artavazdès espérait peut-être dépouiller son homonyme, le satrape d'Atropatène, et lui prendre son territoire. Mais il est impossible qu'Antoine ait été déterminé par les mêmes raisons. Il comptait sans doute pénétrer par l'Atropatène au coeur du pays ennemi, et atteindre les anciennes résidences des rois perses, Ecbatane et Rhagae. Cependant, si tels étaient ses projets, il fallait qu'il ignorât absolument les difficultés du terrain, qu'il dédaignât par trop la force défensive de son adversaire, qu'il oubliât qu'il avait entrepris son expédition beaucoup trop tard et que la saison avancée lui laissait peu de temps pour conduire les opérations militaires dans cette région montagneuse; or, un officier habile et plein d'expérience, comme l'était Antoine, ne pouvait se tromper aussi grossièrement. Ce sont donc probablement des considérations politiques qui l'ont engagé dans cette voie. Le trône de Phraatès chancelait, nous l'avons déjà dit; Monaesès, qu'Antoine croyait fidèle, et qu'il espérait peut-être mettre à la place de Phraatès, était retourné dans sa patrie sur la demande du roi des Parthes1; Antoine pensait sans doute qu'il se révolterait contre le prince; et c'est pour profiter de cette guerre civile attendue par lui qu'il avait conduit son armée au coeur des provinces parthes. Il aurait pu cependant rester dans l'Arménie, pays allié, jusqu'au moment où ce plan aurait été exécuté; puis, s'il avait été nécessaire de continuer la campagne, il l'aurait fait pendant l'été de l'année suivante; mais une pareille lenteur déplaisait à l'impatient général. Dans l'Atropatène il se heurta à la résistance opiniâtre du puissant vice-roi, souverain presque indépendant, qu'il assiégea dans sa capitale Praaspa ou Phraata (au Sud du lac d'Ourmia, probablement sur le cours supérieur du Djaghatou), et qui soutint l'attaque avec courage; en outre, la présence des ennemis rendit aux Parthes, semble-t-il, la paix intérieure. Phraatès conduisit une armée puissante au secours de la ville menacée. Antoine avait amené avec lui un grand appareil de siège; mais, dans sa hâte, il l'avait laissé en arrière sous la protection de deux légions, commandées par le légat Oppius Statianus. Le siège de Praaspa l'empêcha de poursuivre sa marche en avant. Alors le roi Phraates envoya ses cavaliers attaquer, sous la conduite de Monaesès, l'arrière-garde des ennemis, le corps de Statianus qui avançait péniblement. Les Parthes écrasèrent l'escorte, tuèrent son chef, firent prisonniers les autres soldats, et détruisirent tout l'appareil de siège, que portaient 300 voitures. C'était l'échec de l'expédition. Cependant le roi d'Arménie, doutant du succès de la campagne, ramena ses troupes en arrière et regagna son royaume. Antoine ne leva pas le siège de Praaspa; il défit même l'armée royale dans une bataille rangée; mais les rapides cavaliers s'échappèrent sans éprouver de pertes sensibles, et cette victoire n'eut aucun résultat. On essaya, mais en vain, d'obtenir du roi Phraatès la restitution des aigles romaines prises à Crassus et à Statianus, et de traiter sinon avec avantage, du moins honorablement; le Parthe ne voulut pas renoncer pour si peu à un succès assuré. Il affirma seulement aux envoyés d'Antoine qu'il laisserait les Romains retourner dans leur pays, s'ils levaient le siège de Praaspa. Cette promesse faite par un ennemi peu loyal, et presque déshonorante pour les Romains, ne pouvait guère décider Antoine à battre en retraite. Il lui restait de prendre ses quartiers d'hiver en pays ennemi; les troupes parthes n'avaient pas l'habitude de fournir un long service militaire, et selon toute prévision, la plupart des soldats allaient rentrer dans leurs foyers au commencement de l'hiver. Mais l'armée romaine manquait d'appui solide; les subsistances n'étaient pas assurées dans cette région épuisée, et surtout Antoine n'était pas capable de diriger une guerre aussi rude. Il abandonna donc ses machines, que les assiégés brûlèrent aussitôt, et il commença trop vite, ou trop tard, une retraite difficile. Quinze jours de marche (300 milles romains) à travers un pays ennemi séparaient l'armée du fleuve Araxès, frontière de l'Arménie, sur laquelle Antoine était forcé de se diriger, malgré l'attitude équivoque du roi. Oubliant leur promesse, les Parthes lancèrent 40000 cavaliers sur les troupes romaines, qui avaient perdu, lors de la défection des Arméniens, la meilleure partie de leur cavalerie. Les subsistances et les bêtes de somme suffisaient à peine; la saison était très avancée. Mais, dans cette situation périlleuse, Antoine retrouva ses forces, ses talents militaires, et même un peu de son bonheur; il avait pris sa résolution; général et troupes firent vaillamment leur devoir. Si les Romains n'avaient pas eu avec eux un ancien soldat de Crassus, qui, devenu Parthe, connaissait très bien les routes et les sentiers et qui, au lieu de les conduire par les plaines qu'ils avaient parcourues en venant, leur fit traverser les montagnes, où les cavaliers parthes pouvaient moins facilement les attaquer, - les montagnes de Tabriz, semble-t-il, - l'armée n'aurait probablement pas atteint son but; Monaesés, pour payer à sa manière la dette de reconnaissance qu'il avait contractée envers Antoine, ne l'aurait pas averti à temps des fausses promesses et des desseins cachés de ses compatriotes; et les Romains seraient tombés dans quelqu'une des nombreuses embuscades qu'on leur tendit. Le génie guerrier d'Antoine se révéla brillamment à plusieurs reprises dans ces jours difficiles; il sut profiter avec habileté des circonstances favorables; il fut sévère pour les lâches, il reconquit son influence sur les soldats, il fut plein de sollicitude pour les blessés et pour les malades. Le salut fut pourtant presque un miracle; déjà Antoine avait recommandé à son plus fidèle serviteur de ne pas le laisser tomber vivant entre les mains de l'ennemi, si la situation devenait désespérée. Continuellement attaqués par un adversaire perfide, les Romains, éprouvés par un hiver glacial, menacés par la famine et souvent privés d'eau, atteignirent au bout de vingt-sept jours la frontière protectrice, où la poursuite prit fin. Les pertes étaient énormes; pendant ces vingt-sept jours dix-huit grandes batailles furent livrées; dans l'une d'elles on compta 3000 Romains tués et 5000 blessés. C'étaient les meilleurs et les plus braves soldats qui succombaient à l'arrière-garde et sur les flancs. Tous les bagages, un tiers du train, un quart de l'armée, 20000 fantassins et 4000 cavaliers périrent dans cette guerre médique, beaucoup moins par l'épée que par la faim et les maladies. Arrivée à l'Araxés, cette malencontreuse armée n'en avait pas fini avec les souffrances. Artavazdes reçut les Romains en ami; il ne lui était guère possible d'agir autrement. Antoine aurait pu passer l'hiver en Arménie, mais il était trop impatient; il reprit sa marche; la saison devenait de plus en plus rude; la santé des soldats s'affaiblissait; cette dernière partie de l'expédition, depuis l'Araxes jusqu'à Antioche, coûta encore, malgré l'absence de tout ennemi, 8000 hommes. Dans cette campagne on vit briller un dernier reflet de la bravoure et de l'habileté d'Antoine; mais, politiquement, ce fut une défaite pour lui, d'autant plus qu'à la même époque Octave terminait heureusement la guerre de Sicile et obtenait pour toujours, en même temps que l'empire d'Occident, la confiance des Italiens. 1. Antoine, on peut le croire, cacha ses projets à Phraates le plus longtemps possible; lorsque Monaesés fut retourné auprès de son souverain, le triumvir se déclara prêt à traiter, en prenant comme base de la paix la restitution des étendards perdus (Plutarque, 37; Dion, XLIX, 24; Florus, II, 20 [IV, 10]). Mais il devait savoir que ses propositions ne seraient pas acceptées et assurément elles n'étaient pas sérieuses de sa part; sans aucun doute il voulait combattre et détrôner Phraatès. |
||||
35-31 av. J.C. |
Les dernières années d'Antoine en OrientRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteAntoine chercha en vain à renier cet échec en en rejetant la responsabilité sur les rois vassaux de Cappadoce et d'Arménie. Le dernier n'était pas tout à fait innocent; car sa défection prématurée devant Praaspa avait augmenté les périls et les désastres du retour. Mais l'auteur du plan de campagne, le vrai coupable, était Antoine1: ce n'était pas le roi d'Arménie, qui avait réduit au néant les espérances placées sur Monaesès, qui avait causé la défaite de Statianus, qui avait fait échouer le siège de Praaspa. Antoine ne renonça pas à soumettre l'Orient; l'année suivante (719) il sortit de nouveau d'Egypte. La situation était encore relativement favorable. Un traité d'alliance fut signé avec le roi de Médie, Artavazdès; ce prince non seulement était entré en lutte avec son souverain parthe, mais encore il gardait rancune à son voisin d'Arménie, et il comptait sur l'irritation qu'Antoine avait manifestée contre ce roi pour trouver un allié dans l'ennemi de son rival. En outre, l'accord régnait entre les deux maîtres du monde romain, le chef vainqueur de l'Occident et le souverain vaincu de l'Orient. A la nouvelle qu'Antoine avait l'intention de continuer la guerre contre les Parthes, sa femme légitime, Octavie, soeur d'Octave, se rendit d'Italie en Orient pour lui amener de nouvelles troupes, et pour affermir les rapports qu'il entretenait avec elle et avec son frère. Si Octavie songeait, malgré les relations de son mari avec la reine d'Egypte, à lui tendre la main et à lui pardonner, Octave de son côté devait désirer que la situation existante se prolongeât; le fait est d'autant plus croyable qu'il commençait la guerre à cette époque sur la frontière Nord-Est de l'Italie. Le frère et la soeur subordonnaient avec beaucoup de grandeur d'âme leurs convenances personnelles à celles de l'Etat. L'intérêt et le sentiment de l'honneur devaient engager Antoine à accepter la main qu'on lui tendait; mais il n'eut pas la force de rompre avec l'Egyptienne; il renvoya sa femme, ce qui provoqua une nouvelle rupture avec Octave, et, nous pouvons l'ajouter, ce qui l'empêcha de continuer la guerre contre les Parthes. Avant qu'il pût songer à cette expédition, il fallait savoir qui, d'Antoine ou d'Octave, serait le maître du monde. Antoine revint de Syrie en Egypte, et, pendant les années suivantes, il n'entreprit rien pour mettre à exécution ses plans de conquête en Orient; il châtia seulement ceux auxquels il imputait son échec. Il fit mettre à mort le roi de Cappadoce Ariarathès2, et donna son royaume à Archelaos, l'un de ses parents illégitimes. Le même sort était réservé au roi d'Arménie. En l'an 720 de Rome 34 av. J.-C., Antoine pénétra dans ce pays pour continuer la guerre, disait-il; mais cette campagne n'avait pas d'autre but que la prise du roi, qui avait refusé de se rendre en Egypte. Cet acte de vengeance fut exécuté, grâce à une indigne supercherie; il fut célébré plus indignement encore à Alexandrie par une parodie grotesque du triomphe Capitolin. Le fils d'Antoine, auquel on destinait l'empire d'Orient, comme nous l'avons déjà dit, fut proclamé roi d'Arménie et marié avec la fille du roi de Médie, le nouvel allié des Romains; le roi d'Arménie fut emprisonné et tué quelque temps après sur l'ordre de Cléopâtre; son fils aîné, Artaxés, que les Arméniens avaient choisi comme roi à la place de son père, se réfugia chez les Parthes. L'Arménie et la Médie Atropatène furent ainsi soumises à l'influence d'Antoine ou devinrent ses alliées. La reprise de la guerre contre les Parthes fut annoncée, mais elle fut différée jusqu'après l'écrasement du rival d'Occident. De son côté Phraatès attaqua la Médie, d'abord sans succès, parce que les troupes romaines, cantonnées en Arménie, portèrent secours aux Mèdes; mais quand Antoine, lors de ses armements contre Octave, eut rappelé ses troupes, les Parthes furent vainqueurs; ils écrasèrent les Mèdes et donnèrent les couronnes de Médie et d'Arménie au roi Artaxés qui, pour venger la mort de son père, fit saisir et massacrer tous les Romains dispersés dans le pays. Tandis que la grande lutte entre Octave et Antoine se préparait et se livrait, Phraates ne fit aucun mouvement; il avait sans doute les mains liées par de nouveaux troubles qui avaient éclaté dans son royaume. Il fut même chassé et se réfugia chez les Scythes de l'Est. Tiridatés fut proclamé Grand-Roi à sa place. Après la bataille décisive livrée sur la côte de l'Epire et la défaite complète d'Antoine en Egypte, le nouveau roi de Ctésiphon prit possession de son trône chancelant; aussitôt les hordes touraniennes parurent à l'autre extrémité de son empire pour rendre à Phraatès sa couronne et peu de temps après elles y réussirent. 1. Strabon (XI, 13, 4, p. 524) nous raconte cette guerre d'après le récit fait par Dellius, un compagnon d'armes d'Antoine, qui l'écrivit probablement sur les ordres de son chef (cf. XI, 13, 3; Dion, XLIX, 39); c'est une tentative piteuse pour justifier le général vaincu. Si Antoine ne suivit pas la route qui conduisait directement à Ctésiphon, ce n'est pas parce qu'Artavazdès fut un mauvais guide; il y eut là une erreur militaire, et plus encore politique, du commandant en chef. 2. 1. Dion (XLIX, 32) et Valère Maxime (IX, 15, ext. 2) signalent la déposition et l'exécution du roi; ils en indiquent aussi l'époque; quant à la cause ou plutôt au prétexte, il faut les chercher dans la guerre d'Arménie. |
||||
27 av. J.C.-14 |
Premières réformes d'Auguste en OrientRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe politique habile et distingué, qui était appelé à liquider la succession d'Antoine et à rétablir les relations entre les deux parties de l'empire devait accomplir son oeuvre avec modération autant qu'avec énergie. Il eût commis une faute grave, s'il avait adopté les idées d'Antoine et s'il avait voulu conquérir l'Orient ou même une partie de l'Orient. Auguste le comprit; l'organisation militaire qu'il donna à cette région montre clairement qu'il considérait la possession des côtes de Syrie et d'Egypte comme un complément nécessaire à qui voulait dominer dans la Méditerranée; mais il n'attachait aucune importance à la conquête du continent. Cependant l'Arménie était romaine depuis une génération et, dans la situation présente, elle ne pouvait être que romaine ou parthe; car elle offrait par sa position militaire, à chacun des deux grands empires qui la convoitaient, un débouché sur l'état voisin. Auguste n'avait pas l'intention de renoncer à l'Arménie pour l'abandonner aux Parthes; il ne pouvait pas y songer. Mais si l'on gardait l'Arménie, ce n'était pas pour y rester immobile; les conditions géographiques du pays obligeaient les Romains à étendre leur influence dans toute la vallée du Cyrus, à soumettre, sur le cours supérieur de ce fleuve, les Ibériens, sur le cours inférieur les Albaniens, c'est-à-dire les barbares aussi bons cavaliers que braves fantassins qui habitaient la Géorgie et le Chirvân modernes; ils ne pouvaient pas d'autre part laisser la puissance parthe franchir l'Araxes et s'établir dans l'Atropatène. Déjà l'expédition de Pompée avait prouvé que la conquête de l'Arménie conduisait nécessairement les Romains, d'une part jusqu'au Caucase, de l'autre jusqu'au rivage occidental de la mer Caspienne. Tout les y engageait. Les légats d'Antoine avaient fait la guerre aux Ibériens et aux Albaniens. Polémon, soutenu par Auguste, régnait non seulement sur la côte depuis Pharnakeia jusqu'à Trapézonte, mais encore sur le pays des Colchidiens à l'embouchure du Phase. A cette situation générale s'ajoutaient les circonstances particulières du moment : le nouveau maître unique de Rome était absolument forcé de montrer son épée aux Orientaux, et même de la tirer contre eux. Le roi Artaxés, comme jadis Mithridate, avait donné l'ordre de massacrer tous les Romains qui habitaient son royaume; un tel crime ne pouvait rester impuni. Le roi de Médie, mis en fuite par les Parthes, avait demandé du secours à Auguste, comme il l'aurait fait à Antoine. La guerre civile et la lutte entre les prétendants qui déchiraient l'empire parthe rendaient plus facile la tâche des agresseurs. En outre Tiridate, chassé du trône, s'était réfugié auprès d'Auguste et se déclarait prêt à accepter l'empire comme vassal d'Auguste. Le maître du monde pensait peut-être que la restitution des aigles perdues et des Romains faits prisonniers lors des défaites de Crassus et des insuccès d'Antoine n'était pas une cause de guerre suffisante, mais le prince qui avait rendu la paix à l'Etat romain devait régler cette question politique et militaire où l'honneur de Rome était engagé. Auguste était un homme d'Etat trop habile pour ne pas tenir compte de cette situation; l'attitude qu'il prit en Orient et les échecs subis précédemment rendaient doublement nécessaire une politique active. Sans doute il était désirable que l'ordre fût rétabli à Rome le plus tôt possible, mais rien n'obligeait le souverain incontesté du monde romain à accomplir cette oeuvre immédiatement. Après les batailles décisives d'Actium et d'Alexandrie, il se trouvait en Orient, à la tête d'une armée puissante et victorieuse; c'était le moment le plus favorable pour faire ce qui devait être fait. Un chef tel que César ne serait pas revenu à Rome sans avoir rétabli la domination romaine en Arménie, sans avoir fait reconnaître son autorité jusqu'au Caucase et jusqu'à la mer Caspienne, sans avoir terminé la lutte avec les Parthes. Un chef prévoyant et actif aurait organisé dès cette époque la défense des frontières orientales, comme la situation l'exigeait. Il était clair que les 40000 soldats des quatre légions de Syrie n'étaient pas assez nombreux pour sauvegarder les intérêts de Rome sur l'Euphrate, l'Araxes et le Cyrus, et que les milices des royaumes vassaux dissimulaient l'absence des troupes impériales sans y remédier. Par sympathie politique et nationale, les Arméniens se rattachaient plutôt aux Parthes qu'aux Romains; les rois de Commagène, de Cappadoce, de Galatie et de Pont prenaient au contraire le parti de Rome; mais ils étaient faibles et d'une fidélité douteuse. Une politique même modérée devait, pour établir l'autorité romaine, tirer énergiquement l'épée, et pour écarter les rois voisins, établir sur la frontière une armée puissante. Auguste n'a ni porté les premiers coups ni paré ceux des ennemis. Ce n'est pas qu'il méconnût la situation, mais il était dans son caractère d'accomplir lentement et doucement les réformes qui lui paraissaient nécessaires, et il subordonnait trop ses rapports avec l'étranger aux vicissitudes de la politique intérieure. Il avait bien compris que les états vassaux de l'Asie Mineure n'étaient pas assez forts pour défendre la frontière; aussi, lorsque le roi Amyntas, maître de tout le centre de la contrée, mourut en l'année 729 de Rome=25 av. J.-C., au lieu de lui donner un successeur, il envoya dans ce pays un légat impérial. Peut-être voulait-il traiter de la même façon les plus importants des royaumes voisins que Rome protégeait, et les transformer, après la mort du roi qui les gouvernait, en provinces impériales. C'eût été un progrès; les milices locales auraient été par là incorporées à l'armée romaine, et placées sous le commandement d'officiers romains; or, ces soldats, quoique comptés déjà au nombre des troupes impériales, ne pouvaient faire une sérieuse impression ni sur les pays de la frontière sans cesse menacés, ni sur le puissant empire voisin. Mais Auguste s'occupait bien moins de ces considérations que de diminuer l'effectif de son armée, et de réduire ses dépenses militaires à la plus petite somme possible. De même, les mesures prises par Auguste, lorsqu'il fut de retour à Alexandrie, ne répondaient pas à la situation. Au roi détrôné de Médie il donna la couronne de la Petite-Arménie pour tenir en échec le roi Artaxés, qui continuait de se montrer ouvertement hostile aux Romains; au prétendant parthe Tiridates, il accorda un asile en Syrie, pour menacer le roi Phraatès. Les négociations entamées avec ce prince et relatives à la restitution des étendards pris par les Parthes se terminèrent sans succès, quoique Phraatès, en 731 de Rome=23 av. J.-C., eût promis de rendre les aigles, pour obtenir la mise en liberté d'un de ses fils tombé par hasard au pouvoir des Romains. |
||||
(734 de Rome/20 av. J.C.) |
Auguste en SyrieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe fut seulement lorsqu'Auguste parut lui-même en Syrie (734), et se montra disposé à agir sérieusement, que les Orientaux se remuèrent. En Arménie, où un parti puissant s'était élevé contre le roi Artaxés, les insurgés se jetèrent dans les bras des Romains et demandèrent la consécration impériale pour Tigranès, frère cadet d'Artaxés, qui avait été à Rome et qui y vivait encore. Lorsque le beau-fils de l'empereur, Tibeberius Claudius Nero, alors âgé de vingt-deux ans, entra dans l'Arménie à la tête de son armée, le roi Artaxes fut assassiné par ses parents, et Tigranes reçut des mains du lieutenant impérial la tiare royale, comme cinquante ans plus tôt son grand-père Tigranès l'avait reçue de Pompée. L'Atropatène fut de nouveau séparée de l'Arménie et placée sous l'autorité d'un roi, qui lui aussi avait été élevé à Rome, Ariobarzanès, fils de cet Artavazdès, que nous avons nommé plus haut; pourtant ce prince paraît avoir gouverné le royaume sous la suzeraineté non pas des Romains, mais des Parthes. Nous ne savons pas comment l'on organisa les principautés du Caucase; mais, comme elles figurent plus tard au nombre des états clients de Rome, il est probable que l'influence romaine y a triomphé vers la même époque. Le roi Phraatès lui-même, sommé de tenir sa promesse ou de subir la guerre, se résigna à rendre les quelques prisonniers romains qui vivaient encore, et à restituer les drapeaux conquis; il le fit malgré lui, ce qui ne l'empêcha pas de blesser le sentiment national de ses sujets. |
||||
27 av. J.C.-14 |
Gaius Caesar envoyé en OrientRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCette victoire, remportée sans une goutte de sang par un prince pacifique, fut accueillie avec une joie immense. Les relations entre Rome et le roi des Parthes restèrent amicales, longtemps après la mort d'Auguste; car les intérêts vitaux des deux grands empires n'étaient pas opposés. En Arménie, au contraire, la domination romaine, qui ne se soutenait que par elle-même, était sérieusement menacée par l'opposition nationale. Après la mort prématurée du roi Tigranès, ses fils, ou les régents qui gouvernaient en leur nom, s'allièrent avec ce parti. Un compétiteur, Artavazdès, leur fut suscité par les amis de Rome; mais il ne put pas triompher d'adversaires plus puissants que lui. Ces troubles d'Arménie ébranlèrent la paix entre Rome et les Parthes; en fait, le parti national arménien tenta de s'appuyer sur l'empire voisin; d'autre part les Arsacides ne pouvaient pas oublier que l'Arménie avait été jadis une province réservée au cadet de leur famille. Les victoires pacifiques sont souvent peu durables et dangereuses. La situation devint telle que le gouvernement impérial dut renvoyer en Orient avec une forte armée (748 de Rome=6 av. J.-C.) ce même Tibère qui, quatorze années auparavant, avait donné à Tigranès la royauté vassale d'Arménie, et lui confier la mission de rétablir l'ordre à main armée, s'il le fallait. Mais les différends qui divisèrent alors la famille impériale, et qui interrompirent les campagnes de Germanie (t. IX, p. 43), se firent aussi sentir en Orient et y eurent une influence non moins désastreuse. Tibère ne voulut pas se charger de la tâche que son beau-père lui destinait, et, comme aucun membre de la famille impériale n'était capable de le remplacer à la tête des troupes, le gouvernement romain dut assister pendant plusieurs années, de gré ou de force, au triomphe du parti anti-romain en Arménie, sous la protection des Parthes. Enfin, en l'année 753, l'aîné des fils adoptifs de l'empereur, Gaius Caesar, âgé de vingt ans, fût chargé de la même mission. La conquête de l'Arménie devait être, comme son père l'espérait, la préface d'une oeuvre encore plus considérable; on pourrait presque dire que la campagne d'Orient de ce jeune héritier présomptif fut la suite de l'expédition d'Alexandre. Sur l'ordre de l'empereur ou à cause de leurs relations avec la cour, deux écrivains, le géographe Isidore, originaire du pays qui avoisine les bouches de l'Euphrate, et Juba, roi de Maurétanie, qui représentait l'élément grec parmi les souverains créés par Auguste, mirent à la disposition du jeune prince, l'un sa connaissance de l'Orient qu'il avait acquise dans la région même, l'autre les renseignements qu'il possédait sur l'Arabie; car Gaius Caesar paraissait brûler du désir de conquérir l'Arabie, pour laquelle Alexandre était mort, et de compenser par de brillantes victoires l'échec subi depuis longtemps par Auguste dans ces mêmes contrées. L'arrivée du prince impérial eut aussi de l'influence, comme avait eu naguère celle de Tibère sur les affaires d'Arménie. L'héritier présomptif de l'empire et le grand roi parthe Phraatakès eurent une entrevue dans une île de l'Euphrate; les Parthes rendirent encore une fois l'Arménie et le danger d'une guerre avec eux fut écarté; la bonne intelligence, un instant troublée, fut rétablie, au moins en apparence. Gaius donna comme roi aux Arméniens Ariobarzanès, prince de dynastie médique, et la suprématie de Rome fut rétablie une seconde fois. Cependant le parti national des Arméniens ne se soumit pas sans résistance, il fallut non seulement amener des légions dans le pays, mais encore en venir aux mains. Sous les murs d'Artageira, place forte d'Arménie, le prince héritier fut traîtreusement blessé par un officier parthe (an 2 de l'ère chrétienne); après avoir langui plusieurs mois, il mourut. La politique impériale et dynastique subissait un nouvel échec. La mort de ce jeune homme modifia les plans généraux de l'empereur : l'expédition d'Arabie, que l'on avait annoncée au public avec tant de confiance, fut abandonnée, du moment qu'elle ne pouvait plus assurer le trône au fils de l'empereur et l'on ne songea plus à préparer de grandes campagnes sur l'Euphrate. On avait atteint le but le plus rapproché: on avait occupé l'Arménie et rétabli les bonnes relations avec les Parthes; mais la mort du jeune prince jeta sur cette victoire une ombre de tristesse. |
||||
18-19 |
Germanicus est envoyé en OrientRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste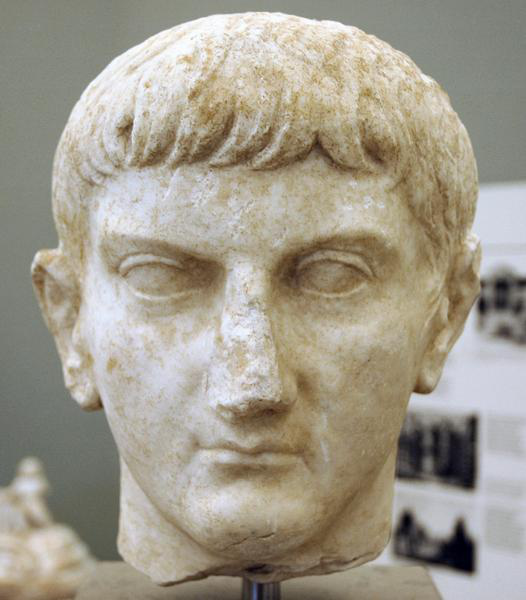
Les résultats de cette guerre ne devaient pas être moins éphémères que ceux de la campagne plus brillante de 734 = 20 av. J.-C. Les rois d'Arménie, soutenus par Rome, furent bientôt attaqués et détrônés par les chefs du parti contraire, avec l'appui secret ou manifeste des Parthes. Lorsque le prince Vonones, élevé à Rome, fut monté sur le trône vacant de Ctésiphon, les Romains espérèrent trouver un appui en lui. C'est précisément pour cette raison qu'il fut détrôné et remplacé par le roi Artaban de Médie, allié par sa mère à la famille des Arsacides, mais qui appartenait à la peuplade scythe des Daces, homme énergique, et qui avait reçu l'éducation ordinaire de ses compatriotes (environ 10 ap. J.-C.). Vonones fut alors proclamé roi par les Arméniens; avec lui l'influence romaine se maintint dans cette région. Mais Artaban ne pouvait pas souffrir que son compétiteur vaincu devint le maître d'un royaume voisin, et le gouvernement romain, pour conserver sa couronne à un prince absolument incapable, aurait été obligé de tourner ses armes contre les Parthes et contre les Arméniens eux-mêmes. Tibère, qui sur ces entrefaites était monté sur le trône, ne fit rien. Pour le moment les ennemis de Rome triomphaient en Arménie. Mais l'empereur n'avait pas l'intention de renoncer à cette province très importante située sur la frontière; au contraire, en l'an 17, il annexa à l'empire le royaume de Cappadoce. Cette annexion était sans doute projetée dès longtemps; le vieil Archelaos, roi du pays depuis l'année 718 (36 av. J.-C.), fut appelé à Rome où il apprit qu'il avait cessé de régner. De même le royaume de Commagène, peu étendu, mais important parce qu'il contenait les passages de l'Euphrate, fut soumis à l'administration directe de l'empereur. La frontière romaine atteignait dès lors le moyen Euphrate. Vers cette époque, Germanicus, l'héritier présomptif de l'empire, qui avait déjà brillamment commandé les légions du Rhin, fut envoyé en Orient avec les plus grands pouvoirs, pour organiser la nouvelle province de Cappadoce, et pour rétablir l'autorité de Rome que l'on méprisait. Cette tâche fut accomplie rapidement et sans difficulté. Germanicus, bien qu'il ne fût pas soutenu par le gouverneur de Syrie Gnaeus Pison, et qu'il n'eût pas obtenu de lui les troupes qu'il pouvait exiger et qu'il exigea en effet, n'en pénétra pas moins dans l'Arménie, qu'il soumit par la seule influence de sa personnalité et de sa situation. Il abandonna l'incapable Vononès, et plaça comme roi à la tête des Arméniens, suivant le désir des principaux partisans de Rome, un fils de ce Polémon, auquel Antoine avait donné la royauté du Pont, Zénon ou Artaxias, ainsi qu'il s'appela sur le trône d'Arménie. Ce prince était allié à la famille impériale par sa mère, la reine Pythodoris, petit-fille du triumvir Antoine; d'autre part il avait été élevé suivant les coutumes du pays; c'était un vaillant guerrier, et dans les festins un buveur de première force. Le Grand-Roi Artaban lui-même entretint avec le prince romain des relations amicales; il le pria seulement d'éloigner de la Syrie son prédécesseur Vononès, pour mettre fin aux complots qui se tramaient entre lui et les Parthes mécontents. Germanicus accéda à cette prière, et envoya en Cilicie ce protégé incommode, qui mourut peu de temps après en essayant de fuir, et la bonne intelligence fut bientôt rétablie entre les deux grands états. Artaban désirait même avoir une entrevue avec Germanicus sur l'Euphrate, comme Phraatakès avait fait avec Gaius, mais Germanicus refusa; il savait combien il était facile d'exciter les défiances de Tibère. Cependant cette nouvelle expédition d'Orient se termina anssi tristement que la précédente. Germanicus, lui aussi, ne revint pas vivant à Rome. |
||||
35-37 |
Expédition de VitelliusRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'effet de ces mesures se fit sentir pendant une assez longue période. Tant que Tibère tint d'une main sûre les rênes de l'Etat, et tant que vécut le roi d'Arménie, Artaxias, la paix ne fut pas troublée en Orient; mais pendant les dernières années du vieil empereur, lorsque, renfermé dans son île solitaire, il laissait aller les choses et craignait la guerre par-dessus tout; principalement après la mort d'Artaxias (vers 34), les anciennes péripéties recommencèrent. Le roi Artaban, ébloui par son règne long et heureux, et par de nombreux succès qu'il avait remportés sur des peuples voisins de l'Iran, convaincu d'ailleurs que le prince âgé n'était nullement disposé à commencer en Orient une guerre difficile, souleva les Arméniens et les engagea à proclamer roi son fils aîné, Arsakes, c'est-à-dire à remplacer la suprématie romaine par la domination des Parthes. Certes il paraissait bien chercher la guerre avec Rome; il réclamait au gouvernement romain l'héritage de son prédécesseur et rival Vononès mort en Cilicie; dans ses lettres à Tibère, il disait ouvertement que l'Orient appartenait aux Orientaux, et il appelait de leur vrai nom les scènes monstrueuses de la cour impériale, dont les Romains osaient à peine parler dans les cercles les plus intimes. Il dut même essayer d'occuper la Cappadoce. Mais il s'était trompé sur le compte du vieux lion. Tibère, même à Caprée (Capri), n'était pas redoutable aux seuls courtisans: il n'était pas homme à se laisser bafouer et à laisser insulter Rome en sa personne. Il envoya en Orient Lucius Vitellius, le père du futur empereur, officier résolu et diplomate habile; il lui donna tous les pouvoirs qu'avaient eus G. Caesar et Germanicus, et lui confia la mission de conduire, s'il le fallait, les légions de Syrie au-delà de l'Euphrate. En même temps, suivant la méthode si fréquemment appliquée envers les souverains orientaux, il cherchait à créer des embarras dans le pays, en provoquant des insurrections et en soulevant des prétendants. Au prince parthe, que le parti national d'Arménie avait proclamé roi, il opposa un prince de la maison royale d'Ibérie, Mithradates, frère du roi des Ibères, Pharasmanès; il ordonna à ce dernier ainsi qu'au prince des Albaniens de soutenir avec toutes leurs forces le prétendant au trône d'Arménie que Rome protégeait. Les Sarmates transcaucasiens étaient belliqueux et tout prêts à s'enrôler. Grâce à l'or romain, des bandes considérables furent rassemblées pour envahir l'Arménie. Le prétendant de l'empire réussit à gagner quelques courtisans de son rival et à le faire empoisonner; il se rendit bientôt maître de tout le pays et de la capitale Artaxata. Artaban envoya, pour remplacer son fils assassiné, un autre de ses fils, Orodès, et chercha lui aussi à se procurer des troupes auxiliaires au-delà du Caucase, mais il ne put en amener qu'un petit nombre en Arménie, et les cavaliers parthes ne furent capables de résister ni à l'excellente infanterie des peuples du Caucase, ni à la redoutable cavalerie des Sarmates. Orodes fut vaincu dans une grande bataille rangée et grièvement blessé par son rival en combat singulier. Alors Artaban se rendit lui-même en Arménie. Cependant Vitellius mit en mouvement les légions de Syrie, pour franchir l'Euphrate et pénétrer dans la Mésopotamie; cette marche fit éclater dans l'empire parthe l'insurrection qui couvait depuis longtemps. Le roi Scythe avait pris une attitude énergique; il était devenu plus dur à mesure qu'il remportait plus de succès; il avait blessé beaucoup de personnes et s'était attaqué à des intérêts puissants; surtout il s'était rendu odieux aux Grecs de Mésopotamie et à la cité considérable de Séleucie, qu'il avait dépouillée de sa constitution démocratique, organisée sur le modèle des municipalités grecques. L'or de Rome avait entretenu ces éléments de révolte. Plusieurs nobles mécontents étaient déjà entrés en relation avec le gouvernement romain, et lui avaient demandé un Arsacide de sang pur. Tibère leur avait d'abord envoyé le seul fils de Phraatès qui vécût encore, nommé Phraatès lui-même, puis, lorsque ce vieillard habitué à la vie de Rome eut succombé en Syrie, un petit-fils de Phraatès, nommé Tiridates, qui vivait aussi à Rome. Le prince parthe Sinnakès, qui avait noué toutes ces intrigues, refusa d'obéir au Scythe Artaban, et releva la bannière des Arsacides. Vitellius franchit l'Euphrate avec ses légions, amenant avec lui le nouveau Grand-Roi soutenu par Rome. Le gouverneur parthe de la Mésopotamie, Ornospadès, qui avait été jadis exilé et qui avait fait sous les ordres de Tibère la guerre de Pannonie, se déclara, lui et ses troupes, pour le nouveau souverain; le père de Sinnakes, Abdagaesès, livra le trésor royal; en très peu de temps Artaban fut abandonné par tout le pays et obligé de s'enfuir en Scythie, où il erra comme un vagabond au milieu des forêts de sa patrie, vivant du produit de sa chasse, tandis que Tiridatés recevait solennellement la tiare à Ctésiphon de la main des princes qui devaient assister, suivant les coutumes de l'état parthe, au couronnement du souverain. Mais le règne de ce Grand-Roi imposé par l'ennemi national ne dura pas longtemps. Ce jeune homme faible et inexpérimenté abandonna le pouvoir à ceux qui l'avaient couronné, surtout à Abdagaesés, et une forte opposition s'éleva bientôt contre lui. Quelques-uns des plus puissants satrapes, qui s'étaient naguère abstenus de paraître à la cérémonie du sacre, appelèrent de son exil le roi détrôné; aidé par eux et soutenu par des troupes que lui avaient fournies ses compatriotes de Scythie, Artaban rentra dans son royaume; dès l'année suivante (36) il avait reconquis l'empire tout entier, sauf Séleucie. Tiridate mis en fuite était obligé de demander à ses protecteurs romains un asile qu'on ne pouvait lui refuser. Vitellius conduisit de nouveau ses légions sur l'Euphrate; mais le Grand-Roi parut en personne et se déclara prêt à accorder tout ce qu'on lui demanderait, pourvu que le gouvernement romain abandonnât Tiridate. Dans ces conditions, la paix fut bientôt signée: non seulement Artaban reconnut Mithridate comme roi d'Arménie, mais encore il vint rendre hommage à la statue de l'empereur, comme les princes vassaux avaient coutume de le faire, et il donna aux Romains son fils Darius en otage. Cependant Tibère était mort; mais il avait assez vécu pour voir le triomphe pacifique et complet de sa politique orientale. |
||||
37-41 |
L'Orient sous GaiusRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa victoire, remportée grâce à la prudence du vieux souverain, fut immédiatement compromise par la folie de son successeur. Non seulement celui-ci rapporta les meilleures mesures que Tibère avait prises, - il rétablit par exemple le royaume annexé de Commagène, mais dans sa jalousie insensée des succès obtenus par l'empereur mort, il fit venir à Rome l'habile gouverneur de Syrie ainsi que le nouveau roi d'Arménie, pour leur demander compte de leurs actes; il déposa ce prince et l'exila, après l'avoir retenu pendant longtemps en prison. Naturellement les Parthes profitèrent de cette occasion pour reconquérir l'Arménie, privée de son chef1. 1. Nous n'avons pas de renseignements sur cette prise de possession de l'Arménie, mais le fait lui-même résulte clairement d'un passage de Tacite (Ann., XI, 9). Il faut rapporter sans doute à cet événement ce que Josèphe nous dit (XX, 3, 3) des projets du successeur d'Artaban, qui voulait déclarer la guerre aux Romains malgré les conseils d'Izatès, satrape mais que, d'Adiabène. Josèphe l'appelle par erreur Bardanès. D'après Tacite (Ann., XI, 8) le successeur immédiat d'Artaban III fut son fils Artaban, que Gotarzès chassa plus tard avec son fils; c'est d'Artaban IV qu'il doit être question ici. |
||||
41-54 |
L'Orient sous ClaudeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteClaude, lorsqu'il monta sur le trône en l'an 41, avait tout à refaire. Il suivit l'exemple de Tibère. Mithridate, rappelé de l'exil, fut replacé sur le trône et chargé de reprendre l'Arménie avec l'aide de son frère. La guerre civile, qui avait éclaté entre les trois fils du roi parthe Artaban III facilitait la tâche des Romains. Lorsque l'aîné eut été assassiné, Gotarzès et Vardanès se disputèrent le trône pendant de longues années; Séleucie, qui avait déjà refusé d'obéir à Artaban, résista sept ans à ses fils et les peuples touraniens intervinrent comme toujours dans cette querelle des princes de l'Iran. Mithridate, soutenu par les troupes de son frère et par les garnisons des provinces romaines voisines, put triompher des Arméniens alliés aux Parthes, et recouvrer la couronne1; le pays reçut une garnison romaine. Lorsque Vardanès se fût mis d'accord avec son frère et fût enfin rentré dans Séleucie, il fit mine d'envahir l'Arménie; mais l'attitude menaçante du légat romain de Syrie le retint; peu de temps après l'accord des deux frères fut rompu et la guerre civile éclata de nouveau. La mort du brave Vardanès, qui avait souvent battu les hordes touraniennes, ne termina pas cette lutte; le parti adverse se jeta dans les bras de Rome et demanda au gouvernement impérial de donner aux Parthes comme roi le fils encore vivant de Vononès, le prince Méherdates; l'empereur Claude le confia devant l'assemblée du Sénat à ses compatriotes et l'envoya en Syrie, après lui avoir recommandé de bien gouverner son royaume et de rester le vassal fidèle de Rome (an 49). La situation dans laquelle il se trouva ne lui permit pas de mettre à profit ces conseils. Les légions romaines, qui l'avaient accompagné jusqu'à l'Euphrate, le remirent entre les mains de ceux qui l'avaient appelé, principalement du chef de la puissante famille des Karen, d'Abgaros, roi d'Edesse et d'Izates, roi d'Adiabène. Ce jeune homme inexpérimenté et peu belliqueux n'était pas plus à la hauteur de sa tâche que les autres souverains donnés par Rome aux Parthes; un grand nombre de ses principaux partisans l'abandonnèrent, sitôt qu'ils le connurent, et prirent le parti de Gotarzès. Le brave Karen fut tué dans une bataille, et sa mort décida du succès de la guerre. Méherdates fut fait prisonnier; on ne le mit pas à mort, mais on l'éloigna pour toujours du trône en lui coupant les oreilles, suivant la coutume orientale. 1. Pierre le Patrice (fr. 3, ed. Muller, raconte que le roi Mithradatès d'Ibérie voulait se séparer de Rome, pour paraître toujours fidèle, il avait envoyé près de Claude son frère Cotys; or, ce Cotys ayant dévoilé ces menées à l'empereur, Mithradates fut déposé et remplacé par son frère. Mais ce récit ne concorde pas avec les faits suivants absolument certains: en Ibérie Pharasmanès a régné au moins depuis l'année 35 (Tacite, VI, 32) jusqu'à l'année 60 (id., XIV, 26), et Mithradatès, son fils, était encore roi en l'année 75 (Corp. insc. lat., III, 6052). Sans doute Pierre le Patrice a confondu Mithradates, roi d'Ibérie, avec Mithradatès, roi du Bosphore (p. 289, n. 1); son récit repose sur le même fonds que celui de Tacite (Ann., XII, 18). |
||||
51 |
Occupation de l'Arménie par les ParthesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMalgré cet échec de la politique romaine, dans l'empire Parthe, l'Arménie ne fut pas enlevée aux Romains, tant que le faible Gotarzès régna à Ctésiphon. Mais lorsqu'un souverain plus énergique eut pris en main les rênes de l'Etat et apaisé les discordes intestines, la lutte recommença autour de ce pays. Après la mort de Gotarzès et le règne très court de Vononès II, Vologasos, fils et successeur de ce dernier1, monta sur le trône, d'accord avec ses deux frères Pakoros et Tiridatés, ce qui était une situation exceptionnelle. Le nouveau roi ne manquait ni de talent ni de prudence; c'était un fondateur de villes, et il s'efforça, non sans succès, de transporter le commerce de Palmyre dans sa nouvelle capitale Vologasias, sur le bas Euphrate. Il ne prenait jamais de décisions rapides ni extrêmes, et il voulait conserver le plus longtemps possible la paix avec son puissant voisin. Mais l'idée qui dominait toute la politique des Arsacides était de reconquérir l'Arménie, et Vologasos était prêt à profiter de toutes les occasions pour mettre ce plan à exécution. 1. Si l'on peut s'en rapporter aux monnaies, reconnaissables seulement, il est vrai, à leur effigie, Gotarzès régna jusqu'en Sel. 362, Daesius = Juin 51 ap. J.-C., et Vologasos depuis Sel. 362, Gorpiaeus Sept. 51 ap. J.-C. Nous ne connaissons aucune pièce de Vononès II (Percy Gardner, Parthian coinage, p. 50, 51), ce qui concorde avec le récit de Tacite (Ann., XII, 14, 44). |
||||
51-53 |
RhadamistosRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : Auguste
Les circonstances semblaient alors favorables. La cour d'Arménie était devenue le théâtre d'une des tragédies de famille les plus terribles que l'histoire connaisse. Le vieux roi des Ibériens, Pharasmanès, entreprit de chasser du trône d'Arménie son frère, le roi Mithradates, et de lui substituer son propre fils Rhadamistos. Sous le prétexte d'une rupture avec son père, Rhadamistos vint à la cour de son oncle et beau-père et entama des négociations de toute sorte avec les personnages les plus puissants de l'Arménie. Après s'être assuré le concours d'un parti, Pharasmanès, en l'an 52, déclara la guerre à son frère, pour des raisons futiles, et s'empara du pays qu'il donna à son fils. Mithridate se plaça sous la protection de la garnison romaine qui occupait la place forte de Gorneae1. Rhadamistos n'osait pas attaquer les Romains, mais leur chef, Caelius Pollio, avait la réputation d'être nul et lâche. Le centurion qui commandait sous ses ordres se rendit auprès de Pharasmanès pour l'exhorter à retirer ses troupes; le roi des Ibériens le promit, mais ne tint pas parole. Pendant l'absence de son lieutenant, Pollio obligea le roi, qui pressentait bien le sort qu'on lui réservait et que le général romain menaça d'abandonner, à se livrer lui-même à Rhadamistos. Il fut mis à mort par celui-ci, et avec lui sa femme, soeur de Rhadamistos; ses enfants furent aussi massacrés, parce qu'ils avaient poussé des cris de douleur en voyant les cadavres de leurs parents. C'est ainsi que Rhadamistos conquit le royaume d'Arménie. Le gouvernement impérial ne pouvait laisser impunis des crimes aussi monstrueux commis avec la complicité d'officiers romains, ni souffrir qu'un de ses vassaux déclarât la guerre à l'autre. Le gouverneur de Cappadoce, Julius Paelignus, n'en reconnut pas moins le nouveau roi. Dans le conseil du gouverneur de Syrie Ummidius Quadratus, on fut aussi d'avis que Rome ne devait pas s'occuper si c'était l'oncle ou le neveu qui régnait en Arménie. Le légat envoyé dans ce pays avec une légion fut seulement chargé d'y maintenir le statu quo jusqu'à nouvel ordre. C'est alors que le roi des Parthes, supposant que les Romains ne s'empresseraient pas de prendre la défense de Rhadamistos, crut le moment venu de faire valoir ses anciennes prétentions sur l'Arménie. Il investit son frère Tiridatés de ce royaume, les troupes parthes l'envahirent et s'emparèrent presque sans coup férir des deux capitales, Tigranocerta et Artaxata, ainsi que du pays tout entier. Rhadamistos essaya de conserver cette couronne, qu'il avait acquise au prix de tant de meurtres, mais les Arméniens eux-mêmes le chassèrent. Après la reddition de Gorneae, la garnison romaine parait avoir quitté l'Arménie, et le gouverneur de Syrie rappela la légion qu'il avait envoyée, pour éviter tout conflit avec les Parthes. 1. Gorneae, en arménien Garhni; les ruines de cette ville (non loin d'Erivan, à l'Est) portent encore ce nom aujourd'hui. - Kiepert. |
||||
52 |
Expédition de Corbulon en CappadoceRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLorsque la nouvelle de ces événements parvint à Rome (fin de l'année 54), l'empereur Claude venait de mourir; les ministres Burrhus et Sénèque gouvernaient au nom du jeune Néron, âgé de dix-sept ans. On ne pouvait répondre que par une déclaration de guerre à l'expédition de Vologasos. En effet, le gouvernement romain prit une mesure exceptionnelle; il envoya le légat consulaire Gnaeus Domitius Corbulo dans la Cappadoce, qui n'était qu'un gouvernement de seconde classe sans légions. Beau-frère de l'empereur Gaius, Corbulon avait eu une rapide carrière : sous Claude, en 47, il avait été légat de Basse-Germanie (t. IX, p. 158); depuis lors, il était considéré comme un des rares généraux à la fois vaillants et capables de combattre énergiquement la décadence apparente de la discipline militaire; d'une taille herculéenne, il pouvait supporter toutes les fatigues et traitait ses soldats aussi durement que l'ennemi. C'est à lui que le gouvernement de Néron confia le premier commandement important dont il disposa; il semblait que ce fût un bon augure. Quadratus, le légat incapable de Syrie, ne fut pas rappelé; mais il reçut l'ordre de mettre deux de ses quatre légions à la disposition du gouverneur de la province voisine. Les légions furent concentrées près de l'Euphrate, et l'on s'occupa immédiatement de jeter des ponts sur le fleuve. Les deux provinces qui bornaient l'Arménie à l'Ouest, la petite Arménie et la Sophène furent données à deux princes syriens fidèles à Rome, Aristobule, issu d'une branche latérale de la famille d'Hérode et Sohaemos, de la maison des rois d'Hemèse; tous deux durent obéir à Corbulon. Le roi de ce qui restait encore de l'état juif, Agrippa, et Antiochus, roi de Commagène, reçurent également l'ordre de marcher. Pourtant la guerre n'éclata pas. L'une des causes de ce retard fut l'état des légions de Syrie; Corbulon dut déclarer qu'il ne pouvait tirer aucun parti des troupes qu'on lui avait envoyées, indiquant par ce témoignage accablant tous les défauts de l'administration précédente. Les légions levées et cantonnées dans les provinces grecques avaient toujours été moins fortes que celles d'Occident; à cette époque elles étaient complètement démoralisées par l'influence énervante de l'Orient, la longue période de paix qu'elles venaient de traverser, et le relâchement de la discipline. Les soldats se plaisaient mieux dans les villes que dans les camps; beaucoup d'entre eux avaient perdu l'habitude de porter les armes; ils ne savaient plus construire un retranchement ni monter la garde; depuis longtemps l'effectif des régiments n'avait pas été complété; parmi les soldats figuraient un grand nombre de vieillards impropres au service. Corbulon fut obligé de renvoyer beaucoup d'hommes, de lever et de former un nombre plus considérable encore de recrues. Les quartiers d'hiver furent transportés de la région tempérée de l'Oronte dans les rudes montagnes de l'Arménie et l'armée fut soumise sans délai à une discipline militaire impitoyable; aussi les maladies furent-elles fréquentes, les désertions plus fréquentes encore. Malgré toutes ces mesures, le général se vit obligé, lorsque les affaires devinrent plus sérieuses, de réclamer l'envoi d'une des meilleures légions de l'Occident. Cependant il ne se hâtait pas de conduire ses soldats à l'ennemi; il y était surtout déterminé par des considérations politiques. |
||||
52-58 |
Le but de la guerreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteSi le gouvernement romain avait eu l'intention de chasser d'Arménie le roi parthe, et de le remplacer non pas par Rhadamistos, dont Rome n'avait aucune raison de se faire la complice, mais par quelque autre prince de son choix, les forces militaires de Corbulon auraient été suffisantes, le roi Vologasos, rappelé par de nouveaux troubles intérieurs, ayant ramené ses troupes d'Arménie. Mais tels n'étaient pas les plans des Romains : ils aimaient bien mieux laisser la couronne d'Arménie à Tiridatés, et l'exhorter, au besoin même le forcer à reconnaître la suprématie romaine. C'était seulement pour obtenir ce résultat que les légions devaient marcher, à la dernière extrémité. En fait, Rome abandonnait presque l'Arménie aux Parthes. Nous avons indiqué plus haut quels étaient le pour et le contre de cette politique; si l'Arménie était désormais réservée au cadet de la famille royale des Parthes, la reconnaissance de la suprématie romaine n'était guère qu'une formalité, pour sauvegarder l'honneur militaire et politique de Rome. Aussi le gouvernement des premières années de Néron, que peu de règnes égalèrent en intelligence et en énergie, avait-il résolu de se débarrasser honorablement de l'Arménie. Cette décision ne doit pas nous surprendre. La guerre d'Arménie était un travail de Danaïdes. Le pays avait été conquis en 20 avant J.-C. par Tibère, en 2 avant J.-C. par Gaius, en 18 par Germanicus, en 36 par Vitellius; Arméniens et Parthes avaient chaque fois accepté et reconnu l'autorité romaine. Ces expéditions extraordinaires se répétaient régulièrement, ne réussissaient pas moins régulièrement, et pourtant n'avaient jamais de résultats durables; les Parthes avaient donc raison, lorsque leurs négociateurs affirmaient sous le règne de Néron, que la domination romaine serait toujours nominale en Arménie, parce que le pays était et voulait être parthe. Pour imposer la suprématie de Rome, il fallait constamment sinon faire la guerre, du moins menacer de la faire; ces froissements continuels provoqués par cette politique rendaient impossible une paix durable entre les deux grands Etats voisins. Les Romains, s'ils agissaient logiquement, devaient ou bien établir leur domination réelle dans l'Arménie et sur la rive gauche de l'Euphrate, en renonçant à une suzeraineté purement indirecte, ou bien abandonner ces contrées aux Parthes, autant que cet abandon était compatible avec le principe fondamental du gouvernement romain, qui ne voulait accorder à aucune puissance voisine les droits dont il jouissait lui-même. Auguste et ses successeurs immédiats avaient formellement repoussé la première alternative; ils avaient donc préparé la seconde solution, mais au moins ils avaient cherché à l'éviter : ils avaient essayé, sans pouvoir y réussir, d'enlever à la famille royale des Parthes la couronne d'Arménie. Les ministres qui gouvernèrent l'état pendant les premières années du règne de Néron, doivent avoir considéré cette tentative comme une faute, puisqu'ils abandonnèrent l'Arménie aux Arsacides, et réduisirent au minimum les droits de l'empire sur cette région. S'ils ont comparé les dangers et les désavantages qu'il y avait à occuper ce royaume, uni seulement à Rome par des liens fictifs, aux inconvénients que présentait la domination des Parthes en Arménie, ils ont bien pu se résoudre à l'abandon définitif de ce pays, d'autant plus que la puissance offensive de l'empire parthe était très peu considérable. En tout cas, cette politique était conséquente et atteignait avec plus de netteté et plus d'intelligence le but qu'Auguste s'était proposé. Si l'on se place à ce point de vue, on comprend dès lors pourquoi Corbulon et Quadratus, au lieu de franchir l'Euphrate, ont entamé des négociations avec Vologasos; l'on comprend aussi pourquoi le roi des Parthes, connaissant sans doute les vraies intentions des Romains, s'est résigné, comme son prédécesseur, à leur céder, et leur a livré comme otages plusieurs personnages alliés de très près à la famille royale. En revanche, Rome consentait tacitement à laisser Tiridatès régner sur l'Arménie, et à ne plus lui opposer de prétendant romain. Cette paix factice dura pendant plusieurs années. Mais Vologasos et Tiridatés ne purent se résoudre à demander au gouvernement romain l'investiture du royaume d'Arménie1, et Corbulon en l'an 58 reprit l'offensive contre Tiridatés. Pour que cette politique de recul et de concessions ne parût ni à leurs amis ni à leurs ennemis un acte de faiblesse, il fallait, ou bien la rehausser par une reconnaissance formelle et solennelle de la suzeraineté de Rome, ou bien par un succès militaire de ses armes. 1. Après l'attaque des Romains, Tiridatés demandait cur datis nuper obsidibus redintegrataque amicitia ..... vetere Armeniae possessione depelleretur, et Corbulon lui promit un regnum slabile, s'il voulait s'adresser à l'empereur dans une attitude de suppliant (Tacite, Ann., XII, 37). D'ailleurs le refus que fit Tiridates de prêter hommage est indiqué par Tacite (Ann., XII, 34) comme la vraie cause de la guerre. |
||||
52-58 |
Corbulon en ArménieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugustePendant l'été de l'année 58, Corbulon conduisit au-delà de l'Euphrate une armée d'au moins 30 000 hommes, assez forte pour entreprendre une lutte sérieuse. Ce fut pendant l'expédition elle-même que les troupes achevèrent de se réorganiser et de s'endurcir. Les premiers quartiers d'hiver furent pris sur le sol arménien. Au printemps de l'année 591, Corbulon marcha dans la direction d'Artaxata. En même temps les Ibères envahissaient l'Arménie par le Nord; le roi Pharasmanès, pour faire oublier ses propres crimes, avait condamné à mort son fils Rhadamistos; il s'efforçait maintenant d'obtenir, par de bons services, le pardon de ses fautes passées. Les Arméniens étaient aussi attaqués par leurs voisins du Nord-Ouest, les braves Moschi, et du côté du Sud par Antiochus de Commagène. Le roi Vologasos était retenu sur la frontière opposée de son empire par la révolte des Hyrcaniens; il ne pouvait pas ou ne voulait pas intervenir directement dans la lutte. Tiridatés opposa une courageuse résistance; mais il lui était impossible de repousser les forces qui l'accablaient. Il essaya en vain de se jeter sur les lignes de communication des Romains avec la mer Noire et le port de Trapézonte, d'où ils tiraient leurs vivres. Les places fortes de l'Arménie succombèrent aux attaques impétueuses des troupes romaines et les soldats des garnisons furent massacrés jusqu'au dernier. Vaincu, sous les murs d'Artaxata, dans une bataille rangée, Tiridatés renonça à cette lutte inégale et s'enfuit chez les Parthes. Artaxata se rendit, et l'armée romaine passa l'hiver dans cette ville, au coeur de l'Arménie. Au printemps de l'année 60, Corbulon se remit en marche après avoir brûlé Artaxata; il traversa l'Arménie et se dirigea sur la seconde capitale du pays, Tigranocerte, située dans la vallée du Tigre au-dessus de Nisibis. La destruction d'Artaxata avait partout répandu la terreur. Nulle part on n'opposa de résistance sérieuse; Tigranocerte ouvrit ses portes au vainqueur, qui se montra très habile en lui faisant grâce. Tiridatés essaya encore de revenir et voulut recommencer la lutte, mais il fut repoussé sans grands efforts. A la fin de l'été 60, toute l'Arménie était soumise et se trouvait à la merci du gouvernement romain. 1. Le récit de Tacite (Ann., XIII, 34-11), embrasse sans doute les campagnes des années 58 et 59, puisque l'historien, à propos de l'an 59, ne parle pas de l'expédition d'Arménie et relie, à propos de l'année 60, le récit qu'il fait au 41e chapitre du XIIIe livre à celui qu'on lit au 23e chapitre du XIV livre. Il ne raconte évidemment qu'une seule guerre. C'est d'ailleurs son habitude d'anticiper ainsi, lorsqu'il expose de cette manière un événement historique. Ce qui confirme que la campagne avait commencé avant l'année 59, c'est que Corbulon était en Arménie lorsqu'il observa l'éclipse de soleil du 30 avril 59 (Pline, Hlist. nat., II, 70, 180); s'il n'avait pénétré dans l'Arménie qu'en 59, à cette époque de l'année, il aurait à peine pu franchir la frontière ennemie. La narration de Tacite ne divise pas en années la période de la guerre (XIII, 34-41); mais telle qu'elle est; elle nous permet de comprendre que la première année fut consacrée à franchir l'Euphrate et à prendre pied en Arménie. L'hiver, dont il est parlé au chap. 35, est donc l'hiver 58/59. Dans l'état de l'armée, il était nécessaire de donner à la guerre proprement dite une telle préface, et l'été est si court en Arménie, qu'il était utile militairement de séparer ainsi la marche en avant et les opérations elles-mêmes. |
||||
52-58 |
Tigranès roi d'ArménieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteOn comprend facilement que Tiridatés ait été abandonné par les Romains. Le prince Tigranès, arrière-petit-fils par son père d'Hérode le Grand, et par sa mère d'Archelaos, roi de Cappadoce, était allié par sa femme à l'ancienne maison royale d'Arménie, et neveu d'un des rois éphémères qui avaient gouverné le pays dans les dernières années d'Auguste; élevé à Rome, il devait être l'instrument du gouvernement impérial; en l'année 60, il reçut de Néron l'investiture du royaume d'Arménie, et d'après les ordres de l'empereur, fut installé dans son gouvernement par Corbulon. Une garnison romaine resta dans la contrée; elle comptait mille légionnaires, et trois ou quatre mille auxiliaires, cavaliers et fantassins. Plusieurs provinces frontières furent détachées de l'Arménie et partagées entre Polémon, roi de Pont et de Trapezonte, Aristobule, roi de la Petite-Arménie, Pharasmanès d'Ibérie et Antiochus de Commagène. En revanche, le nouveau prince d'Arménie envahit, avec l'assentiment des Romains naturellement, l'Adiabène, province parthe voisine, battit le gouverneur Monobazos, et parut vouloir conquérir ce pays sur les Parthes. |
||||
58 |
Traité avec les ParthesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCes événements forcèrent le gouvernement parthe à sortir de sa neutralité; il ne s'agissait plus de reprendre l'Arménie, mais de maintenir l'intégrité de l'empire. Le conflit qui menaçait depuis longtemps d'éclater dans les deux grands Etats semblait inévitable. Vologasos, dans une assemblée des grands de son royaume, confirma de nouveau Tiridatés comme roi d'Arménie, et l'envoya avec le général Monaesés contre l'usurpateur romain, qui occupait Tigranocerte avec ses troupes, et qui y fut assiégé par les Parthes. Vologasos lui-même rassembla en Mésopotamie les principales forces militaires de son royaume et menaça la Syrie au commencement de l'année 61. Corbulon, après la mort de Quadratus, avait réuni la Cappadoce à son commandement de Syrie, mais il avait demandé au gouvernement de nommer un autre gouverneur pour la Cappadoce et l'Arménie; il envoya provisoirement deux légions dans ce pays pour porter secours à Tigranès, tandis que lui-même s'avançait vers l'Euphrate, afin de s'emparer du roi des Parthes. Le résultat de tous ces mouvements ne fut pas une bataille, mais un traité. Vologasos, sachant combien était dangereux le jeu qu'il jouait, se montra disposé à accepter les conditions proposées en vain par les Romains avant le commencement de la guerre d'Arménie et consentit à ce que son frère reçût de l'empire romain l'investiture. Corbulon traita. Il abandonna Tigranès, rappela d'Arménie les troupes romaines, et laissa Tiridatés y rentrer, tandis que les auxiliaires parthes battaient en retraite de leur côté. Vologasos envoya une ambassade au gouvernement romain, pour déclarer que son frère acceptait la suzeraineté de Rome. |
||||
58-64 |
La guerre contre les parthes sous NéronRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes mesures prises par Corbulon étaient dangereuses1; elles provoquèrent de nouveaux désastres. Plus encore que les ministres romains, le général pensait peut-être qu'il était inutile de conserver l'Arménie; mais le gouvernement impérial venait d'en donner la couronne à Tigranes; Corbulon ne devait pas revenir sur les conditions qu'il avait naguère imposées, abandonner ses conquêtes et rappeler du pays les troupes romaines. Il était d'autant moins excusable qu'il n'administrait que par interim la Cappadoce et l'Arménie; il avait déclaré lui-même au gouvernement, qu'il lui était impossible de rester à la tête tout à la fois de ces deux provinces et de la Syrie; c'est alors que le consulaire Lucius Caesennius Paetus avait été nommé gouverneur de Cappadoce et s'était mis en route pour gagner ce pays. On peut soupçonner Corbulon d'avoir voulu ravir à Paetus l'honneur de soumettre complètement l'Arménie, en signant avec les Parthes une paix factice qui aurait établi avant son arrivée une situation définitive. A Rome, on repoussa les propositions de Vologasos et on prétendit garder l'Arménie, qui devait être directement administrée par des fontionnaires romains, comme le déclarait le nouveau gouverneur, arrivé en Cappadoce pendant l'été de l'année 61. On ne saurait dire si le gouvernement était réellement décidé à aller aussi loin; en tout cas, c'était la conséquence de sa politique. Etablir un roi vassal de Rome, c'était prolonger la situation précédente devenue impossible; si l'on ne voulait pas abandonner l'Arménie aux Parthes, il fallait transformer ce royaume en une province romaine. La guerre allait donc continuer. Une des légions de Mésie fut envoyée à l'armée de Cappadoce. Lorsque Paetus arriva, les deux légions que Corbulon lui destinait campaient dans la Cappadoce, en-deçà de l'Euphrate; l'Arménie était évacuée; il était nécessaire de la reconquérir. Paetus se mit aussitôt à l'oeuvre; il franchit l'Euphrate près de Mélitène (Malatia), envahit l'Arménie et s'empara des chateaux-forts voisins de la frontière. La saison avancée l'obligea à suspendre ses opérations; il dut renoncer à rentrer dans Tigranocerte la même année, comme il en avait eu l'intention; mais, afin de pouvoir reprendre sa marche dès les premiers jours du printemps suivant, il hiverna, suivant l'exemple de Corbulon, en pays ennemi, à Rhandeia, sur un affluent de l'Euphrate, l'Arsanias, non loin du moderne Charput, tandis que les bagages, les femmes et les enfants s'enfermaient assez près de là dans la place forte d'Arsamosata. 1. La partialité et l'embarras sont très visibles dans le récit de Tacite (Ann., XV, 6). L'historien n'ose pas dire que l'Arménie fut livrée à Tiridatés, il laisse au lecteur le soin de tirer cette conclusion. |
||||
63 |
Capitulation de RhandelaRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais Paetus ne s'était pas assez rendu compte des difficultés de l'entreprise. L'une de ses légions, la meilleure, celle de Mésie, était encore en marche; elle passa l'hiver en-deçà de l'Euphrate, dans le royaume de Pont. Les deux autres, non pas celles que Corbulon avait dressées à la guerre et à la victoire, mais les anciennes légions syriennes de Quadratus, étaient incomplètes et il fallait les réorganiser de fond en comble, si l'on voulait en tirer parti. En outre, Paetus avait à combattre non les Arméniens seuls, mais toute l'armée des Parthes. Vologasos, quand il avait vu que la guerre devenait sérieuse, avait conduit ses meilleures troupes de Mésopotamie en Arménie, et, en se rendant maître des communications intérieures et des plus courts chemins, il s'était assuré l'avantage stratégique. Corbulon, qui avait jeté des ponts sur l'Euphrate et construit des têtes de ponts au-delà du fleuve, aurait pu rendre plus difficile ou même empêcher cette marche de Vologasos par une invasion rapide en Mésopotamie. Mais il ne quitta pas ses positions et laissa Paetus soutenir, comme il le pouvait, le choc de toutes les forces ennemies. Ce général n'avait pas de talents militaires; il n'était pas disposé à accepter et à suivre les conseils d'autrui en pareille matière; c'était un homme sans décision, vaniteux et glorieux au moment de l'attaque, lâche et abattu dans la défaite. Il arriva donc ce qui devait arriver. Au printemps de l'année 62, ce fut Vologasos et non Paetus qui prit l'offensive; les troupes avancées, chargées de barrer le chemin aux Parthes, furent écrasées par des forces supérieures. Bientôt les Romains, au lieu d'être les agresseurs, furent assiégés à la fois dans leurs quartiers d'hiver et dans Arsamosata, positions assez éloignées l'une de l'autre. Les légions ne pouvaient plus ni avancer, ni reculer; les soldats désertaient en masse; Paetus n'avait plus d'espoir que dans les légions de Corbulon, inactives et campées au loin dans la Syrie septentrionale, sans doute près de Zeugma. La responsabilité de la catastrophe doit retomber sur les deux généraux : Corbulon, qui se mit trop tard en route pour porter secours aux Romains, quoiqu'il ait marché le plus vite possible, lorsqu'il connut toute l'étendue du désastre; Paetus qui n'osa pas prendre l'énergique résolution de mourir plutôt que de capituler, et perdit ses chances de salut; trois jours de plus et les cinq mille hommes commandés par Corbulon auraient amené le secours tant désiré. La capitulation fut signée aux conditions suivantes : les Romains pourraient se retirer librement; ils évacueraient l'Arménie, en livrant toutes les places qu'ils y occupaient, et tous leurs approvisionnements dont les Parthes avaient grand besoin. Malgré sa victoire, Vologasos se déclarait prêt à demander que le gouvernement impérial investit son frère du royaume d'Arménie, et à envoyer des ambassadeurs à Rome. Si le vainqueur fit preuve d'une si grande modération, c'est peut-être parce qu'il connaissait, mieux que l'armée assiégée, l'approche de Corbulon; il est plus probable pourtant que Vologasos, en homme prévoyant, ne voulut pas renouveler la catastrophe de Crassus et rapporter à Ctésiphon d'autres aigles romaines. La défaite d'une armée romaine n'était pas, il le savait, une victoire sur Rome; il n'achetait pas trop cher, par une grande condescendance de forme, la concession réelle qu'on lui faisait en reconnaissant Tiridatés. |
||||
63 |
Traité de paixRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe gouvernement impérial repoussa encore une fois la proposition du roi des Parthes et prescrivit de continuer la guerre. Il ne pouvait agir autrement; c'était un danger de reconnaître Tiridates avant d'avoir remporté une nouvelle victoire, et, les Parthes ayant déclaré la guerre, il était impossible, du moins on le croyait, d'accepter cette clause comme une conséquence, presque comme la ratification de la capitulation de Rhandeia. De Rome on ordonna aux généraux de reprendre énergiquement la guerre contre les Parthes. Paetus fut rappelé; Corbulon, que l'opinion publique, surexcitée par la capitulation honteuse de Paetus, considérait toujours comme le vainqueur de l'Arménie, et qui était désigné comme le capitaine le plus habile et le seul chef capable de mener la guerre d'Orient par tous ceux qui connaissaient exactement la situation et qui la jugeaient bien, reprit le gouvernement de la Cappadoce et le commandement général de toutes les troupes destinées à cette expédition. Une septième légion fut envoyée de Pannonie. Tous les gouverneurs et tous les princes de l'Orient furent soumis militairement à Corbulon; son autorité était donc à peu près égale aux pouvoirs que l'on avait donnés aux princes Gaius et Germanicus héritiers présomptifs de l'empire, lorsqu'ils furent envoyés en Orient. Si ces mesures devaient préparer une revanche sérieuse et relever l'honneur des armes romaines, elles manquèrent leur but. La paix que Corbulon signa avec le roi des Parthes, peu de temps après la défaite de Rhandeia, nous montre comment il envisageait la situation: elle stipulait que les garnisons parthes évacueraient l'Arménie; les Romains quitteraient les châteaux-forts élevés en Mésopotamie pour défendre les ponts de l'Euphrate. Si les Romains voulaient prendre l'offensive, les ponts de l'Euphrate étaient aussi importants que les garnisons parthes de l'Arménie l'étaient peu; si, au contraire, Tiridatès devait être reconnu comme roi d'Arménie vassal des Romains, les ponts de l'Euphrate étaient inutiles, et les Parthes ne pouvaient tenir garnison en Arménie. Au printemps de l'année 63, Corbulon, d'après les ordres qu'il avait reçus, prit l'offensive; il franchit l'Euphrate près de Mélitène avec ses quatre meilleures légions, et marcha contre les forces réunies des Parthes et des Arméniens, campées aux environs d'Arsamosata. Mais la lutte ne fut pas importante; on détruisit seulement quelques châteaux occupés par des nobles arméniens ennemis de Rome. Cette campagne se termina encore par un traité. Corbulon accepta les propositions des Parthes que son gouvernement avait repoussées peu de temps auparavant, en ce sens que l'Arménie devait toujours être réservée aux cadets des rois parthes, comme le prouve l'histoire postérieure de cette région: Rome, au moins d'après l'esprit du traité, ne devait accorder cette couronne dans l'avenir qu'à un Arsacide. D'après une autre clause, Tiridatès promettait d'enlever publiquement de sa tête, en présence des deux armées, à Rhandeia même, où la capitulation avait été signée, la couronne royale, pour la déposer devant l'image de l'empereur, et de ne la reprendre qu'après l'avoir reçue, à Rome, des mains de Néron ce qui fut exécuté (63). Malgré cette humiliation, il n'en était pas moins vrai que le général romain, au lieu de faire la guerre comme on le lui avait ordonné, avait traité aux conditions que son gouvernement avait déjà rejetées1. Mais les anciens ministres étaient morts ou tenus à l'écart; le règne personnel de l'empereur avait commencé. Le public et surtout Néron ne pouvaient pas ne pas être frappés par la cérémonie de Rhandeia, et par l'espérance de voir le prince parthe demander à Rome l'investiture du royaume d'Arménie. 1. D'après Tacite (Ann., XV, 25, cf. Dion, LXII, 22) Néron, en congédiant avec des paroles bienveillantes les ambassadeurs de Vologasos, leur fit entrevoir qu'une entente serait possible si Tiridatès se rendait personnellement auprès de lui; dans ce cas, Corbulon peut bien avoir agi d'après les instructions de l'empereur. Mais il se pourrait que ce détail fût l'une des additions que l'on a faites dans l'intérêt de Corbulon. Dans le procès qui lui fut intenté quelques années plus tard, tous ces événements furent probablement relatés, puisque ce fut un de ses officiers de la campagne d'Arménie qui fut son accusateur. C'est à tort que l'on a contesté l'identité du préfet de cohortes Arrius Varus (Tacite, Ann., XIII, 9) et du primipile qui porte le même nom (Hist., III, 6, cf. Corp. insc. lat., V, 867). |
||||
66 |
Tiridatès à RomeRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa paix fut ratifiée et le traité exécuté. En l'an 66 le prince parthe vint à Rome, comme il l'avait promis, escorté de trois mille cavaliers parthes, et amenant comme otages les enfants de ses trois frères avec ceux de Monobazos d'Adiabène. Il s'agenouilla sur le forum, devant son suzerain, assis sur le siège impérial, qui, devant tout le peuple, lui ceignit le front du bandeau royal. |
||||
69-96 |
L'Orient sous les FlaviensRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'attitude réservée, on pourrait dire pacifique, des deux adversaires pendant cette lutte qui dura nominalement dix ans, et le traité qui la terminait en donnant l'Arménie aux Parthes sans choquer les susceptibilités du puissant empire d'Occident, eurent d'excellents résultats. L'Arménie, gouvernée par une dynastie nationale que les Romains reconnaissaient, leur était plus soumise qu'auparavant, lorsqu'elle était dominée par des princes étrangers imposés au pays. Une garnison romaine resta au moins dans la Sophène, province immédiatement voisine de l'Euphrate1. On demanda et on obtint la permission de l'empereur pour reconstruire Artaxata; Néron contribua à cette oeuvre en envoyant de l'argent et des ouvriers. Jamais les relations ne furent meilleures entre les deux grands états que l'Euphate séparait, qu'après la conclusion du traité de Rhandeia, pendant les dernières années du règne de Néron et sous les trois empereurs Flaviens. D'autres circonstances y contribuèrent. Les peuplades transcaucasiennes, alléchées peut-être par le rôle qu'elles avaient joué dans les dernières guerres et qui avaient appris le chemin de l'Arménie comme mercenaires soit des Ibériens, soit des Parthes, commencèrent à menacer surtout les provinces occidentales du royaume parthe, mais aussi les provinces orientales de l'empire romain. Ce fut sans doute pour défendre le pays contre ces barbares que Rome, immédiatement après la guerre d'Arménie, en l'an 63, annexa ce que l'on appelait le royaume de Pont, c'est-à-dire le coin Sud-Est de la côte de la mer Noire, avec Trapézonte et la vallée du Phase. La grande expédition d'Orient que Néron était sur le point d'entreprendre, lorsqu'il fut renversé (68), et en vue de laquelle il avait déjà dirigé les meilleures troupes de l'Occident soit vers l'Eypte, soit vers le Danube, avait assurément pour but d'étendre de plusieurs côtés les frontières de l'empire2; mais l'empereur se proposait spécialement d'atteindre les défilés du Caucase au-dessus de Tiflis et de combattre les tribus scythes établies sur le versant septentrional de la montagne, entre autres les Alains3. Ces peuplades menaçaient d'un côté l'Arménie, de l'autre la Médie. L'expédition de Néron était si peu dirigée contre les Parthes, qu'on pouvait croire qu'elle avait été entreprise pour leur porter secours. Ces deux états civilisés de l'Ouest et de l'Est avaient tout intérêt à s'allier contre les hordes sauvages venues du Nord. L'empereur avait amicalement invité Vologasos à lui rendre visite dans Rome même, comme son frère l'avait fait; le roi parthe refusa tout aussi courtoisement; il ne se souciait guère de paraître sur le forum en vassal de l'empire romain, mais il se déclarait prêt à se présenter devant l'empereur s'il venait en Orient. Ce sont les Orientaux, et non les Romains qui ont sincèrement regretté Néron. Le roi Vologasos, dans une adresse officielle au sénat, le priait d'honorer la mémoire de Néron, et plus tard lorsqu'apparut un faux Néron, ce fut surtout chez les Parthes qu'il trouva des sympathies. Pourtant le Parthe avait à rechercher plutôt l'amitié de Rome que celle de Néron. Non seulement il s'abstint de toute attaque pendant l'année si mouvementée des quatre empereurs4, mais encore, devinant l'issue probable de la prochaine bataille décisive, il offrit à Vespasien, qui était resté dans Alexandrie, 40 000 cavaliers pour lutter contre Vitellius, ce dont naturellement on le remercia sans accepter. Mais surtout il se préta sans plus tarder aux mesures qu'adopta le nouveau gouvernement pour protéger la frontière orientale. Vespasien, quand il était gouverneur de Judée, s'était convaincu de l'insuffisance des troupes permanentes cantonnées dans le pays, et lorsqu'il échangea ce gouvernement contre la puissance impériale, il transforma d'abord en province le royaume de Commagène, comme avait fait Tibère; puis il porta de quatre à sept le nombre des légions qui tenaient garnison dans l'Asie romaine. Ce chiffre avait même été dépassé pour la guerre parthe; il le fut aussi lors de la guerre contre les Juifs. Jusqu'alors il n'y avait eu en Asie qu'un seul commandement militaire important, confié au gouverneur de Syrie; Vespasien le divisa en trois. La Syrie, à laquelle on joignit la Commagène, garda ses quatre anciennes légions; les deux provinces de Palestine et de Cappadoce, qui n'étaient occupées auparavant que par des troupes de second ordre, reçurent la première une, la seconde deux légions5. L'Arménie resta, entre les mains des Arsacides, une principauté vassale de Rome; mais, sous Vespasien, un détachement de soldats romains tint garnison au-delà de la frontière arménienne, dans la place forte d'Harmozika, près de Tiflis, en Ibérie6; c'est probablement à la même époque que les Romains établirent leur autorité militaire en Arménie. Toutes ces mesures ne constituaient certes pas une menace de guerre; elles étaient néanmoins dirigées contre l'état voisin de Rome en Orient. Pourtant après la chute de Jérusalem, c'était Vologasos qui le premier avait félicité le fils aîné de l'empereur et lui avait souhaité de consolider la domination romaine en Syrie. Lorsque l'on avait établi des camps de légions en Commagène, en Cappadoce et dans la Petite-Arménie, il n'avait fait aucune objection. Il conseilla même à Vespasien d'entreprendre la fameuse expédition transcaucasienne projetée par Néron, et d'envoyer une armée romaine contre les Alains, sous le commandement d'un des princes impériaux. Vespasien ne voulut pas mettre à exécution un aussi vaste plan; il est néanmoins difficile de croire que la garnison romaine des environs de Tiflis n'ait pas été envoyée pour barrer les défilés du Caucase; elle agissait ainsi dans l'intérêt des Parthes. Quoique Rome se fût fortifiée sur l'Euphrate, ou peut-être parce qu'elle s'était fortifiée, - inspirer le respect à ses voisins, c'est assurer la paix, - les relations restèrent pacifiques pendant toute la période des Flaviens. Sans doute des collisions se produisirent, la guerre menaça même d'éclater, ce qui n'est pas étonnant à cause des changements continuels de dynastie dans les royaumes parthes, mais tous ces nuages disparurent très rapidement7. Pourtant l'apparition d'un faux Néron, dans les dernières années du principat de Vespasien, - ce fut cet imposteur qui provoqua l'Apocalypse de saint Jean - faillit amener un conflit. Ce prétendant, en réalité un certain Terentius Maximus d'Asie Mineure, mais qui ressemblait à s'y méprendre par la figure, la voix et les talents à l'empereur virtuose, non seulement fut très populaire dans les pays romains voisins de l'Euphrate, mais encore trouva des alliés chez les Parthes. A cette époque plusieurs princes, semble-t-il, se disputaient, comme il arriva souvent, la royauté; et l'un d'eux, Artaban, ayant appris que l'empereur Titus s'était déclaré contre lui, soutint la cause de l'imposteur romain. Mais cette révolte n'eut aucune suite; bien plus, le gouvernement parthe peu de temps après livra le faux Néron à l'empereur Domitien8. Un commerce actif, aussi avantageux pour les Parthes que pour les Romains, se faisait entre la Syrie et l'Euphrate inférieure, où le roi Vologasos venait de fonder non loin de Ctésiphon le nouvel emporium de Vologasias ou Vologasocerta; cet état de choses doit avoir aussi contribué à maintenir la paix. 1. A Ziata (Charput) l'on a trouvé deux inscriptions provenant d'un château-fort construit en l'an 64 sur les ordres de Corbulon par une légion qu'il avait menées au-delà de l'Euphrate, la III. Gallica (Eph. epigr., V, p. 25). 2. Néron projetait inter reliqua bella une campagne d'Ethiopie (Pline, VI, 29, 182; cf. 184). C'est pour cette expédition qu'il envoya des troupes à Alexandrie (Tacite, Hist., I, 31, 70). 3. Tacite (Hist., I, 6) et Suétone (Néron, 19) affirment que l'expédition devait se diriger vers les portes Caspiennes, c'est-à-dire vers le défilé du Caucase situé entre Tiflis et VladiKavkas près de Darval, que, suivant la légende, Alexandre aurait fermé avec des portes de fer (Pline, Hist. nat, VI, 11, 30; Josèphe, Bell. Jud., VII, 7, 4; Procop, Bell. Pers., I, 10). D'après cette destination comme d'après les préparatifs généraux de l'entreprise, il est impossible que Néron ait eu le projet de faire la guerre aux Albaniens établis sur le rivage occidental de la mer Caspienne. Il ne peut être question ici et dans un autre passage (Ann., II, 68: ad Armenios, inde Albanos Heniochosque) que des Alains, nommés par Josèphe (loc. cit. et ailleurs), et souvent confondus avec les Albaniens du Caucase. Mais le récit de Josèphe est lui-même erroné. Si c'est par les portes Caspiennes que les Alains ont pénétré en Médie, puis en Arménie avec le consentement du roi des Hyrcaniens, l'auteur veut parler' d'une autre porte Caspienne, à l'Est de Rhagae; alors il s'est trompé, car l'expédition de Néron ne peut pas avoir eu pour but un passage situé au coeur de l'empire parthe. D'ailleurs les Alains n'habitaient pas à l'Est de la mer Caspienne, mais au Nord du Caucase. En vue de cette expédition, la meilleure des légions romaines, la XIVe fut rappelée de Bretagne; elle n'alla pas, il est vrai, plus loin que la Pannonie (Tacite, Hist., II, 11, cf. 27, 60); une nouvelle légion, la Ie Italica, fut créée par Néron (Suét., Néron, 19). On voit par là quelle était l'étendue de l'entreprise. 4. On ne sait pas bien dans quelle circonstance il refusa à Vespasien le titre d'empereur (Dion, LXVI, 11); sans doute ce fut immédiatement après sa révolte, quand il n'était encore que général. Vologasos n'avait pas alors reconnu que les Flaviens seraient les plus forts. Son intercession en faveur des princes de Commagène (Josèphe, Bel. Jud., VII, 3) fut heureuse; mais c'était une démarche purement personnelle, et non une manière de protester contre la transformation de ce royaume en province. 5. Les quatre légions de Syrie sont là III. Gallica, la VI. Ferrata, toutes deux auparavant en Syrie, la IVe Scythica, autrefois en Mésie, mais qui avait pris part aux guerres contre les Parthes et les Juifs, et la XVI Flavia, nouvellement créée. L'unique légion de Palestine est la Xe Fretensis, auparavant en Syrie. Les deux légions de Cappadoce sont la XII. Fulminata, jusqu'alors en Syrie, établie par Titus à Mélitène (Josèphe, Bel. Jud., VII, 1, 3), et la XV. Apollinaris, autrefois en Pannonie, mais qui avait combattu contre les Parthes et les Juifs comme la IV. Scythica. On changea le moins possible les garnisons; on se contenta d'établir en permanence en Syrie deux légions appelées quelque temps auparavant, et d'y envoyer une légion nouvellement créée. Après la guerre contre les Juifs, sous Hadrien, la Vie Ferrata fut transportée de Syrie en Palestine. 6. Vers le même temps (cf. Corp. insc. lat., V, 6988), la Cappadoce fut gouvernée par C. Rutilius Gallicus, dont Stace a dit (I, 4, 78): hunc... timuit..... Armenia et patiens Latii jam pontis Araxes, en faisant allusion sans doute à un pont construit par cette garnison romaine. Le silence de Tacite ne permet guère de croire que Gallicus ait servi sous les ordres de Corbulon. 7. Pline, dans son Panegyrique de Trajan (ch. 14) rappelle, sans doute avec beaucoup d'exagération, que la guerre faillit commencer sur l'Euphrate en l'an 75, pendant le règne de Vespasien, tandis que M. Ulpius Trajanus, le père de l'empereur, était gouverneur de Syrie; la cause en est inconnue. 8. Nous avons des monnaies datées et portant les noms individuels des rois de (V)ologasos (389 et 390 = 77-78), de Pakoros (389-394 = 77-82 et 404-407 = 92-95); d'Artaban 392 = 80-81. Nous ne connaissons pas les synchronismes historiques avant l'époque d'Artaban et de Titus, que Zonaras déclare avoir été contemporains (XI, 18; cf. Suétone, Néron, 57; Tacite, Hist., I, 2); mais les monnaies datent d'une période où les rois changeaient souvent, et même où plusieurs prétendants rivaux frappaient simultanément des monnaies. |
||||
113-117 |
Guerre de Trajan contre les Parthes
Retrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe conflit éclata sous Trajan. Dans les premières années de son règne, cet empereur n'avait pas modifié d'une façon essentielle la situation de l'Orient; il avait seulement changé en districts, administrés directement par Rome, les deux états clients établis sur la lisière du désert de Syrie, l'état nabatéen de Pétra et l'état juif de Caesara Paneas (an 106). Les relations n'étaient pas des plus amicales avec le roi Pakoros, qui gouvernait à cette époque l'empire parthe1: mais la guerre ne commença que sous son frère et successeur Chosroès, toujours à propos de l'Arménie. La faute en fut aux Parthes. Trajan, en donnant au fils de Pakoros, Axidarès, le trône d'Arménie resté vacant, n'avait pas excédé les limites de son droit; mais le roi Chosroès déclara que ce personnage était incapable de régner, et de sa propre autorité proclama roi à sa place un autre fils de Pakoros, Parthomasiris2. Les Romains répondirent à cet acte par une déclaration de guerre. Vers la fin de l'année 1143, Trajan quitta Rome et vint prendre le commandement des troupes romaines de l'Orient, qui d'ailleurs se trouvaient dans un état complet de décadence, mais qui furent rapidement réorganisées par l'empereur et renforcées par des légions pannoniennes plus aguerries4. A Athènes il rencontra les ambassadeurs du roi parthe; ils étaient simplement chargés de lui dire que Parthomasiris était prêt à accepter la couronne d'Arménie comme vassal de Rome; aussi furent-ils congédiés. La guerre commença; dans les premiers combats qui se livrèrent près de l'Euphrate, les Romains furent battus5; mais lorsque le vieil empereur, toujours guerrier et victorieux, se mit lui-même à la tête de ses troupes au printemps de l'année 115, tous les Orientaux se soumirent sans résistance sérieuse. En outre la guerre civile avait encore une fois éclaté chez les Parthes, et un prétendant du nom de Manisaros s'était élevé contre Chosroès. D'Antioche l'empereur marcha vers l'Euphrate, puis vers le Nord jusqu'au camp légionnaire le plus septentrional, Satala, dans la Petite-Arménie; de là il pénétra en Arménie et se dirigea sur Artaxata. Cependant Parthomasiris se présenta devant l'empereur à Elégeia; il enleva le diadème de sa tête, espérant, par cette humiliation, obtenir, comme autrefois Tiridatés, l'investiture de son royaume. Mais Trajan était décidé à transformer en province cet état vassal, et à reculer la frontière orientale de l'empire. C'est ce qu'il déclara au prince parthe devant toute son armée, en lui ordonnant de quitter le camp et l'empire avec toute sa suite; il en résulta une émeute dans laquelle le prétendant périt. L'Arménie se résigna à son sort et devint une province romaine. Les princes des peuples caucasiques, Albani et Iberi, des peuplades qui habitaient plus loin le long de la mer Noire, Apsili, Colchi, Heniochi, Lazes et autres, et même les chefs des tribus sarmates campées au-delà du Caucase furent plus que jamais traités comme des vassaux ou le devinrent alors pour la première fois. Trajan envahit ensuite le territoire des Parthes et occupa la Mésopotamie. Il fit toutes ces conquêtes presque sans tirer l'épée; Batnae, Nisibis, Singara tombèrent entre les mains des Romains; à Edesse l'empereur reçut la soumission non seulement Fronton dans le passage que nous avons cité, Dion d'ailleurs nous raconte (LXVIII, 19) que Trajan prit Samosate sans combat, la XVIe légion qui y tenait garnison en avait donc été chassée. Trajan prit encore une fois ses quartiers d'hiver à Antioche; mais un tremblement de terre y fit périr plus de soldats que la campagne de l'été précédent. Au printemps suivant (an 116), Trajan, le vainqueur des Parthes, ainsi que le Sénat le saluait déjà, partit de Nisibis, franchit le Tigre et envahit l'Adiabène, non sans avoir rencontré quelque résistance au passage du fleuve et plus tard. Ce pays forma une troisième province nouvelle, nommée Assyrie. En descendant le Tigre, l'empereur continua sa marche vers Babylone; Séleucie et Ctésiphon furent prises par les Romains; Trajan s'y empara du trône doré et de la fille du roi; il atteignit la satrapie persane de la Mésène, et la grande cité commerçante située aux bouches du Tigre, Charax Spasinou. Il semble que ce pays ait été lui-même annexé à l'empire, de telle sorte que la nouvelle province de Mésopotamie comprenait toute la région enfermée entre les deux fleuves. Avec son esprit ardent, Trajan devait souhaiter d'être aussi jeune qu'Alexandre, afin de pouvoir quitter les rivages du golfe Persique et porter ses armes dans le monde mystérieux de l'Inde. Mais il s'aperçut bientôt qu'il lui fallait combattre des ennemis plus rapprochés. Jusqu'alors le grand empire parthe n'avait pour ainsi dire pas résisté à l'attaque; il avait même souvent demandé la paix, mais en vain. En revenant de Babylone, Trajan apprit la révolte de la Babylonie et de la Mésopotamie. Tandis qu'il s'attardait aux bouches du Tigre, toute la population de ces nouvelles provinces s'était soulevée contre lui5. Les habitants de Séleucie, sur le Tigre, de Nisibis, d'Edesse même avaient massacré ou chassé les garnisons romaines, puis fermé leurs portes. L'empereur se vit forcé de diviser son armée et d'envoyer un corps de troupes contre chacun des foyers de la révolte. Une des légions, commandées par Maximus, fut cernée en Mésopotamie et massacrée avec son chef. Néanmoins, l'empereur triompha des insurgés, grâce surtout à Lusius Quietus, un chef Mauretanien qui avait déjà fait ses preuves comme général dans la guerre contre les Daces. Séleucie et Edesse furent assiégées et réduites en cendres. Trajan alla jusqu'à déclarer que l'empire parthe devenait un état vassal de Rome; il investit même de la royauté, à Ctésiphon, un partisan des Romains, le Parthe Parthamaspates, quoique les troupes impériales n'eussent pas dépassé la lisière occidentale du grand état. Puis il se remit en route pour la Syrie, en suivant le chemin par lequel il était venu; il s'arrêta, pour attaquer sans succès les Arabes, dans Hatra, résidence du roi des tribus vaillantes qui habitaient le désert de Mésopotamie et place de guerre dont les fortifications puissantes et les magnifiques monuments présentent encore aujourd'hui des ruines imposantes. Trajan avait l'intention de continuer la guerre l'année suivante, et de soumettre réellement les Parthes. Mais la bataille que l'empereur, âgé de soixante ans, avait livrée dans le désert de Hatra aux cavaliers arabes, devait être le dernier acte de sa vie. Il tomba malade et mourut pendant son retour (8 août 117), sans avoir pu compléter sa victoire et célébrer le triomphe à Rome; mais, comme il était juste, cet honneur lui fut décerné après sa mort; il est le seul des empereurs divinisés qui porte encore, comme dieu, un titre tiré du nom d'un peuple vaincu. 1. Ce fait résulte du renseignement que Suidas nous fournit d'après Arrien (au mot ?) : ?, et du soin avec lequel Pline, dans une lettre écrite à l'empereur en l'an 112 (ad Traj., 74), signale les rapports entre Pakoros et le roi des Daces, Décébale. Les dates du règne de Pakoros ne peuvent pas être fixées avec précision. Sous Trajan, il n'y a pas de monnaies parthes portant des noms de rois; il semble qu'on n'ait pas frappé alors de pièces d'argent. Ce fait résulte du renseignement que Suidas nous fournit d'après Arrien (au mot ?), et du soin avec lequel Pline, dans une lettre écrite à l'empereur en l'an 112 (ad Traj., 74), signale les rapports entre Pakoros et le roi des Daces, Décébale. Les dates du règne de Pakoros ne peuvent pas être fixées avec précision. Sous Trajan, il n'y a pas de monnaies parthes portant des noms de rois; il semble qu'on n'ait pas frappé alors de pièces d'argent. 2. Les fragments du récit de Dion (LXVIII, 17) prouvent qu'Axidarès (ou Exédarès) était fils de Pakoros, qu'il fut roi d'Arménie avant Parthomasiris, mais que Chosroès le détrôna; c'est ce qu'établissent également deux fragments d'Arrien (16, ed. Muller); le premier est tiré sans doute d'un discours adressé à Trajan par un ami d'Axidarès, chargé de le défendre: ? kupilogov; on y lit l'exposé des griefs contre Parthomasiris et la réponse de l'empereur; ce n'est pas à Axidares, mais à Trajan de juger Parthomasiris, car c'est lui, - Axidarès, semble-t-il, qui, le premier, a rompu le traité; il en sera puni. On ne sait pas ce que l'empereur veut reprocher par là à Axidarès, mais Chosroès, dans le récit de Dion, affirme qu'il déplut à la fois aux Romains et aux Parthes. 3. D'après les fragments de Dion rapportés par Xiphilin et Zonaras, il est certain que l'expédition contre les Parthes fut divisée en deux campagnes: la première (Dion, LVI, 17, 1; 18, 2; 23-25) eut lieu sous le consulat de Pedo, par conséquent en l'an 115 (c'est aussi la date donnée par Malalas, p. 275, pour le tremblement de terre d'Antioche: 13 déc. 164 de l'ère d'Antioche = 115 ap. J.-C.); la seconde (Dion, ibid., 26-32, 3) est fixée à l'année 116 par l'apparition du titre de Parthicus (cf. 28, 2), que Trajan obtint entre les mois d'avril et d'août de la même année (v. ce que j'ai dit à ce sujet, Droysen, Hellenismus, III, 2, p. 361). Au chap. 23 les surnoms d'Optimus (ce dernier fut donné à Trajan pendant l'année 111) et de ParThicus sont cités sans ordre chronologique; ce qui le prouve, c'est leur réunion et la répétition du second un peu plus loin. Parmi les fragments de Dion, la plupart concernent la première campagne; le ch. 22, 3 et aussi 22, 1, 2 se rapportent à la seconde. Les salutations impériales de l'empereur ne sont pas une objection. En l'an 113 il était imp. VI (Corp. insc. lat., VI, 960); en l'an 114, imp. VII (Corp. insc. lat., IX, 1558, etc.); en l'an 115, imp. IX (ibid., IX, 5894, etc.), et imp. XI (Fabretti, 398, 289, etc.); en l'an 116, imp. XII (Corp. insc. lat., VIII, 621; X, 1634), et XIII (ibid., III, Dipl., XXVII). Dion rapporte que Trajan fut salué imperator en l'an 115 (LXVIII, 19), et de nouveau en l'an 116 (ibid., 28): cela est parfaitement possible, et il n'y a aucune raison de rapporter le titre d'imp. VII à la conquête de l'Arménie, comme on a voulu le faire. 4. Fronton, pour nous décrire l'armée de Syrie au temps de Trajan (p. 206 et suiv., ed. Naber), emploie presque les mêmes termes que Tacite lorsqu'il fait le tableau de l'armée de Corbulon (Ann., XIII, 15): Les troupes romaines s'étaient depuis longtemps déshabituées du service militaire; elles avaient perdu toute leur valeur (ad ignaviam redactus); mais les soldats les plus pitoyables étaient ceux de Syrie, insoumis, turbulents, ne répondant jamais ponctuellement à l'appel; ivres dès midi, on ne pouvait les trouver à leur poste; ils ne portaient même plus leur équipement; ils étaient incapables de supporter les fatigues, ils abandonnaient leurs armes l'une après l'autre, et marchaient à moitié nus comme les troupes légères et les tirailleurs. En outre ils étaient tellement démoralisés par leurs échecs qu'ils tournaient le dos dès qu'ils voyaient les Parthes, et que le son des trompettes était pour eux le signal de la fuite. Lorsqu'au contraire Fronton nous décrit l'attitude de Trajan, il dit : Il ne parcourait jamais les tentes sans s'inquiéter de chaque soldat en particulier; mais il montrait son dédain pour le luxe syrien, et se plaisait à considérer les rudes Pannoniens (sed contemnere c'est ainsi qu'il faut lire - Syrorum munditias, introspicere Pannoniorum inscitias); il jugeait les aptitudes (ingenium) d'un homme d'après sa tenue (cullus). De même dans l'armée orientale de Sévère les soldats européens sont distingués des soldats de Syrie (Dion, LXXV, 12). 5. C'est ce qu'indiquent les mala praelia signalés par Fronton dans le passage que nous avons cité, Dion d'ailleurs nous raconte (LXVIII, 19) que Trajan prit Samosate sans combat, la XVIe légion qui y tenait garnison en avait donc été chassée. 6. Il se peut que l'Arménie se soit révoltée à la même époque. Gutschmid (cité par Dierauer dans les Untersuchungen de Budinger, I, p. 179) prétend que Méherdatés et Sanatrukios, donnés par Malalas comme rois de Perse pendant la guerre de Trajan, étaient rois de l'Arménie, au moment où elle abandonna de nouveau le parti de Rome; mais il n'arrive à cette interprétation que par une série de corrections hasardées, qui dénaturent les noins de personnes et les noms de peuples et qui modifient entièrement le récit. D'ailleurs il se trouve dans la série des légendes confuses de Malalas quelques faits historiques, par exemple l'avènement à la royauté parthe de Parthamaspatès (fils du roi Chosroès d'Arménie), protégé par Trajan; de même les dates du départ de l'empereur pour l'Orient en octobre 114, de son arrivée à Séleucie en décembre et de son entrée dans Antioche en janvier 115 peuvent être exactes. Mais, dans l'état où ces récits nous sont parvenus, l'historien ne peut que les négliger. Il ne doit pas essayer de les rectifier. |
||||
117-161 |
Réaction sous Hadrien et AntoninRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugustePour le moment l'on agit d'autre façon. La lueur dont les conquêtes de Trajan en Orient éclairèrent le soir obscur de l'empire romain ressemble aux éclairs dans la nuit sombre; elle n'est pas plus qu'eux la lumière d'une nouvelle aurore. Le successeur de Trajan dut choisir entre deux alternatives : ou soumettre complètement les Parthes ou abandonner cette oeuvre inachevée. Or il était impossible de reculer partout les frontières de l'empire sans augmenter considérablement l'armée et le budget; et déplacer vers l'Est le centre de gravité avait comme conséquence inévitable un agrandissement sensible de l'Etat. Hadrien et Antonin suivirent tout à fait les errements des premiers empereurs. Hadrien cessa de soutenir Parthamaspates, roi des Parthes, vassal des Romains, et lui donna une compensation. Il évacua la Syrie et la Mésopotamie, et rendit volontairement ces provinces à leur ancien maître. Il renvoya au roi parthe sa fille faite prisonnière par Trajan. Le pacifique Antonin restitua aux Parthes le trône doré de Ctésiphon, signe permanent de la victoire remportée sur eux. L'un et l'autre empereur étaient sérieusement décidés à vivre en paix et en relations d'amitié avec leur voisin; jamais les rapports entre les entrepôts romains de la frontière orientale de Syrie et les villes commerciales de l'Euphrate ne semblent avoir été plus fréquents qu'à cette époque. L'Arménie cessa de même d'être une province romaine et redevint ce qu'elle était auparavant, un royaume vassal de Rome, réservé aux cadets de la dynastie parthe1. Les rois des Albaniens et des Ibériens du Caucase, et les nombreux principicules qui habitaient le coin Sud-Est du rivage de la Mer Noire2 restèrent également soumis à l'autorité romaine. Les garnisons furent établies non seulement sur la côte, à Apsaros3 et dans la vallée du Phase, mais encore, sous Commode, en Arménie non loin d'Artaxata. Tous ces états dépendaient militairement du commandant de la Cappadoce4. Mais cette suprématie, indéterminée par sa nature même, fut conçue, principalement par Hadrien5, beaucoup plutôt comme un droit de protection que comme une suzeraineté proprement dite; au moins les plus puissants de ces princes vassaux furent-ils libres d'agir à leur guise. Nous avons déjà dit que les Parthes et les Romains avaient autant d'intérêt les uns que les autres à repousser les peuplades sauvages qui habitaient au-delà du Caucase; cet état de choses fut encore plus prononcé à cette époque, et a certainement contribué à rapprocher les deux grands états. Vers la fin du règne d'Hadrien, les Alains, avec la connivence, semble-t-il, du roi d'Ibérie, Pharasmanès II, qui était chargé de défendre contre eux les défilés du Caucase, envahirent les pays du Sud et ravagèrent non seulement le territoire des Albaniens et des Arméniens, mais encore la province parthe de Médie et la province romaine de Cappadoce. Les Parthes et les Romains ne s'allièrent pas formellement, il est vrai, pour faire la guerre, quoique l'or du roi de Ctésiphon Vologasos III, qui régnait alors, et la mise en mouvement des troupes romaines de Cappadoce6 aient décidé les Barbares à battre en retaite; mais les intérêts des deux empires n'en restaient pas moins communs, et ce qui prouve leur union, c'est que les Parthes vinrent à Rome exposer leurs griefs contre Pharasmanès d'Ibérie7. 1. Il est impossible qu'Hadrien ait rompu les liens de vassalité qui rattachaient l'Arménie à Rome. Les termes de son biographe (c. 21) Armeniis regem habere permisit, cum sub Trajano legatum habuissent conduisent à la conclusion opposée; à la fin du règne d'Hadrien, nous trouvons dans l'armée du gouverneur de Cappadoce le contingent des Arméniens (Arrien, Contra Alanos, 29). Antonin non seulement décida les Parthes par ses préparatifs à ne pas envahir l'Arménie, comme ils en avaient l'intention (Vita, 9), mais encore il fit de ce pays un royaume réellement vassal (Monnaies des années 140-144, Eckhel, VII, p. 15). De plus les Ibères étaient certainement les vassaux de Rome sous Antonin, puisque les Parthes ne purent formuler de griefs contre leurs rois; l'Arménie devait donc se trouver dans la même situation. Les noms des rois d'Arménie de ce temps ne sont pas connus. Si les proximae gentes, dont Hadrien donna la royauté au prince parthe que Trajan avait élevé sur le trône de Ctésiphon (Vila, c. 5), sont vraiment les Arméniens, ce qui n'est pas invraisemblable, il en résulte à la fois que l'Arménie dépendait toujours de Rome et qu'elle était toujours gouvernée par des Arsacides. De même ??Mevlas, qui construisit dans son royaume un tombeau pour son frère Aurelius Mérithatès mort à Rome (Corp. insc. graec, 6559), appartient par son nom à la famille des Arsacides. Mais il ne peut guère être le roi d'Arménie couronné par Vologasos IV et détrôné par les Romains (p. 245); s'il avait été fait prisonnier et conduit à Rome, nous le saurions; en ce cas il n'aurait guère pu se donner, dans une inscription romaine, le nom de Grand-Roi d'Arménie. 2. Arrien (Peripl., c. 15) cite comme vassaux de Trajan ou d'Hadrien les Heniochi ou Nachelones (cf. Dion, LXVIII, 18; LXXI, 14), les Lazae (cf. Suidas au mot Aquet'avos) auxquels Antonin donna un roi (Vita, 9); les Apsilae, les Abosgi, les Sanigae, tous peuples établis en-deçà de la frontière impériale qui atteignait Dioskurias (Sebastopolis); au-delà de cette frontière, dans l'état vassal du Bosphore, les Zichi ou Zinchi (ibid., c. 27). 3. Outre le témoignage d'Arrien (Peripl., c. 7) nous avons, pour confirmer ce fait, une inscription qui nous révèle l'existence d'un officier du temps d'Hadrien, praepositus numerorum tendentium in Ponto Absaro (Corp. insc. lat., X, 1202). 4. Cf. p. 247, n. 1. De même le détachement qui occupait Valarchapat (Etchmiazin), près d'Artaxata, et qui se composait probablement de 1000 hommes (il était commandé par un tribun) appartenait à une des légions de Cappadoce (Corp. insc. lat., III, 6052). 5. On a souvent parlé des efforts que fit Hadrien pour conserver l'amitié des princes vassaux de l'Orient, non sans remarquer à ce propos qu'il s'est montré trop indulgent pour eux (Vita, c. 13, 17, 21). Pharasmanès d'Ibérie ne vint pas à Rome malgré l'appel d'Hadrien; mais il s'y rendit sur l'invitation d'Antonin (Vita Hadr., 13, 21; Vita Pii, 9; Dion, LXIX, 15, 2, fragment qui concerne le règne d'Antonin). 6. Nous possédons encore, parmi les petits écrits de Flavius Arrianus, gouverneur de la Cappadoce sous Hadrien, le remarquable récit qu'il a fait de la mobilisation des troupes de Cappadoce contre les Scythes; lui-même était alors près du Caucase dont il surveillait les passages (Lydus, De mag., III, 53). 7. C'est ce que nous apprennent les fragments de Dion, cités par Xiphilin, par Zonaras et dans les Excerpta; Zonaras a conservé la bonne leçon 'Alavo! au lieu de 'AW6avo!. Ce sont les extraits d'Ursinus (LXXII) qui nous signalent l'invasion des Alains sur le territoire des Albaniens eux-mêmes. |
||||
161-180 |
Guerre contre les Parthes sous Marc-Aurèle et VerusRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe fut encore le Parthe qui troubla la situation. La suprématie des Romains sur l'Arménie a tenu dans l'histoire le même rôle que la domination des empereurs d'Allemagne sur l'Italie; quoiqu'elle fût nominale, elle n'en était pas moins considérée toujours comme un empiètement et ne cessait d'être une cause de guerre. Déjà sous Hadrien le conflit était imminent; mais cet empereur réussit, dans une entrevue avec le prince des Parthes, à conserver la paix. Sous Antonin, on crut encore une fois que les Parthes allaient envahir l'Arménie; il se montra ferme et sut les en détourner. Néanmoins cet empereur, le plus pacifique de tous, auquel la vie d'un seul citoyen tenait plus à coeur que la mort de mille ennemis, dut, dans les dernières années de son règne, se préparer au combat et renforcer les armées d'Orient. A peine avait-il fermé les yeux (an 161), que l'orage, depuis longtemps menaçant, éclata. Sur l'ordre du roi Vologasos IV, le général perse Chosroès1 envahit l'Arménie et proclama roi le prince arsacide Pakoros. Le gouverneur de Cappadoce, Severianus, fit son devoir; il conduisit les troupes romaines au-delà de l'Euphrate. Les deux armées se rencontrèrent près d'Elégeia, à l'endroit même où trente ans auparavant Parthomasiris, élevé par les Parthes sur le trône d'Arménie, s'était en vain humilié devant Trajan. Les troupes romaines furent non seulement défaites, mais anéanties après trois jours de luttes; leur malheureux chef se donna la mort, comme jadis Varus. Les Orientaux vainqueurs ne se contentèrent pas d'occuper l'Arménie; ils passèrent l'Euphrate et firent irruption en Syrie. L'armée qui campait dans cette province fut battue, et l'on craignit la défection des Syriens. Le gouvernement romain ne pouvait pas hésiter. Les troupes de l'Orient avaient prouvé dans cette circonstance leur peu de valeur militaire; en outre, elles venaient d'être affaiblies et démoralisées par leur défaite; de nouvelles légions furent envoyées de l'Ouest, du Rhin même, sur la frontière orientale, et des levées d'hommes se firent jusqu'en Italie. L'un des deux nouveaux empereurs, Lucius Verus se rendit lui-même en Orient (an 162) pour prendre le commandement suprême de l'armée. Il n'était ni guerrier ni fidèle au devoir; il ne fut pas à la hauteur de sa tâche, et de ce qu'il fit en Orient, il n'y a guère rien à dire sinon qu'il y épousa sa nièce, et qu'il fut la risée d'Antioche à cause de son enthousiasme pour le théâtre; mais les gouverneurs de Cappadoce, d'abord Statius Priscus, puis Martius Verus, et celui de Syrie Avidius Cassius2, les meilleurs généraux de l'époque, défendirent mieux que l'empereur les intérêts de Rome. Une fois encore, avant que le combat ne fût engagé, les Romains offrirent la paix - Marc-Aurèle désirait éviter cette rude guerre, - mais Vologasos repoussa durement les propositions raisonnables de l'empereur. L'adversaire pacifique fut aussi le plus fort. L'Arménie fut immédiatement reconquise; dès l'année 163 Priscus s'empara de la capitale Artaxata et la détruisit. Non loin de là fut bâtie par les Romains la ville de Kainèpolis, en arménien Nor-Khalakh ou Valarchapat (Etchmiazin), la nouvelle capitale du pays, qui reçut une forte garnison3. L'année suivante Pakoros fut remplacé sur le trône de la Grande-Arménie par Sohaemos, Arsacide de naissance, mais sujet et sénateur romain4. En droit, la situation de l'Arménie n'était donc pas changée; néanmoins les liens qui l'unissaient à Rome devenaient plus étroits. La lutte fut plus sérieuse en Syrie et en Mésopotamie. La ligne de l'Euphrate fut courageusement défendue par les Parthes; après un combat très vif à Sura, sur la rive droite, les Romains emportèrent d'assaut la forteresse de Niképhorion (Ragga) située sur la rive gauche. La bataille fut encore plus chaude lorsque les Romains franchirent le fleuve à Zeugma; mais dans la rencontre décisive d'Europos (Djerabis au Sud de Biredjik), la victoire resta aux Romains. Ils envahirent à leur tour la Mésopotamie. Edesse fut assiégée; Dausara, cité voisine, fut prise; les Romains parurent devant Nisibis; le général parthe se sauva en traversant le Tigre à la nage. De la Mésopotamie les Romains pouvaient marcher sur Babylone. Plusieurs satrapes abandonnaient déjà la cause du Grand-Roi vaincu; Séleucie, la grande capitale des Jellènes de l'Euphrate, ouvrit d'elle-même ses portes aux Romains; mais elle fut plus tard réduite en cendres, parce que les bourgeois furent accusés à tort ou à raison d'entretenir des relations avec les ennemis. La capitale parthe, Ctésiphon, fut également prise et détruite; au début de l'année 165, le sénat pouvait donner avec justice aux deux empereurs le nom de vainqueurs des Parthes. Pendant la campagne de cette même année, Cassius pénétra jusqu'en Médie, mais la peste qui éclata dans cette région décima les troupes et força les Romains à revenir en arrière; elle hâta peut-être aussi la conclusion de la paix. Le résultat de la guerre fut pour Rome la conquête de la Mésopotamie occidentale; les princes d'Edesse ou de l'Osrhoène furent soumis à la suzeraineté romaine, et la ville de Karrhae, qui depuis longtemps soutenait le parti des Grecs, devint une ville libre sous le patronage de Rome5 L'étendue des territoires annexés à l'empire n'était pas considérable, eu égard au succès complet des opérations militaires; mais elle n'en était pas moins importante, parce que les Romains prenaient pied sur la rive gauche de l'Euphrate. Les autres régions occupées furent rendues aux Parthes et le statu quo fut rétabli. En somme on abandonnait de nouveau la politique modérée suivie par Hadrien et l'on marchait sur les brisées de Trajan. Ce changement est d'autant plus remarquable que Marc-Aurèle ne peut pas être soupçonné d'avoir agi par ambition et par esprit de conquête; tout ce qu'il fit, il le fit par nécessité et en restant dans les bornes fixées. 1. C'est ainsi qu'il est nommé par Lucien (Quomodo sil hist. conscr., 21); si le même auteur l'appelle ailleurs Othryades (Alex., 27), c'est qu'il emprunte ce nom à l'un de ces historiens qu'il raille dans le premier ouvrage et dont l'un hellénise le nom de Chosroès en Oxyroès (Quomodo sit hist. conscr., c. 18). 2. Lorsque la guerre éclata, la Syrie était administrée par L. Attidius Cornelianus (Corp. insc. graec., 4661, de l'an 160; Vila Marci, 8; Corp. insc. lat., III, 129, de l'an 162); elle le fut ensuite par Julius Verus (ibid., III, 199, sans doute de l'an 163); enfin par Avidius Cassius, depuis l'année 164 selon toute apparence. Ce ne peut être qu'après le départ de l'empereur Verus que Cassius reçut le commandement général de toutes les provinces orientales (Philostrate, Vit. sophist., 1, 13; Dion, LXXI, 3) comme l'avait eu Corbulon, en tant que légat de Cappadoce; tant que Verus fut nominalement le chef suprême, il est impossible que Cassius ait joui de cette dignité. 3. Il est rapporté dans un fragment, de Dion sans doute (Suidas, au mot Maptios), que Priscus fonda en Arménie la Karvin Trois et y établit une garnison romaine, que son successeur Martius Verus calma une agitation nationale qui s'était produite dans la région, et proclama cette ville la première du pays. C'est Valarchapat (?tiomn chez Agathangelus) qui fut depuis la capitale de l'Arménie. Karvin Toms, comme Kiepert me l'apprend, est, d'après Stilting, la traduction de l'arménien Nor-Khalakh; quant à l'autre nom de Valarchapat, il est sans cesse employé par les auteurs arméniens du cinquième siècle à côté du nom habituel. Moïse de Khorène raconte, d'après Bardésanès, que cette ville fut fondée par une colonie de Juifs, sous le roi Tigranès VI, qui régna, dit-il, de 150 à 188. Ce serait, d'après cet auteur, son fils Valarch II (188-208) qui aurait bâti les fortifications de la ville et lui aurait donné son nom. En l'an 185 une garnison romaine importante occupait Valarchapat, comme le prouve une inscription (Corp. insc. lat., II, 6052). 4. Sohaemos était Achéménide et Arsacide (ou prétendait l'être) avant de monter sur le trône de la grande Arménie; il était fils de roi et roi lui-même en même temps que sénateur et consul romain; c'est ce que nous dit son contemporain Jamblique (c. 10 de l'extrait de Photius). Il appartenait sans doute à la famille des princes d'Hémèse (Josèphe, Bell. Jud., XX, 8, 4 et ailleurs). Si Jamblique le Babylonien écrit sous lui, il faut entendre simplement par là qu'il a composé son roman à Artaxata. Il n'est dit nulle part que Sohaemos ait été roi d'Arménie avant Pakoros; d'un autre côté ni les termes de Fronton (p. 127) : quod Sohaemo potius quam Vologaeso regnum Armeniae dedisset, aut quod Pacorum regno privasset, ni le fragment de Dion (?) (LXXI, 1): ?, ne permettent de conclure avec quelque vraisemblance que Sohaemos ait été rétabli sur le trône; au contraire les monnaies qui portent la légende Rex Armeniis datus (Eckhel, VII, 91; cf. Vita Veri, 7, 8) excluent en fait cette hypothèse. Nous ne connaissons pas le prédécesseur de Pakoros; nous ne savons même pas si le trône était vacant ou occupé, lorsqu'il y monta. 5. C'est ce que nous prouvent les monnaies royales municipales de la Mésopotamie. La tradition ne nous donne aucun renseignement sur les conditions de la paix. |
||||
193-195 |
Guerre de Sévère contre les ParthesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'empereur Sévère s'avança plus loin et plus résolument dans la même voie. Pendant l'année 193 qui vit trois empereurs, la guerre avait éclaté entre les légions de l'Occident et de l'Orient; ces dernières avaient été vaincues avec Pescennius Niger. Les princes orientaux vassaux de Rome, et le roi des Parthes Vologasos V, fils de Sanatrukios, avaient, cela se comprend, reconnu Niger et mis leurs troupes à sa disposition. Celui-ci avait d'abord refusé; mais, lorsque ses affaires prirent une mauvaise tournure, il accepta ce secours. La plupart des vassaux de Rome, et surtout le roi d'Arménie, se tinrent prudemment en arrière. Seul le roi d'Edesse Abgaros fournit le contingent que Niger lui demandait. Les Parthes promirent leur aide : des troupes furent envoyées à Niger, au moins des districts les plus voisins, par Barsemias, prince d'Hatra dans le désert de Mésopotamie, et par le satrape d'Adiabène, dont la province était située au-delà du Tigre. Après la mort de Niger (an 194), ces étrangers non seulement restèrent dans la Mésopotamie romaine, mais encore ils réclamèrent le retrait des garnisons romaines établies dans le pays et la restitution du territoire conquis1. C'est alors que Sévère envahit la Mésopotamie et occupa toute cette contrée, si étendue et si importante. De Nisibis une expédition fut dirigée contre le prince arabe d'Hatra; mais on ne put pas s'emparer de cette forte citadelle; de même les généraux de Sévère n'obtinrent au-delà du Tigre aucun résultat important dans leur campagne contre le satrape d'Adiabène2. 1. Les premières lignes du fragment ursinien de Dion (LXXV, 1, 2) sont confuses. L'Osrhoene était alors romaine, l'Adiabène parthe; de qui ces deux provinces faisaient-elles défection ? pour qui les habitants de Nisibis avaient-ils pris parti? L'hypothèse que leur ennemi aurait envoyé une ambassade à Sévère après avoir été vaincu par lui est incompatible avec le cours du récit; car c'est parce que ces ambassadeurs font à Sévère des propositions inacceptables, que l'empereur commence la guerre. Vraisemblablement le soutien que les peuples vassaux des Parthes avaient donné à Niger et l'alliance faite avec ceux des Romains qui avaient pris son parti sont considérés comme un abandon de la cause de Sévère. Si les mêmes gens ont prétendu ensuite qu'ils avaient l'intention de soutenir Sévère, c'était évidemment un faux-fuyant. Les habitants de Nisibis ont peut-être refusé de faire cause commune avec eux; c'est pourquoi ils avaient été attaqués par les partisans de Niger. Nous comprenons alors également ce que Dion (LXXV, 2) veut dire dans le fragment rapporté par Xiphilin, quand il avance que la rive gauche de l'Euphrate était pour Sévère un pays ennemi, excepté Nisibis; il n'est donc pas nécessaire de supposer que Nisibis fût déjà une ville romaine; au contraire, suivant toute apparence, elle ne le devint que grâce à Sévère. 2. Comme les guerres contre les Arabes et l'Adiabène étaient en réalité dirigées contre les Parthes, il est naturel que l'empereur ait pris à cette occasion les titres de Parthicus Arabicus et Parthicus Adiabenicus. Ces dénominations se rencontrent en effet; mais le plus souvent Parthicus est omis, évidemment parce que, excusavit Parthicum nomen, ne Parthos lacesseret, comme le dit le biographe de Sévère (c. 9). Ces données s'accordent très bien avec les renseignements que Dion (LXXV, 9, 6) nous fournit relativement à l'année 195 sur le traité de paix conclu avec les Parthes et l'abandon en leur faveur d'une portion de l'Arménie. |
||||
198 |
Province de MésopotamieRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa Mésopotamie, au contraire, c'est-à-dire toute la région comprise entre l'Euphrate et le Tigre jusqu'à Chaboras, fut réduite en province romaine et occupée par deux légions nouvelles, dont la création était devenue nécessaire après cette conquête. La principauté d'Edesse resta sous la suzeraineté de Rome; mais ce ne fut plus un pays frontière; elle était entourée de tous côtés par des provinces impériales. La capitale de cette nouvelle province et la résidence du gouverneur fut la ville considérable et fortifiée de Nisibis, qui porta dès lors le nom de l'empereur et fut organisée en colonie romaine. Rome avait donc enlevé à l'empire parthe un territoire important, et avait usé de ses forces militaires contre deux satrapes qui dépendaient de cet Etat; aussi le Grand-Roi n'hésita plus à se mettre en route avec son armée, pour marcher contre les Romains : Sévère offrit la paix et proposa de céder une partie de l'Arménie en compensation de la Mésopotamie. Mais la décision par la voie des armes n'était qu'ajournée. Sévère dut partir pour l'Occident, où le rappelaient les intrigues de son compétiteur en Gaule; les Parthes profitèrent de son absence pour rompre la paix1 et envahir la Mésopotamie. Le prince d'Osrhoène fut chassé; son royaume fut occupé, et le gouverneur Laetus, un des meilleurs capitaines de cette époque, fut assiégé dans Nisibis. Il courait les plus grands dangers, lorsque Sévère, après avoir triomphé d'Albinus, reparut en Orient (an 198). La fortune de la guerre changea. Les Parthes reculèrent, et l'empereur reprit l'offensive. Il pénétra en Babylonie, et s'empara de Séleucie et de Ctésiphon. Le roi des Parthes s'enfuit avec quelques cavaliers; son trésor tomba entre les mains des vainqueurs; la capitale de son royaume fut livrée aux soldats romains, et plus de 100,000 prisonniers furent vendus comme esclaves à Rome sur le marché. Il est vrai que les Arabes d'Hatra se défendirent mieux que les Parthes. Sévère fit de vains efforts, à deux reprises différentes, pour forcer cette citadelle du désert. Mais en somme, les deux campagnes de 198 et de 199 se terminèrent par une complète victoire. Depuis que la Mésopotamie était devenue une province romaine et un grand commandement militaire, l'Arménie n'était plus dans la position fausse où elle s'était trouvée jusqu'alors. On pouvait désormais la laisser dans sa situation actuelle et renoncer à l'annexer formellement. Cette province conserva troupes indigènes, et même le gouvernement impérial lui donna plus tard pour aider à leur entretien une subvention sur le fisc2. 1. Hérodien (V, 9, 2) nous apprend que l'Arménie elle-même tomba en leur pouvoir; il est vrai que son récit est confus et défectueux. 2. Lorsque les anciennes relations qui existaient entre Rome et l'Arménie furent rétablies par la paix signée en 218, le roi d'Arménie espera que Rome allait recommencer à lui donner des subventions annuelles (Dion, LXXVIII, 27). Il est impossible d'admettre qu'au temps de Sévère et avant lui l'empire ait payé aux Arméniens un tribut proprement dit. Ce n'est pas d'ailleurs ce qu'exprime le texte de Dion. Il faut donc l'interpréter comme nous l'avons fait. Au IVe et au Ve siècle le château-fort de Biriparakh dans le Caucase, qui défendait le défilé de Dariel, fut occupé avec une subvention de Rome par les Perses, qui depuis le traité de 364 jouaient dans ce pays le rôle de maîtres: cette subvention fut de même considérée comme un tribut (Lydus, de Mag., III, 52, 53; Priscus, fr. 3, ed. Muller). |
||||
211 |
Changement de régime en Occident et en OrientRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes changements qui se produisirent dans l'organisation intérieure des deux empires eurent une grande influence sur l'histoire postérieure de leurs relations. Sous la dynastie de Nerva comme sous le règne de Sévère, la monarchie romaine relativement stable avait triomphé de l'état parthe déchiré sans cesse par la guerre civile et par les luttes des prétendants. Mais après la mort de Sévère la paix intérieure disparut de l'empire romain, et pendant près d'un siècle on vit se succéder au pouvoir des souverains pitoyables pour la plupart et surtout éphémères, qui ne savaient être envers les peuples étrangers qu'arrogants ou faibles. Tandis que l'Occident dégénérait, l'Orient se relevait. Peu d'années après la mort de Sévère (an 211), l'Iran fut bouleversé par une révolution, qui ne renversa pas seulement, comme tant d'autres crises précédentes, le souverain du jour, qui ne se contenta même pas de substituer une dynastie aux Arsacides vieillis, mais qui, donnant un puissant essor aux éléments nationaux et religieux, remplaça la civilisation bâtarde introduite par l'hellénisme dans l'état parthe, par l'organisation politique, les croyances, les coutumes, et les princes du pays qui avait fondé jadis l'ancien empire perse, et qui, depuis l'avènement de la dynastie parthe, avait conservé, en même temps que les tombeaux de Darius et de Xerxés, les germes de la résurrection du peuple. La grande royauté perse détruite par Alexandre fut reconstruite par les Sassanides. Jetons un regard sur ce nouvel aspect des choses, avant de poursuivre l'histoire des Parthes et des Romains en Orient. |
||||
224 |
Les SassanidesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteNous avons déjà dit que la dynastie parthe, quoiqu'en réalité elle eût chassé l'hellénisme de l'Iran, avait été considérée par la nation comme un gouvernement pour ainsi dire illégitime. Artahchatr ou, en nouveau persan, Ardachir, suivant l'historiographie officielle des Sassanides, apparut pour venger la mort de Dara tué par Alexandre, pour rendre le pouvoir à la famille légitime, et pour la faire renaître telle qu'elle était au temps des ancêtres, avant le régime des rois vassaux. Cette légende contient une bonne part de vérité. La dynastie qui porte le nom de Sasan, grand-père d'Ardachir, n'est pas autre chose que la dynastie royale de la Perse proprement dite; le père d'Ardachir, Papak ou Pabek1, et avant lui un grand nombre de ses aïeux, avaient, sous l'autorité suprême des Arsacides, tenu le sceptre dans ce berceau de la nation iranienne2: leur résidence était Istachr, non loin de l'antique Persépolis, et leurs monnaies portaient des légendes en écriture et en langue iraniennes ainsi que les emblèmes sacrés de la religion nationale, tandis que les Grands-Rois, établis dans une province frontière à moitié grecque, faisaient frapper leurs monnaies sur le modèle des pièces grecques et graver des légendes grecques. La base du système politique iranien, c'est-à-dire la grande royauté superposée à des royautés vassales, ne fut pas plus différente sous les deux dynasties, que l'organisation de l'empire allemand sous les empereurs saxons et sous les empereurs souabes. Si l'histoire officielle représente le règne des Arsacides comme l'époque des royautés vassales et fait d'Ardachir le premier souverain commun de tout l'Iran, depuis la mort du dernier Darius, c'est parce que dans l'ancien empire perse, la situation de la Perse proprement dite vis-à-vis des autres provinces, et par conséquent du pays des Parthes était la même que celle de l'Italie vis-à-vis des autres régions de l'empire romain. Les Perses prétendent que les Parthes ne sont pas des rois légitimes, parce que la grande royauté appartient de droit à leur patrie3. 1. Dans l'inscription citée p. 257, note 2, Artaxarès donne à son père Papakos le titre de roi; mais nous ne savons comment accorder ce renseignement, non seulement avec la légende indigène (dans Agathias, II, 27), qui fait de Pabek un cordonnier, mais encore avec le passage du contemporain Dion (si toutefois c'est bien à lui que Zonaras, XII, 15, a emprunté ces mots), qui compte Artaxarès. Naturellement les historiens romains prennent parti pour l'Arsacide légitime et faible contre l'usurpateur dangereux. 2. Noldeke dit (Tabari, p. 449) : Ce qui distingue surtout l'empire des Sassanides de celui des Arsacides c'est que dans l'un les principaux pays de la monarchie sont directement soumis à la couronne et dans l'autre les différentes provinces ont de vrais rois. Dans ce cas la puissance de la royauté dépend donc essentiellement de la personnalité du roi; elle a dû être beaucoup plus considérable sous les premiers Sassanides que sous les derniers Arsacides dégénérés. Mais on ne peut pas trouver entre les deux régimes de différence fondamentale. Depuis Mithridate I, le véritable créateur de la dynastie, les rois Arsacides se sont appelés Rois des Rois, comme plus tard les Sassanides, tandis qu'Alexandre le Grand et les Séleucides n'ont jamais porté ce titre. De même sous ces princes grecs, il y avait quelques rois vassaux, par exemple dans la Perside (p. 255, n. 2); mais la forme régulière de l'administration impériale n'était pas alors la royauté vassale, et les rois grecs n'ont pas porté le titre de Grand-Roi, pas plus que les Césars ne l'ont fait sous prétexte que leur empire comprenait les royaumes de Cappadoce ou de Numidie. Les satrapes de l'état arsacide sont essentiellement les Marzbanes des Sassanides. Ce qui est plus probable, c'est que la royauté arsacide n'a pas connu les grands dignitaires impériaux, qui, dans l'organisation politique des Sassanides, correspondent aux fonctionnaires supérieurs de la constitution de Dioclétien et de Constantin, et qui en ont été sans doute le modèle. Il y a d'ailleurs entre les deux régimes les mêmes rapports qu'entre l'empire d'Auguste et celui de Constantin. Mais nous ne connaissons pas assez l'organisation de l'empire arsacide pour affirmer cela avec certitude. |
||||
224-651 |
Etendue de l'empire des SassanidesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'empire des Sassanides était-il plus ou moins grand que celui des Arsacides ? C'est là une question, à laquelle la tradition ne donne aucune réponse suffisante. Depuis que la nouvelle dynastie fut solidement établie sur le trône, toutes les provinces de l'Ouest lui furent soumises, et les prétentions que celle-ci éleva en face des Romains dépassaient de beaucoup, autant que nous pouvons le connaître, celles des Arsacides. Nous ne savons pas jusqu'où s'étendait vers l'Est la domination des Sassanides, et si elle a atteint l'Oxus, qui fut plus tard regardé comme la frontière légitime de l'Iran et du Touran1. 1. D'après des notes perses conservées dans la chronique arabe de Tabari, et qui datent des derniers Sassanides, Ardachir, après avoir tranché de sa main la tête d'Ardavan et pris le titre de Chahan-Chah, Roi des Rois, conquiert d'abord Hamadhan (Ecbatane) dans la Grande-Médie, puis l'Adarbaidian (Atro. patène), l'Arménie, le district de Mossoul (Adiabène), ensuite le Souristan ou Savad (Babylonie). De là il retourne à Istakhr, dans sa patrie perse, puis repartant de nouveau il s'empare du Sagistan, du Gourgan (Hyrcanie), d'Abrachahr (Nisapour dans le pays des Parthes), de Marv (Margiane), de Balkh (Bactres) et de Kharizm (Khiva), jusqu'aux limites extrêmes du Khorasan. Après avoir tué beaucoup d'ennemis et avoir envoyé leurs têtes au temple du feu d'Anahedh (à Istakhr), il revint de Marv à Pars, et mourut à Gor (Ferouzabad). Nous ne savons pas ce qu'il y a de légendaire dans ce récit (cf. Noldeke, Tabari, p. 117 et 116). |
||||
224 |
Etat des SassanidesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLe système politique de l'Iran ne subit aucune modification essentielle après l'avènement de la nouvelle dynastie. Le titre officiel du premier souverain sassanide, tel qu'il est gravé en trois langues sur le rocher sculpté de Nakchi-Roustam : le Dieu Artaxarès, serviteur de Mazda, Roi des Rois des Aryens, de race divine1, est essentiellement celui des Arsacides, avec cette seule différence que la nation iranienne, comme dans le titre des anciens rois indigènes, et le dieu national sont expressément nommés. La substitution d'une famille issue de la Perside à une dynastie d'origine étrangère et simplement nationalisée, fut l'oeuvre et le triomphe de la réaction nationale; mais les résultats de cette révolution furent enfermés, par la force même des choses, dans des limites infranchissables. Persépolis ou, comme cette ville s'appelle désormais, Istachr redevient, d'après son nom même, la capitale de l'empire; sur le même rocher que Darius, Ardachir et Chapour nous apprennent leurs glorieux exploits par des sculptures curieuses et par les inscriptions plus curieuses encore que nous venons de citer. Mais il était impossible de bien administrer l'empire en résidant dans cette capitale écartée: Ctésiphon resta le centre de l'Etat. Le nouveau gouvernement perse ne rendit pas aux Perses proprement dits la situation prépondérante qu'ils avaient occupée sous les Achéménides. Si Darius se nommait Perse, fils de Perse, Aryen de race aryenne Ardachir se donnait simplement, comme nous l'avons vu, le titre de roi des Aryens. Nous ne savons pas si de nouveaux éléments perses furent introduits dans les grandes familles, la dynastie royale exceptée; en tout cas plusieurs d'entre elles subsistèrent, comme les Suren et les Karen. Ce fut seulement sous les Achéménides, et non sous les Sassanides, qu'elles furent exclusivement perses. 1. En grec (Corp. insc. graec., 4675) le titre est: (serviteur de Mazda, employé comme nom propre) (eos 'Apta??; son fls Sapor I (ibid., 4776) porte le même titre; seulement après on lit xai 'Avaplaruv, ce qui signifie que la dynastie a étendu son empire sur les pays étrangers. Parmi les titres des Arsacides, autant que nous pouvons les connaître d'après les légendes des monnaies grecques et perses, reviennent les mots , ? (= ?), mais on n'y trouve pas la mention des Ariens ni, ce qui est plus remarquable encore, le titre de serviteur de Mazda; plusieurs autres titres sont empruntés au roi de Syrie, comme ; on rencontre meme le titre romain ?. |
||||
224-651 |
L'Eglise et le Sacerdoce sous les SassanidesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa religion ne subit pas non plus de modification proprement dite; mais sous les Grands-Rois perses, la foi et les prêtres acquirent une influence et une autorité qu'ils n'avaient jamais possédées sous les princes parthes. Il se peut que la double propagande de cultes étrangers à l'Iran, du bouddhisme venu de l'Est et de la religion judéo-chrétienne venue de l'Ouest, ait régénéré l'ancienne religion de Mazda obligée de lutter. Le fondateur de la nouvelle dynastie, Ardachir, était, comme nous l'apprennent des renseignements dignes de foi, un fervent adorateur du feu; il prit même les ordres. Aussi la caste des Mages, cela se comprend, devint-elle influente et arrogante, tandis qu'auparavant, loin de posséder autant d'honneur et de liberté, elle n'était presque pas considérée par les puissants. Désormais les Perses respectent et vénèrent tous les prêtres; les cérémonies officielles sont réglées d'après leurs conseils et leurs oracles; chaque traité, chaque jugement est soumis à leur examen et à leur décision; les Perses ne trouvent juste et légal que ce qui a été confirmé par un prêtre. Aussi rencontrons-nous dans l'état perse une organisation sacerdotale qui rappelle la situation du pape et des évêques à côté de l'empereur et des princes. Chaque cercle est soumis à un Haut-Mage (Magoupat, chef mage, en nouveau persan, Mobedh); et tous les Hauts-Mages sont dominés par le Mage-suprême (Mobedhan-Mobedh), image du Roi des Rois, que d'ailleurs il couronne. Les conséquences de cette domination des prêtres ne se firent pas longtemps attendre. Le rituel sévère, les prescriptions strictes sur la faute et l'expiation, la science réduite à la connaissance aride des oracles et à l'art de la magie, tout cela existait depuis longtemps dans l'état perse; mais c'est pendant le règne des Sassanides que le développement en a été le plus complet. |
||||
224-651 |
Les langues indigènes sous les SassanidesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteDes traces de réaction nationale se montrent également dans l'emploi de la langue et des coutumes nationales. La plus grande ville grecque de l'état parthe, l'antique Séleucie, resta debout; mais elle changea le nom du général grec pour celui de son nouveau maître Beh, c'est-à-dire, Ardachir. La langue grecque, que l'on avait parlée jusqu'alors, quoique corrompue et déchue de son rang de maîtresse, disparut tout à coup avec l'avénement de la nouvelle dynastie, et ne fut plus employée sur les monnaies; on ne la rencontre que sur les inscriptions des premiers Sassanides, auprès et au-dessous de la véritable langue nationale. L'écriture parthe, le Pahlavi, subsiste; mais à côté d'elle apparaît une seconde écriture peu différente, et considérée comme officielle, d'après les monnaies, qui est probablement l'écriture employée jusqu'alors dans la Perse proprement dite. Il en résulte que les plus anciens documents relatifs aux Sassanides sont, comme ceux des Achéménides, en trois langues; c'est ainsi qu'au moyen âge, en Allemagne, le latin, le saxon et le franconien étaient employés à côté l'un de l'autre. Après le roi Sapor I (mort en 272), il ne reste plus qu'une langue, qui prend à elle seule toute la place, et qui hérite du nom de Pahlavi. L'année des Séleucides et les noms de mois qui s'y rattachent n'existent plus après le changement de dynastie; suivant l'ancienne coutume perse, on date d'après les années de règne du souverain et les noms de mois indigènes reparaissent1. Même les anciennes légendes persanes sont appliquées au nouvel empire. Nous possédons encore le récit où Ardachir fils de Papak est représenté comme le fils d'un berger perse, amené à la cour de Médie, qui remplit d'abord des offices de valet, puis qui délivre son peuple: c'est l'antique histoire de Cyrus habillée avec de nouveaux noms. Un autre livre de fables des Parses indiens nous apprend que le roi Iskander Roumi, c'est-à-dire l'Alexandre des Romains, a fait brûler les livres sacrés de Zarathoustra, mais qu'ils ont été refaits par le pieux Ardaviraf, lorsque le roi Ardachir est remonté sur le trône. Par là est exprimée la lutte des Romains et des Grecs contre les Perses. La légende a négligé, naturellement, le bâtard Arsacide. 1. Fravardin, Ardhbehecht, etc. (Ideler, Chronologie, II, p. 515). Ce qui est curieux, c'est que les mêmes noms de mois se sont conservés dans le calendrier de la province romaine de Cappadoce (Ideler, I, p. 443); ils doivent dater de l'époque où cette région fut une satrapie perse. |
||||
224-651 |
Gouvernement des SassanidesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteD'ailleurs l'état général de l'empire resta sensiblement le même qu'auparavant. Les troupes des Sassanides ne furent ni permanentes ni aguerries; elles étaient formées par le ban des hommes capables de porter les armes, auxquels le mouvement national avait peut-être donné un nouvel esprit, mais le principe essentiel en resta toujours le service des nobles dans la cavalerie. L'administration ne fut pas non plus modifiée; le ferme empereur châtia impitoyablement les voleurs de grande route et les fonctionnaires trop durs. Si l'on compare le gouvernement des Sassanides à la domination postérieure des Arabes et des Turcs, la prospérité régna à cette époque et le trésor public fut constamment rempli. |
||||
224-476 |
Les nouveaux Perses et les romainsRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMais c'est sous le rapport des relations avec les Romains que l'établissement de ce nouvel empire est surtout important. Les Arsacides ne s'étaient jamais considérés comme les égaux des Césars. Les deux Etats s'étaient fait la guerre et avaient conclu des traités comme deux puissances de même force; tout l'Orient romain croyait à l'existence de deux empires aussi grands l'un que l'autre; néanmoins Rome avait toujours conservé une prépondérance, semblable à celle que le saint empire romain germanique a exercée pendant de longs siècles à son détriment. Il est difficile de ne pas regarder comme des actes de soumission les démarches que les grands rois parthes firent auprès de Tibère et de Néron, sans y être astreints par une nécessité majeure. Ce qui est plus significatif encore, c'est que les princes parthes renoncèrent à frapper des monnaies d'or. Or ce ne peut être par un effet du hasard que, sous le règne des Arsacides, aucune pièce d'or n'a été frappée, et que le premier des Sassanides a battu monnaie d'or; ce monnayage est le privilège le plus évident d'une souveraineté absolue, que ne limite aucun devoir de vassal. Les Césars prétendaient avoir seuls le droit de monnayer pour l'univers; tous les Arsacides sans exception se sont soumis à cette prétention, en s'abstenant par eux-mêmes de tout monnayage, et en n'accordant aux villes et aux satrapes que le droit de battre monnaie d'argent et de cuivre. Les Sassanides au contraire recommencèrent à frapper des pièces d'or, comme jadis Darius. La grande royauté orientale réclamait enfin tous ses droits; le monde n'appartenait plus aux seuls Romains. C'en était fait de la subordination de l'Orient et de la suprématie de l'Occident. Jusqu'alors les relations entre Rome et les Parthes s'étaient toujours terminées par des traités de paix : désormais commence une lutte impitoyable. |
||||
211-217 |
Guerre de Caracalla contre les PersesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteMaintenant que nous avons décrit le nouvel état politique avec lequel la décadence de Rome devait avoir bientôt à lutter, reprenons le cours de notre récit. Antonin Caracalla, le fils et le successeur de Sévère, n'était ni un guerrier ni un politique comme son père; des deux il était plutôt la grossière caricature. Il doit avoir eu l'intention, si l'on peut parler d'intention lorsqu'il s'agit d'un tel personnage, de soumettre l'Orient tout entier à la puissance romaine. Il manda à la cour impériale les princes de l'Osrhoène et de l'Arménie, et ne fit pas de difficulté de les emprisonner et d'annexer leurs fiefs à l'empire. Mais à la nouvelle de cet attentat l'Arménie prit les armes. Le prince Arsacide Tiridatés fut proclamé roi et sollicita le secours des Parthes. Caracalla se mit alors à la tête d'une armée considérable; il parut l'an 216 en Orient pour écraser les Arméniens et, s'il le fallait, les Parthes. Tiridatès se crut perdu, quoique le détachement romain envoyé dans l'Arménie y eût rencontré une vive résistance, et s'enfuit chez les Parthes. Les Romains le réclamèrent. De leur côté les Parthes n'étaient pas disposés à entreprendre une longue guerre, d'autant plus que les deux fils du roi Vologasos V, Vologasos VI et Artabanos, se disputaient le trône avec acharnement. Le premier se soumit, lorsque l'empereur eut réitéré sa demande sous la forme d'un ordre, et livra Tiridatés. L'empereur reconnut Artabanos comme roi, et lui demanda la main de sa fille, dans le but nettement exprimé de conquérir par ce moyen l'empire parthe et d'unir sous son autorité l'Orient et l'Occident. Le refus que l'on opposa à cette proposition grossière1 fut le signal de la guerre; ce furent les Romains qui la déclarèrent et qui franchirent le Tigre. Les Parthes n'étaient pas prêts; les Romains brûlèrent sans rencontrer de résistance les villes et les villages de l'Adiabène, et détruisirent d'une main impie les anciennes sépultures royales d'Arbèles2. Mais Artaban fit les préparatifs les plus sérieux pour la campagne suivante, et au printemps de l'année 217 il mit en ligne une puissante armée. Caracalla, qui avait passé l'hiver à Edesse, fut assassiné par ses officiers, au moment où il allait entreprendre cette seconde expédition. Son successeur Macrin, peu solide sur le trône et peu redouté, se trouvait à la tête d'une armée sans discipline, sans tenue et qu'avait effrayée le meurtre de l'empereur; il aurait bien désiré renoncer à cette guerre commencée par méchanceté et dont les conséquences pouvaient être très graves. Il renvoya les prisonniers au roi parthe et rejeta sur son prédécesseur la responsabilité des crimes commis. Mais Artaban ne se déclara pas satisfait; il voulait une compensation pour tous les ravages faits dans son empire; il demanda l'évacuation de la Mésopotamie. On en vint aux mains près de Nisibis, et les Romains furent battus. Néanmoins les Parthes, soit parce que leur armée menaçait de se dissoudre, soit peut-être sous l'influence de l'or romain, accordèrent la paix à des conditions relativement douces (an 218). Rome paya une contribution de guerre considérable (50 mille deniers), mais elle garda la Mésopotamie; l'Arménie resta à Tiridates, mais ce prince se déclara le vassal de Rome. En Osrhoène l'ancienne dynastie fut aussi rétablie. 1. Tel est le récit de Dion (LXXVIII, 1) que nous devons accepter; il est impossible de croire Hérodien (IV, 11) d'après lequel Artaban aurait promis sa fille, et Caracalla, le jour des fiançailles, aurait fait massacrer les Parthes présents. 2. Si ce sont vraiment les Cadusii qui sont nommés dans la Biographie (c. 6), c'est que les Romains exhortèrent cette peuplade sauvage qui habitait le Sud-Ouest de la mer Caspienne et qui ne leur était pas soumise, à tomber en même temps sur l'empire parthe. |
||||
224-241 |
Le roi ArdachirRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteCe fut le dernier traité de paix que la dynastie des Arsacides conclut avec Rome. Presque aussitôt après cette convention et peut-être à cause d'elle, éclata l'insurrection qui transforma l'état parthe en un état perse; les Orientaux estimaient que, étant donnée la situation, le gouvernement de Ctésiphon n'avait tiré aucun parti des victoires remportées. Le chef de la révolte, Ardachir ou Artaxarès, dut combattre pendant plusieurs années les partisans de l'ancienne dynastie, avant d'obtenir un succès complet1; après trois grandes batailles, dont la dernière coûta la vie au roi Artaban, il fut maître de l'empire parthe proprement dit et put entrer dans le désert de Mésopotamie, pour soumettre les Arabes de Hatra et pour s'avancer de là contre la Mésopotamie romaine. Mais les Arabes, courageux et indépendants, se défendirent contre les Perses, derrière les murs de leur puissante citadelle, avec autant de succès qu'ils l'avaient fait contre les Romains, et Artaxarès fut obligé de tourner immédiatement ses armes contre la Médie et l'Arménie, où les Arsacides se maintenaient encore et où les fils d'Artaban avaient trouvé du secours. Ce fut seulement en l'an 230 qu'il attaqua les Romains; non seulement il leur déclara la guerre, mais encore il leur réclama toutes les provinces qui avaient appartenu jadis à l'empire de ses prédécesseurs Darius et Xerxés; il voulait reconquérir entièrement l'Asie. Pour donner du poids à ces paroles menaçantes, il conduisit une nombreuse armée au-delà de l'Euphrate; la Mésopotamie fut occupée et Nisibis assiégé; les cavaliers ennemis se montrèrent jusqu'en Cappadoce et en Syrie. C'est alors que monta sur le trône romain Sévère Alexandre, prince qui n'avait de guerrier que le nom, et dont la mère Mamée exerça en réalité le pouvoir. Rome fit des propositions de paix pressantes, presque humbles, qui furent sans résultat; il ne restait plus qu'à trancher le différend par les armes. Les troupes romaines appelées de tout l'empire furent divisées en trois corps : l'aile gauche se dirigea sur l'Arménie et la Médie, l'aile droite sur Mesène, place située aux bouches de l'Euphrate et du Tigre; l'on comptait peut-être s'appuyer dans ces deux régions sur le parti des Arsacides; le corps d'armée principal s'avança vers la Mésopotamie. Les soldats étaient assez nombreux, mais sans discipline et sans tenue; un officier supérieur romain de ce temps affirme même qu'ils avaient perdu l'habitude de la guerre, qu'ils étaient insoumis, qu'ils refusaient de se battre, tuaient leurs officiers et désertaient en masse. Le corps central ne franchit pas l'Euphrate2; Mamée persuada à l'empereur que ce n'était pas à lui de se battre pour ses sujets, mais à ses sujets de se battre pour lui. L'aile droite, surprise en pays plat par le gros des troupes perses et abandonnée par l'empereur, fut anéantie. Sévère Alexandre donna alors l'ordre aux troupes dirigées sur la Médie de revenir en arrière; cette retraite, effectuée pendant l'hiver à travers l'Arménie, coûta beaucoup de monde. Si pourtant l'expédition d'Orient ne se termina pas par une catastrophe complète, après que les troupes romaines se furent retirées sur Antioche, si même la Mésopotamie resta au pouvoir des Romains, il ne faut en savoir gré ni à l'armée de Rome ni à son chef: ce fut tout simplement parce que les guerriers perses étaient fatigués de la lutte et s'en retournèrent chez eux3. Mais ils ne furent pas longtemps absents, d'autant plus que peu de temps après le dernier représentant de la famille de Sévère fut assassiné et que dès lors les différents chefs de légions et le sénat de Rome entrèrent en lutte pour la possession de l'empire. Les adversaires n'étaient d'accord que pour faire le jeu des ennemis extérieurs. Sous Maximin (235-238) la Mésopotamie romaine fut conquise par Ardachir, et les Perses se préparèrent encore une fois à franchir l'Euphrate4. 1. La chronologie reconstituée postérieurement place l'avènement de la dynastie des Sassanides en l'année 538 de l'ère des Séleucides = 1 oct. 226/7 après J.-C. ou à la quatrième année (complète) du règne d'Alexandre Sévère qui était devenu empereur au printemps de 222 (Agathias, IV, 24). D'après d'autres dates le roi Ardachir comptait l'année 223/4 après J.-C. comme la première de son règne; c'est à ce moment qu'il prit le titre de Grand Roi (Noldeke, Tabari, p. 410). La dernière monnaie datée de l'ancien système que l'on connaisse jusqu'à présent est de l'année 539. Lorsque Dion écrivait entre 230 et 234, Artaban était mort, son parti avait succombé, et l'on s'attendait à voir Artaxarès envahir la Mésopotamie et la Syrie. 2. L'empereur resta probablement à Palmyre; tout au moins une inscription de Palmyre (Corp. insc. graec., 4483) parle-t-elle de l'?. 3. Les renseignements tout à fait défectueux que nous avons sur cette guerre (la relation relativement la meilleure se trouve chez Hérodien, Zonaras et le Syncelle, p. 674, qui l'ont puisée à la même source) ne donnent pas une réponse nette à cette question : qui fut le vainqueur dans tous ces combats ? Tandis qu'Hérodien signale une défaite extraordinaire des Romains, les sources latines, la Biographie, Victor, Eutrope et Rufius Festus célèbrent Alexandre comme le vainqueur d'Artaxerxés ou Xerxès. D'après ces derniers la suite de la guerre aurait été également favorable à Rome. C'est Hérodien (VI, 6, 5) qui nous donne le moyen de concilier tout cela. D'après les historiens d'Arménie (Gutschmid, Zeitschrift der deutschen morgenland. Gesellschaft, XXXI, p. 47), les Arsacides se sont maintenus en Arménie contre Ardachir jusqu'en 237 avec l'appui des peuples du Caucase. Cette diversion peut avoir existé réellement et avoir favorisé les Romains. 4. Les meilleurs renseignements, puisés à la même source, se trouvent dans le Syncelle (p. 683) et dans Zonaras (XII, 18). Les détails isolés donnés par Ammien (XXIII, 5, 7 et 17) concordent avec ces renseignements, ainsi que la lettre apocryphe de Gordien au sénat inscrite dans la Biographie (c. 27), d'où l'on a maladroitement tiré tout le récit de la guerre (au ch. 26). Antioche était dangereusement menacée; mais les Perses ne l'avaient pas encore prise. |
||||
242-244 |
L'expédition de Perse sous GordienRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLorsque les troubles intérieurs se furent relativement apaisés, et lorsque Gordien III, presque encore enfant, fut devenu le maître incontesté de tout l'empire sous la protection de Furius Timesitheus, chef des prétoriens et bientôt son beau-père, la guerre fut solennellement déclarée aux Perses. En l'an 242 une forte armée romaine, commandée par l'empereur lui-même ou plutôt par son beau-père, pénétra en Mésopotamie. Cette expédition eut un plein succès : Karrhae fut reprise; à Resaina, entre Karrhae et Nisibis, l'armée du roi des Perses Chahpor ou Sapor (211-272), qui avait succédé peu de temps auparavant à son père Ardachir, fut complètement écrasée; à la suite de cette victoire les Romains s'emparèrent de Nisibis. Toute la Mésopotamie fut reconquise. On résolut alors de revenir sur l'Euphrate et de descendre le fleuve pour marcher sur la capitale ennemie, Ctésiphon. Malheurement Timésithée mourut, et son successeur, Marcus Julius Philippus, Arabe originaire de la Trachonitide, profita de l'occasion pour détrôner le jeune empereur. Lorsque les troupes eurent atteint de nouveau l'Euphrate par une marche difficile à travers la vallée du Chaboras, elles ne trouvèrent à Kirkesion, au confluent de cette rivière et de l'Euphrate, ni les vivres ni les secours attendus, et elles rendirent l'empereur responsable d'une situation que Philippe avait probablement préparée à dessein. On n'en continua pas moins de marcher sur Ctésiphon, mais à la première halte près de Zaitha (un peu au-dessous de Mejadin), plusieurs soldats de la garde révoltés tuèrent l'empereur (printemps ou été de 244), et proclamèrent Auguste à sa place leur chef Philippe. Le nouveau souverain fit ce que demandaient les soldats ou plutôt les prétoriens; non seulement il renonça à l'expédition projetée contre Ctésiphon, mais même il ramena ses troupes en Italie. Il acheta sa liberté d'action aux ennemis vaincus en leur cédant la Mésopotamie et l'Arménie, c'est-à-dire la ligne de l'Euphrate. Mais ce traité souleva une telle indignation, que l'empereur n'osa pas en exécuter les clauses, et qu'il laissa les garnisons romaines dans les provinces cédées1. Les Perses acceptèrent au moins provisoirement cette violation de la paix; cela nous donne une idée de leur puissance à cette époque. Ce ne sont pas les orientaux qui ont brisé les dernières forces de l'empire romain; ce sont les Goths, c'est la peste qui a sévi pendant un demi-siècle, ce sont les querelles des divers chefs de légions toujours en rivalité pour la possession de l'empire. 1. Tel est le récit de Zonaras (XII, 19). Zosime (III, 32) est d'accord avec lui, et l'histoire postérieure de ces régions nous prouve que l'Arménie n'était pas formellement au pouvoir des Perses. D'après Euagrius (V, 3) la Petite-Arménie seule restait alors romaine; ce renseignement peut être juste, si l'on entend par là que la dépendance du royaume vassal de la Grande-Arménie ne fut plus que nominale après cette paix. |
||||
271-273 |
PalmyreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteA ce moment, où l'Orient romain en lutte avec l'Orient perse est laissé à lui-même, il nous semble opportun de parler d'un Etat curieux, créé pour et par le commerce du désert, qui joua pendant une courte période un rôle prépondérant dans l'histoire politique. L'oasis de Palmyre, en langue indigène Tadmor, est située à moitié chemin entre Damas et l'Euphrate. Elle est importante comme station intermédiaire entre la vallée de l'Euphrate et la Méditerranée; mais cette importance n'est apparue que tard et a peu duré, de telle sorte qne la prospérité de Palmyre coïncide presque exactement avec la période dont nous nous occupons. Toutes les traditions sont muettes sur l'origine de cette ville1. Elle est citée pour la première fois, à propos du séjour d'Antoine en Syrie (713 de Rome=41 ans av. J.-C.), lorsqu'il fit de vains efforts pour la dépouiller de ses richesses; les monuments que l'on a trouvés dans l'oasis la plus ancienne inscription datée est de l'an 745 ( 9 av. J.-C.) - ne permettent pas non plus de remonter plus haut. Il est probable que l'établissement des Romains sur la côte syrienne n'est pas sans rapport avec la prospérité de Palmyre. Tant que les Nabatéens et les villes de l'Osrhoène ne furent pas directement soumis aux Romains, ceux-ci eurent un grand intérêt à chercher une autre voie directe qui les menat sur l'Euphrate, et cette voie passait nécessairement par Palmyre. La ville ne fut pas fondée par Rome; car pour justifier sa tentative de razzia, Antoine prétexta la neutralité que gardait cette cité de négociants, qui faisaient le commerce entre les deux grands Etats ses voisins, et les cavaliers romains durent tourner bride sans avoir pu forcer la chaîne de défense que les habitants de Palmyre opposèrent à leurs attaques. Mais déjà sous les premiers empereurs la cité doit avoir été considérée comme annexée à l'empire; les mesures financières que Germanicus et Corbulon prirent en Syrie furent également appliquées à Palmyre; dans une inscription de l'année 80, on trouve la mention d'une tribu claudienne. Depuis Hadrien la ville porta le nom d'Hadriana Palmyra, et au troisième siècle elle fut même comptée parmi les colonies. 1. Le récit biblique (Rois, III, 9, 18) sur la fondation de la ville de Thamar en Idumée par le roi Salomon n'a été rapporté à Thadmor que par une erreur, qui date, il est vrai, de fort longtemps: ce sont les Juifs qui plus tard ont établi cette relation (Chron., II, 8, 4, et traduction grecque des Rois, III, 9, 4); c'est là le plus ancien témoignage de l'existence de Palmyre (cf. Hitzig, Zeitschrift der deutschen morgenland. Gesellschaft, VIII, p. 222). |
||||
271-273 |
Indépendance militaire de PalmyreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugustePalmyre n'était pas soumise à l'empire romain comme les autres provinces; elle était sous le patronage de Rome à peu près comme les royaumes vassaux. Sous Vespasien, Palmyre est encore appelée un territoire intermédiaire entre les deux grandes puissances voisines, et l'on se demandait, chaque fois que la guerre éclatait entre les Romains et les Parthes, quelle politique allaient suivre les Palmyréniens. C'est par l'état de la frontière et par les mesures prises pour la défendre que nous devons expliquer cette situation particulière. Tant que les troupes de Syrie furent campées sur l'Euphrate même, leur quartier général se trouva à Zeugma, en face de Biredjik, principal passage de l'Euphrate. Plus bas, sur le cours du fleuve, les pays directement soumis à Rome et le territoire parthe étaient séparés par l'état de Palmyre, qui atteignait l'Euphrate, et qui contenait le point de passage important de Sura en face de la ville mésopotamienne de Nikephorion (plus tard Kallinikon, aujourd'hui ErRagga). Il est plus que probable que la garde de cette forteresse considérable située sur la frontière était confiée à la ville de Palmyre, ainsi que le soin d'assurer la sécurité de la route du désert entre Palmyre et l'Euphrate, et d'une partie de la route qui conduit de Damas à Palmyre. Dans ces conditions la cité, pour remplir cette tâche importante, devait être autorisée et astreinte à se donner une organisation militaire toute particulière1. Plus tard des troupes impériales campèrent dans les environs de Palmyre : l'une des légions de Syrie fut envoyée à Danava, entre Palmyre et Damas, et la légion d'Arabie à Bostra. Depuis Sévère, la Mésopotamie fut réunie à l'empire; les deux rives de l'Euphrate étaient occupées par les Romains, et la frontière coupait l'Euphrate non plus près de Sura, mais à Kirkésion, au confluent du Chaboras, au-dessus de Mejâdîn. De fortes garnisons furent alors établies en Mésopotamie. Mais les légions de cette province gardaient la grande route du Nord à Resaina et Nisibis, et le secours des soldats de Palmyre n'était pas inutile aux troupes de Syrie et d'Arabie. Il se peut même que la défense de Kirkésion et de cette partie du cours de l'Euphrate fût précisément confiée aux habitants de Palmyre. Lorsque cette ville eut été détruite, et peut-être pour la remplacer, Dioclétien fit de Kirkesion2 une forte forteresse puissante, sur laquelle s'appuya dès lors la défense de la frontière. 1. Ce fait n'est nulle part expressément signalé, mais tout parle dans ce sens. Pline affirme le plus nettement du monde que la frontière romano-parthe, avant que les Romains ne fussent établis sur la rive gauche de l'Euphrate, aboutissait, sur la rive droite, un peu au-dessous de Sura (Hist. nat., V, 26, 89: a Sura proxime est Philiscum cf. p. 273, n. 1 oppidum Parthorum ad Euphratem, ab eo Seleuciam dierum decem navigatio), et qu'elle est restée telle jusqu'à la création de la province de Mésopotamie sous le règne de Sévère. La Palmyrène de Ptolémée (V, 15, 24 et 25) est une contrée de la Coelésyrie, qui semble contenir une bonne partie du territoire situé au Sud de Palmyre, mais qui atteint certainement l'Euphrate, et qui comprend Sura; d'autres villes formant un centre ne paraissent pas avoir existé en dehors de Palmyre, et rien n'empêche de considérer ce grand district comme le territoire de la ville de Palmyre. Tant que la Mésopotamie fut entre les mains des Parthes, et même plus tard, une garnison permanente a dû être postée à Palmyre, à cause du désert environnant; au IVe siècle la Notitia nous apprend que la Palmyrène était fortement occupée, au Nord par les troupes du duc de Syrie, au Sud et dans Palmyre même par celles du duc de Phénicie. Ce qui prouve qu'il n'y eut pas dans cette ville de troupes romaines sous les premiers empereurs, c'est que les historiens n'en parlent pas et qu'aucune des inscriptions, très nombreuses de Palmyre, n'en fait mention. Dans la table de Peutinger, on lit sous le mot Sura: fines exercitus Syriatici et commercium barbarorum, c'est-à-dire : ici finissent les garnisons romaines et commencent les relations avec les Barbares. Il faut entendre par là ce qu'ont répété plus tard Ammien (XXIII, 3, 7: Callinicum munimentum robustum et commercandi opimitate gratissimum) et l'empereur Honorius (Cod. Just., IV, 63, 4): Kallinikon est un des entrepôts peu nombreux où le commerce se fait librement entre les Romains et les barbares; mais il n'en résulte pas que des troupes impériales y fussent cantonnées à l'époque où la table fut dressée; car les habitants de Palmyre appartenaient en général à l'armée de Syrie, qu'on ne peut avoir désigné sous le nom de exercitus Syriaticus. Palmyre a sans doute levé des troupes à son compte comme les princes de Numidie et de Pantikapaeon. Cette hypothèse peut seule nous faire comprendre la retraite des troupes d'Antoine et l'attitude des habitants de Palmyre pendant les troubles du VIe siècle, ainsi que la présence des numeri Palmyrenorum parmi les innovations militaires de la même époque. 2. Ammien XXIII, 5, 2 : Cercusium... Diocletianus exiguum ante hoc et suspectum muris turribusque circumdedit celsis... ne vagarentur per Syriam Persae ita ut paucis ante annis cum magnis provinciarum contigerat damnis. Cf. Procope, De aed., II, 6. Peut-être cette localité n'est-elle pas différente de la Damye d'Isidore de Charax (Mans. Parth., 1, cf. Etienne de Byzance à ce mot), et du Philiscum de Pline (v. p. 272, n. 1). |
||||
271-273 |
Indépendance administrative de PalmyreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes traces de cette situation particulière se retrouvent aussi dans les institutions politiques de Palmyre. Si le nom des empereurs manque sur les monnaies de la cité, c'est uniquement parce qu'elle n'a frappé que de petites pièces de billon. L'usage de la langue nous renseigne bien davantage. Dans les provinces subordonnées à sa domination immédiate, Rome n'autorisait jamais que les deux langues d'empire: Palmyre n'a pas été soumise à cette règle. Aussi longtemps que la ville a existé, ses habitants ont employé officiellement l'idiome usité dans tout le reste de la Syrie et dans la Judée depuis l'exil des Juifs, mais qui y était réservé exclusivement pour les relations quotidiennes. On ne trouve pas de différences essentielles entre le syriaque de Palmyre et celui des autres pays que nous venons de citer; les noms propres, souvent tirés de l'arabe ou de l'hébreu, et même du perse, témoignent du mélange des peuples; la présence d'un grand nombre de mots greco-romains prouvent l'influence de l'Occident. Ce fut plus tard la règle d'ajouter un texte grec au texte syriaque; dans un décret rendu en 137 par la municipalité de Palmyre, l'idiome du pays est placé en second; postérieurement il est toujours en tête; mais des inscriptions purement grecques concernant des Palmyréens d'origine sont de rares exceptions. Même dans les dédicaces, que les habitants de Palmyre gravaient à Rome en l'honneur de leurs divinités indigènes, et dans les épitaphes des soldats de Palmyre morts en Afrique ou en Bretagne, on a ajouté la version palmyrénienne. Là comme dans tout l'empire l'année romaine servait à dater; mais les noms de mois n'étaient pas les noms macédoniens officiellement reçus dans la Syrie romaine; c'étaient les noms communément employés dans le même pays, au moins chez les juifs et en dehors chez les tribus araméennes soumises d'abord aux Assyriens, puis aux Perses. |
||||
271-273 |
Fonctionnaires de PalmyreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'organisation municipale fut, pour l'essentiel, constituée sur le modèle de l'organisation des villes grecques situées dans l'empire romain; les noms des dignités, du conseil1, et même celui de la colonie sont empruntés la plupart du temps au grec ou au latin dans les textes palmyréens. Néanmoins ce district put s'administrer avec beaucoup plus d'indépendance que les autres cités de l'empire. A côté des fonctionnaires municipaux nous trouvons, au moins au troisième siècle, un chef suprême qui commande dans la ville de Palmyre et dans tout son territoire. Il est de rang sénatorial et nommé par les Romains, mais ils le choisissent dans la famille la plus illustre de la cité; Septimios Hairanès, fils d'Odaenathos, est en réalité un prince de Palmyre2, qui ne dépend pas plus du légat de Syrie que les princes vassaux ne dépendent des gouverneurs impériaux voisins. Peu d'années après nous trouvons son fils3, Septimios Odaenathos, héritier de sa puissance, dans une situation encore plus élevée. De même Palmyre formait un district douanier à part, dans lequel les droits étaient affermés non par l'Etat, mais par la municipalité4. 1. Par exemple Archon, Grammateus, Proedros, Syndikos, Dekaprotoi. 2. C'est ce que nous apprend une inscription de Palmyre (Corp. insc. graec., 4491, 4492 = Waddington, 2600 = De Vogue, Inscr. sem. Palm., 22) dédiée à cet Hairanès en l'an 251 par un soldat de la légion campée en Arabie. Son titre est en grec ? (= princeps) ?], en palmyrénien illustre sénateur, chef de Thadmor. L'épitaphe (Corp. insc. graec., 4507 =Waddington, 2621 =De Vogue, 21) du père de Hairanès, Septimios Odaenathos, fils de Hairanès, petit-fils de Vaballathos, arrière-petit-fils de Nassoros, lui donne aussi le rang de sénateur. 3. Le père de cet Odaenathos n'est nommé nulle part; mais il est pour ainsi dire certain qu'il est le fils de cet Hairanès que nous venons de nommer, et qu'il porte le nom de son grand-père. Zosime (1, 39) le nomme aussi comme un des principaux Palmyréniens qui aient possédé le pouvoir (avoca ?). 4. La Syrie forma sous l'empire une circonscription douanière spéciale; les droits de douane étaient perçus non seument sur la côte, mais sur la frontière de l'Euphrate, principalement à Zeugma. Il en résulte nécessairement que plus au Sud, où l'Euphrate ne coulait plus en pays romain, des douanes semblables avaient été établies sur la frontière orientale de l'empire. Un décret rendu par le conseil de Palmyre en l'an 137 nous apprend que cette ville et son territoire formaient un district douanier spécial et que les droits perçus sur les marchandises importées ou exportées appartenaient à la cité. Il est probable que ce territoire était situé hors des douanes impériales: d'abord, si le territoire de Palnyre avait été entouré d'une ligne de douanes romaines, elle serait certainement mentionnée dans le décret dont nous avons parlé; en second lieu, une ville impériale entourée d'une ligne de douanes impériales n'aurait pas pu avoir le droit de percevoir des impôts à la frontière de son territoire, comme le faisait Palmyre. Il faut reconnaître que Palmyre se trouvait sous le rapport douanier dans la même situation particulière que sous le rapport militaire. Peut-être le fisc impérial prélevait-il quelques droits sur les recettes douanières de la ville; il pouvait ou bien se réserver une partie du produit des douanes ou augmenter le chiffre du tribut. Bostra et Petra ont joui sans doute des mêmes privilèges que Palmyre, puisque, à coup sûr, les marchandises ne sont pas entrées sur leurs territoires sans payer des taxes; et que, si nous en croyons Pline (Ilist nat., XII, 144, 65), l'encens venant du fond de l'Arabie par Gaza n'était soumis à un impôt douanier que sur la côte, à Gaza. L'administration romaine était encore plus indolente que le fisc n'était avide; elle s'est déchargée probablement sur les communes des douanes incommodes. |
||||
271-273 |
Situation commerciale de PalmyreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugustePalmyre devait son importance au commerce des caravanes. Les chefs des caravanes, qui se rendaient de Palmyre aux grands entrepôts de l'Euphrate, soit à Vologasias, la nouvelle ville fondée par les Parthes, comme nous l'avons déjà dit, non loin de l'emplacement de l'ancienne Babylone, soit à Forath ou à Charax Spasinou, cités jumelles situées à l'embouchure du fleuve près du golfe persique, apparaissent dans les inscriptions comme les citoyens les plus considérables de Palmyre1; non seulement ils exercent des charges dans leur patrie, mais encore ils sont pour la plupart fonctionnaires impériaux. Ce qui témoigne encore de l'importance commerciale et industrielle de Palmyre, c'est l'existence des grands négociants (apzep.Topol) et de la corporation des ouvriers en or et en argent; ce qui prouve sa prospérité, ce sont les temples encore debout, dans la ville, les longues colonnades des marchés publics, et les tombeaux massifs richement décorés. Le climat est peu favorable à l'agriculture; le pays est voisin de la frontière septentrionale des palmiers à dattes; mais ce n'est pas de là qu'il tire son nom grec. Dans les environs de Palmyre on trouve pourtant les restes de grands caveaux souterrains et d'immenses réservoirs artificiels construits en pierres de taille, grâce auxquels une riche culture doit avoir jadis recouvert le sol aujourd'hui vierge de toute végétation. Cette richesse, cette originalité, cette indépendance administrative que la domination romaine n'a pas pu détruire, expliquent en quelque façon le rôle que Palmyre a joué au milieu du troisième siècle dans la grande crise dont nous reprenons maintenant le récit. 1. Les inscriptions de Palmyre nous montrent ces caravanes comme des associations puissantes, qui entreprennent à intervalles fixes les mêmes voyages sous la direction de leur chef, p2.95 (Waddington, 2589, 2590, 2596); à l'un de ces chefs une statue fut élevée par les marchands qui s'étaient rendus avec lui à Vologasias ? (Waddington, 2599; de l'an 247) ou qui étaient revenus avec lui de Forath (cf. Pline, Hist. nat., VI, 28, 145) et de Vologasias ? (Waddington, 2589); de l'an 142), ou de Spasinou Charax ? (Waddington, 2596; de l'an 193 de même 2590; de l'an 155). Tous ces chefs de caravanes sont des hommes considérables, pourvus d'une longue série d'aïeux; les monuments faits en leur honneur se trouvent dans la grande colonnade à côté de ceux de la reine Zénobie et de sa famille. Le plus remarquable d'entre eux est Septimius Vorodès; de 262 à 267 on lui éleva une rangée de statues, dont les socles ont survécu (Waddington, 2606-2610). Il était chef de caravanes ? (Waddington, n. 2606 a); il paya les frais du retour pour tous les marchands qui l'avaient accompagné; les grands négociants le louèrent publiquement de cette générosité. Non seulement il exerça les charges municipales de stratège et d'agoranome, mais encore il fut procurateur impérial de seconde classe (ducenarius) et argapète (p. 286, n. 1). |
||||
259 |
L'empereur Valérien est fait prisonnierRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLorsque l'empereur Décius eut péri dans la lutte contre les Goths d'Europe en 251, le gouvernement impérial, si l'on peut encore parler à cette époque de gouvernement et d'empire, abandonna complètement l'Orient à son sort. Tandis que les pirates de la mer Noire ravageaient partout les côtes et même l'intérieur des terres, le roi des Perses Sapor reprenait l'offensive. Son père s'était contenté de se proclamer le maître de l'Iran; il commença, et ses successeurs continuèrent, à s'attribuer le nom de Grand-Roi de l'Iran et du Non-Iran. Tel fut le programme de leur politique conquérante. En 252 ou en 253 Sapor occupa l'Arménie; peut-être se soumit-elle volontairement, saisie d'un grand enthousiasme pour l'ancienne religion et l'ancienne nationalité perse. Le roi légitime Tiridatés se réfugia chez les Romains, et les autres membres de la famille royale se rangèrent sous les drapeaux des Perses1. Lorsque l'Arménie fut ainsi redevenue perse, les bandes de la Mésopotamie orientale se répandirent dans la Syrie et dans la Cappadoce; elles ravagèrent tout le pays plat; mais les habitants des grandes villes résistèrent à l'attaque des ennemis peu experts dans l'art des sièges, entre autres les braves citoyens d'Edesse. Sur ces entrefaites un gouvernement au moins reconnu de tous s'était établi en Occident. L'empereur Publius Licinius Valerianus, maître juste et bien intentionné, mais caractère sans décision et inférieur aux tâches difficiles, apparut enfin en Orient et se rendit à Antioche. De là il marcha vers la Cappadoce, qu'évacuèrent les troupes de partisans perses. Mais la peste décima son armée, et il tarda trop longtemps à entreprendre la lutte décisive en Mésopotamie. Il se décida enfin à secourir Edesse, que les ennemis serraient de près; il franchit l'Euphrate avec ses troupes. C'est alors que non loin d'Edesse se produisit la catastrophe, qui fut presque aussi désastreuse, pour l'Orient romain, que la victoire des Goths aux bouches du Danube et la mort de Decius pour l'Occident. L'empereur Valérien fut fait prisonnier par les Perses (fin de 259 ou commencement de 260)2. Nous avons sur ces évènements des renseignements opposés. D'après une première version, il cherchait à atteindre Edesse avec une faible troupe, lorsqu'il fut entouré et fait prisonnier par une armée perse beaucoup plus nombreuse. D'après une autre version, il entra, quoique battu, dans la ville assiégée; mais il craignit une insurrection militaire, parce qu'il n'amenait pas de secours suffisant, et que sa présence faisait diminuer les vivres plus rapidement, et il se livra lui-même aux ennemis. D'après un troisième récit, réduit à la dernière extrémité, il aurait ouvert des négociations avec Sapor pour capituler; le roi perse ayant refusé de traiter avec les ambassadeurs romains, l'empereur se rendit lui-même dans le camp ennemi et fut fait prisonnier au mépris de la parole donnée. 1. D'après le récit grec, (Zonaras, XII, 21) le roi Tiridatés s'enfuit chez les Romains, et ses fils prennent le parti des Perses; d'après les historiens d'Arménie, le roi Chosro est tué par ses frères, et Tiridatès, fils de Chosro, se réfugie chez les Romains (Gutschmid, Zeitschrift der deutschen morgenl. Geschichte, XXXI, 48). Cette dernière version est peut-être préférable. 2. La seule donnée chronologique certaine nous est fournie par les monnaies d'Alexandre, d'après lesquelles Valérien fut fait prisonnier entre le 29 août 259 et le 28 août 260. Une fois captif, il ne fut plus considéré comme empereur, cela se comprend, puisque les Perses le forçaient à donner des ordres dans leur propre intérêt à ses anciens sujets (Continuation de Dion, fr. 3). |
||||
259-263 |
L'Orient sans empereurRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteQuel que soit de ces trois récits celui qui s'approche le plus de la vérité, l'empereur mourut prisonnier des Perses1 et la conséquence de sa défaite fut l'abandon de l'Orient aux ennemis. Antioche, la cité la plus grande et la plus riche de l'Orient, tomba pour la première fois depuis qu'elle était romaine entre les mains des ennemis, en grande partie par la faute de ses habitants. Un riche citoyen d'Antioche, Maréadès, que le conseil de ville avait banni parce qu'il avait détourné les deniers publics, conduisit les Perses dans sa patrie; le récit, d'après lequel les habitants auraient été surpris par les assaillants en plein théâtre est sans doute légendaire; mais il est certain que la ville n'opposa aucune résistance, et que même une grande partie de la population, soit par connivence avec Maréadès, soit dans l'espoir de l'anarchie et du pillage, favorisa la victoire des Perses. La ville devint ainsi avec tous ses trésors la proie de l'ennemi, et fut affreusement ravagée; Maréadès, il est vrai, fut condamné par Sapor au supplice du feu, nous ne savons pas pourquoi2. Un grand nombre de villages subirent le même sort, ainsi que les capitales de la Cilicie et de la Cappadoce, Tarse et Césarée; cette dernière comptait environ 400 000 habitants. Les longs convois de prisonniers, que l'on faisait manger comme les troupeaux une fois par jour, couvrirent les routes des déserts de l'Orient. Pendant leur retour, les Perses, pour franchir plus vite un ravin, le comblèrent, dit-on, avec les cadavres des captifs qu'ils vaient emmenés. Ce qui est plus probable, c'est que le grand barrage impérial (Bend-i-Kaiser) de Sostra (Chouchter) en Susiane, qui conduit encore maintenant les eaux de Pasitigris aux régions plus élevées, fut construit par les prisonniers, comme autrefois des architectes envoyés par l'empereur Néron avaient aidé à bâtir la capitale de l'Arménie; sur ce terrain les Occidentaux ont toujours conservé leur supériorité. Les Perses ne rencontrèrent nulle part les troupes impériales; mais Edesse tenait toujours; Césarée s'était vaillamment défendue et n'avait été prise que par trahison. Partout où l'on résista, ce fut en se retirant derrière les murs des villes, et la dispersion des troupes perses, rendue nécessaire par la grande étendue du territoire conquis, favorisait l'audace de quelques chefs de partisans. Un général romain indépendant Kallistos3 fit un heureux coup de main : avec des vaisseaux, qu'il avait réunis dans les ports de Cilicie, il marcha sur Pompeioupolis que les Perses assiégeaient, tout en mettant la Lycaonie à feu et à sang; il leur tua plusieurs milliers d'hommes et s'empara du harem royal. Le roi battit immédiatement en retraite sous le prétexte de célébrer une fête solennelle qui ne pouvait être ajournée; dans sa hâte, et craignant d'être retardé, il acheta aux habitants d'Edesse le libre passage à travers leur territoire moyennant tout l'or monnayé romain qu'il avait pris. Le prince de Palmyre, Odaenatos, fit subir des pertes sensibles aux troupes qui revenaient d'Antioche, avant qu'elles eussent pu franchir l'Euphrate. Mais la crainte pressante des Perses était à peine écartée que deux des plus considérables parmi les généraux abandonnés à eux-mêmes en Orient, l'officier Fulvius Macrianus4, qui administrait la caisse et le dépôt de l'armée à Samosate, et Kallistos, dont nous avons déjà parlé, refusaient d'obéir au fils et corégent de l'empereur, Gallien, qui allait bientôt devenir seul empereur lui-même, - il est vrai que, pour lui, l'Orient et les Perses n'existaient pas -, et, refusant de prendre la pourpre pour eux, ils proclamèrent empereurs les deux fils de Fulvius Macrianus, Fulvius Macrianus et Fulvius Quietus (an 261). Cette attitude de deux généraux puissants eut pour résultat de faire reconnaître les deux jeunes empereurs en Egypte et dans tout l'Orient, sauf à Palmyre, dont le prince resta fidèle à Gallien. L'un d'eux, Macrien, partit avec son père pour l'Occident, afin d'y établir aussi son pouvoir. Mais la fortune tourna bientôt; dans l'Illyricum Macrien fut vaincu et tué, non par Gallien, mais par un autre prétendant. Odaenathos déclara la guerre à l'autre empereur resté en Syrie; près d'Hémèse, où les deux armées se rencontrèrent, les soldats de Quietus, pressés de se rendre, répondirent qu'ils supporteraient tout plutôt que de capituler devant un barbare. Le général de Quietus, Kallistos n'en livra pas moins son souverain au prince de Palmyre5. Ainsi finit ce règne éphémère. 1. Les meilleurs historiens nous apprennent seulement que Valérien était prisonnier des Perses quand il mourut. Les chrétiens ont imaginé la fable suivant laquelle Sapor se serait servi de lui comme d'un escabeau pour monter à cheval (Lactance, De morle persec., 5; Orose, VII, 22, 4; Victor, Ep., 33), puis qu'il le fit écorcher vif (Lactance, loc. cit.; Agathias, IV.) 2. Il ne faut pas ajouter foi à la tradition suivant laquelle Maréadès (c'est ainsi qu'Ammien l'appelle, XXIII, 5, 3; il est nommé Mariades par Malalas, XII, p. 295; Mariadnès par le continuateur de Dion, fr. 1), ou, comme il s'appelle dans ce récit, Cyriadès se fit proclamer empereur (Vit. trig. tyr., 1); on pourrait d'ailleurs trouver dans ce fait la raison pour laquelle Sapor le fit périr. 3. C'est ainsi qu'il est nommé dans l'une des sources qui remonte à Dexippe et qu'ont adoptée le Syncelle (p. 716) et Zonaras (XII, 23); il est appelé au contraire Ballista dans les biographies des empereurs et par Zonaras lui-même (XII, 24). 4. D'après le récit le plus digne de foi il était procurator summarum (?: Denys dans Eusebe, Hist. eccl., VII, 10, 5), par conséquent ministre des finances avec rang équestre. Le continuateur de Dion (fr. 3, ed. Müller) exprime cela dans la langue du bas empire lorsqu'il dit : ?. 5. Au moins d'après le récit, qui sert de base aux biographies des empereurs (Vita Gallieni, 3 et ailleurs). D'après Zonaras (XII, 24) le seul historien qui parle en outre de la mort de Kallistos, Odaenathos le fit exécuter. |
||||
260-267 |
Puissance d'Odaenathos (Odenat) en OrientRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteC'est alors que Palmyre prit en Orient la première place. Gallien, sans cesse occupé à combattre les barbares d'Occident et à réprimer les insurrections militaires qui éclataient de toute part, donna au prince de Palmyre, qui lui était seul resté fidèle sous la dernière crise, une situation exceptionnelle et unique, mais que les circonstances justifiaient entièrement. Odaenathos (Odenat), prince héréditaire, ou comme il s'appela, dès lors, roi de Palmyre fut, en même temps, non pas corégent de l'empereur, mais un gouverneur indépendant de lui en Orient1. La cité de Palmyre fut administrée sous son autorité par un autre citoyen, comme procurateur impérial et comme fonctionnaire royal2. Ainsi toute la puissance de l'empereur, autant qu'elle existait encore en Orient, était entre les mains du Barbare qui rétablit vite et brillamment la domination romaine à l'aide de ses troupes palmyréniennes, renforcées avec les débris des corps d'armée romains et avec des soldats levés dans la région. L'ennemi avait déjà évacué l'Asie et la Syrie. Odaenathos franchit l'Euphrate, délivra enfin la vaillante ville d'Edesse, et reprit aux Perses les places de Nisibis et de Karrhae qu'ils avaient conquises (an 264). Il est probable que l'Arménie fut aussi replacée à cette époque sous l'autorité de Rome2. Puis Odaenathos, pour la première fois depuis Gordien, reprit l'offensive contre les Perses et marcha sur Ctesiphon. Dans une première campagne il cerna la capitale de l'Iran et en ravagea les environs; dans une seconde expédition il défit les Perses sous les murs mêmes de cette ville ?. Les Goths, qui poussaient leurs incursions jusque dans l'intérieur des terres, battirent en retraite, lorsqu'il se dirigea sur la Cappadoce. Un tel déploiement de forces était à la fois un bonheur et un danger sérieux pour l'empire menacé. Odaenathos, il est vrai, observait toutes les formes envers le souverain de Rome: il lui envoyait les officiers ennemis faits prisonniers et une grande partie du butin et l'empereur ne dédaignait pas de célébrer un triomphe à cette occasion; mais, en réalité, l'Orient sous Odaenathos n'était pas moins indépendant que l'Occident sous Postume, et l'on comprend que les officiers restés fidèles à Rome aient fait opposition au vice-empereur de Palmyre3. D'une part, il est question des tentatives faites par Odaenathos pour s'allier aux Perses, dont l'échec n'avait été causé que par l'orgueil de Sapor4; d'autre part, ce fut, dit-on, à l'instigation du gouvernement romain qu'Odaenathos fut assassiné à Hémèse en 266-267. Mais le véritable meurtrier était un neveu d'Odaenathos, et rien ne prouve que le gouvernement ait trempé dans ce crime. 1. Les nombreuses inscriptions de Septimius Vorodès, qui datent des années 262-267 (Waddington, 2606-2610) par conséquent du règne d'Odaenathos, désignent toutes ce personnage comme un procurateur impérial de seconde classe (ducenarius); elles lui donnent en outre soit le titre d'Apparetns, mot perse, usité aussi chez les Juifs, qui signifie commandant de place, Vice-Roi (Levy, Zeitschrift der deutschen morgenland. Gesellschaft, XVIII, 90; Noldeke, ibid., XXIV, 107), soit le nom de ? ?, ce qui est certainement en fait, sinon en terme, la même fonction. Peut-être pouvons-nous comprendre par là pourquoi le père d'Odaenathos s'appelait le chef de Thadnior (p. 276, note 1), c'est-à-dire le maître de Palmyre, disposant seul du droit de guerre et de la justice. Mais, depuis qu'Odaenathos eut étendu son empire, cette charge, considérée comme inférieure, fut donnée à un citoyen de rang équestre. Sachau suppose (Zeitschrift der deut. morgenland. Gesellschaft, XXXV, p. 738) que ce Vorodés est le Voroud, d'une monnaie de cuivre du cabinet de Berlin, et que ces deux noms sont identiques à celui d'Hérodès, le fils aîné d'Odaenathos, tué en même temps que son père; de fortes objections s'opposent à cette conjecture. Hérodès et Orodès sont deux noms différents; dans une inscription de Palmyre donnée par Waddington (n. 2610) ils sont placés l'un après l'autre; de plus le fils d'un sénateur ne peut pas exercer une charge équestre; enfin un procurateur frappant des monnaies à son effigie est impossible, même dans la situation exceptionnelle où se trouvait Palmyre. Sans doute cette monnaie de cuivre ne provient pas de cette ville. Elle est, m'écrit von Sallet, probablement plus ancienne qu'Odaenathos et appartient sans doute à un Arsacide du second siècle ap. J.-C.; elle présente une tête revêtue d'ornements semblables à ceux des Sassanides; au revers on voit S. C. dans une couronne de lauriers, ce qui semble imité des monnaies d'Antioche. Plus tard, après la rupture avec Rome en l'an 271, les Palmyréniens, d'après une inscription de Palmyre (Waddington, 2611), sont commandés par deux généraux distincts, Zabdas, bien connu dans l'histoire, et c'est le dernier qui, vraisemblablement, est l'Argapetes. 2. C'est la situation générale qui l'exige: les témoignages manquent. Dans les biographies impériales de cette époque les Arméniens sont cités d'habitude parmi les peuples limitrophes indépendants de Rome (Valer., 6; Trig. tyr., 30, 7, 18; Aurel., 11, 27, 28, 41); mais c'est là un détail purement décoratif, auquel il ne faut pas ajouter foi. 3. Ce récit plus modeste (Eutrope, 9, 10; Vila Gallieni, 10; Trig. tyr., 15, 4; Zosime, I, 39, qui seul parle de la seconde expédition) doit être préféré à celui qui rapporte la prise de la ville (le Syncelle, p. 716). 4. C'est ce que nous apprennent les renseignements que nous avons sur Carin (Continuation de Dion, p. 8) et sur Rufin (voir la note 3). Il n'est pas impossible qu'après la mort d'Odaenathos, Zénobie ait attaqué et vaincu Héraclien, général qui luttait contre les Perses sur l'ordre de Gallien (Vita Gall., 13, 5), puisque les princes de Palmyre possédaient légalement le commandement suprême dans tout l'Orient et qu'une telle action, même ordonnée par Gallien, pouvait être considérée comme rebelle; cela pourrait expliquer que la situation se fût tendue; mais l'auteur de ce récit présente si peu de garantie, qu'il n'y a pas grand compte à en tenir. |
||||
271-273 |
Règne de Zénobie
Retrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteEn tout cas la situation ne fut nullement changée. L'épouse d'Odaenathos, la reine Bat-Zabbaï, en grec Zénobie, femme belle, prudente et active autant qu'un homme1, réclama, par droit d'héritage royal, la situation de son époux, pour Vaballathos ou Athenodoros, le fils qu'elle avait eu d'Odaenathos2 et qui était encore enfant : - l'aîné Hérode avait été tué avec son père. Elle fit triompher ses prétentions à Rome et en Orient. Les années de règne de son fils sont comptées de la mort d'Odaenathos. Zénobie décida et agit au nom du nouveau prince trop jeune pour gouverner3. Elle ne se contenta pas de rester dans la situation actuelle; par ambition ou plutôt par présomption, elle voulut établir sa domination sur toutes les régions de l'empire où l'on parlait le grec. Le gouvernement de l'Orient, qui avait été confié à Odaenathos et que son fils avait hérité de lui, pouvait légalement comprendre la domination de l'Asie-Mineure et de l'Egypte; mais en réalité Odaenathos n'avait établi son autorité qu'en Arabie, en Syrie, et un peu en Arménie, en Cilicie et en Cappadoce. Un Egyptien influent, Timagène, engagea Zénobie à occuper l'Egypte; pour répondre à cette invitation, la reine envoya sur le Nil son général en chef Zabdas, avec une armée d'environ 70 000 hommes. Le pays résista énergiquement; mais les Palmyréniens battirent l'armée égyptienne et s'emparèrent de l'Egypte. Un amiral romain, Probus essaya de les en chasser; il les défit et les força de reprendre la route de Syrie; mais ayant voulu leur barrer le chemin près de Babylone d'Egypte, non loin de Memphis, il fut vaincu par le chef des Palmyréniens, Timagène, qui connaissait le pays mieux que lui, et il se tua4. Lorsque au milieu de l'année 270, Aurélien monta sur le trône après la mort de l'empereur Claude, les soldats de Palmyre étaient maîtres d'Alexandrie. Zénobie se préparait de même à conquérir l'Asie Mineure; elle établit des garnisons jusque près d'Ancyre en Galatie, et jusqu'à Chalcédoine : elle songeait à soumettre Byzance à son autorité. Tout cela se faisait sans que les Palmyréniens parussent jeter un défi au gouvernement romain; l'empire avait confié au prince de Palmyre l'administration de l'Orient, et ce prince se créait un pouvoir réel. Les officiers romains qui s'opposaient à l'extension du royaume de Palmyre étaient même considérés comme rebelles aux ordres de l'empereur. Les monnaies frappées à Alexandrie nomment Aurélien et Vaballathos à côté l'un de l'autre et ne donnent qu'au premier le titre d'Auguste. En réalité l'Orient se séparait de Rome; l'empire était divisé en deux depuis que les mesures arrachées par la nécessité au malheureux Gallien commençaient à recevoir leur exécution. 1. Tous les détails, répandus dans nos histoires sur Zénobie, proviennent des biographies impériales. Pour les répéter, il faut ne pas connaître leur source. 2. Le nom de Vaballathos est donné, en dehors des monnaies et des inscriptions, par Polemius Silvius (p. 243 de mon édition) et par le biographe d'Aurélien (c. 38), qui n'admet pas qu'Odaenathos ait laissé deux fils, Timolaüs et Herennianus. En fait ces deux personnages, cités uniquement dans les biographies impériales, ont été imaginés avec tout ce qui les concerne, par les copistes coupables d'avoir falsifié toutes ces vies. Zosime (1, 59) parle seulement d'un fils qui fut fait prisonnier avec sa mère. 3. On ne peut affirmer avec certitude que Zénobie ait réclamé formellement une part d'autorité. A Palmyre, elle se nomme seulement, même après la rupture avec Rome, (Waddington, 2611, 2628). Dans le reste de l'empire, elle peut avoir pris le titre d'Auguste, Debaot'. Les monnaies de Zénobie antérieures à la guerre font défaut; mais d'une part Pinscription alexandrine qui porte ?(Eph, epigr., IV, p. 25, n. 33) ne peut pas être considérée comme un texte officiel; d'autre part une inscription de Byblos (Corp. insc. graec., 4503 b = Waddington, n. 2611) donne en effet à Zénobie le titre de ? à côté de Claude ou d'Aurélien, mais ne l'accorde pas à Vaballathos. Cela se comprend, si l'on se rappelle qu'Augusta est un titre honorifique, Augustus un nom de dignité; on pouvait donc accorder à la femme ce que l'on refusait à l'homme. 4. Telle est la relation que fait Zosime (I, 4) d'accord pour les points essentiels avec Zonaras (XII, 27) et le Syncelle (p. 721). Le récit contenu dans la vie de Claude (ch. 11) est plutôt faussé que contradictoire au sens propre du mot. La première moitié n'y est indiquée que par le nom de Saba. Le récit commence avec la tentative heureuse de Timagène, qui repousse l'attaque de Probus (ici Probatus). Ce que j'ai avancé à ce sujet dans le livre de Sallet (Palmyra, p. 41) ne doit pas être maintenu. |
||||
271-273 |
Guerre d'Aurélien contre PalmyreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteL'empereur puissant et prévoyant, qui venait de monter sur le trône, rompit aussitôt avec le gouvernement rival de Palmyre; la conséquence de cet acte devait être et fut en effet la proclamation de Vaballathos comme empereur par les siens. A la fin de l'année 270, l'Egypte fut rattachée à Rome, après une guerre opiniâtre, par le vaillant général Probus, le futur successeur Aurélien1. Cette victoire fut désastreuse, il est vrai, pour Alexandrie, la seconde ville de l'empire, qui fut détruite, comme nous le raconterons dans un prochain chapitre. Il fut plus dificile de conquérir la lointaine oasis de Syrie. Dans toutes les autres guerres que les Romains avaient faites en Orient, ils avaient surtout employé des soldats du pays : cette fois, l'Occident avait à soumettre de nouveau l'Orient qui se séparait de lui. Les Occidentaux se heurtèrent contre les Orientaux comme au temps de la République2; les soldats du Rhin et du Danube triomphèrent des soldats de Syrie. C'est vers la fin de 271, semble-t-il, que commença la grande expédition. L'armée romaine atteignit la frontière de la Cappadoce sans rencontrer de résistance; mais la ville de Tyana, qui gardait les passages de la Cilicie, se défendit vaillamment. Lorsqu'elle fut tombée, Aurélien pardonna aux habitants et s'assura ainsi d'autres victoires; il franchit alors le Taurus, traversa la Cilicie et arriva en Syrie. Si Zénobie, comme cela n'est pas douteux, comptait sur une alliance active du roi des Perses, elle fut déçue dans son espoir. Le vieux roi Chapour ne voulut pas prendre part à cette guerre, et la maîtresse de l'Orient romain resta abandonnée à ses propres forces, dont une partie s'était peut-être déjà soumise à l'empereur légitime. A Antioche la principale armée palmyrénienne commandée par Zabdas barra le chemin à Aurélien; Zénobie elle-même était présente. A la suite d'une victoire remportée près du fleuve Oronte sur l'innombrable cavalerie des ennemis, Aurélien entra dans la ville, qui obtint un pardon complet comme Tyana; l'empereur avait reconnu que les sujets de l'empire n'étaient guère coupables d'obéir au prince de Palmyre, puisqu'il avait été nommé gouverneur suprême de l'Orient par le gouvernement romain lui-même. Les troupes de Palmyre se retirèrent, après avoir livré un dernier combat près de Daphné, faubourg d'Antioche, et prirent la grande route qui menait de la capitale de Syrie à Hémèse, puis à Palmyre à travers le désert. Aurélien engageait la reine à se soumettre, en lui rappelant les pertes considérables qu'elle avait subies dans les combats de l'Oronte. C'est aux Romains à se soumettre, répondit Zénobie. Les Orientaux ne se considèrent pas encore comme vaincus. A Hémèse3 elle s'arrêta pour livrer la bataille décisive. La lutte fut longue et sanglante; la cavalerie romaine succomba et s'enfuit en désordre; mais les légions décidèrent du sort de la journée et la victoire resta aux Romains. La poursuite fut plus pénible que le combat. Entre Hémèse et Palmyre il y a en ligne droite dix-huit milles allemands [133 kilom.]; et quoique pendant cette période de la plus brillante civilisation syrienne, le pays fût moins désert qu'il ne l'est aujourd'hui, l'expédition d'Aurélien n'en était pas moins une entreprise difficile, d'autant plus que les rapides cavaliers ennemis voltigeaient de tous côtés autour de l'armée romain Aurélien atteignit pourtant son but et vint investir Palmyre, qui était aussi bien fortifiée qu'abondamment approvisionnée; l'armée des assiégeants avait plus de peine à se procurer des vivres qu'à mener le siège. La princesse fut enfin prise de peur; elle s'enfuit de la ville pour aller chercher du secours chez les Perses. La fortune favorisa l'empereur. Des cavaliers romains poursuivirent Zénobie et la firent prisonnière avec son fils au moment où, ayant atteint l'Euphrate, elle allait s'embarquer pour se sauver; Palmyre découragée par sa fuite capitula (272). Aurélien accorda un pardon complet aux citoyens soumis, comme il l'avait fait pendant toute sa campagne. Mais il sévit durement contre la reine, ses fonctionnaires et ses officiers. Zénobie, après avoir gouverné de longues années avec l'énergie d'un homme, osa invoquer les privilèges de la femme, et faire retomber toute la responsabilité de ses actes sur ses conseillers, dont la plupart périrent de la main du bourreau, entre autres le fameux savant Cassius Longinus. Elle-même figura dans le cortège triomphal de l'empereur; elle n'imita pas Cléopâtre; devant le char du vainqueur, les mains liées de chaînes d'or, elle monta au Capitole romain au milieu de la foule. Mais avant de célébrer sa victoire, Aurélien dut la remporter une seconde fois. Peu de mois après sa défaite, Palmyre se souleva de nouveau : les rebelles massacrèrent la petite garnison romaine établie chez eux par l'empereur et proclamèrent un certain Antiochos4, tandis qu'ils poussaient à la révolte le gouverneur de Mésopotamie Marcellinus. Aurélien venait de franchir l'Hellespont, lorsqu'il reçut ces nouvelles. Il revint sur ses pas, et parut de nouveau sous les murs de la ville insurgée, plutôt que ne l'attendaient amis ou ennemis. 1. Pour dater avec précision tous ces événements, on part de ce fait que les monnaies de l'usurpateur Vaballathos cessent dès la cinquième année de sa royauté égyptienne qui tombe en 270/271 (29 août). Comme elles sont très rares pour cette dernière année, il faut placer sa chute dans les premiers mois. Ce qui confirme cette conclusion, c'est que la prise de Prucheion (qui était non un faubourg de la ville, mais une localité située près de la ville dans la direction de la grande oasis : Saint Jérôme, Vita Hilarionis, c. 33, 34, vol. II, p. 32, ed. Vallarsi), est rapportée par Eusèbe dans sa Chronique à la première année du règne de Claude, et est placée par Ammien (XXII, 16, 15) sous Aurélien. Le récit plus précis d'Eusèbe (Hist. eccles., VI, 32) manque de dates. La reprise de l'Egypte par Probus n'est citée que dans la biographie de cet empereur (ch. 9); elle peut avoir eu lieu comme elle est racontée, mais il se peut aussi que dans cette source complètement altérée, il faille rapporter à Timagène mutatis mutandis tout ce qui est dit de l'empereur. 2. C'est ce qu'indique la relation de Zosime (1, 52) à propos de la bataille d'Hémèse; dans l'armée d'Aurélien figuraient des Dalmates, des Mésiens, des Pannoniens, des soldats du Norique, de la Rétie, des Maurétanies et des prétoriens. Si cet auteur ajoute à ces troupes celles de Tyana et quelques détachements de Mésopotamie, de Syrie, de Phénicie et de Palestine, c'est que les garnisons de Cappadoce s'adjoignirent à elles après la prise de Tyana, et que plusieurs détachements de l'armée d'Orient, restés fidèles à Rome, se rangèrent sous le drapeau d'Aurélien lorsqu'il envahit la Syrie. 3. C'est par erreur qu'Eutrope (IX, 13) place la bataille de la bataille décisive. La lutte fut longue et sanglante; la cavalerie romaine succomba et s'enfuit en désordre; mais les légions décidèrent du sort de la journée et la victoire resta aux Romains. 4. Tel est le nom que donnent Zosime (1, 60) et Polemius Silvius (p. 243); si le biographe d'Aurélien (ch. 31) l'appelle Achilleus, c'est probablement par confusion avec l'usurpateur du temps de Dioclétien. - Il est possible qu'à la même époque un chef de bandes, partisan de Zénobie, nommé Firmus, se soit soulevé en Egypte contre le gouvernement, mais cet épisode nous est rapporté par les biographies impériales, et les détails dont il est entouré nous paraissent sujets à caution. |
||||
273 |
Destruction de PalmyreRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLes rebelles n'étaient pas prêts : Aurélien ne rencontra aucune résistance, mais ne fit aucune grâce. Palmyre fut détruite, la cité disparut; les murs furent rasés; les plus beaux morceaux du magnifique temple du soleil furent transportés à Rome, dans le sanctuaire que l'empereur éleva au dieu Soleil de l'Orient, en souvenir de sa victoire. Il ne resta plus debout que les marchés déserts et les murs, à peu près dans l'état où ils sont conservés jusqu'à nos jours. Ces évènements se passaient en l'an 2731. La prospérité de Palmyre était une prospérité artificielle, comme le prouvent les routes commerciales et les grands travaux publics que leur construction nécessita. Dès lors le gouvernement ne s'occupa plus de la malheureuse ville. Le commerce chercha et trouva d'autres voies. La Mésopotamie était alors considérée comme une province romaine, et bientôt elle fut de nouveau rattachée à l'empire; bientôt le pays des Nabatéens jusqu'au port d'Aelana était au pouvoir des Romains; il était donc possible de négliger cette station intermédiaire et de faire passer le commerce par Bostra ou Beroea (Alep). La splendeur de Palmyre et de ses rois fut semblable à un court météore; elle fut immédiatement suivie de l'abandon et du silence qui règnent depuis lors sur ce misérable village du désert et sur ses colonnades en ruine. 1. La chronologie de ces événements n'est pas très sûre. La rareté des monnaies syriennes où Vaballathos est nommé Auguste prouve que la défaite des rois de Palmyre suivit de près leur rupture avec Aurélien (fin de 270). D'après les inscriptions datées d'Odaenathos et de Zénobie, au mois d'août 271 (Waddington, 2611), la reine était encore toute-puissante. Comme une expédition de cette nature ne peut avoir eu lieu dans un pareil climat qu'au printemps, Palmyre doit avoir été prise pour la première fois dans la première partie de l'année 272. La plus moderne des inscriptions purement palmyréniennes que nous connaissions (De Vogué, n. 116) est d'août 242. C'est donc vers cette époque que l'insurrection éclata; Palmyre dut être prise une seconde fois et détruite au printemps de l'année 273 (c'est ainsi qu'il faut corriger ce que j'ai dit plus haut, IX, p. 211, n. 1). |
||||
283 |
Guerre de Carus contre les PersesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteLa naissance et la chute de l'empire ephémère de Palmyre se rattachent étroitement aux rapports des Romains avec l'Orient non romain; mais ils n'en intéressent pas moins l'histoire générale de l'empire. Comme l'empire d'Occident de Postume, l'empire d'Orient de Zénobie est une de ces masses qui cherchaient alors à se détacher du grand ensemble. Les rois de Palmyre essayèrent d'opposer une barrière sérieuse aux incursions des Perses; d'ailleurs c'était la condition même de leur puissance; néanmoins, lorsque Palmyre tomba, non seulement elle chercha son salut chez les Perses, mais encore la défection de Zénobie a probablement fait perdre aux Romains la Mésopotamie et l'Arménie, et l'Euphrate est restée pendant longtemps la frontière de l'empire, même après la soumission de Palmyre. Arrivée sur le bord de ce fleuve, la reine espérait trouver un refuge chez les Perses; Aurélien ne voulut pas conduire ses légions au-delà de l'Euphrate, parce que la Gaule et la Bretagne ne l'avaient pas encore reconnu comme empereur. Ni lui ni son successeur Probus n'entreprirent la lutte contre les Perses. Mais en l'an 282, lorsqu'après la mort prématurée de celui-ci les troupes proclamèrent Marcus Aurelius Carus, l'officier le plus considérable de l'armée, la première parole du nouveau souverain fut que les Perses se souviendraient de son avènement; ce qui fut dit fut fait. Il envahit aussitôt l'Arménie avec ses troupes et rétablit dans ce pays l'ancienne organisation. A la frontière, des ambassadeurs perses vinrent au-devant de l'empereur et se déclarèrent prêts à accepter toutes les conditions raisonnables que Carus poserait1; mais ils furent à peine écoutés et l'armée continua sa marche. La Mésopotamie redevint romaine; Séleucie et Ctésiphon, anciennes résidences des rois parthes, furent encore une fois occupées par les Romains, qui ne rencontrèrent pas de longue résistance, grâce surtout à la guerre civile qui désolait alors l'empire perse2. L'empereur venait d'arriver sur le Tigre; il allait pénétrer au coeur du pays ennemi, lorsqu'il périt de mort violente, probablement assassiné; l'expédition se termina avec sa vie. Son successeur obtint par un traité de paix la cession de l'Arménie et de la Mésopotamie3. Quoique Carus ait porté la pourpre à peine plus d'un an, il rétablit la frontière impériale telle qu'elle était au temps de Sévère. 1. Il ne nous sert à rien, pour connaître la situation des Arméniens, de savoir, d'après des récits complètement apocryphes d'ailleurs (Vila Valer., 6; Vita Aurel., 27, 28), que l'Arménie fut rattachée à la Perse après la défaite de Valérien, et que les Arméniens furent, dans la crise suprême du royaume de Palmyre, les alliés de Zénobie avec les Perses; ce sont là deux conséquences naturelles de la situation générale. Aurélien ne soumit pas plus l'Arménie que la Mésopotamie; c'est ce qui résulte en partie du silence des sources, en partie du récit de Synésius (De regno, p. 17), suivant lequel l'empereur Carin (plutôt Carus) renvoya durement à la frontière de l'empire perse une ambassade perse qui était venue le trouver en Arménie; effrayé par le récit de ses envoyés, le jeune roi se serait déclaré prêt à toutes les concessions. Je ne vois pas comment l'on pourrait rapporter ce fait au règne de Probus, comme le fait Gutschmid (Zeitschrift der deutsche morgenland. Gesellschaft, XXXI, p. 50); il convient parfaitement à l'expédition de Carus contre les Perses. 2. Seul le biographe (c. 8) signale la reprise de la Mésopotamie; mais cette province était romaine, au moment où Dioclétien commença la guerre contre les Perses. Le même auteur nous parle des troubles intérieurs de l'empire perse; en outre dans un traité conclu en l'an 289 (Paneg.. III, 17), il est fait mention de la guerre que mène contre le roi de Perse - c'était alors Bahram II, son propre frère Ormiès ou Hormizd adscitis Sacis et Ruffis (?) et Gellis (cf. Noldeke, Tabari, p. 479). Nous n'avons d'ailleurs que des renseignements épars sur cette expédition importante. 3. C'est ce que dit clairement Mamertin (Paneg., II, 7, cf. II, 10; IV, 6) dans un discours tenu en l'an 289 : Syriam velut amplexu suo tegebat Euphrates antequam Diocletiano sponte (c.-a-d. sans que Dioclétien ait eu besoin de prendre les armes, comme il est dit plus loin) se dederent regna Persarum; un autre panegyriste de l'année 296 (Paneg., V, 3) écrit : Partho ultra Tigrim reducto. Ces témoignages ne peuvent être infirmés par des détails comme il s'en trouve dans Victor (Caes., XXXIX, 33) d'après lequel Galère a marché sur la Mésopotamie relictis finibus, ou dans Rufius Festus (c. 25) qui rapporte que Narseh céda la Mésopotamie pendant la paix, pas plus que par les sources orientales qui placent en l'an 609 Sel. = 297/298 ap. J.-C. la prise de possession de Nisibis par les Romains (Noldeke, Tabari, p. 50). Si cela était exact, le récit détaillé que Pierre le Patrice (fr. 14) nous donne des négociations de l'an 297 devrait signaler la cession de la Mésopotamie, et la régularisation des rapports à la frontière. |
||||
287-298 |
Guerre de Dioclétien contre les PersesRetrouvez le résumé de cette partie au sein du synopsis : AugusteQuelques années plus tard (293), un nouveau souverain, Narseh, fils du roi Chapour, monta sur le trône de Ctésiphon, et, en 296, déclara la guerre aux Romains, à propos de la Mésopotamie et de l'Arménie1. Dioclétien, qui avait alors le gouvernement suprême de l'empire et surtout de l'Orient, confia la direction de cette guerre à son compagnon de pouvoir, Galère Maximien, général barbare, mais vaillant. Le début des opérations fut malheureux. Les Perses envahirent la Mésopotamie et arrivèrent jusqu'à Karrhae; Galère conduisit contre eux les légions supérieures et passa l'Euphrate à Niképhorion. Entre ces deux villes les armées se rencontrèrent, et les Romains, beaucoup plus faibles que leurs ennemis, furent battus. C'était un grave échec; le jeune général dut recevoir des reproches violents, mais il ne désespéra pas. Des soldats furent levés dans tout l'empire afin de renforcer l'armée pour la campagne suivante, et les deux souverains prirent part en personne à la guerre. Dioclétien s'établit en Mésopotamie avec le corps de troupes principal, tandis que Galère, soutenu par les meilleurs soldats d'Illyrie qui étaient arrivées dans l'intervalle, se trouvait à la tête d'une armée de 25 000 hommes. Il rencontra l'ennemi en Arménie et remporta une vistoire décisive. Le camp, le trésor, le harem même du Grand-Roi tombèrent entre les mains des vainqueurs et Narseh faillit être fait prisonnier. Pour recourer ses femmes et ses enfants, le roi se déclara prêt à accepter toutes les conditions de paix; son ambassadeur Apharban supplia les Romains d'épargner les Perses: les deux empires, dit-il, Romains et Perses étaient les deux yeux du monde; aucun d'eux ne pouvait se passer de l'autre. Les Romains auraient pu ajouter une province de plus à toutes celles qu'ils possédaient en Orient; mais Dioclétien, en habile politique, se contenta d'assurer les conquêtes de Rome dans le Nord-Ouest. Il garda naturellement la Mésopotamie; le commerce important qui se faisait avec les pays voisins fut placé sous le contrôle sévère de l'Etat et concentré spécialement dans la ville forte de Nisibis, sur laquelle s'appuyait la défense de la frontière romaine dans la Mésopotamie orientale. La domination immédiate de Rome eut pour limite reconnue le Tigre : mais toute l'Arménie méridionale jusqu'au lac de Thospitis (lac de Van) et jusqu'à l'Euphrate, c'est-à-dire la haute vallée du Tigre, était rattachée à l'empire romain. Ce boulevard de la Mésopotamie ne fut pas une province proprement dite; mais elle fut administrée, comme la Sophène l'avait été, en satrapie romaine. Un an plus tard, fut construite la citadelle d'Amida (Diarbekr), principale forteresse des Romains dans la région du Tigre supérieure. En même temps la frontière fut déterminée de nouveau entre l'Arménie et la Médie : la suprématie de Rome sur l'Arménie et l'Ibèrie fut encore une fois reconnue. Ce traité de paix n'enlevait pas aux vaincus de vastes territoires; mais il assurait aux Romains une frontière avantageuse, qui pendant longtemps sépara les deux empires dans ces territoires contestés2. Les plans de Trajan étaient complètement exécutés. A la même époque, le centre de gravité de la domination romaine se transportait de l'Ouest à l'Est. 1. Ammien (XXIII, 5, 11) prétend que Narseh envahit l'Arménie, qui était alors romaine; Eutrope (IX, 24) nous donne le même renseignement pour la Mésopotamie. La paix régnait encore au 1er mars 296 ou tout au moins la déclaration de guerre n'était pas connue en Occident (Paneg., V, 10). 2. Les différences qui existent entre les récits particulièrement bons de Pierre le Patrice (fr. 14) et d'Ammien (XXV, 7, 9) sont purement formelles. De ce que le Tigre devait être la frontière impériale proprement dite, comme le dit Priscus, il ne s'ensuit pas que cette frontière ne le franchit pas par endroits, surtout dans son cours supérieur; les cinq districts nommés en premier lieu par Pierre le Patrice semblent au contraire être situés au-delà du Tigre, et ne sont pas compris dans la dénomination générale qui suit. Les régions que Priscus et Ammien nomment, ce dernier expressément, comme transtigritanes, ce sont l'Arzanène, la Karduène et la Zabdécène chez les deux auteurs, chez Priscus la Sophène et l'Intilène (ou plutôt l'Ingiline, en arménien Angel, aujourd'hui Ejil : Kiepert), chez Ammien la Moxoène et la Rhéimene (?) ne peuvent pas avoir toutes été considérées par les Romains comme des provinces perses avant le traité de paix, où l'Arménie était déjà Romano juri obnoxia. Sans doute les plus occidentaux de ces districts formaient alors une partie de l'Arménie romaine; ils ne sont cités ici que parce qu'ils ont été annexés à l'empire comme la satrapie de Sophène à la suite de la paix. La clause du traité qui détermine la frontière entre l'Arménie et la Médie nous montre qu'il s'agissait de la frontière impériale proprement dite, et non pas de la frontière des pays cédés. |
||||